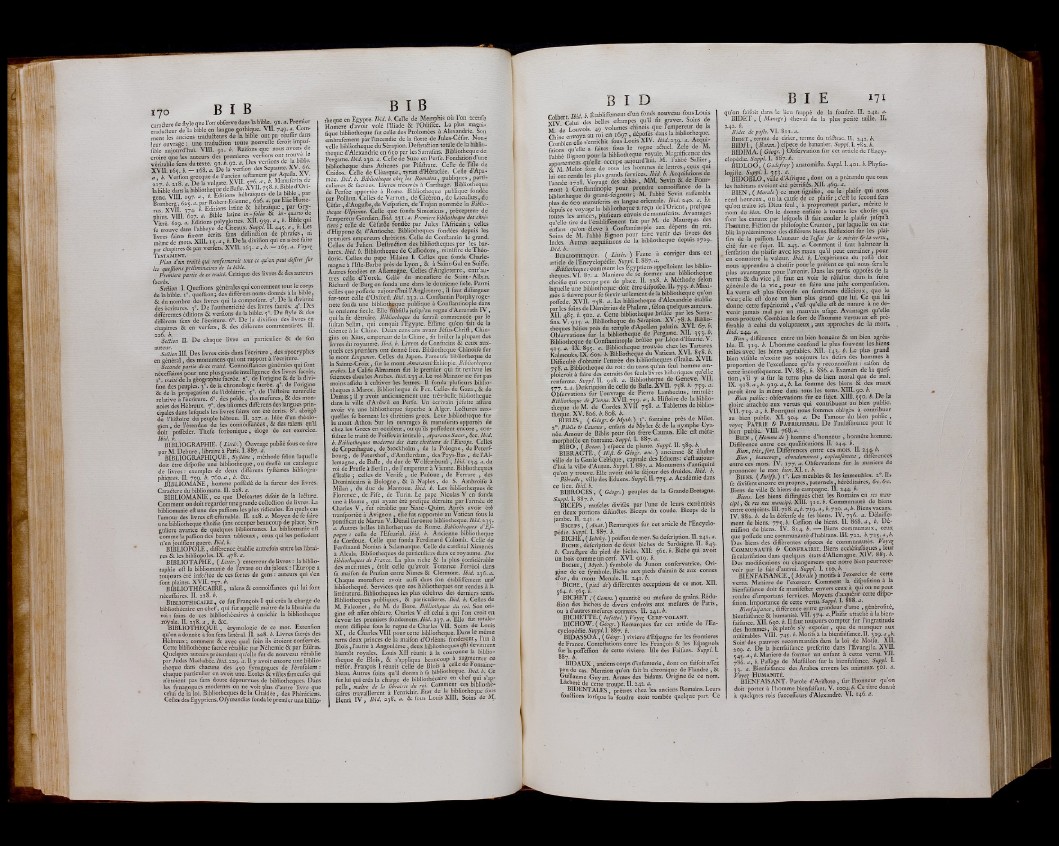
170 B I B B I B
caratfere de ityle que l’onobferve dans la bible. 91. a. Prunier
tradufteur de la bible en langue gothique. VII. 749. a. Corn-
ment les anciens tradufteurs de la bible ont pu réunir dans
leur ouvrage : une traduction toute nouvelle feroit impof-
fible aujourd’hui. VIII. 91. b. Raifons que nous avons de
croire que les auteurs des premières veriions ont trouve--le
véritable fens du texte. 91.4.92. u. Des verfions de la bible.
XVII 165. 4. — 168. a. De la veriion des Septante. XV. 66.
g 4. Ve lion grecque de l’ancien teiament parAqmla.XV.
2 ,7. 4. 2.8. n. De l'a vulgate. XVII. & & , 4.
la bible dans la bibliothèque de.Bafle. XVII. 7Î^-B«bled On
gene. VIII. 197. a , ¿.Editions hébraïques de la bible , par
fombergî62 V. a. par Robert-Etienne, 626 a. par EUe Hutte-
rus XVII. 174. b. Editions latine & hébraïque, par Gry-
phius. VIIÏ. 627. a. Bible latine in-folio &
Vitré. 629. a. Editions polyglottes. XII. 939. a , b. Bible qui
fe trouve dans l’abbaye de Çiteaux-Suppl. H. 445. a b. Les
livres faims furent écrits fans diftinétion de phrafes, m •
même de mots. XHI. 13. a , b. De la divifion qui en a été faite
par chapitres & par verlets. XVII. 163. a , b. — 165. a. Voye^
Testament. , , r r
Plan d’un traité qui renfermeroit tout ce qu on peut dejtrer Jur
les queftions préliminaires de la bible.
Première partie de ce traité. Critique des livres 8c des auteurs
facrés. .
Seilion I. Queftions générales qui concernent tout le corps
de la bible, i*. queftion ; des différens noms donnés à la bible,
& du nombre des livres qui la compofent. 2e. D e la divinité
des écritures. 3e. De l'authenticité des livres facrés. 4 . Des
différentes éditions & verfions delà bible. 5e. Du ftyle & des
différens fens de l’écriture. 6e. De la divifion des livres en
chapitres & en verfets, & des différens commentaires. II.
22&rfîion H. De chaque livre en particulier & de fon
auteur. . ... . , ..... .
Sedionlü.. Des livres cités dans l’écriture, des apocryphes
en général, des monumens qui ont rapport à l’écriture.
Seconde partie de ce traité. Connoiffances générales qui font
nèceffaires pour une plus grande intelligence des livres facrés.
i e. traité de la géographie facrée. i*. de l’origine & de là divifion
des peuples. 3e. de la chronologie facrée. 4e. de l’origine
& de la propagation de l’idolâtrie. 5 e. de l’hiftoire naturelle
relative a l’écriture. 6e. des poids, ues mefures, & des mon-
noies des Hébreux. 7e. des idiomes différens des langues principales
dans lefquels les livres faints ont été écrits. | p abrégé
de l’hiftoire du peuple hébreu. II. 227. a. Idée d’un théologien
| de l’étendue de fes connoiffances, & des talens qu’il
doit pofféder. Thefe forbonique, éloge de cet exercice.
Ibid. b ..
BIBLIOGRAPHIE. ( Littér.) Ouvrage publié fous ce titre
par M. Debure, libraire à Paris. 1. 887. a.
BIBLIOGRAPHIQUE, Syftéme, méthode félon laquelle
doit être difpofée une bibliothèque, ou drefle un catalogue
de livres : exemples de deux différens fyftêmes bibliographiques.
II. 759. b. 760. a , b. &c.
BIBLIOMANE, homme poffédé de la fureur des livres.
Caraâere du bibliomane. II. 228. a.
BIBLIOMANIE, ce que Defcartes difoit de la lefture.
Comment on doit regarder une grande collection de livres. La
bibliomanie eftune des pallions les plus ridicules. En quels cas
l’amour des livres efteftimable. II. 228. a. Moyen de fe faire
une bibliothèque ehoifie fans occuper beaucoup de place. Singulière
avarice de quelques bibliomanes. La bibliomanie eft
comme lapaffion des beaux tableaux, ceux qui les poffedent
n’en jouiflent guere. Ibid. b.
BIBLIOPOLE, différence établie autrefois entre les libraires
& les, bibliopoles. IX. 478. a.
BIBLIÔTArHE, ( Littér. ) enterreur.de livres : labiblio-
taphie eft la bibliomanie de l’avare ou du jaloux : l’Europe a
toujours été mfeélée de ces fortes de gens : auteurs qui s’en
font plaints. XVII. 757. b. .
BIBLIOTHÉCAIRE, talens & connoiffances qui lui font
néceflaires. II. 228. b.
Bibliothécaire , ce fut François I qui créa la charge de
bibliothécaire en chef, qui fut appellé maître de la librairie du
roi : foins de ces bibliothécaires à enrichir la bibliothèque
xoÿale. II. 238. a , b. &c.
BIBLIOTHEQUE , étymologie de ce mot. Extenfion
qu’on a donnée à fon fens littéral. IL 228. b. Livres facrés des
Hébreux ; comment & avec quel foin ils étoient eonfervés.
Cette bibliothèque facrée rétablie par Néhemie & par Efdras.
Quelques auteurs prétendent qu’elle fut de nouveau rétablie
par Judas Machabéc.iéid. 229. a. Il y avoit encore une bibliothèque
dans chacune des 450 fynagogues de Jérufalem :
chaque particulier en avoit une. Ecoles oc villes femeufes qui
n’étoiènt pas fans doute dépourvues de bibliothèques. Dans
les fynagogues modernes on ne voit plus d’autre livre que
celui de la loi. Bibliothèques de la Chaldèe, des Phéniciens.
Celles des Egyptiens. Ofymandias fonda le premier une bibliothèque
en Egypte. Ibid. b. Celle de Mcmphis ou 1 on accufe
Homere d’avoir volé l’Iliade & l’Odiffée. La plus magnifique
bibliothèque fut celle des Ptolomées à Alexandrie. Son
embrafement par l’incendie de la flotte de Jules-Céfar. Nou*
velle bibliothèque du Sérapion. Deftruétion totale de la bibliothèque
d’Alexandrie en 650 par les Sarrafins. Bibliothèque de
Pergame.Ibid. 230. a. Celle de Suze en Perfe. Fondation d’une
bibliothèque dans Athènes par Pififtrate. Celle de rifle de
Cnidos. Celle de Cléarque, tyran d’Héraclée. Celle d’Apa-
mée. Ibid. b. Bibliothèque che^les Romains , - publiques , particulières
8c facrées. Livres trouvés à Cartilage. Bibliothèque
de Perfée apportée à Rome. Bibliothèque publique fondée
par Pollion. Celles de Varron, de Cicéron, de Lucullus»de
Céfar, d’Augufte, de Vefpafien, de Trajan nommée la Bibliothèque
Ulpienne. Celle que fonda Simonicus , précepteur de
l’empereur Gordien. Ibid. 231. a. Première bibliothèque des chrétiens
; celle de Céfarêe fondée par Jules l’Africain ; celles
d’Hippone 8c d’Antioche. Bibliothèques fondées depuis les
premiers empereurs chrétiens. Celle de Conftantin le grand.
Celles de Julien. Deftruôion des bibliothèques par les barbares.
Ibid. b. Bibliothequede Cafliodore, miniftre de Théo-
doric. Celles du pape Hilaire I. Celles que fonda Charle-
magne à l’Ifle-Barbe prèsde Lyon, & à Saint-Gai en Suiffe.
Autres fondées en Allemagne. Celles d’Angleterre, entr’au-
tres celle d’Yorck. Celle du monàftere de Saint-Albrji.
Richard de Burgen fonda une dans le douzième fiele. Parmi
celles que poffede aujourd’hui l’Angleterre, il faut diftinguer
fur-tout celle d’Oxford. Ibid. 232. a. Conftantin Porphyroge-
nete fonda une bibliothèque publique à Conftantinople dans
le onzième fiecle. Elle fttbfifta jufqu’au regne d’Amurath IV ,
qui la fit détruire. Bibliothèque du ferrail commencée par le
fultanSelim, qui conquit l’Egypte. Eftime qu’on fait de la
fcience à la Chine. Deux cens ans avant Jéfus-Chrift, Chin-
gius ou Xius, empereur de la Chine, fit brûler la plupart des
livres du royaume. Ibid. b. Livres de Confucius & ceux auxquels
ces premiers ont donné lieu. Bibliothèque Chinoife fur
le mont Lingumen. Celles du Japon. Fameufe bibliothèque de
la Sainte-Croix, fur le mont Amara eii'Eûnop\e. Bibliothèques
arabes. Le Calife Almamon fut le premier qui fit revivre les
: feiences chez les Arabes. Ibid. 233 a. Le roi Manzor ne fut pas
moins aflidu à cultiver les lettres. 11 fonda plufieurs bibliothèques
à Maroc. Bibliothèque de Fez. Celles de Gaza, & de
Damas ; il y avoit anciennement une très-belle bibliothèque
dans la ville d’Ardwil en Perfe. Un écrivain jéfuite allure
avoir vu une bibliothèque fuperbe à Alger. Leâures auxquelles
fe bornent les chrétiens grecs. Leur bibliothèque fur
le mont Athos. Sur les ouvrages & manuferits apportés de
chez.les Grecs en occident, ou qu’ils poffedent encore , con-
fultez le traité de Poiffevin intitulé, Aparatus Sacer, 8cc. Ibid.
b. Bibliothèques modernes des états chrétiens de l'Europe. Celles
de Copenhague, de Stockholm , de la Pologne, de Peterf-
bourg, de Petershof, d’Amfterdam , des’Pays-Bas , de l’Allemagne
, de Balle, du duc de Wolfembutel, Ibid. 134. a. du
toi de Pruffe à Berlin, de l’empereur à Vienne. Bibliothèques
d’Italie ; celles de Venife, de Padoue, de Ferrare , des
Dominicains à Bologne, & à Naples, de S. Ambroife à ■
Milan , du duc de Mantoue. Ibid. b. Les bibliothèques de
Florence , de Pife, de Turin. Le pape Nicolas V en fonda
une à Rome , qui ayant été prefque détruite par l’armée de
Charles V , fut rétablie par Sixte-Quint. Après avoir été
tranfportée à Avignon, elle fut rapportée au Vatican fous le
pontificat de Martin V. Détail fur cette bibliothèque. Ibid. 23 ç.
a. Autres belles bibliothèques de Rome. Bibliothèques d’Ef-
pagne : celle de l’Efcurial. Ibid. b. Ancienne bibliothèque
de Cordoue. Celle que fonda Ferdinand Colomb. Celle de
Ferdinand Nonius à Salamanque. Celle du cardinal Ximenès
à Alcala. Bibliothèques de particuliers dans ce royaume. Des
bibliothèques de France. La plus riche & la plus confidérable
des anciennes, étoit celle qu’avoit Tonance Ferréol dans
fa maifon de Prufian entre Nîmes & Clermont. Ibid. 236. a.
Chaque monàftere avoit aufli dans fon établiffement une*
bibliothèque. Services que ces bibliothèques ont rendus à la
littérature. Bibliothèques les plus célébrés des derniers tems.
Bibliothèques publiques, & particulières. Ibid. b. Celles de
M. Falconet, de M. de Boze. Bibliothèque du roi. Son origine
eft affez obfcure. Charles V eft celui à qui l’on croit en
devoir les premiers fondemens. Ibid. 237. a. EUe fut totalement
diffipée fous le regne de Charles VII. Soins de Louis
X I , de Charles VIII pour cette bibliothèque. Dans le même
tems deux princes de la maifon d’Orléans fondèrent, l’un à
Rlois, l’autre à Angoulême, deux bibliothèques qûi devinrent
bientôt royales. Louis XII réunit à la couronne la bibliothèque
de Blois, 6c s’appliqua beaucoup à augmenter ce
tréfor. François I réunit celle de Blois | celle de Fontainebleau.
Autres foins qu’il donna à fa bibliothèque. Ibid. b. Ce
fut lui qui créa la charge de bibliothécaire en chef qui sap-
pella, maître de la librairie du roi. Commentées bibliothécaires
travaillèrent à l’enrichir. État de la bibliothèque fous
Henri I V , Ibid. 238. a. 6c fous Louis XIII. Soins de M.
B I D
rnlhett m 4. Établiffementd'un fonds nouveau fous Louis
Celui ¿es ¡ ¡ S S eftampes qu'il fit graver. Soins de
M de Louvois. 49 volumes chinois que l'empereur de la
Thine envoya au roi en 1697, dépofts ¿»us la bibliothèque.
Combien eSTs'enricbit fous^ouis XIV. AU. 239. K Acqut-
f,tions qu'elle a faites fous le regne a§ueh Zele de M.
l’abbé Bignon pour la bibhotheque royale. Magnificence des
appartemens qu’elle occupe aujourd hui. M. 1 abbe Sallier,
& M Melot font de tous les hommes de lettres,-ceux qui
lui ont-rendu les plus grands ferviccs>- {bid.J>. Acquifitions de
l’année 1728. Voyage des abbés, MM. Sevin & de Four-
mont à Conftantinople pour prendre connoiffance de a
bibliothèque du grand-feigneur ; M. l’abbé Sevin raffembla
plus de 6co manuferits en langue orientale. Ibid. 240. a. Lt
depuis ce voyage la bibliothèque a reçu de l'Orient, prefque
toutes les années, plufieurs envois de manuferits. Avantages
qu’elle tire de l’établiffement fait par M. de Maurepas des
enfans qu’on éleve à Conftantinople aux dépens du roi.
Soins de M. l’abbé Bignon pour foire venir des livres des
Indes. Autres acquifitions de la bibliothèque depuis 1729.
Ibid. b. ■ , . .
BIBLIOTHEQUE. ( Littér. ) Faute a corriger dans cet ,
article de l’Encyclopédie. Suppl. 1. 887. a.
Bibliothèque: comment les Égyptiens appelaient: les bibliothèques.
VI. 87. d. Maniéré de fe former une bibkotheaue
choifiequi occupe peu de place. II. 228. ¿.Mctliode félon
laquelle une bibliothèque doit être difpofee. II» 759. b. Maximes
à fuivre pour fè fervir utilement de la bibliothèque qu on
poffede. XVU. 758. a. La bibliothèque d’Alexandrie établie
par les foins de Demétrius de Phalere, félon quelques auteurs.
XII. 485. b. 502. a. Cette bibliothèque brûlée par les Sarrafins.
V . 915. a. Bibliothèque du-Sérapion. XV. 78. ¿. Bfoho-
theques bâties près du temple d’Apollon palatin. X y l. 67. b.
Oblervaùons lur la bibliothèque de Pergame. XIL 353.^
Bibliothèque de Conftantinople brûlée par Léon d Haune. V.
913 a. IX. 895. a. Bibliothèque trouvée chez les Tartares
Kalmouks,IX: 602. b. Bibliothèque du Vatican. XVI. 8s8. b.
Difficulté d’obtenir l’entrée des bibliothèques d Italie. A Vil.
7«8. a. Bibliothèque du roi: du tems qu’un feul homme em-
ploieroit à foire des extraits des feuls livres hiftoriques qu elle
renferme. Suppl. II. 928. *. Bibliothequede Geneve. VII.
K77. 2. a. Dclcription de celle de Bafle. XVII. 758. b. 7Ç9. a.
Obfervations fur l’ouvrage de Pierre Lambecius, intitulé:
Bibliothèque de yicnne. XVIL 759. a , b. Hiftoire de la bibhotheque
deM. de Cordes. XVII 758. Tablettes de bibliothèque.
XV. 806. b. 808. b. v ,
BIBLIS, ( Géogr. & Myth.) i°. fontaine près de Milet.
a°. Biblis 6* Caunus, enfans de Mylet 6c de la nymphe Cya-
née. Amour de Biblis pour fbn frere Caunus. Elle eft méfa-
morphofée en fontaine. Suppl. I. 887. a.
BIBO, ( Botan. ) efpece de plante. Suppl. II. 380. b.
BIBRACTE, ( Hifl. & Géogr. anc. ) ancienne 6c illuftre
ville de la Gaule Celtique, capitale des Eduens: c’eft aujourd’hui
la ville d’Autun. Suppl. 1. 887. a. Monumens d’antiquité
qu’on y trouve. Elle avoit été le féjour des druides. Ibid. b.
Bibraéle, ville des Eduens. Suppl. II. 775. a. Académie dans
ce lieu. Ibid. b.
BIBROCES, ( Géogr.) peuples de la Grande-Bretagne.
Suppl.. 1. 887. b. 1 . l
BICEPS, mufcles divifés par l’une de leurs extrémités
en deux portions diftinftes. Biceps du coude. Biceps de la
jambe. H. 241. a. ' ’ .
B iceps , (Anat.) Remarques fur cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. 1. 887. b. . . _T
BICHE, (lchthy. ) poiffon de mer. Sa defcnption. U. 241. a.
Biche , defeription de deux biches de Sardaigne. II. 84^.
b. Caraftfre du pied de biche. XIL 561. ¿. Biche qui avoit
un bois comme un cerf. XVI. 019. b. _ . .
Biche , ( Myth. ) fymbole de Junon confervatnce. Origine
de ce fymbole. Biche aux pieds d’airain 6c aux cornes
<l’o r ,d u mont Menale. II. 241. b. s ___
B iche , (pied de) différentes acceptions de ce mot. XU.
364. ¿.56s. b. ■
BICHET ( Comm. ) quantité ou mefure de grains. Réduction
des bichets de divers endroits aux mefurés de Paris,
ou à d’autres mefures connues. II. 241. b.
BICHETTE. ( Infeflol. ) Voyei C erf-vo lan t .
BICHOW. ( Géogr. ) Remarques fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl.l. 887. b.
BIDASSOA, ( Géogr. ) riviere,d’Efpagne fur les frontières
de France. Conteflations entre lés François 6c les Efpagnols
fur la poffeffion de cette riviere. Ifle des Faifans. Suppl. I.
887. b. • ' .
BIDAUX, anciens corps d’infonterie, dont on foifoit affez
peu de cas. Mention qu’en fait la chronique de Flandre , 6c
Guillaume, Guy art. Armes des bidaux. Origine de ce nom.
Lâcheté de cette troupe. II. 242. a.
BIDENTALES, prêtres chez les anciens Romains. Leurs
fonctions lorfque la foudre étoit tombée quelque part. Ce
qu’on foifoit dans le lieu frappé de la foudre. II. 242. a•
BIDET, ( Manege) cheval de la plus petite taille. EL,
242. b.
Bidet de pojle. VI. 811 .a.
B idet , terme de cirier, terme du triârac. II. 242. b.
BIDJI, (Botan. ) efpece de bananier. Suppl. 1. 782. b.
BIDIMA. ( Géogr.) Obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl« I. 887. b.
BIDLOO, (Godcfroy) anatomifte. Suppl. 1.401. b. Phyfior
logifte. Suppl. I. 353. a. ,
BIDOBLO, ville d’Afrique, dont on a prétendu que tous
les habitans avoient été pétrifiés. XII. 469. a. '
BIEN, (Morale) ce mot fignifie, ou le plaifir qui nous
rend heureux, ou la caufe de ce plaifir; c’elt le fécond fens
qu’on traite ici. Dieu feul , à-proprement parler, mérite le
nom de bien. On le donne enfuite à toutes les choies qui
font les canaux par lefquels il fait couler le.plaifir jufqu’à
l’homme. FiCtion du philofophe Crantor, par laquelle on établit
la prééminence' des différens biens. Réflexion fur les plai-
firs de la pafïion. L’auteur de YeJJdi fur le mérite & la vertu,
cité fur ce fujet. H. 243. a~ Comment il faut balancer la
fenfation du plaifir avec les maux qu’il peut entraîner, pour
' en connoitre la valeur. Ibid. b. L’expérience du paffé doit
nous apprendre à choifir pourle prêtent ce qui nous fera le
plus avantageux pour l’avenir. Dans les partis oppofés de la
vertu 6c du vice, il fout en voir le réfultat dans la fuite
générale de la v ie , pour en foire une jufte compenfation.
La vertu eft plus féconde en fentimens délicieux, que le
vice; elle eft donc un bien plus grand que lui. Ce qui lui
donne cette fupériorité , c’eft- qu’elle eft de nature à ne devenir
jamais mal par un mauvais ufage. Avantages qu elle
nous procure. Combien le fort de l’homme vertueux eft préférable
à celui du voluptueux, aux approches de la mort.
Ibid. 244. a. ■ ■' ■
Bien, différence entre un bien honnête & un bien agréable.
IL 319. b. L’homme confond le plus fouvent les biens
utiles avec les biens agréables. XII. 143. b. Le plus grand
bien vifible n’excite pas toujours les defirs des hommes à
proportion de l’excellence qu’ils y reconnoiffent : raifon de
cette inconféquence. IV. 885. b. 886. a. Examen de la queftion
, s’il y a fur la terre plus de bien moral que de mal.
IX. 918.a,b. 919.a , b. La fomme des biens 8c des maux
paroit être la même dans tous les tems. XIII. 90. b.
Bien public: obfervations für ce fujet. XIII. 550. b. De la
gloire attachée aux vertus qui contribuent au bien public.
Vil. 719. a , b. Pourquoi'nous fommes obligés à contribuer
au bien public. XI. 304. a. De l’amour du bien public,
voye{ Patrie 6* Patrio tisme . De l’indifférence pour le
bien public. VHI. 768. ii.
Bien , ( Homme de ) homme • d’honneur , honnête homme.
Différence entre ces qualificationsi H. 244. b.
Bien y très y fort. Différences entre ces mots. IL 244. b.
Bien , beaucoup, abondamment , copieufemenl , différences
entre ces mots. IV. 177. a. Obfervations fur la maniéré de
prononcer le mot bien.XI. x. b.
B iens. (Jurifp.) i° . Les meubles8c les immeubles. 2 .Ils
fe divifent encore en propres, paternels, héréditaires, &c. &c.
Biens de ville 8c biens de campagne. H. 244.^.
Biens. Les biens diftineués chez les Romains en res man-
dpi, 8c res nec mancipi. XIII. 311. b. Communauté de biens
entre conjoints. III. 718. atb. 71g.ajb.720. a, b. Biens yacans.
IV. 882. b. de la défenfe de fes biens. IV. 736. a. Délaiffe-
ment de biens. 775. b. Ceflion de- biens. II. 868. a, b. Dé-
miffion de biens. IV. 814. b. — Biens communaux, ceux
que poffede une communauté d’habitans. III. 722. b.725.a yb.
Des biens des différentes efpeces de communautés. Voye^
C ommunauté & C onfra irie . Biens eecléfiaitiques, leur
fécularifation dans quelques états d’Allemagne. , XIV. 883. b.
Des modifications ou changemens que notre bien peurrece-
voir par le fait d’autrui. Suppl. I.' 110, b.
BIENFAISANCE, ( Morale) motifs à l’exercice de cette
vertu. Maniéré de l’exercer. Comment la difpofition à la
bienfoifance doit fe manifefter envers ceux à qui 011 ne peut
. rendre d’importans fervices. Moyens d’acquérir cette dilpo-
fition. Importance de cette vertu. Suppl. I. 888. a.
Bienfaïfance, différence entre grandeur dame , eénèrohte,
bienfoifance 8c humanité. VII. 574- ¿..Plaifir attaché a labien-
foifance. XII. 690. b. Il faut toujours compter fur 1 ingratitude
des hommes, 6cplutôt s’y expofer , que de manquer aux
miférables. VIII. 745- ¿.Motifsà la bienfoifance.il. 329.a , b.
Soin' des pauvres recommandés dans la loi de Moïfe. XII.
209. a. De la bienfoifance preferite dans l’Évangile. XVII.
«45. at b. Maniéré de former un enfant à cette vertu. VII.
786. a, b. Paflage de Maffillon fur la bienfoifance. Suppl. I.
. 33. a. Bienfoifance des Arabes envers les animaux. 501. a.
Voyez Humanité.
BIENFAISANT. Parole d’Ariftote, fur l’honneur qu’on
doit porter à l’homme bienfoifant. V. 1004. b. Ce titre donné
à quelques rois fucceffeurs d’Alexandre. VI. 146. a.