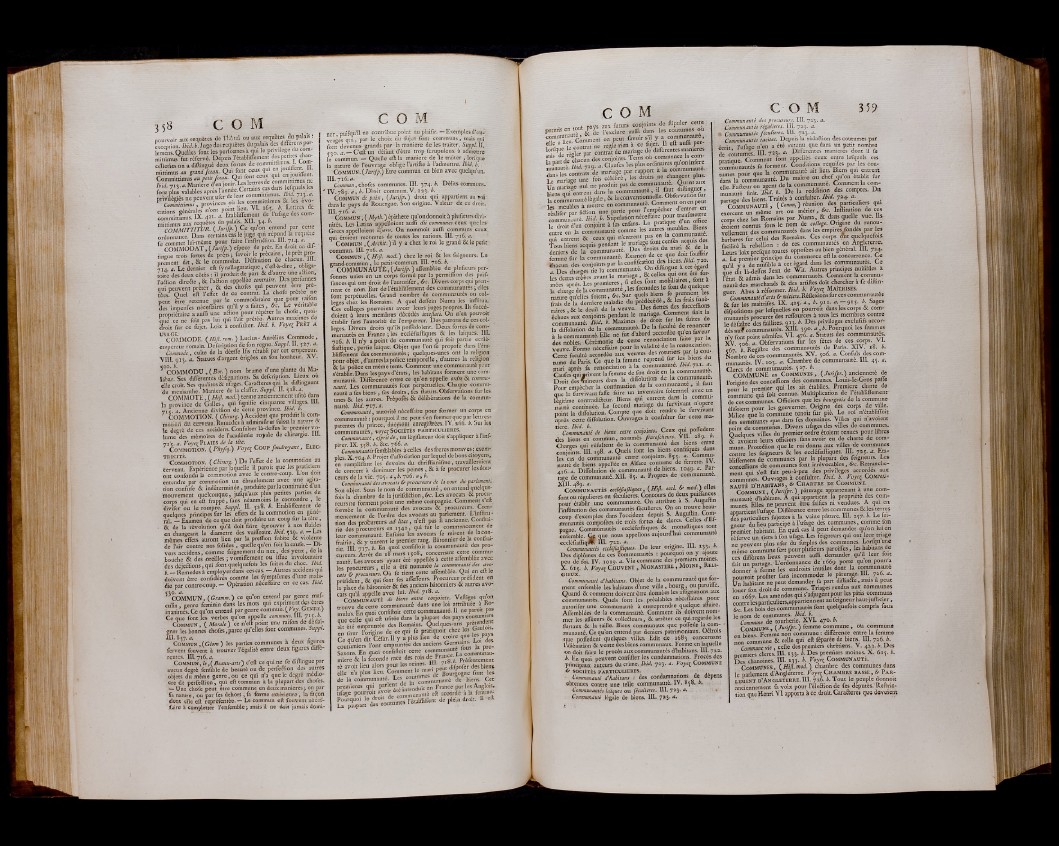
358 COM COM
pourvoir aux requêtes de l’hôtel ou aux K l palais •
éxecution. ItU.é.'Jugcdesrcquêtes dupaais des diffère® par-
lumens. Quelles font les perionnes à qui le f e r a iW . « B | g
tnittimus fut réfervè. Depuis rétabliuement des peu
celleries on a diftinguè deux fortes de 90tnm.ft.n..:s I.
Commtttimus, provinces ou «» w r , . , r(1, .1*
p i ffaaMiS g nmtimus aux requêtes du palais. XU. 34. b.
COMMITTITUR. (Jurifp.) Ce qu'on entend par cette
ordonnance. Dans certains cas le juge qui répond la grange
fc commet lui-même pour faire l'uiftru8mn. 111.71+ a.
COMMODAT, (Jurifp.) efpece de prêt. En droit on dif-
ringiic trois fortes de prêts; favoir le précaire, le prêt proprement
dit, & le commodat. Définition de chacun. III.
71a. a. Le dernier cft fynallagmauquc, c cft-à-dire, obligatoire
des deux cêtès : il produit de part 8c dautre une atlion,
l’aàion direfte , & l’a&ion appellêe contraire. Des perionnes
oui peuvent prêter , & des chofes qui peuvent être prêtées;
Ouel cft l’effet de ce contrat. La chofe prêtée ne
peut être retenue par le commodataire que pour raifôn
Ses impenfes néceffaires qu'il y a faites, fie. Le yéritable
propriétaire a aufli une affion pour répéter la cl.ofe, quoique
ce ne foit pas lui qui l'ait prêtée. Autres maximes de
âroit fur ce fujet. Loix à confulicr. lbtd. b. Voyej Prêt a
^COMMODE. (Hiß. rom.) Lucius-Aurélius Commode,
empereur romain. Defcription de fon regne. Suppl. II. 507. a.
Lommodc, culte de la déeflelfis rétabli par cet empereur.
VIII. 913. a. Statues d’argent érigées en fon honheur. AV.
5°COMMODU A Bot.) nom brame d’une plante du Malabar.
Ses différentes déhgnations. Sa defcription. Lieux ou
elle croît. Ses qualités 8c ufages. Caraaeres qui la difhnguent
du menianthe. Maniéré de la claffer. Suppl. II. 528.a,
COMMOTE, ( Hift. mod.) terme anciennement uiite dans
la provirtee de Galles, qui fignifie cinquante villages. III.
71 f. a. Ancienne divifion de cette province. Ibid. b.
COMMOTION. ( Chirurg. ) Accident que produit la commotion
du cerveau. Remedcs à adminiftrer félon la nature 8c
le deerê de ces accidens. Confulter là-deffus le* premier volume
des niémoires de l’académie royale de chirurgie. III.
71 ç. a. Voyez Plaies de la tête.
C ommotion. ( Phyfiq.) ^ C oup foudroyant, Elec-
TAICITÉ
C ommotion. ( Chirurg. ) De l’effet de la commotion au
cerveau. Expérience par laquelle il paroît que les praticiens
ont confondu la commotion avec le contre-coup. L on doit
entendre par commotion un ébranlement avec une agitation
confufe 8c indéterminée, produite parla continuité d un
mouvement quelconque, jufqu’aux plus petites parues du
corps qui en eû frappé, fans néanmoins le confondre , e
tiivifer ou le rompre. Suppl. II. 3*8. b. Etabhflcme.it de
quelques principes fur les effets de la commotion en général.
— Examen de ce que doit produire un coup fur la tête,
i & de la révolution qu’il doit faire éprouver à nos fluides
en changeant le diamètre des vaiffeaux. Ibid. 529. a. — Les
mêmes effets auront lieu par lapreflion fubite 8c violente
de l’air contre nosfolides, quelle qu’en foit la caufe.— Divers
accidens, comme faignement du nez, des yeux, de la
bouche 8c des oreilles ; vomiffement ou ilTue involontaire
des déieélions, qui font quelquefois les fuites du choc. Ibid.
b - Remedes à employerdans ces cas.-Autres accidens qui
doivent être confidérés comme les fymptomes d une maladie
par contre-coup. - Opération néceflaire en ce cas. lbii.
COMMUN, (Gramm.) ce qu’on entend par genre maf-
culin, genre féminin dans les mots qui expriment des êtres
inanimés. Ce qu’on entend par genre commun. ( Voy. GENRE.)
Ce que font les verbes qu’on appelle communs. UL 715.1i.
C ommun , ( Morale) ce rieft point une raifon de dédai-
1 gner les bonnes chofes,parce qu’elles font communes. Suppl.
III. 8<7. a. . ,
C ommun , (Géom ) les parties communes à deux figures
fervent fouvent à trouver l ’égalité entre deux figures différentes.
III. 716. . ....
C ommun, le ABeaux-arts) Ceft ce qui ne le diftmgue par
aucun degré fenfible de beauté ou de perfeftion des autres
objets dii même genre, ou ce qui n’a que le degré médiocre
de perfection, qui eft commun à ia plupart des chofes.
— Une chofe peut être commune en deux maniérés j ou par
fa nature, ou par fes dehors, fa forme extérieure, la façon
dont elle eft représentée. — Le commun eft fouvent nécef-
faire à completter l’cnfemble ; mais il ne doit jamais dominer
pulfqu’il ne contribue point au plaifir. — Exemples d’ouvrages
qui, par le choix du fujet font communs, mais qui
font devenus grands par la maniéré de les traiter. Suppl. II.
53o. a. — C’eft un défaut d’être trop fcrupuleux à admettre
le commun. — Quelle eft la maniéré de le traiter , lorfque
la nature de l’ouvrage oblige l’artifte à l’admettre. Ibid. b. .
C ommun. (Jurifp.) Etre commun en bien avec quelqu’un.
III. 716. a.
Commun, chofes communes. III. 374. b. Délits communs.
' IV. 789. a , b. DVoit commun. V. 123. b.
C ommun de paix, (Jurifa.) droit qui appartient au toi
dans le pays de Roucrgue. Son origine. Valeur de ce droit.
III. 716. a.
C ommun , ( Myth.)épithete qu’ondonnoit àplufieursdivinités.
Les Latins appelaient aufli du communes ceux que les
Grecs appelloient «£<■>«». On nommoit aufli communs ceux,
qui étoient reconnus de toutes les nations. III. 716. a.
C ommun , (Archit.) il y a chez le roi le grand & le petit'
commun. III. 716. a. T
C ommun 0 H/É mod-) chez le r° l & les fei&neurs* Le
erand-commun, le petit-commun. III. 716. b.
COMMUNAUTÉ, (Jurifp. ) affcmblée de plufieurs per-
fonnes unies en un corps formé par la permiflion des puifj
. . : . j . l’7i»Arili>i> fancesqui ont droit de l’autorifer, f6j>rc . rDjiivveir«s ccnorrnp5s fqiunii pnrreenn
nent ce nom. But de l’établiflement des communautés ; elles
font perpétuelles. Grand nombre de communautés ou collèges
chez les Romains. A quel deffein Numa les inftitua.
Ces collèges pouvoient avoir leurs juges propres. Ils fuccé-
doient à leurs membres décédés inteftati. On n’en pouvoit
établir fans l’autorité de l’empereur. Des patrons de ces col-
leges. Divers droits qu’ils poffédoienr. Deux fortes de communautés
en France 5 les eccléfiaftiqucs 8c les laïques. III.
716. b. Il n’y a point de communauté qui foit partie ecclé-
fiaftique, partie laïque. Objet que l’on le propofe dans l’éta-
bliflement des communautés j quelques-unes ont la religion
pour objet »d’autres la police temporelle, d’autres la religion
& la police en même tems. Comment une communauté peut
s’établir. Dans les pays d’états, les habitans forment une communauté.
Différence entre ce qu’on appelle ordre 8c communauté.
Les communautés font perpétuelles. Chaque communauté
a fes biens , fes droits, les ftatuts.Obfervations furies
unes 8c les autres. Prépofés 8c délibérations de la communauté.
Ibid. 717. a. ^ §
Communauté, autorité néceflaire pour former un corps en
communauté : pourquoi il ne peur s’en former que par lenrcs-
patentes du prince, finement enregiftrées. IV. 266. b. Sur les
communautés, veyeïSociétés PARTICULIERES.
Communauté, ejprit de, un légiflateur doit s appliquer à 1 inf-
pîrer. IX. a 38. b. 8cc. 766. a.
Communautés {emblebles à celles des frères moraves ; exemples.
X. 704. b. Projet d’affociarion par lequel de bons citoyens,
en renipliflant les devoirs du chriftianifme, travailleraient
de concert a diminuer les peines , 8c àfe procurer les douceurs
de la vie. 705. a ,b .706. a. b. -
Communauté des avocats 6* procureurs de la cour du varie ment.
Son objer. Sous le nom de communauté, on entend quelquefois
la chambre de la jurifdiaion,fic. Les avocats 8t procureurs
ne forment point une même compagnie. Comment s ett
formée la communauté des avocats & procureurs Commencement
de l’ordre des avocats au parlement. L mitai ’
non des procureurs ad lites, rieft pas fi ancienne. Contrarie
des procurcure en i j 4», § E fut
leur communauté. Enfuite les avocats fe mirent de lacon-
frairie, 8e y tinrent le premier rang. Bâtonnier de la confiai-
rie III 717. b. En quoi confiftoit la communauté des procureurs.
Arrêt du 18 mars 1508, concernant cette communauté.
Les avocats ayant été appellés à cette aifemblée avec
les procureurs, elle a été nommée la communauté des avo-
cats Ce procureurs. Oh fe tient cette aftemblée. g j f e R f f l i
préfident 8e qui font fes aflefteurs. Procureur préf.dent en
la place du bâtonnier 6e des anciens bâtonniers 8e autres avocats
qu’il appelle avec lin. lbtd. 718. a. v a. ,
COMMUNAUTÉ de biens entre conjoints. Vefliges quon
trouve de cette communauté dans une loi attribuée a Ko-
inuîus En quoi confiftoit cette communauté. Il ne paroit pas
qtie cclfo qui eft ufitée dans la plunar, des pays commn.ers
ait été empruntée des Romains, (¿uelques-uns pré^ndro
en .¡ter l’iriglne de ce qu. fenrar.qi.oi. chez les Gaul
Ce qu’en dit Céfar.U y a plus fieu âe Loi des
coutumiers l’ont emptuntee des anciens Germain
Saxons. En quoi “ "««“ t / ' " ' . u eommunaumiere
& la iccondc race des rois d p^fentement
té avoit lieu alors pour les reJne®* . ' difpofer des biens
elle n’a plus lieu. Comment e de Bourg0gne font les
de là communauté. Les coutum^mii^a.,^ de Hens. Cet
premières qui P^. ^ t,întroduit en France parles Anglois.
ufàge pourroit avoir t unaUti cft accordé à la femme:
ri" aiirsm de i>i' in
C O M C O M 3 59
mut navs aux futurs conjoints de ftipuler cette
pernnsen tout p y all|n p | les coutumes ou
communauté, ». (avoir s’il y a communauté,
regle rien à ce fujei. Il eft aufli per-
1“ ‘T e & contrat de mariage de différentes manières
nus de regle p ¿.g- Tcras ou commence la eommA
IbL 7« . n. Claufcs les plus ordinaires qu on ulfere
Un 'mariale f e r ï
biens qui g g j g & la e "nvetaonnelle. Obfcrva.ion fur
réalifer par nenon une p r traofmettre
communauté. Ibid. b. Staulation necer p d'u„ office
deniers de la communauté.^ Ue Sâ'ffnr
ia^cliargede k e o E n r a t é .foffeetadesTe0(ont de quelque s ä com m un am n S Maximes de droit fur les fuites de
la diflolution de la communauté. De la faculté de renoncer
à la rommunauté. Elle ne for d’abord -eordeequen faveur
des nobles. Cérémonie de cette renonciation faite par la
veuve Forme néceflaire pour la validité de la renonciation.
Cette faculté accordée aux veuves des roturière par la corn
tume de Paris. Ce que la femme reprend for l«.j>iens *■
mari après fa renonciation h la communauté. Ibid. 711. a.
Caufes qui .rivent la femme de fon droit en a eommunau é.
Droit des miineurs dans la diflolution de la communauté.
Pour empêcher la conrinuadon de la
oue le furvivaul fafle faire un mventaire folcmnel avec un
Lhime contradifteur. Biens qoi entrent dans la commu-
nauté continuée. Le fécond mariage du fegrignl: n opere
point la diflolution. Compte que doit rendre le
après cette diflolution. Ouvrages à confulter fur cette ma-
Betomnwauté de biens entre conjoints. Ceux qui poffedent
des biens en commun, nommés fianfdmtn. VIL e°9- '•
Charges qui réfoitent de la communauté des biens entre
conjoints, in. 198. o. Quels font les btens confifques dans
les cas de communauté entre con)omts. 855. a. Communauté
de biens appellêe en Alfaee coutume de fettete. IV.
Aiô. a. Diflolution de communauté de biens. 1049. a. far-
tage de communauté. XII. 8S. n. Propres de communauté.
Communautés eccléfiaftiqucs, (Hiß. eccl- & moi/.) elles
font ou régulières ou féculiercs. Concours de deux putflances
pour établir une communauté. On attribue à S. Auguftin
ïinftitution des communautés féculieres. On en trouve beaucoup
d’exemples dans l’occident depuis S. Auguftin. Communautés
Communauté des procureurs. III. 723. a.
Communautés régulières. III. 723. a.
% Communautés féculieres. III. 723. <».
Communautés tacites. Depuis la rédaction des coutumes pat
écrit l’uiaee n’en a été retenu que dans un petit nombre
île coutumes. III. 7*3- ” • Ë Î f e S S t S S ® ?ont. | fe
pratique. Comment font hppeMs ceux eqtre lefqoels ces
communautés fe forment, ¿ond.i.qns requifes par les cou-
tume” pour que la communauté tut heu. Biens
tûmes [ “ 1 , ]>u maître ou chef quon établir fur
elle Faiteur ou agent' de 1a communauté. Comment la communauté
compofées de trois fortes de clercs. Celles d Ef-
paene. Communautés eccléfiaftiques 8c monaftiques tout
cnfcmble. Çç que nous appelions aujourd hui communauté
eccc—llé élifaialtfiqt1i uqK* . u11l1.. 77s*21/*a2 n.. '.aa_.. _ - 1a.«— rtviumi* .1.1.1 . Iftl. D,.
Communautés eccléjiajllpies. De leur origine. IU. 133. »■
Des diplbmes de ces îommunautés : pourquoi on y ajoute
peu de foi. IV. 1019. a. Vie commune des premiers moines.
X. 613. b. Voyt[ Couvent , Monastère , Moine, Reli-
GIEUX. . .
Communauté d'habitans. Objet de la communauté que ror-
ment cnfcmble les habitans d’une ville, bourg > ou paroille..
Quand 8c comment doivent être données les aliignations aux
communautés. Quels font les préalables néceffaires P?ur
autorifer une communauté à entreprendre quelque anaire.
Affemblées de la communauté. Comment ils doivent nommer
les afféeurs 8c colleétcurs, 8c arrêter ce qui regarde les
furtaux 8c la taille. Biens communaux que poffede la communauté.
Ce qu’on entend par deniers patrimoniaux. Oôrois
que poffedent quelques villes. Edit de 1683 concernant
l’aliénation 8c vente des biens communaux. Forme en laquelle
on doit faire le procès aux communautés d’habitans. III. 722.
h. En quoi peuvent confifter les condamnations. Procès des
principaux auteurs du crime, lbtd. 723. a. Voyeç C ommune
SOCIÉTÉS PARTICULIERES.
Communauté d'habitans : des condamnations de dépens
obtenues contre une telle communauté. IV. 858. b.
Communntnpe )Minute /mi Cir.uHeres. 111. 722. a . DÉ
finit. m ia
nartaRe des biens. Traités à confulter. Ibid. 714. a.
C om m u n a u té , ( Comtnj) réunion des parneuhers qui
exercent un même art ou métier, fie. Inftitmion de ces
corps chez les Romains par Numa, 8c dans quelle vue. Ils
étoient connus fous le nom de collège. Origine du renouvellement
des communautés dans les emptresfondés par les
barbares for celui des Romains. Ces corps dfit quelquefois
faeffiié la rébellion : 8e ces communautés en Angleterre.
Leurs loix prefque toutes oppofées au bien général. I1L 704-
a. Le premier principe du commerce eft la concurrence. Ce
qu’il v a de nuifiblc i cet égard dans les communautés Ce
que ¿ t là-deffus Jean de Win Autres pnncipes nuiflbles à
pétat 8c admis dans les communautés. Comment la comniu-
nautè des marchands 8c des artiftes doit chercher à fe dtfon-
“cr. Abus à réformer. Ibid. b: Voyej. Maîtrises.
Communauté d ’arts Sr m/rierr.Réflextons fur ces communautés
8c for les maîtrifes. IX. 4x5- 911- «• — 9‘ S- b- Si8es
dlfoofitlons par lefquefles on pourroit dans les corps 8c communautés
procurer des rcflburces à tous les membres contre
le défaftre des faillites. 913- b. Des pnvdeges exclufifs accordés
an f communautés. XIIL 390. e , b. Pourquoi les femmes
n’y font point admifes. VI. 478- f- Statuts des communautés.
XV. toô.a. Obfervations for les fêtes de cescorps. VI.
,67. b. Regiftre des communautés de Paris. XIV. 18. b.
Nombre de ces communautés. XV. 506. n. Gonfols des communautés.
IV. 103. n. Chambre de communauté. III. 43. n-
Clercs de communautés. 317. 4. .
COMMUNE ou Communes , ( Jurtfpr.) ancienneté de
l’origine des coneeflions des communes. Loms-le-Gros pafle
pou? le premier qui les ait établies. Première charte de
commune qui foit connue. Muluplicanon de 1 établiflemenr
de ces communes. Officiers que les bourgeois de la commune
élifoient pour les gouverner. Ongme des corps de ville.
Milice que la commune tenon fur pté. Le rot nétabliffoit
des communes que dans fes domames. VtUes qui navotent
point de communes. Divers ufages des villes de communes.
Quelques villes du premier ordre étoient tenues pour libres
& avoient leurs officiers fans avoir eu de charte de com-
mune Proteftion que le roi donna aux villes-de communes
contré les felgneure 8c les eedéfiafliques. HI. 7x3. a. Eta-
bliffemens de communes par la plupart des feigneure. Les
coneeflions de communes font irrévocables, fie. Retranchement
qui s’eft fait peu-à-peu des pnvilcgcs acconlés aux
communes. Ouvrages à confulter. lbtd. b. l'oyez Commun
a u t é d’h a b i ta n s , f i C h a r t r e de Commune.
C om m u n e , (Jurtfpr.) pâturage appartenant à une communauté
d’habitans. A qui appartient la propriété des com-
munes Elles ne peuvent être faifies ni vendues. A qui en
appartient l’ufage. Différence entre les communes 8c les terres
des particuliers fojettes à la vaine pâture. III. 137. b. Le fet-
eneur du lieu participe à l’ufage des communes, comme Ion
orimler habitant. En quel cas il peut demander qu on lut en
rèferve un tiers à fon ufage. Les feigneure qui ont leur triage
ne peuvent plus ufer du iurplus des communes. Lorfquune
même commune fort pour plufieurs paroiffes, les habitans de
ces différons lieux peuvent aufli demander quil leur loit
fait un partage. L’ordonnance de 1669 porte qu on pourra
donner à ferme les endroits Inutiles dont la communauté
pourroit profiter faos Incommoder le pâturage. 111. vab- e-
tin habitant ne peut demander fa part diftintfc, mats il peut
louer fon droit de commune. Triages rendus aux communes
en .667. Les amendes qui s'adjugent pour les pans communs
contre les particuliers,appartiennent au fetgneur haut-plfocier,
fie. Les bois des communautés fon! quelquefois compris fous
le nom de communes. Ibid-b.
Commune de tourbene. XVI. 470. i.
C om m u n e , ( Jurifpr.) femme commune , ou commune
en biens Femme non commune : différence entre la femme
non commune 8c celle qui eft féparée de biens. UL 726. é.
Commune vie, celle des premiers chrétiens. V. 422. b. Des
premiers clercs. III. 133. b. Des premiers moines. X. 613. é.
bes chanoines. III. 133- *• f f Ü Communauté.
C ommunes, (Hift.mod.) chambre des communes dans
le parlement d’Angleterre. Voyez C hambre basse, 6* Pa r lement
d’A ngleterre. IU. 716.¿.Tout le peuple donnoit
.„/.ennnmunr fa voix oour l’êlc&ion de fes députés.' Reftric