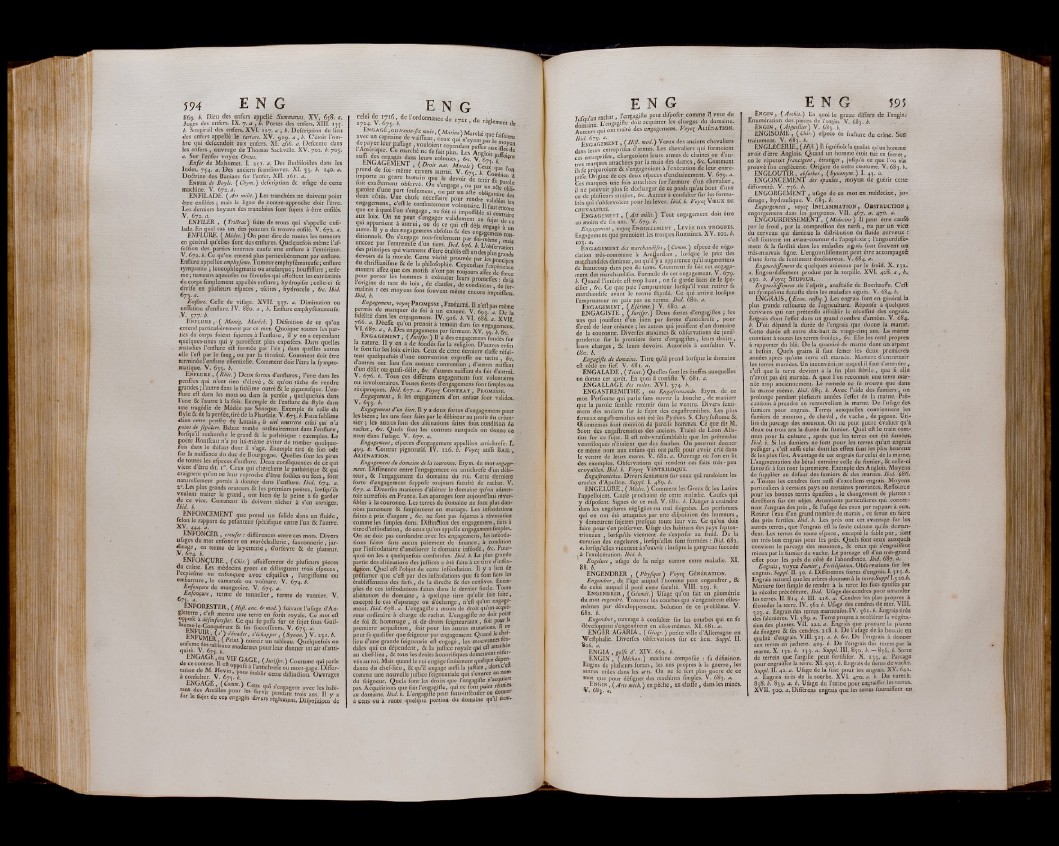
594 E N G
86g. b- Dieu des enfers appcllé Summanus. XV, 638. a.
Juges des^ enfers. IX. 7. a , b. Portes des enfers. XIII. 123.
b. Soupirail des enfers. XVI. 127. a , b. Defcription du lieu
des enfers appcllé le tartare. XV. 919. » , b. Gérait l’ombre
qui defeendoit aux enfers. XI. 466. ». Defeente dans
les enfers , ouvrage de Thomas Sackvillc. XV. 702. b. 703.
». Sur l’cnfcr voyez Orcus.
Enfer de Mahomet. I. 231. ». Des Budfdoïftcs dans les
Indes. 734. ». Des anciens feandinaves. XI. 33. b. 140. ».
Doélrine des Banians fur l’enfer. XII. 161. ».
E n f e r de Boylc. ( Chym. ) defcription 8c ufage de cette
machine. V. 672. ».
ENFILADE. ( milit. ) Les tranchées ne doivent point
être enfilées ; mais la ligne de contre-approche doit 1 être.
Les derniers hoyaux des tranchées font fujets à être enfilés.
iV. 672. ».
ENFILER , ( TriÜrac) fuite de trous qui s’appelle enfilade.
En quel cas un des joueurs fc trouve enfile. V . 672. ».
ENFLURE. ( Médec.) On peut dire de toutes les tumeurs
en général qu’elles font des enflures. Quelquefois même l’af-
fcétion des parties internes caufe une enflure à l’extérieur.
V. 672. b. Ce qu’on entend plus particulièrement par enflure.
Enflure appelléc emphyfenu."Tumeur emphyfémateufe j enflure
tympanitc ; leucophlegmatie ou anafarque ; bouffi flùre ; oedème;
tumeurs aqueufes ou féreufes qui affrètent les extrémités
du corps Amplement appellés enflure ; hydropifie ; celle-ci fe
divife en plufieurs elpeccs, afeites, hydrocele , bc. Ibid.
673.». ■
Enflure. Celle du vifage. XVII. 337. ». Diminution ou
ceflation d’enflure. IV. 880. » , b. Enflure emphyfémateufe.
•V- 577- b.
E n f l u r e , ( Manég. Maréch. ) Définition de ce qu’on
entend particulièrement par ce mot. Quoique toutes les parties
du corps foient fujettes à l’enflure, il y en a cependant
quelques-unes qui y paroiffrnt plus exportes. Dans quelles
maladies l’enflure eft formée par l’air ; dans quelles autres
elle J’eft par le iang, ou par la (érofité. Comment doit être
terminée l’enflure effeniicUe. Comment doit l’être la fympto-
matique. V. 633. b.
E n f l u r e , ( Rhét. ) Deux fortes d’enflures, l’une dans les
penfccs qui n’ont rien d’élevé, 8c qu’on tâche de rendre
grandes ; l’autre dans le fubüme outré oc le gigantefquc. L’enflure
eft dans les mots ou dans la penfée, quelquefois dans
l’une 8c l’autre à la fois. Exemple de l’enflure du ftyle dans
une tragédie de Médéc par Sencque. Exemple de celle du
ftyle 8c de la penfée,tiré de la Phariale. V . 673. b. Faux fublime
dans cette penfée de Lucain, le ciel couvrira celui qui n a
point de fépulcre. Balzac tombe ordinairement dans l’enflure,
lorfqu’U recherche le grand 8c le pathétique : exemples. Le
poète Rouflcau na pu lui-mémc éviter de tomber quelquefois
dans le défaut dont il s’agit. Exemple tiré de fon ode
fur la naiflance du duc de Bourgogne. Quelles font les pires
de toutes les efpeces d’enflure. Deux conféquences de ce qui
vient d être dit. i°. Ceux qui cherchent le pathétique 8c qui
craignent qu on ne leur reproche d’être foibles ou fecs, font
naturellement portés à donner dans l’cnflurc. Ibid. 674. ».
20. Les plus grands orateurs 8c les premiers poètes, lorfqu’ils
veulent traiter le grand, ont bien de la peine à fc garder
de ce vice. Comment ils doivent tâcher à s’en corriger.
Ibid. b. 0
ENFONCEMENT que prend un folidc dans un fluide,
fcton le rapport de pefanteur fpécifique entre l’un 8c l’autre.
A V . 444. ».
ENFONCER, creufer : différences entre ces mots. Divers
mages du mot enfoncer en maréchallcric, fauconnerie, jar-
«inage, en terme de layctteric, d’orfevre 8c de planeur.
y . 674. b.
ENFONÇURE, ( Chir. ) affaiffrment de plufieurs pièces
du crâne. Les médecins grecs en diftinguent trois efpeccs,
lecpicfmc ou enfonçure avec cfquillcs , l’cngiflbme ou
embarrure, le camarofc ou voûture. V. 674. b.
Enfonçure de mangeoire. V. 673. ».
Enfonçure, terme de tonnelier, terme de vannier. V.
®7i- ».
ENFORESTER, ( Hifl.anc. b mod. ) fuivant l’ufage d’An-
gieterre, c eft mettre une terre en forêt royale. Ce mot eft
pport à défenforefler. Ce qui fc pafTa fur ce fujet fous Guil-
FNP?;ÎÿIT ^ ant & fcs fucceflcurs. V. 673. ».
FNPi li/i t r> / *'Wwfài t ’échapper 8 (Synon. ) V. 231. b.
enfume1 1 1 1 P ^ l noircir ™ tM e™ ‘ Quelquefois on
q îité V . ? “X m°dCrnCS P°urleur donn«r p S 1 É §
de Mpoft à r ’ Cou,umc é ç 11
ration de M. ' rn” Cr'
à confultcr. V. fo ,. 4 ccm J,ametion' Ouvrage»
iifedfeVAntÎllra Ù T s‘ m lv “
g I S I • • • « * f e r a
E N G
Ï Ï i V f t ï . ’1' l’° rd~ <■■= ' 7- ; du règlement de
au® “ PS'ia dans leurs colonies, ¿c.
ENGAGÈRENT , (Droit nat. M o r J f t Z l L
prend de foi-mime envers attinti. V. b c S - lo!î
importe au genre humain que le devoir de
fort exaftemenr obforvé. d u s'engage, ou par un afle „? ■'
garotre dune part feulement, ou par un afleoblieaSe c
deux côtés. Une cltofe uéeeflaire pour rendre S ï « Î
engagemens, e'eltle confememenr volonrairc. I16u,c?côrn
que ce à quoi l'on s’engage, ne foit ni impoffible ni c Ô „ 2
aux loix. On ne peut s’engager validement au fui« d? £
qui appartient à autrui, ou de ce qui eft déjà engagé i nî
autre. Il y a des engagemens abfolus & des engagcmfns con
dittonncls. On s’engage non-feulement par foi-même mT
encore par l 'o a r r iS d’un tiers. Ibid. ¿76. b. L o Z y T n
des principes qui viennent d'être établis eft un des plus grmdl
devoirs de la morale. Cette vérité prouvée par i S f f i
du chriftiattifme & de la philofophie. C cpeuLt l'expéSS
montre aflez que ces motifs n’ont pas toujours aftez Se force
pour porter les hommes h exécuter, leurs promefles : dc-li
Iongtnc de tant de loix, de claufes, de conditions, de formatés
: ces moyens four fouvent même encore impuiflans.
Engagement, voyrj P r o m ç s s e , F i d î l i t î . Il n’eft pas même
S ï T î . Ü foi »" ennemi. V. 6nn.n. De la
fidélité dans les engagemens. IV. 916. b. VI. 686. a. XVII
766., 4. Décile qu on prenoit à témoin dans fes engagemens!
vi. 687. » , b. Des engagemens par ferment. XV. qq. b. bc
E n g a g e m e n t , ( funfpr.) Il a des engagemens fondés' fur
la nature. Il y en a de fondés fur la religion. D’autres enfin
le lont fur les loix civiles. Ceux de cette dernicre claffe résultent
quelquefois d’une convention expreffr ou tacite , bc.
d autres ont lieu fans aucune convention ; d’autres naiffrnt
d un délit ou quafi-délit, bc. d’autres naiffrnt du fait d’autrui;
V. 676. b. Tous ces différens engagemens font volontaires
ou involontaires. Toutes fortes d’engagemens font fimplcs ou
réciproques. Ibid. 677. ». Voye^ C o n t r a t , P r o m e s s e .
Engagement, fi les engagemens d’un enfant font valides.
V. 6ç3. b.
Engagement d'un bien. Il y a deux fortes d’engagemens pour
les biens ; les uns font faits par le débiteur au profit du créan*
cier ; les autres font des aliénations faites fous condition de
rachat, bc. Quels font les contrats auxquels on donne ce
nom dans l’ufagc. V. 677. ».
Engagement, efpcces (rengagement appellécs antichrefe. I.
499. b. Contrat pignoratif. Iv . 126. b. Voyc{ aufli B a i l ,
A l i é n a t i o n .
Engagement du domaine de la couronne.- Etym. du mot engage- ■
ment. Différence entre l’engagement ou antichrefe d’un débiteur,
8c l’engagement du domaine du roi. Cette derniere
forte d’engagement fuppofe toujours faculté de rachat. V.
677. ». Diverfes manières d’aliéner le domaine qu’on adtnct-
toit autrefois en France. Les apanages font aujourd’hui réver-
fibles à la couronne. Les terres de domaine ne font dIus données
purement 8c Amplement en mariage. Les inféodations
faites à prix d’argent, bc. ne font pas lujettes à révocation
comme les Amples dons. Diftinftion des engagemens, faits a
titre d’inféodation, de ceux qu’on appelle engagemens Amples.
On ne doit pas confondre avec les engagemens, les inféodations
faites fans aucun paiement de finance, à condition
par l’inféodataire d’améliorer le domaine inféodé, bc. Pourquoi
on les. a qnelquefois confondus. Ibid. b. La plus grande
partie des aliénations des juftices a été faite à ce titre (Finféo-
djtion. Quel eft l’objet de cette inféodation. U v a lieu de
préfumer que c’eft par des inféodations que fe font faits les
établiffrmens des fiefs,, de la direélc 8c des cenfivcs. Exemples
de ces inféodations faites dans le dernier fiecle. Toute
aliénation du domaine, à quelque titre qu’elle .foit faite >
excepté le cas d’apanage ou d’échange, n’eft qu’un engagement.
Ibid. 678. ». L’cngagifte a moins de droit qu’un acquéreur
ordinaire â charge ac. rachat. L’engagifte ne doit point
de foi 8c hommage , ni de droits fcigneuriaux, foit pour la
premiere acquifitton, foit pour les autres mutations.• Illu®
peut fe qualifier que feigneur par engagement. Quand le cher-
lieu d’une grande feigneurie eft engagé, les mouvances féodales
qui en dépendent, 8c la jufticc royale qui eft attachée
au chef-lieu, 8c tous les droits honorifiques demeurent refer-
vés au roi. Mais quand le roi cngàgc feulement quelque dépendance
du chef-lieu, 8c qu’il engage auifi la jufticc, alors c cl
comme une nouvelle jufticc feigncuriale qui s’exerce^ au nom
du feigneur. Quels font les droits que l’cngagifte n’acquiert
pas. Acquificions que fait l’cngagifte, qui ne font point réunie
au domaine. Ibid. b. L’engagifte peut fous-inféoder ou donner
â cens ou à rente quelque porno» du domaine quii tient.
E N G E N G 595
Jufqu’au rachat, l’cngagiflc peut difpofer comme il veut du
J 1 l ’eneazifte doit acquitter les charges du domaine.
tTcuîs qu i ont Saité des engagemens. Voy\ A l i é n a t i o n .
^ E n g a g e m e n t , ||§|}É mod.) Voeux des anciens chevaliers
dans leurs entreprifes d’armes. Les chevaliers qui formoient
ces entreprifes, chargeoient leurs armes de chaînes ou d’autres
marques attachées par la main des dames, bc. Comment
ils fc préparoient 8c s’engageoient à l’exécution de leur entre-
prife. Origine de ces deux efpeccs d’enchainemenr. V. 679. ».
Ces marques une fois attachées fur l’armure d’un chcvaUcr,
¡1 ne pouvoir plus fe décharger de ce poids qu’au bout d’une
ou de plufieurs années, bc. Auteur à confultcr fur les formalités
qui s’obfcrvoicnt pour les lever. Ibid:b. Voyt[\<ivx. d e
c h e v a l e r i e . .
E n g a g e m e n t , {Art milit.) Tout engagement doit être
au moins de fix ans. V. 679. b.
Engagement, voyeç E n r o l l e m e n t , L e v e e DES TROUPES.
Engagemens que prenoient les troupes Romaines. XV. 102. b.
103. ». . ' . ■
E n g a g e m e n t des marchandifes, ( Comm.) cfpcce de négociation
très-commune à .Amuerdam , lorfque le prix des-
marchandifes diminue, ou qu’il y a apparence qu’il augmentera
de beaucoup dans peu de tems. Comment fe fait cet engagement
des marchandifes. Formule de cet engagement. V. 679.
b. Quand l’intérêt eft trop haut, on fc garde bien de le fpé-
cifier, bc. Ce que paie 1 emprunteur lorfqu’il veut retirer fa
marchandée avant le terme ftipulé. Ce qui arrive lorfque
l’emprunteur ne paie pas au terme. Ibid. 080. ».
E n g a g e m e n t , (Efcrime.) V. ¿¡8 b . ».
ENGAGISTE , \jurifpr.) Deux fortes d’engagiftes ; les
uns qui jouiflent d un bien par forme d’anticnrefe , pour
ftreté de leur créance ; les autres qui jouiflent d’un domaine
de la couronne. Diverfes maximes 8c obfcrvations de jurifprudencc
fur la première forte d’engagiftes, leurs droits,
leurs charges, 8c leurs devoirs. Autorités à confultcr. V.
680. b.
Engagijlc de domaine. Titre, qu’il prend lorfque le domaine
eft cédé en fief. V. 681. ».
ENGALADE, ( Teint.) Quelles font les étoffes auxquelles
on donne cet aprêt. En quoi il confifte. V. 681. ».
ENGALLAGE des toiles. XVI. 374. b.
ENGASTREMITHE, ou Engajlremande. Etym. de ce
mot. Perfonnc qui parle fans ouvrir la bouche, de maniéré
que la parole femble retentir dans le ventre. Divers fenti-
mens des anciens fur le fujet des engaftremithes. Les plus
fameux engaftremithes ont été les Pythies. S. Chryfoftome 8c
OEcumcnius font mention de pareils hommes. Ce que dit M.
Scott des engaftremithes des anciens. Traité de Léon Alla-
lius fur ce iujct. Il eft três-vraifemblablc que les prétendus
ventriloques n’étoient que des fourbes. On pourrait donner
ce même nom aux enfans qui ont paffé pour avoir crié dans
le ventre de leurs meres. V. 681. ». Ouvrage où l’on en lit
des exemples. Obfcrvations qui rendent ces faits très-peu
croyables. Ibid. b. Voyc{ V e n t r i l o q u e .
Engaflremithes. Divers fentimens fur ceux qui rendoient les
oracles d’Apollon. Suppl. I. 489. b.
ENGELURE, (Médec.) Comment les Grecs 8c les Latins
l'appelloicnt. Caufe prochaine de cette maladie. Caufes qui
y difpofenr. Signes de ce mal. V. 681. b. Danser à craindre
dans les engelures négligées ou mal foignées. Les perfonnes
qui en ont été attaquées par une difpofition des humeurs,
y demeurent fujettes prefque toute leur vie. Ce qu’on doit
faire pour s’en préferver. Ufage des habitans des pays fepten-
trionaux , lorlqu’ils viennent de s’expofer au froid. De la
curation des engelures, lorfqu’clles font formées : Ibid. 682.
». lorfqu’clles viennent à s’ouvrir : lorfque la gangrené fucccde
1 à l’cxulcération. Ibid. b.
Engelure, ufage de la neige contre cette maladie. XI.
88. b.
ENGENDRER , ( Phyjlque) Voye[ G é n é r a t i o n .
Engendrer, de. l’âge auquel 1 iiomme peut engendrer, 8c
de celui auquel il perd cette faculté. VIII. 239. b.
E n g e n d r e r , (Géornét.) Ufage qu’on fait en géométrie
du mot engendré. Trouver les courbes qui s’engendrent elles-
mêmes par développement. Solution de ce problème. V.
<582. b.
Engendrer, ouvrage à confulter fur les courbes qui en fe
développant s’engendrent en elles-mêmes. XI. 681.».
ENGER AGARIA, ( Géogr. ) petite ville d’Allemagne en
Wcftphalie. Diverfes obfcrvations fur ce lieu. Suppl. II.
806.». ...
ENGIA, golfe d’. XIV. 662. b.
ENGIN, ( Michan.) machine compoféc : fa définition.
Engins de plufieurs fortes, les uns propres à la guerre, les
autres utiles dans les arts. On ne le lert plus guere de 1 i
mot que pour défigner des machines Amples. V7 683. ».
E n g in , (Arts méch. ) en pêche, en chaffc, dans les mines.
E n g in , ( Archit.) En quoi le gruau diffère de l’engin;
Enumération des pièces de renain. V. 682. b.
E n g i n , ( Aiguillïer) V. 683. b.
ENGISOME, (Chir.) efpecc de fraflurc du crâne. Son
traitement. V. 683. b.
ENGLÉCERIE, ( Hift. ) Il fignifioit la qualité qu’un homme
avoit d’être Anglois. Quand un homme étoit tué en fccret,
on le réputoit francigent, étranger, jufqu’à ce que l'on eût
prouvé ion cngléccrie. Origine de cette coutume. V. 683. b.
ENGLOUTIR, abforbcr, (Synonym.) I. 43. ».
ENGONCEMENT des épaules, moyen de guérir cette
difformité. V. 736. b.
ENGORGEMENT, ufage de ce mot en médecine, jardinage
, hydraulique. V. 683. b.
Engorgement , voye[ IN FLAM MAT ION , O B STRU C T IO N ;
engorgemens dans les gangrenés. VII. 467. ». 470. ».
ENGOURDISSEMENT, (Médecine) Il peut être caufé
par le froid, par la compreflion des nerfs, ou par un vice
du cerveau qui diminue la diftribution du fluide nerveux :
c’cft fouvent un avant-coureur de l’apoplexie ; l’cngourdifle-
ment & la furdité dans les maladies aiguès font fouvent un
très-mauvais figne. L’engourdiffement peut être accompagné
d’une forte de lcntiment douloureux. V. 684. ».
Engourdijfcmcnt de quelques animaux par le froid. X. 132.
». Engourdiffemcnt produit par la torpille. XVI. 428. » , b.
430. b. Voyc{ S t u p e u r .
Engourdiffcment de l’efprit, anaftaifie de Boerhaave. C’eft
un fymprôme fupefte dans les maladies aiguës. V. 684. b.
ENGRAIS, (Econ. ruftiq. ) Les engrais font en général la
plus grande reuourcc de l’agriculture. Réponfe à quelques
écrivains qui ont prétendu affaiblir la néceflité des engrais.
Engrais dont l’effet dure un grand nombre d’années. V. 684.
b. D’où dépend la durée de l’engrais que donne la marne.
Cette durée eft entre dix-huit 8c vingt-cinq ans. La marne
convient à toutes les terres froides, bc. Elle les rend propres
à rapporter du blé. De la quantité de marne dont un arpent
a befoin. Quels grains il faut femer les deux premicre's
années après qu’une terre eft marnée. Maniéré d’entretenir
les terres marnées. Un inconvénient auquel il faut s’attendre ,
c’eft que la terre devient à la fin plus ftérile, que fi elle
n'avoit pas été marnée. A quoi l'on reconnoît une terre marnée
trop anciennement. Le remede ne fe trouve que dans
la marne même. Ibid. 683. b. Avec l’aide des fumiers, on
prolonge pendant plufieurs années l’effet de la marne. Précautions
à prendre en renouvellant la marne. De l’ufage des
fumiers pour engrais. Terres auxquelles conviennent les
fumiers de mouton, de chenal, de vache, de pigeon. Utilité
du parcage des moutons. On ne peut guere évaluer qu’à
deux ou trois ans la durée du fumier. Quel eft le train commun
pour la culture , après que les terres ont été fuméçs.
Ibid. b. Si les fumiers ne font pour les terres qu’un engrais
paffager, c’eft aufli celui dont les effets font les plus heureux
& les plus iùrs. Avantage de cet engrais fur celui de la marne.
L’augmentation du bétail entraîne celle du fumier, 8c celle-ci
favorife à fon tour la première. Exemple des Anglois. Moyens
de fuppléer au défaut des fumiers 8c des marnes. Ibid. 686.
». Toutes les cendres font aufli d'excellens engrais. Moyens
particuliers à certains pays ou certaines provinces. Reflource
pour les bonnes terres epuifées, le changement de plantes t
direftions fur cet objet. Attentions particulières qui concernent
l’engrais des prés, 8c l’ufage des eaux par rapport à eux.
Retirer l’eau d’un grand nombre de marais, ce feroit en faire
des prés fertiles. Ibid. b. Les prés ont cet avantage fur les
autres terres, que l’engrais eft la feule culture qu'ils demandent.
Les terres de toute efpece, excepté le fable pur, font
un très-bon engrais pour les prés. Quels font ceux auxquels
convient le parcage des moutons, 8c ceux qui s’engraiffrnt
mieux par le fumier de vache. Le parcage eft d’un très-grand
effet pour les prés du côté de l’abondance. Ibid. 687. ».
Engrais, voyez Fumier, Fertilifation. Obfcrvations fur les
engrais. Suppl. II. 30. b. Différentes fortes d’engrais. 1. 313. b.
Engrais naturel que les arbres donnent à la tutre.Suppl I. < lo.b.
Maniéré fort Ample de rendre à la terre les fucs épuifés par
la récolte précédente. Ibid. Ufage des cendres pour amander
les terres. II. 814. b. III. 216. ». Cendres les plus propres à
féconder la terre. IV. 362 b. Ufage des cendres de mer. VIII.
323. ». Engrais des terres marneufes.IV. 361. b. Engrais tirés
des falunières. VI. 289. ». Terre propre à accélérer la végétation
des plantes. VII. 222. ». Engrais que procure la plante
de fougère 8c fes cendres. 218. b. De l’ufaee de la houille en
qualité d’engrais. VIII. 323. ». b. bc. De ï’engrais à donner
aux terres en jachere. 429/ b. De l’engrais des terres par la
marne. X. 132. b. 133. ». Suppl. III. 830. b. — 836. b. Sorte
de terrein que l’argille peut fertilifcr. X. 133. ». Parcage
pour engraifler la terre. XI. 923. b. Engrais de fiente de vache.
Suppl. I». 42. ». Ufage de la fuie pour les engrais. XV. 642.
». Engrais tirés de la tourbe. XVI. 470. ». b. Du varech.
838. b. 839. ». b. Ufage de l’urine pour engraifler les terres.
XVII, 300. ». Différens engrais que les terres fourniffent co