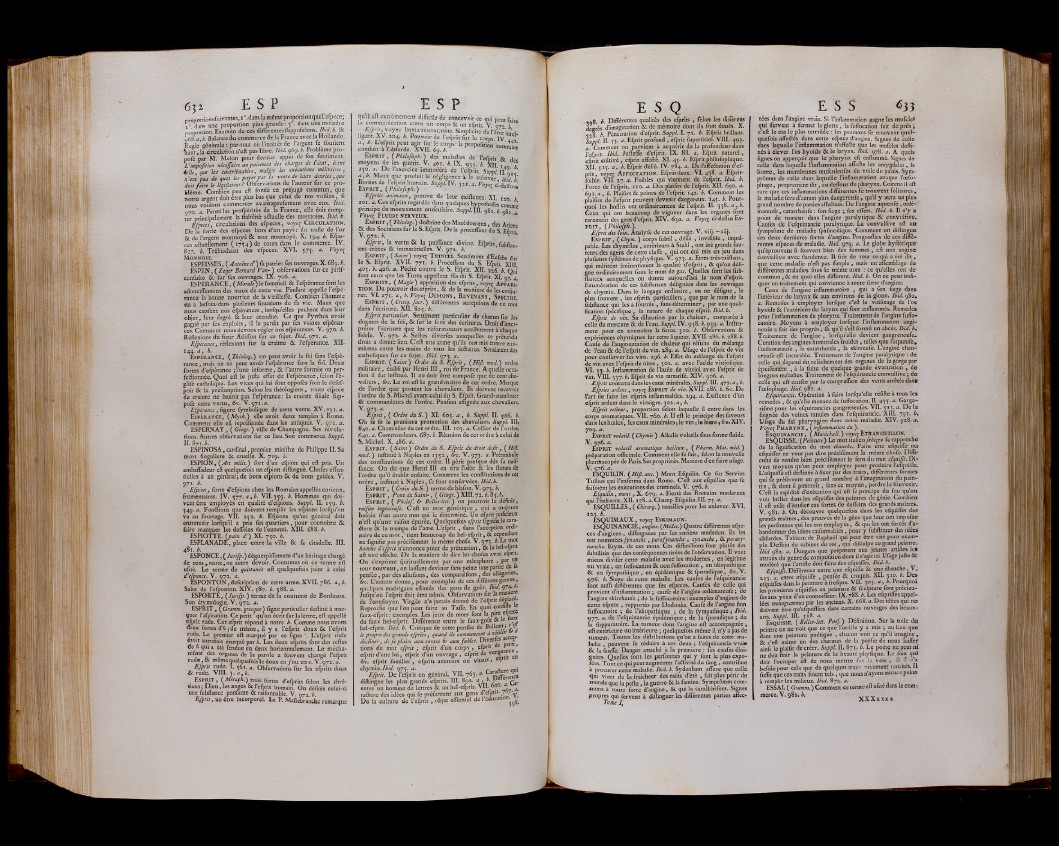
E S P
oronortions Vivantes, i'°. dans la mime proportion querefpece-,
a0 dans une proportion plus grande: 3“. dans une moindre
proportion. Examen de ces différentes fuppofitions. Ibid. b. &
068.a, A. Balance du commerce de la France avec la Hollande.
Regle générale: par-tout où l’intérêt de l’argent fe foutient
lia it I la circulation n’eft pas libre. Ibid. 969. ¿. Problème pro-
pofé par M. Melon pour dernier appui de fon fentiment.
L'irhpofttion néceffaire au paiement des charges de letal’, étant
4elle\que les contribuables, malgré Us exécutions militaires,
n’ont pas de quoi Us payer par la vente de leurs denrées,que
doit faire U legiflateur? Obfervations de 1 auteur fur ce problème.
Combien peu eil fondé ce, préjugé commun, que
notre argent doit être plus bas que celui de nos vodins, fi
nous voulons commercer avantaeeufement avec eux. Ibid.
070. a. Parmi les profoérités de la France, elle doit compter
principalement la itabilité añuelle des monnoies. Ibid. b.
Efpeces, circulations des efpeces, voye^ C i r c u l a t i o n .
De la fortie des efpeces hors d’un pays: du trafic de l’or
& de l’argent monnoyé & non monnoyé. X. 194. b. Efoe-
ces aftueñement (1754) de cours dans le commerce. IV.
827. b. Trébùchant des efpeces. XVI. 575. a. Voyeç
M o n n o i e .
ESPEISSES, ( Antoine d’ ) fa patrie: fes ouvrages. X. 689. b.
ESPEN, (Zeger Bernard Van-) obfervations fur ce jurif-
confulte & fur fes ouvrages. IX 706. à.
ESPÉRANCE, {Morale)le fommeil & l’efpérance font les
âdouciflemens des maux de cette vie. Pindare appelle l’efpé-
rance la bonne nourrice de la vieilleffe. Combien l’homme
en a befoin-dans plufieurs fituations de fa vie. Maux que
nous caufent nos efpérances, lorfqu’elles pechent dans leur
objet, leur degré & leur étendue. Ce que Pyrrhus avoit
gagné par fes exploits, il le perdit par íes vaines efpérances.
Comment nous devons régler nos efpérances. V. 970. b.
Réflexions du fieur Adiffon fur ce fujet. Ibid. 971. a.
Efpèrance, réflexions fur la crainte 8c l’efpérance. XII.
144. a , b.
E s p é r a n c e , ( Théolog.) on peut avoir la foi fans l’eipé-
rance, mais on ne peut avoir l’efpérance fans la foi. Deux
fortes d’efpérance ; l’une informe, 8c l’autre formée ou perfectionnée.
Quel eil le jufte effet de l’efpérance, félon l’é-
glife catholique. Les vices qui lui font oppofés font le défef-
poir & la préfomption. Selon les théologiens, toute efpece
de crainte ne bannit pas l’efpérance: la crainte filiale fup-
pofe cette vertu, &c. V .971 .a.
Efpèrance »figure fymbolique de cette vertu. XV. 731 .a.
E s p é r a n c e , ( Myth.) elle avoit deux temples à Rome.
Comment elle eil repréfentée dans les antiques. V. 971. a.
ESPERNAY, ( Géogr. ) ville de Champagne. Ses révolutions.
Autres obfervations fur ce lieu. Son commerce. Suppl.
11.871.*.
ESPINOSA, cardinal »premier, miniilre de Philippe II. Sa
mort finguliere & cruelle. X. 719. b.
ESPION, (Art mili t.) fort d’un efpion qui eil pris. Un
ambaffadeur eil quelquefois un efoion diifingué. Choies effen-
tielles à un général ; de bons eipions 8c de bons guides. V.
97l- %
Efpion, forte d’efpions chez les Romains appellés curieux,
frumentaires. IV. 377. a,b. V II.359. b. Hommes qui doivent
être employés en qualité d’efpions. Suppl. II. 159. b.
349. a. Fondions que doivent remplir les eipions loriqu’on
va au fourrage. VII. 232. b. Efpions qu’un général doit
entretenir lorfqu’il a pris fes quartiers, pour connoître 8c
faire manquer les defleins de l’ennemi. XI1L 688. b.
ESPIOTTE. (pain d’ ) XI. 730. b.
ESPLANADE, place entre la ville 8c fa citadelle. III.
481. b.
ESPONCE, ( Jurifp.) déguerpiffement d’un héritage chargé
de cens »rente,ou autre oevoir. Coutumes où ce terme eil
ufité. Le terme de quittance eil quelquefois joint à celui
d'efponce. V. 972. a.
' ESPONTON | defcription de cette arme. XVII. 786. a, b.
Salut de l’efoonton. X IV. 387. b. <88. a.
ESPORTÉ, (Jurifp.) terme de la coutume de Bordeaux.
Son étymologie. V . 972. a.
ESPRIT, (Gramm.grecque) ligne particulier deiliné à marquer
l’afpiration. Ce petit' qu’on écrit fur la lettre, eil appellé
efprit rude. Cerefprit répond à notre h. Comme nous avons
aeux fortes d’/t ; de même, il y a l’efprit doux 8c l’efprit
rude. Le premier ¿il marqué par ce ligne ’. L’efprit rude
étoit autrefois marqué par A. Les deux eforits font des relies
de A qui a été fendue en deux horizontalement. Le mécha-
nifme des organes de la parole a fouvent changé l’eforit
ru™ » . même quelquefois le doux en f ou en v. V. 972. a.
Efprit rude. ï . 361. a. Obfervations fur les efprits doux
8c rude. VIII. 3. a, b. r
E s p r i t , (Métaph.) trois fortes d’efprits félon les chrétiens
; D ieu , les anees 8c 1 efprit humain. On définit celui-ci
une fubilance penfante 8c raifonnable. V. 972. b.
Efprit, un être incorporel. Le P. MaÚebrañche remarque
E S P
qu'il eft extrêmement difficile de concevoir ce qui peut î
la communication entre un corps 8c un efprit. V 0 7 , ?
lvigeJnrt. XWV. 2?04“ . b. Pouvoir de l’efprit fur le co<1r«p ¡s %IV "in¡tcTU
a , I S M i É j i l f « fur le corps: la propofition*contrW
conduit a 1 ablurde. XVII. 69. b. *
E sp r it, (Philofopk.) des maladies de lVfptié & j „
moyens de les guérir. V. 401. 4. IX. 955. 4. Sfll “ ,
150. a. De l’exercice immodéré de l’eiprit. Suppl n L
a, 4. Maux que produit la négligence à le cultiver’ ihíj i"
5,,-‘
Efprits animaux, preuve de leur exiílence. XI. IOÔ A
101. a. Ces efprits regardés dans quelques hypothefés comme
principe du mouvement mufculaire. Suppl. lu . 981. b. 082
Voye[ F l u i d e n e r v e u x . ’ J • **•
E s p r i t , ( Théolog. ) doftrine des Macédoniens, des Ariens
8c des Sociniens fur le S. Efprit. De la proceflion du S. Efprit
V. 972. b. r »
Efprit, la vertu 8c la puiffance divine. Efprits, fuhrt™
ces créées 8c immatérielles. V. 972. b. — -■
E s p r i t , (Saint) voye[ T r i n i t é . Sentiment d’Êufebe fur
le S. Efprit. XVII. 771. b. Proceflion du S. Efprit. XIII
403. A. 406. a. Péché contre le S. Efprit. XII. 226. b. Ou|
font ceux que les Turcs appellent fils du S. Efprit. XI. 97 *.
E s p r i t s , ( Magie ) apparition des efprits, voyeç A p p a r i t
i o n . Du pouvoir des efprits, 8c de la maniere de les conjurer.
VI. 271. a, b. Voyez D é m o n s , R e v e n a n s , S p e c t r e .
E s p r i t , ( Critiq. MÊffl différentes acceptions de ce mot
dans l’écriture. XÍI. 803. b.
Efprit particulier. Sentiment particulier de chacun fur les
dogmes de la foi, 8c fur le fens des écritures. Droit d’interpréter
l’écriture que les réformateurs attribuèrent à chaque
fidele. V. 972. b. Señes diverfes auxquelles ce prétendu
droit a donné lieu. C’eil une arme qu’ils ont mis contre eux-
mêmes entre les mains de tous les feñaires. Sentiment des
catholiques fur ce fujet. Ibid. 973. a.
E s p r i t . (Saint) Ordre du S. Efprit, (Hiß. mod.) ordre
militaire, établi par Henri I II, roi de France. A quelle occa-
fion il fut inilitué. Il ne doit être compofé que de cent chevaliers
, &c. Le roi eil le grand-maître de cet ordre. Marque
de l’ordre que portent les chevaliers. Us doivent recevoir
l’ordre de S. Michel avant celui du S. Eforit. Grand-aumônier
8c commandeurs de l’ordre. Penfion affignée aux chevaliers.
V. 973. a.
Efprit, ( Ordre du S. ) XI. 603. a , b. Suppl. II. 306. b.
Où ie fit la première promotion des chevaliers. Suppl. III.
840. a. Chancelier de cet ordre. III. 103. a. Collier de l’ordre.
640. a. Commandeurs. 687. b. Réunion de cet ordre à celui de
S. Michel. X. 486. a.
E s p r i t . (Saint ) Ordre du S. Efprit du droit defir, ( Hiß.
mod. ) inilitué à Naples en 1332 , &c. V. 973. a. Préambule
des conilitutions de cet ordre. Il périt prefque dés fa naif-
fance. On dit que Henri III en tira l’idée 8c les ffatuts de
l’ordre qu’il établit enfuite. Comment les conilitutions de cet
ordre , inilitué à Naples, fe font confervées. Ibid.b.
- E s p r i t , ( Croix du S. ) terme de blafon. V. 973. A*
E s p r i t , Pont du Saint- , ( Géogr. ) XIII. 72. A. 8 3. A.
E s p r i t , ( Philof. 6* Belles-lett. ) on pourrait le définir,
rai fon ingénieufe. C’eil un mot générique , qui a toujours
befoin dun autre mot qui le détermine. Un eforit judicieux
n’eil qu’une raifon épurée. Quelquefois efprit lignine le cara-
ûere & la trempe de l’ame. L’efprit, dans l'acception ordinaire
de ce mot,' tient beaucoup du bel-eforit, 8c cependant
ne lignifie pas précifément la même chofe. V. 973. A. Le mot
homme d'efprit n’annonce point de prétention, 8c le bel-efprit
eil une affiche. De la maniere de dire les chofes avec efprit.
On s’exprime fpirituellement par une métaphore , par u“
tour nouveau, en laiffant deviner fans peine une partie de la
penfée, par des allufions, des comparaifons , des allégories,
&c. L’auteur donne, pour exemples de ces diffêrens genres,
quelques madrigaux eflimés des gens de goût. Ibid. 974* a‘
Jufqu’où l’efprit doit être admis. Obfervations fur la marJ,ei^
de l’employer. Virgile n’a jamais donné de l’efjîrit dewa •
Reproche que l’on peut faire au Tafle. En quoi confute ^
faux-efprit: exemples. Les jeux de mots font la P*-re. Çf x
du faux bel-efprit. Différence entre le faux-goût 8c te *a
bel-efprit. Ibid. A. Critique de cette peniée de Boileau ^
le propre des grands efprits, quand ils commencent1 i vieillir 6* à
décliner, de Je plaire aux contes & aux fabUs. Diverfes a
rions du mot efprit ; efprit d’un corps , eforit de P cg*
efprit d’une loi, efprit d’un ouvrage, efprit de ven£ -t
&c. efprit familier, efprits animaux ou vitaux, ? P
chymie. Ibid. 973. a. _ _norP
Efprit. De l’efprit en général. VII. 763. a. ^rvgtteac»
diftingue les plus grands eforits. III. 892. a , J
entre un homme de lettres oc un bel-eipri t. VIl-Ooo. • ^
rañere des idées qui fe préfentent aux gens d efon ' 7 ~'7
De la culture de l’efprit, objet eflentiel de 1 éducation.^
E S Q
*08. A. Différentes qualités des efprits ; félon les diffêrens
degrés d’imagination 8c de mémoire dont ils font doués. X.
-28. A. Pénétration d’efprit. Suppl. I. 72. A. Efprit brillant.
Suppl. II. 33- u. Efprit profond, efprit fuperficiel. VIII. 493.
a. Comment on parvient à acquérir de la profondeur dans
J’èforit. Ibid. Juflefle d’efprit. lX. 88. a. Efprit naturel,
efprit cultivé, eforit affefté. XI. 43. A. Efprit philofophique.
XII. 313- a, A. Efprit délié. IV. 784. a. D e l’affeñation d’efprit
, voyez A f f e c t a t i o n . Efprit-faux. VI. 438. a. Efprit-
foible. VII. 27. a. Foibles qui viennent de l'eiprit. Ibid. A.
Force de l’efprit. 110. a. Des plaifirs de l’efprit. XII. 690. a.
691.a, A. Plaifirs 8c peines de l’cfprit. 142. A. Comment les
plaifirs de l’efprit peuvent devenir dangereux. 143. A. Pour- 2uoi les boffùs ont ordinairement de l’efprit. II. 338. a , A.
¡eux qui ont beaucoup de vigueur dans les organes font
r a r em e n t des gens d’efprit. XIV. 630. a. Voye^ ci-deflus E s p
r i t , ( Philofph. ).
Efprit des loix. Analyfe de cet ouvrage. V. viij. -xiij.
E s p r i t , ( Chym. ) corps fubril, délié , invifible , impalpable.
Les chymiiles , antérieurs à Stahl, ont été grands fauteurs
des agens de cette clafle , qui ont été mis en jeu dans
plufieurs fyilêmes de phyfique. V. 973. a. Etres très-exiilans,
qui méritent éminemment la qualité d’efprit, 8c qu’on défi-
gne ordinairement fous le nom de gas. Quelles font les liib-
itances auxquelles on donne aujourd’hui le nom d’efprit.
Enumération de ces fubflances défignées dans les ouvrages
de chymie. Dans le langage ordinaire, on ne défigne, le
plus fouvent, les efprits particuliers, que par le nom de la
fubilance qui les a fournis , fans déterminer, par une qualification
fpécifique, la nature de chaque efprit. Ibid. A.
Efprit de vm. Sa dilatation par la chaleur, comparée à
celle du mercure 8c de l’eau. Suppl. IV. 938. A. 039. a. Infiniment
pour en connoître la force. 310. A. Obfervations 8c
-expériences chymiques fur cette liqueur. XVII. 286. A. 288. A.
Caufe de l’augmentation de chaleur qui réfulte du mélange
de l’eau 8c de l’efprit de vin. 289. a. Ùfage de l’efprit de vin
pour conferver les vins. 296. A. Effet du mélange de l’efprit
de vin avec l ’efprit de nitre, 302. a. avec l’aciae vitrioiique.
,VI. 33. A. Inflammation de l’huile de vitriol avec l’efprit de
vin. Vni. 337. A. Efprit de vin tartarifé. XIV. 906. a.
Efprit contenu dans les eaux minérales. Suppl. III. 472. a, A.
.. Efprits ardens , voye^ E s p r i t de vin. XVII. 286. A. &c. De
l’art de faire les efprits inflammables. 294. a. Exiílence d’un
efprit ardent dans le vinaigre. 302. a, b.
Efprit refleur, proportion ielon laquelle il entre dans les
corps aromatiques. VII. 760. A. Il eil le principe des faveurs
dans les huiles, les eaux minérales, le vin, la biere, &c. XIV.
.709. a.
E s p r i t volatil. ( Chymie ) Alkalis volatils fous forme fluide.
V . 976. a. .
ESPRIT volatil aromatique huùUux, ( Pharm. Mat. méd. )
préparation officinale. Comment elle fe fait, félon la nouvelle
pharmacopée de Paris. Ses propriétés. Maniere d’en faire ufage.
1V. 976. a.
ESQUILIN. (Hifl.anc.) Mont Efquilin. Ce fut Servius
Tullius qui l’énferma dans Rome. C’eil aux efquilies que fe
faifoient les exécutions des criminels. V. 976. A.
Efquilin, mont, X. 679. a. Fierté des Romains modernes
qui l’habitent. XII. 178. a. Champ Efquilin. III. 73. a.
ESQUILLES, ( Chirurg.) tenailles pour les enlever. XVI.
123. A.
ESQUIMAUX, voyei E s k im a u x .
ESQUINANCIÉ, angine. (Médec.) Quatre différentes efpeces
d’angines , diifinguées par les anciens médecins. Ils les
ont nommées fynanche , parajynanche , cynanche , 8c paracy-
nanche. Etym. de ces mots. Ces diílinñions font plutôt des
fubtilités que des conféquences tirées de l’obfervation. U vaut
mieux divifer cette maladie avec les modernes, en légitime
ou vraie, en fuffocarion 8c non fuffocation, en idiopathique
8c en fympathique, en épidémique 8c fooradique, fr c .v .
976'. A. Siege de cette maladie. Les caules de l’efquinancie
font auifi différentes que fes efpeces. Caufes de celle qui
.provient d’inflammation ; caufe ae l’angine oedémateufe ; de
l’angine skirrheuie ; de la fuffocatoire : exemples d’angines de
<iette -efpece, rapportés par Dodonée. Caufe de l’angine ñon
fuffocatoire ; de l’idiopathioue ; de la fympathiaue ; Ibid.
077. a. de l’efquinancie épidémique ; de la lporadique ; de
la fuppuratoire. La tumeur dont l’angine eil accompagnée,
eil extérieure ou intérieure ; quelquefois même il n’y a pas de
tumeur. Toutes les diilributions qu’on a faites de cette maladie
, peuvent fe réduire à ces deux ; l’cfquinancie vraie
3 c la faufle. Danger attaché à la première : íes caufes éloignées.
Quelles iont les perfonnes qui y font le plus expo-
iées. Tout ce qui peut augmenter l’aftivite du fang, contribue
à procurer cette maladie. Ibid. b. Sydenham alfure que celle
qui vient de la fraîcheur des nuits d’été , fait plus périr de
monde que la peile, la guerre 8c la famine. Symptômes communs
à toute forte d’angine, 8c qui la carañérifent. Signes
propres qui fervent à duiinguer les différentes parties affec-
Tome It
E S S <533
tées dans, l’angine vraie. Si l'inflammation gagne les mufcleS
qui fervent à fermer la glotte, la fuffocation fuit de près;
c’eil le cas le plus terrribîe : les poumons fe trouvent quelquefois
affeétés dans cette efpece d'angine. Signes de celle
dans laquelle l’inflammation n’affeâe que les mufcles deifi-
nés à élever l’os hyoïde 8c le larynx. Ibid. 978. a. A quels
lignes on apperçoit que le pharynx eil enflammé. Signes de
celle dans laquelle l’inflammation affeéle les amygdales, la
luette, les membranes mufculeufes du voile du palais. Symptômes
de celle dans laquelle l’inflammation attaque l’cefo-
phage, proprement dit, au-deflous du pharynx. Comme il eil
rare que ces inflammations différentes fe trouvent folitaires,
la maladie fera d’autant plus dangereufe, qu’il y aura un plus
grand nombre de parties affeftées. De l’angine aqueufe, oedémateufe
, catarrheufe : fon fiege ; fes effets. Ibid. A. Il n’y a
point de tumeur dans l’angine paralytique 8c convulitve.
Caufes de l’efquinancie paralytique. La convulfive eil un
fymptôme de maladie fpàfmodique. Comment on diilingue
ces deux dernieres fortes d’angine. Prognoilics de ces différentes
efpeces de maladie. Ibid. 979. a. Le globe hyftériguè
qu’éprouvent fi fouvent bien des femmes, cil une angine
convulfive avec flatulence. Il fuit de tout ce qui a été ait ,
que cette maladie n’eil pas fimple , mais un afiemblage de
différentes maladies fous le même nom : ce qu’elles ont de
commun, 8c en quoi elles différent. Ibid. b. On ne peut indiquer
un traitement qui convienne à toute forte d’angine.
Ceux de l’angine inflammatoire , qui a fon fiege dans
l’intérieur du larynx 8c aux environs de la glotte. Ibid. 980.
a. Remedes à employer lorfque c’eil le voifinage de l’os
hyoïde 8c l’extérieur du larynx qui font enflammés. Remedes
pour l’inflammation du pharynx. Traitement de l’angine fuffocatoire.
Moyens à employer lorfque l’inflammation angi-
neufe a fait des progrès, & qu’il s’eil formé un abcès. Ibid. A.1
Traitement de l’angine , lorfqu’elle devient gangreneufe.
Curation des angines humorales froides , telles que l’aqueufe,
l’oedemateufe , la catarrheufe , la skirreufe. L angine chan-
creufe eil incurable. Traitement de l’angine paralytique : de
celle qui dépend du relâchement des organes de la gorge par
épuifement , a la fuite de quelque grande évacuation , de
longues maladies. Traitement de l’efquinancie convulfive} de
celle qui eil caufée par la compreflion des vents arrêtés dan»
l’cefopnage. Ibid. 981. a. / » a i
Efquinancie. Opération à faire lorfqu’elle réfiile à tous les
remedes, 8c qu’elle menace de fuffocation. II. 433. a. Garga-
rifme pour les efquinancies gangrenéufes. VII. <13. a. De la
faignée des veines ranules dans l’efquinancie. XllI. 791. A.
Ufage du fel pharyngien dans cette maladie. XIV. 928. a,
Voyc{ PH A R Y N X , ( inflammation du ).
ESQUINANCIE , ( Maréchall. ) voyc{ EtrAN G U IL LO N.
ESQUISSE. (Peinture) Le mot italien fthi^o fe rapproche
de la lignification du mot ébauche. Faire une efquifle ou
efquifTer ne veut pas dire précifément la même chofe. Difficulté
de rendre bien précifément le fens du mot efauifle. Divers
moyens qu’on peut employer pour produire l’efquiiTe.
L’efquifle eft deftinée à fixer par des traits, différentes formes
qui ie préfentent en grand nombre à l’imagination du peintre
, 8c dont il pourrait, fans ce moyen, perdre le fouvenir.
C’eft la rapidité d’exécution qui eft le principe du feu qu’on
voit briller dans les efquiffes des peintres de génie. Combien
il eft utile d’étudief ces fortes de deffeins des grands maîtres.
V. 981. A. On découvre quelquefois dans les efquiffes des
grands maîtres, des preuves de la gêne que leur ont impofée
les perfonnes qui les ont employés, 8c qui les ont forcés d’abandonner
des idées raifonnables, pour y fubilituer des idées
abfurdes. Tableau de Raphaël qui peut être cité pour exemple.
Deffein du cabinet du roi, qui difculpe ce grand peintre.
Ibid 982. a. Dangers que préparent aux jeunes artiftes les
attraits du genre de compofition dont il s’agit ici.Uiage julte oc
modéré que l'artifte doit 6ire des efquiffes. Ibid. 4.
Ejquijje. Différence entre une efquiffe & une ébauche, V.
213. a. entre efquiffe , penfée 8c croquis. XlL 310. A. Des
efquiffes dans la peinture à frefque. VII. 303. a , A. Pourquoi
les premières efquiffes en peinture 8c iculpture font précieu-
fes aux yeux d’un connoiffeur. IX. 788. A. Lesefquiffes appel-
lées monogrammes par les anciens. X. 668. a. Des idées qui ne
doivent être qu’efquiffées dans certains ouvrages des beaux-
arts. Suppl. lu. 318. a. . . c 1 •« j
E s q u i s s e . (Belles-lett. Poef.) Définition. Sur la toile du
peintre on ne voit que ce que l’artifte y a mis ; au lieu que
dans une peinture poétique , chacun voit ce qu’il imagine,
& c’eft même un des charmes de la poéfie de nous laiffer
ainfi le plaifir de créer. Suppl. II. 871. A. Le poëte ne peut ni
ne doit finir la peinture de la beauté phyfique. Le foin qui
doit l’occuper eft de nous mettre fur la voie , & il n’a
befoin pour cela que de quelques traits vivement touchés. Il
fuffit que ces traits foient tels, que nous n’ayons aucune peine
à remplir les milieux. Ibid. 872. a. •
ESSAI. ( Gramm.) Comment ce terme eft ufité dans le com-
mcrce.V. 982. 4. X X X x « *