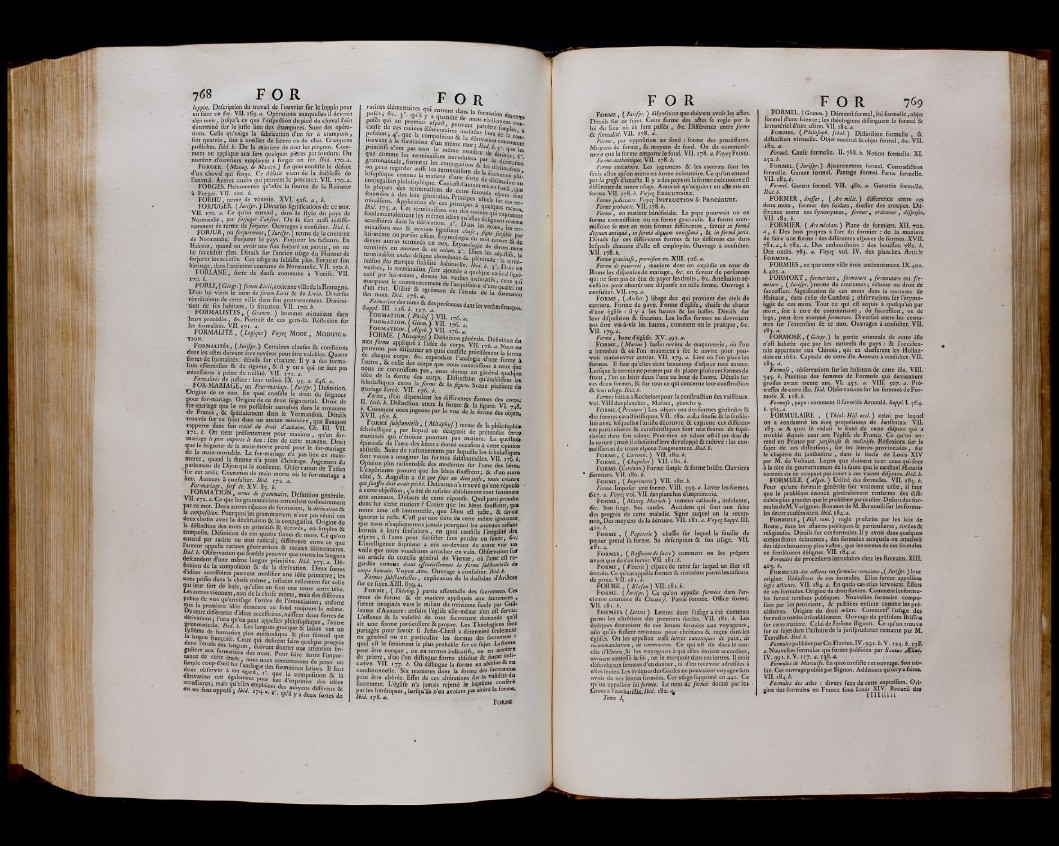
7 6 8 F O R
loppin. Description du travail de l'ouvrier fur le loppin pour
en faire un fer. VII. 169.4. Opérations auxquelles il devroit
s’en tenir, jufqu a ce que l’inipeélion du pied du cheval l’eût
déterminé fur le jufte lieu des étampurcs. Suite des opérations.
Celle qu’exige la fabrication d’un fer à crampons,
foit quarrés, foit à oreilles de lièvre ou de char. Crampons
poftiches. Ibid. b. D e la maniéré de tirer les pinçons. Comment
on applique aux fets quelques pièces par foudure. Du
nombre d’ouvriers employés à forcer un fer. Ibid. 170.4.
F o r g e r . ( Maneg. 6* Ma rich.) En quoi confifte le défaut
d’un cheval qui forge. Ce défaut vient de la foiblcffe de
l’animal. Autres caufcs ^ ^ n V T T gN* -
FORGES. Phénomer
à . FFoorrggeess.. VVIIII.. riàôoo.. bb..
FORHU, rcrme de vénerie. X V I . 926. 4 , b.
FORJUGER. ( Jurifpr. ) Divcrfes fignifications de ce mot.
VU. 170. 4. Ce qu’on entend, dans le ftyle du pays de
Normandie , par forjuger l ’abfent. On fe fert aufli indifféremment
du terme de forjurer. Ouvrages à confulter. Ibid. b.
FORJUR, ou forjurement t ( Jurifpr?) terme de la coutume
de Normandie^ Forjurer le pays. Forjurer les faéleurs. En
Hainaut, quand on avoit une fois forjuré un parent, on ne
lui fuccédoit plus. Détails fur l’ancien ufage du Hainaut de
forjurer les accufés. Ce t ufage ne fubfifte plus. Forjurer fon
héritage, dans l’ancienne coutume de Normandie. VII. 170. b.
FO R LAN E , forte de danfe commune à Vcnife. VII.
• *70. b.
FORLI, ( Géogr. ) forum L iv ii, ancienne ville de la Romagne.
D ’où lui vient le nom de forum Liv ii 8c de Livia. Divcrfes
révolutions de cette ville dans fon gouvernement. Diminution
de fes habitans, fa iîtuation. V il. 170. b.
FORMALISTES, ( Gramm. ) hommes minutieux dans
leurs procédés, &c. Portrait de ces gcns-là. Réflexion fur
les formalités. VII. 171. a.
FORM A L ITÉ , ( Logique) Foyer M o d e , M o d i f i c a t
io n .
F o r m a l it é s , {Jur ifpr.) Certaines daufes & conditions
dont les a&es doivent être revêtus pour être valables. Quatre
fortes de formalités : détails fur chacune. Il y a des formalités
effenticlles & de rigueur, & il y en a qui ne font pas
néceffaires k peine de nullité. VII. 171 .a .
Formalités de juflice : leur utilité. IX. 93. a. 646. a.
FOR-MARIAGE, ou Feur-mariaee. { Jurifpr.) Définition.
Origine de ce mot. En quoi confifte le droit du feîgneur
pour for-mariage. Origine de ce droit feigneurial. Droit de
for-mariage que le roi poffédoit autrefois dans le royaume
de France, & fpécialemcnt dans le Vermandois. Détails
trouvés fur c e fujet dans un ancien mémoire, que Bacquet
rapporte dans fon traité du droit d ’aubaine. Ch. III. VII
171. b. On tient préfentement pour maxime, qu’en for-
mariage le pire emporte le bon : fens de cette maxime. Droit
que le feîgneur de la main-morte prend pour le for-mariaee
de la main-mortable. Le for-mariage n’a pas lieu en mainmorte
, quand la femme n’a point d’héritage. Jugement du
parlement de Dijon qui le confirme. Obfervation de Taifan
sur cet arrêt. Coutumes de main-morte où le for-mariaee a
lieu. Auteurs k confulter. Ibid. 17a. 4.
For-mariaee, f e r f de. X V . 83. b.
.F O R M A T IO N , terme de grammaire. Définition générale.
v il. 172.4. C e que les grammairiens entendent Ordinairement
par ce mot. Deux autres efpeces de formation, la dérivation 8c
ia compofitton. Pourquoi les grammairiens n’ont pas réuni ces
1C n- ay eC déclination 8c la conjugaifon. Origine de
la diftinétion des mots en primitifs 8c dérivés, en Amples 8c
compofés. Définition de ces quatre fortes de mots. C e qu’on
entend par racine ou mot radical; différence entre ce que
S T Æ e,le ™cines génératr‘ces 8c racines élémentaires.
ibid. ¿. Obfervation qui fcmble prouver que toutes les langues
deicendent d une même langue primitive. Ibid. 173 .4 D é la
t io n de la compofition 8c de la dérivation. Deux fortes
d idées acceffoires peuvent modifier une idée primitive; les
«nés pnfes dans la chofe même, influent tellement fur celle
qui leur fort de bafe, qu’elles en font une toute autre idée
“ J * * * • viennent, non de la chofe même, mais des différens
polmsdc vue quamn.Be l'ordre de rénonciation ; enforte
î le cette (TffâCfe j ‘ / ' mCUr<îr-aU fond toui ° urs I
Ï Ï Î S * * * » d,,dics «ceiroires,naiffent deux fortes de
^ “ 5 . Ï Ï Î ° i PtT a|’PeU' r K P É l É . l'autre
iyftimé de n, ■ , lanB“ ' ! & latine ont un
la langue francoT ?' S S l S & P>us ®rand que
dans fétude 3« | i § P l 1 7 " P i S g i P É É
guliere aux £ 2 “ , ' doivent donner une attention lin-
rance de cette étude no* c ^ntir l’imporlimple
coup-d’ocil fur contenterons de jetter un
donc obferver i Ce. te , ? ' ' , ? “ fo™ al,0" ! la'ines. Il finit
dérivation ont également nohi J? " “ P0®'“ 0 & la
acceffoires; mais qu’elles emploiem'd..1 “ Prln,i:r ,.d“ ¡dées
nn fensoppolï; JUd. »• c ?
/n • HUu y a deux fortes de
caule de ces racines élémen i r ^ S é C r " S
pnooffiitttioonn :; 4a °°.. nqnu»e ula .c.o..m porf i.. ïo,,„& « ima idtéteisv h ors t® » iI.. P.
fouvent à la formation dfun même m o t ■ TOnco»™t
primitifs n'ont pas tous le même ¡Tombre 1 PI
que comme les terminaifons introduites Daf l j . i 6°-
ammaticalrc’, ,f?or™me“nt1 ,llecss cfPonnjjuuggaaiiffoonnss «g ?f£u r i I P i l É
- J peut regarder aufli les terminïifons de il L • "aifom >
lofophtque comme la matière d'une for ,. J f e d o i i phiconjugaifon
plulofophique. Ceci cft d'autant mi™ c”ai,fon 0,1
la plupart des terminaifons de cette fecon,! r°” i ' tluc
fonmifes à des loix générales. Principes ufbrt r Pcce font
minaifons. Amibcation de ces princiues i CC! fer-
{ ■ l 71- «• Ces terminaifons ont dés racine. •** racm“ .
fondamentalement les mêmes idécs qu'cUe d iV “ ' w Prim« t
acceffoires dans la dérivation. i° Dmc i ,ëI1Cnt comme
minaifons mm & m,mum flK„ y e„'t ¿ S '« w n » , les
lui-même ouparfes effets. m M i M S m M
divers autres terminés en m/n. E i v i J S l l l mtn & de
terminés en mentum S a t . ^ D ^ s 1 î r 'n r ” ’0“
terminaifon undus défigne abondance S S adj.aifs, la
naifonyinr marque fliÆilité habituelle, f t j ' i - V '« m i -
verbes , la terminaifon Ceere aioutée s n...i‘ '! ',r's les
ca tifpa r lui-même, donne les verbesInchoarifÎ f '
marquent le commencement de ’ cc"x fl"i
d'un état. Utilité & agréménéde“ S t b t
des mots. Ibid. 176. 4 ae de la formation
F o r m a t io n . ? Philof. ) V I I . i 7 6, .
F o rm a t i o n . (G r é™ .) V I I . ï û -
F o rm a t i o n . {Algcb . ) V I I «
noél n e^ o -n COrps 1 “ c nous connoiffons i ceux que
¡ ¿ A i ' co""Oiffons pa s , nous donne en général qucld^
fcholaflL, L ° f eS/ orpsi m û t * qu’établiffent lei ÿ l p E p f c p » afpd"
II FZ T ‘î S d,lPcndem' lef dllfcrentes formes des corps.'
II. 606. b. Diflinéhon entre la forme & la figure. VI. 74S:
y ; * “ ® jugeons par la vue de la fofme des objets,
f > ( m m ) terme, de la philolophi»
fcholaflique , par lequel on délignolt de prétendus être»
matériels qui n étoient pourtant pas matière. La queftioa
épineufe de 1 ame des bêtes a donné occafion à cette opinion
abfurde. Suite de raifonncmens par laquelle les fcholaflique»
font venus k imaginer les formes fubflantielles, VII. 176. b.
Opinion plus raifonnable des modernes fur l’ame des bêtes.
aCaP c CnCe pr<?uve i.“® les bétcs fouffrent; & d’un autro
■ y fr A u * uilin 3 d it que fou s un dieu ju fle , toute créature
qui fouffre doit avoirvéchi. Defcartes n’a trouvé qu’une réponfo •
a cette objeélion, ç a été de refufer abfolument tout fcntiment
aux animaux. Défauts de cette réponfe. Quel parti prendre
donc fur cette maticre ? Croire que les bêtes fouffrent, qu®
notre àme eft immortelle, que Dieu eft jufle, 8c favoir
ignorer le refle. C ’eft par une fuite de cette même ignorance,
que nous n’expliquerons jamais pourquoi les animaux relient
bornés à leurs fenfations, en quoi confifle l’inégalité des
efprits, fl l’ame peut fubfifler fans penfer ou fentir, d/ci
L’intelligence fuprême a mis au-devant de notre vue un
voile que nous voudrions arracher en vain. Obfervation fut
un article du concile général de Vienne, où l’ame eft regardée
comme étant ejfentiellement la forme fubflantielle du
corps humain. V o y e z Ame. Ouvrage à confulter. Ibid. b.
Formes fubftantielles, explication de la doflrine d’Ariftote
fur ce fujet. A lII. 839.4.
F o r m e , ( Théolog. ) partie effentielle des facremens. Ces
mots de forme 8c de matière appliqués apx facremens ,
furent imaginés vers le milieu du treizième flecle par Guillaume
d’Auxcrre : enfuire l’églife elle-même s’en eft fervie.
L’effence 8c la validité de tout facrement demande qu’il
ait une forme particulière 8c propre. Les Théologiens font
partagés pour lavoir fl Jefus-Chrift a déterminé feulement
en général ou en particulier les formes des facremens s
q u e f eft le fentiment le plus probable fur ce fujet. La forme
quei eu ic icntiment lujet.w
•peut lf êf|-£être ro conçue n r ilf * , ou nn en nn M termes r ttia . indicatifs,. n JiA A .it Ait ou nn en maniéré
fU3illCrC
de priere, d’où l’on diflingue forme abfolue 8c forme indicative.
VII. 177, b. On diflingr ’ ^ uMu eftea
conditionnelle. Six maniérés d<
peut être altérée. Effet de ces altérations fur la validité du
facrement. L’églife n’a jamais rejetté le baptême contèr*
par les hérétiques, lorfqu’Us n’en avoient pas altéré la forme.
F o rms
F O R
F o rm e , ( Jurifpr. ) difpofltion que doivent avoir les ailes.
Détails fur ce fujet. Cette forme des aéles fe réglé par la
loi du lieu où ils font paffés , &c. Différence entre forme
& formalité. VII. 178. a.
Forme, par oppofition au fond : forme des procédures.
Moyens de forme, 8c moyens de fond. On dit communément
que la forme emporte le fond. VII. 178. a. Voye^ F o n d .
Forme authentique. "VII. 178. b.
Forme exécutoire. L e s jugemens 8c les contrats font les
feuls aéles qu’on mette en forme exécutoire. Ce qu’on entend
par la grojfe d’unaéle. Il y a des pays où la forme exécutoire eft
différente de notre ufage. Autorité qu’acquiert un aéte mis en
forme. VII. 178. b. Voyeç EXÉCUTOIRE.
Forme judiciaire. Voye{ INSTRUCTION & PROCÉDURE.
Forme probante. VII. 178. b.
Forme, en matière bénéflciale. Le pape pourvoit ou en
forme commiffoire ou en forme gracieufc. La forme com-
miffoirc fe met en trois formes différentes , favoir in forma
dignum antiqua, in forma diguum noviffimâ , 8c in formâ juris.
Détails fur ces différentes formes 8c les différens cas dans
lefquels chacune d’elle eft employée. Ouvrage à confulter.
y Ü . i 7 S.b .
Forme gracieufe, provifion en. XIII. 526. a.
Forme de pauvreté , maniéré dont on expédie en cour de
Rome les difpenfcs de mariage, d/c. en faveur de perfonnes
qui ne font pas en état de payer les droits, &c. Arteftation né-
ceffaire pour obtenir une diipenfe en telle forme. Ouvrage à
confulter. V II. 179. a.
F o rm e , ( Archit. ) libagc dur qui provient des ciels de
carrière. Forme de pavé. Forme déglife, chaife du choeur
d’une églife : il y a les hautes 8c les baffes. Détails fur
leur difpofltion & fltuation. Les baffes formes ne devroient
pas être vis-à-vis les hautes, comment on le pratique, &c.
.Vi l 179.4.
Forme , banc d'églife. XV . 491.4.
F o rm e , ( Marine ) baffm revêtu de maçonnerie, où l’on
a introduit 8c où l’on maintient à fec le navire pour pouvoir
manoeuvrer autour. VIL 179. a. Lieu où l’on place les
formes. Il faut qu’elles aient beaucoup d’efoace tout autour.
Lorfque le terrein ne permet pas de placer plufieurs formes de
f ro n t , l’on en bâtit deux l’une au bout de l ’autre. Détails fur
ces deux formes, 8c fur tout ce qui concerne leur conftruélion
& leur ufage. Ibid. b.
Formes bâties à Rochefor t pour la conftruélion des vaiffeaux.
V o l. VIII des planches, Marine, planche 9.
F o rm e . {Peinture ) Les objets ont des formes générales 8c
des formes caraélériftiques. VII. 180. aJL* ffnefle 8c la fenflbi-
lité avec lefquelles l’artifte découvre 8c exprime ces différences
particulières 8c caraélériftiqucs font une fource de fupé-
riorité dans fon talent. Peut-être ce talent eft-il un don de
la nature ; mais il a befoind’être développé 8c cultivé : les con-
noiffances de toute efpece l’augmentent. Ibid. b.
F o rm e , ( Cartonn. ) VII. 180. b.
F o r m e , ( Chapelier) VII. 180.b.
F o rm e . {Cordonn.) Forme Ample 8c forme brifée. Ouvriers
formiers. VII. 180. b.
F o r m e , {Imprimerie) VII. 180. b.
Forme. Impofer une forme. VIII. <99 .a . Laver les formes.
617. 4. Foyer vol. VII. des planches d imprimerie.
F o r m e , \M an cg .M a r ich .) tumeur calleufe, indolente,
<&c. Son ftege. Ses caufes. Accidens qui font une fuite
des progrès de cette maladie. Signe auquel on la recon-
noit. Des moyens de la détruire. VII. 181.4. Foye^Suppl. III.
4 10, k ■ ' ’ n i
F o rm e , ( Papeterie ) chaffis fur lequel la feuille de
papier prend fa forme. Sa defeription 8c fon ufage. V IL
10 1 . a.
F o r m e s , ( Rajfmeurdefucre) comment on les prépare
avant que des’eniervir.VlI. t8 i.ê .
F o r m e , ( Vénerie) efoacedc terre fur lequel un filet eft
étendu. Ce qu’on appelle formes 8c tiercelets parmi lesoifeaux
de proie. V II. i8 i.é .
FORMÉ , ( Blafon ) VII. 181. b.
F o rm é . {Jur ijpr.) Ce qu’on appelle formées dans l’ancienne
coutume de Chauny. Partie formée. Office formé.
VU . 181. b.
F o rm é e s . ( Lettres ) Lettres dont l’ufage a été commun
parmi les chrétiens des premiers ficelés.• v i l . i8x. b. Les
évêques donnoient de ces lettres formées aux voyageurs,
afin qu’ils fuffent reconnus pour chrétiens 8c reçus dans les
églifes. On les appelloit aufli lettres canoniques de p a ix , de
recommandation , de communion. Ce qui eft dit dans' le concile
d’Elvire.,Si les voyageurs à qui elles étoient accordées,
avoient confeffé la foi, on le marquoit dans ces lettres. Il étoit
défendu aux femmes d’en donner, ni d’en recevoir adreffées à
elles feules. Les évêquesdes Gaules ne pouvoient voyager fans
avoir de ces lettres formées. Cet ufage fupprimé en 442. Ce
S l’on appelloit loi formée. Le nom de formée donné par les
recs à 1’euchariftie.iéid. 182.
Tome L
F O R 769
FORMEL. {Gramm.) Démenti formel, loi formelle, objet
formel d une fcience ; les théologiens diftinguent le formel 8c
le matériel d’une aélion. VII. 182. a.
F o rm e l . {Philofoph. f ih o l.) ’ Diftinétion formelle , 8c
diftinélion virtuelle. Objet matériel 8cobjet formel, &c. VII.
182. 4.
Formel Caufe formelle. II. 788. b. Notion formelle. XI.
2Ç2. b.
F o rm e l . ( Jurifpr. ) Ajournement formel. Contradiétion
formelle. Garant formel. Partage formel. Partie formelle.
VII. 182. b.
Formel. Garant formel. V IL 480. a. Garantie formelle.
Ibid. b.
FORMER , drejfer, ( A r t milit. ) différence entre ces
deux mots, former des foldats, dreffer des troupes. Différence
entre ces fynonymes, former, ordonner. difpofer.
VII. 182. b.
FORMIER. ( Art méchan. ) Plane de formiers. XII. 702.
a t b. Des bois propres à l’art du formier : de la maniéré
de faire une forme : des différentes efpeces de formes. X VII.
78 1 .4 ,6 .78 2 . 4. Des embouchoirs : des bouiffes. 782. b.
Des outils. 783. 4. Foyei vol. IV. des planches. Article
F o rm ie r .
FORMIES, ce que cette ville étoit anciennement. IX. 402.
b. 403.4.
FORMORT , formorture , formoture , formouture ou fre-
meture , {Jurifpr. ) terme de coutumes; échoiteou droit de
fucceflion. Signification de ces mots dans la coutume de
Hainaut, dans celle de Cambrai ; obfervations fur l’étymo-
lqgie de ces mots. Tout ce qui eft acquis à quelqu’un par
mort, foit à titre de communauté, de fucceflion, ou de
legs, peut être nommé formoture. Diverflté entre les coutumes
fur l’extenfion de ce mot. Ouvrages à confulter. VII.
183. 4.
FORMOSE, ( Géogr.) la partie orientale de cette ifle
n’eft habitée que par les naturels du pays : 8c l’occidentale
appartient aux Chinois, qui en chaiferent les Hollan-
doisen 1661. Capitale de cette ifle. Auteurs à confulter. V II.
183. 4.
Formofe, obfervations fur les habitans de cette ifle. VIII.
345. b. Punition des femmes de Formofe qui deviennent
groffes avant trente ans. VI. 433. a. VIIL 307. a. Prêt-
trèfles de cette ifle. Ibid. Obfervations fur les femmes de Formofe.
X. 118. b.
Formofe, pape : comment il favorife Arnould. Suppl. I. 364.
1ORMULA1RE , ( Théol. Hifl. teel. ) celui par lequel
on a condamné les cinq propofitions de Janfénius. VII.
183. 4. A quoi fe réduit le fond de cette difpute qui a
troublé depuis cent ans l’églife de France. Ce qu’on entend
en France par janfénifle 8c molinifie. Réflexions fur le
fujet de ces diflenuons, fur les letttes provinciales, fur
le chapitre du janfénifme , dans le flecle de Louis X IV
par M. de Voltaire. Leçon que doivent tirer ceux qui font
à la tête du gouvernement de la faute que le cardinal Mazarin
commit en ne coupant pas court à ces vaines dilputes. Ibid. b.
FORMULE. {A le e b .) Utilité des formules. VII. 183.6.
Pour qu’une formule générale foit vraiment utile, il faut
que le problêipe énoncé généralement renferme des difficultés
plus grandes que le problème particulier. Défaut des formules
de M. Varignon. Bon mot de M. Bernoulli fur les formules
de cet académicien. Ibid. 184.4.
F o r m u l e , {H ifl. rom.) réglé preferite par les loix de
Rome, dans les affaires publiques oc particulières, civiles 8c
religieufes. Détails fur ces formules. Il y avoit dans quelques
conjonélures éclatantes, des formules auxquels on attachoit
des idées beaucoup plus vaftes, que les termes de ces formules
ne fembloient défîgner. V IL 184.4.
Formules de procédures introduites chez les Romains. XIII.
403. 6.
FORMULES des allions ou formules romaines, ( Jurifpr. ) leur
origine. Rédaâcur de ces formules. Elles forent appellées
legis afliones. VII. 184. a. En quels cas elles fervoient. Effets
de ces formules. Origine du droit flavien. Comment les formules
furent rendues publiques. Nouvelles formules composées
par lespatriciens, oc publiées enfuite comme les précédentes.
Origine du droit slien. Comment* l’ufage des
formules tomba infenfiblement. Ouvrage du préfident Briffoa
fur cette matière. Celui de Jérôme Bignon. Ce qu’on trouve
fur ce fuiet dans l’hiftoire de la jurifprudence romaine par M.
Tcrraffon. Ibid. b.
Formules publiées par Cn.Flavius. IV . 991.6. V . 123. 6.138.
4. Nouvelles formules qui furent publiées par Sextus Ælius.
IV. 991.6. V . 117. 4.138.4.
Formules de Marculfe. En quoi confifte cet ouvrage. Son utr-.
lité. Cet ouvrage publié par Bignon. Additions qu’ony a faites.
VII. 184.6.
Formules des ailes : divers fens d» cette exprelfion. Origine
des formules en France fous Louis XIV. Recueil des
* I I I l i i iM