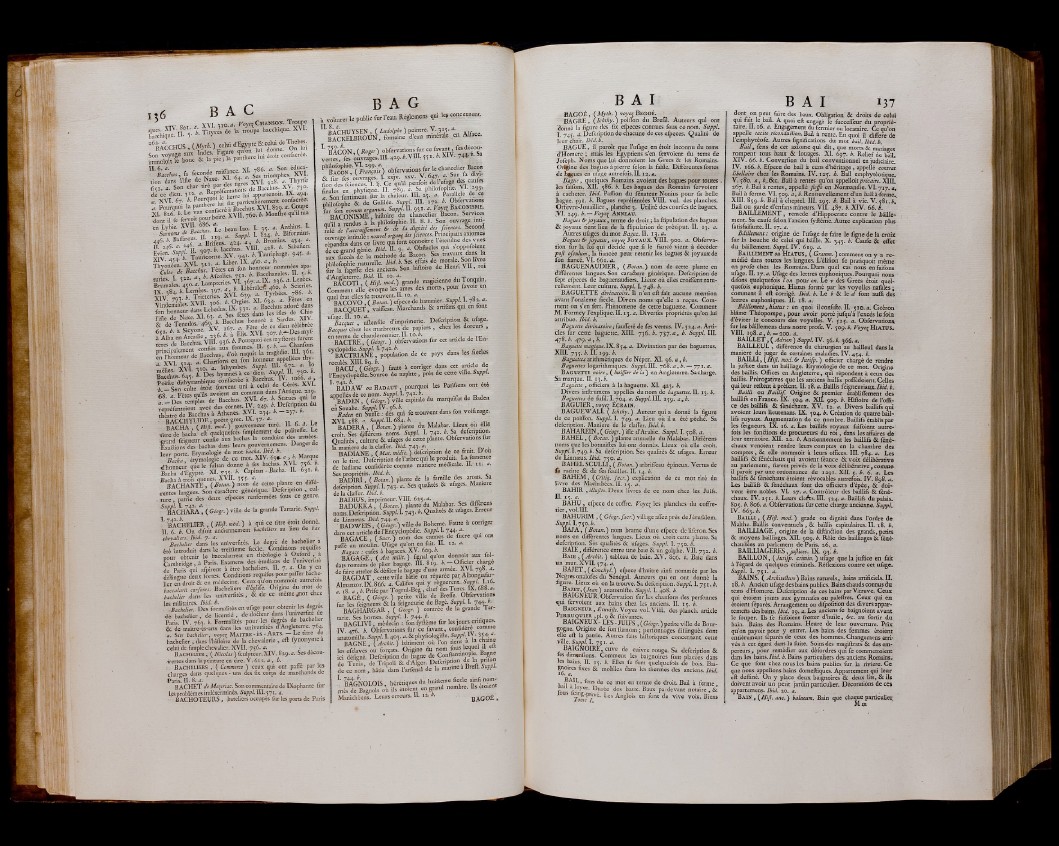
i î6 B A C
YIV 801 XVI.3T0.a- roy^CiiANSOi;. Troupe !
g i p e'I M 1 S “ «¥• bacchl<!UC- XVL
a"'"BArCCHiUSl I &>>& ¡§ritou c°ni“crée- UÜ » , i to°n ie " ^ n“ 4 Xj - s7ef „ b mpB«eX-vl
tion dans l'iflç de Naxe XI ÎA ^ Thyrfe
«,». a. Son char tné par de stigra’ ¿ BJ huSm XV 730.
de ce dieu. 312- ^ P , ,iem lui appartenoit. IX. 494- I
0. XVI. I m fut particulièrement confacrée.
a. Pourquoi la - à §Jg|| XVI. 820. aj Coupe 1
en Lybie. X VW S jP t e beau lao. I. 35- a. Anffiius. I.
Surnom de Bdcchies. £ g Bifommis.
446.ABtdTareos. il. A Bromtus. 434-0. sss S tunes. I. 31a. o . 4-A f 3JJ , f o r i n t 236. o. Lenèes.
Brùmries. 430.42. Lampten . t ¡ulraie^ 46o. b. Scieries.
IX. 384. A Lemêes. ?97- «• | ^ é™ Tyrbées. 786. b.
XIV 70 V b. Tnetenes. XVI. 039. • y -p.^, en îb Ssraw
teres de Baccmis. v u j i f me/ n. <r. b. — Chanfons
i t . . XVI 210 u. Ithymbes. Suffi. III. 672. a. Io
S 9 B B S N n l à celui àe Cérès. XVI.
v-o rAtes qu’ils avoient en commun dans 1 Attique. 210. j f ' S H S B B B Bacchus. XVI. 67- * Statues qui le
ï £ Â S M cornes^V g . i Defcnpuon du
théâtre de Bacchus à Athènes. XVI. 234. *. *37-
i BACCHYLIDE. poete grec.lX. 37. o.
BACHA , (Hiß- mod.) gouverneur turc. II. 6. 4. Le 1
•titre de bacha eft quelquefois funplement de pohteffe. U I
urand feieneur confie aux bachas la conduite des armées. I
Ixaffions des bachas dans leurs gouvememens. Danger de
leur porte. Etymologie du mot H | M „ .
Suîria, étymologie de ce a K U t g H g t e g jM M «
d’honneur que le gitan donne à Tes bachas. XVI. 736. .
Bacha d’Egypte. XI. 73V b- Capitan - Bacha. II. 6 jt. .
Bacha à trois queues. XVII. 355. 4.
BACHANTE, (Botan.) nom de cette plante en différentes
langues. Son caraftere ■ générique. Defcription , B
. „ .r é , patrie des deux efpeces renfermées fous ce genre.
SUFI x à i ! & î ' , ( Geogr. ) ville- de la grande Tartarie. Suffi.
S BACHELIER , ( Hiß. moi. ) à qui ce titre étoit donné.
II. 6. b. On difoit anciennement bacheliers au heu ae cas
chevaliers. Ibidh 7. a. ■ , ..
Bachelier dans les univerfités. Le degré de bachelier a
été introduit dans le treizième fiecle Copdmons requifes
pour obtenir le baccalauréat en théologie à Oxford , a
Cambridge, à Paris. Examens des etudians de luniverfité
de Paris qui afpirent à être bachelière. 11 7- a- ®". Y *n
diflingue deux fortes. Conditions requifes pour paffer bachelier
en droit & en médecine. Ceint qu’on nommoit autrefois
baccalarii cnrfores. Bacheliers d’églife. Origine du morde
bachelier .dans lés univerfités, & de ce même jnot chez
les militaires. Ibid. b. - . ,
Bachelier. Des formalités en ufage pour obtenir les degres
dé bachelier, de licentié , dedofteur dans^ luniverfité de
Paris. IV. 763. b. Formalités pour les degrés de bachelier
& de maître-ès-arts dans les univerfités d Angleterre. 764.
M Sur bachelier, voyez M A IT R E - ès - A r t s . - Le titre de
bachelier , dans l’hiftoire de la' chevalerie , eft fynonyme a
celui de fimple chevalier. XVII. jefi: a. .
Bachelier , ( Nicolas) fcnlpteur.XIV. 849. a. Ses décou-
•vertes dans la peinture en cire. V . 612. a , b.
. . B a c h e lie r s , | Commerce ) ceux qui ont paffé par les
charges dans quelques - uns des fix corps de marchands de
•Paris. II. 8. a:
B ACHET de Meçeriac. Son commentaire de Diophante fur
les problèmes indéterminés. Suppl. III. <571. a.
BACHOTEURS , bateliers occupés fur les ports de Paris
B A G
i voiturer le public fur l’eau. Réglemens qui les concernent.
’ ’ 'BACHUYSEN, ( Ludolphc ) peintre. Y - I 1!' a’ Alf
BACKELBROUN, fontaine deau nunérale .en AUace.
| Ï A C O N , (Eogcr) obfervafionsfiir ce
vertes, fes ouvrages.III. 429.b.VUE 331. 4-A tv . 744
& fur fes ouvrages. L xxjv. xxv- V- 647. • cau(es
fion des fciences. I. lj. Ce qu’d penfoit de 1 ufage dy.cailles
finales en phyfique. II. 7 8 9 . 4 . Sa phdofoph.e. Vl^agp.
4 Son fentiment fur la chaleur. III. 23. a. Parallèle de ce
philofophe &, de Gahlée Suupl. IH. . 7 - b. Obfervat.o^
fur fon novum organum. S uffi IL 931. a. r u w BACONISME.
BACONISMË lüftoire du chancelier Bacon. Services
I nuHl a rendus à îa philofophie. H. 8. b. Son ouvrage intitulé
Je l’accroiffeenent b Je la Jipiue des fciences. Second
ouvrage intitulé : nouvel orgauf des fciences. Principaux axiomes
I réuanfus dans ce livre qui font connoitre 1 étendue des vues
de ce grand génie. 9 .4 . Obftacles qui s oppofoienr
ara f S de la méthode de Bacon. Ses travaux dans la I philofophie naturelle. Ibid. b. Ses e ffa« ie““ri1e;^nU70ei I fur la fagefle des anciens. Son lüftoire de Henri V i l , rot
I d ^ A C O T Î '/ fH ^ 's o i ) grande magicienne .du Toncjuin.
Comment elle évoque les ames.des morts, pour favoir en I quel état elles fe trouvent. H. 10. 4. _ Q s „0, „
I BACOVO , ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl.. 1. 702. a-
1 BACQUET, vaiffeau. Marchands & artifans qui en font I UÎ!i^cque™' uftenfile d’imprimerie. Defcription & ufage. I Bacquet chez les marbreurs de papiers , chez les doreurs ,
II en terme de chauderonnier. II. 10. b. BACTRE, ( Geogr. ) obfervations fur cet article de ic.n
I ^BAPO T i fÆ , ' p o t i o n do êe pays dans lesfiedes
reBACU^Grogr. ) faute à corriger dans cet arucle de
l’Encyclopédie. Source de naphte, près de cette ville. Supp .
1 BADÀW ou Bad aut , pourquoi les Parifiens ont été
appellés dë ce nom. Suppl. I. 742. h p-a-«
BADEN, ( Geogr.) ville capitale du marqmfat de Baden
enSouabe. Suppl.lV. <6.b. ..
Baden en Suiffe.- dés qui fe trouvent dans fon voifinage.
X V I . 188. 4. Suffi. H. 684. b. ,
BADERA, (BombA plante du Malabar. Lieux ou elle
croit. Ses djfférens noms. Suffi. I. 74a- ASa
Qualités , culture & ufages de cette plante. Obfervauons fur
I la maniéré de la clafler. Ibid. 743. 4. , . p.. .
BADIANE, (Mut. médie. ) defcnpuon de ce fruit. D ou
on le tire. Defcription de l’arbre qui le produit Lafemence
de badiane confidérêe cotpme matière médicale. 11. 11. a.
^CBADIRl'T( Botan.) plante de la ftmille des arons. Sa
defcription. Suffi. 1. 743- “■ Ses qualités & ufages. Mamere
I de la clafler. Ibid. b.
\ BADIÜS, imprimeur.VIII. 625.a. ^
| BADUKKA, (Botan.) plante du Malabar. Ses différens
noms.Defcription. Suppl. 1. 743- ¿- Qualités & ufages. Erreur I ÜBADWEIst (Géogr.) ville de Boheme. Faute à corriger
dans cet article de l’Encyclopédie, iupp/.1. 744- 4.
BAGACE, (Suer.) nom des cannes de fucre qui ont
paffé au moulin. Ufage qu’on en fait. II. 12. a.
Bagace .- cafés à bagaces. XV. 609. -• .
BAGAGE, (Art milit. ) fignalquon donnoit ara fol-
dats romains de plier bagage, lll. 819. i. — Officier chargé
de faire atteler & défiler le bagage d’une armée. XVI. 798. 4.
BAGDAT, cette ville bâtie ou réparée par Albongiatar-
Almanzor. IX. 8ü6. 4. Califes qui y règmtrent..S«™i. I.16.
4.18. a.b. Prife par Togml-Beg, chef Ses Turcs. IX. 688.4.
BAGÉ, ( Geogr. ) petite ville de Breffe. Obfervauons
fur les feigneure & la feigneurie de Bagé. Suffi. I. 744-*•
BAGHARGAR , ( Giogr. ) contrée de la grande Tar-
tarie. Ses bornes. Suffi. I. 744. b. _ ..
BAGLIVI, médecin : fonfyftême fur les jours crmques.
IV 476 b. Obfervations fur ce favant, confidéré comme
anatomifte. Suffi. 1. 403.4.8c phyfiolqgifte. Suffi.1V. 3 54-4-
BAGNE, (Archit.) bâtiment ou Ion tient a la chaîne
les efclaves ou forçats. Origine du nom fous lequel il eft
d t f ÿ Z Defcription du f e e de Çonft^nople Bagne
de Tunis, de Tripoli 8c d’Alger. Defcription deHa pnfon
de ce nom, bâtie dans l’arfenal de la marin • PP
1 RAGNOLOIS hérétiques du huitième fiecle ainfi noinl
â l P l I t étoient en grand nombre. lUetoient
Manichéens. Leurs erreurs. IL 12.0. BAGOÉ ,
B A I BAI 137 BAGOÉ, ( Myth. ) voyez Begoé.
BAGRE, ( Ichthy. ) poiflon du Brefil. Auteurs qui ont
"donné la figure des fix efpeces connues fous ce nom. Suppl.
I. 745. a. Defcription de chacune de ces efpeces. Qualité de
leur chair, lbid.b. ..
BAGUE, il paroît que l’ufage en ¿toit inconnu du teins
d’Homere ; mais les Egyptiens s’en fervoient du tems de
Jofeph. Noms que lui donnoient les Grecs & les Romains.
Oi^ine des bagues à pierre félon la fable. Différentes fortes
de h^gues en ulage autrefois. II. 12. a.
Bague, quelques Romains avoient des bagues pour toutes .
les faifons. XII. 586. b. Les bagues des Romains fervoient
à cacheter. Ibid. Paflion du fénateur Nonius pour fa belle
bague. 591. b. Bagues repréfentées VIO. vol. des planches.
Orfevre-Jôuaillier , planche 3. Utilité des courfes de bagues.
VI. 249. b. — Voye{ A nneau.
Bagues 6* joyaux, terme de droit ; la ftipulation des bagues
& joyaux tient lieu de là ftipulation de préciput. II. 13. a.
Autres ufages du mot Bague. U. 13. a.
Bagues & joyauxvoye{ JOYAUX. VIII. 900. a. Obferva-
tion fur la loi qui décide que fi le fiancé vient à décéder
poft ofculum, la fiancée peut retenir les bagues & joyaux de
fon fiancé. VI. 661. a.
BAGUENAUDIER, ( Botan. ) nom de cette plante en
différentes langues. Son caraâere générique. Defcription de
fept efpeces de baguenaudiers. Lieux où elles çroiflent naturellement.
Leur culture. Suppl. I. 748. b.
BAGUETTE divinatoire. Il n'en eft fait aucune mention
avant l’onzieme fiecle. Divers noms, qu’elle a reçus. Comment
on s’en fert. Phénomène de cette baguette. Comment
M. Formey^l’explique. II. 13. a. Diverfes propriétés qu’on lui
attribue. Ibid. b.
Baguette divinatoire; faufleté de fes vertus. IV. 3 24. a. Articles
lur cette baguette. XIII. 736. b. 737. a3 b. Suppl. III.
478. b. 479<a > Î>.
Baguette magique. IX. 8 <4. a. Divination par des baguettes,
xm . 733.¿ .fi. i 9o.b.
Baguettes arithmétiques de Néper. XI. 96. a , b.
Baguettes logarithmiques. Suppl. III. 768.a ,b . — 771.47.
Baguette noire, ( huiffier de la ) en Angleterre. Sa charge.
Sa marque. II. 13. b.
Baguette , officiers à la baguette. XI. 423. b.
Divers inftrumens appelles du nom de baguettes. II. 13. b.
Baguettes de fiifd.'ï. 704. a. Suppl. IU. 159. a.b.
BAGUIER, voyez Écr ain .
BAGUEWALI. ( Ichthy. ) Auteur qui a donné la .figure
de ce poiflon. Suppl. I. 749. a. Lieu où il a été péché. Sa
defcription. Maniéré de le clafler. Ibid. b.
BAnAREIN, ( Géogr. ) ifle d’Arabie! Suppl. I. 308. <7. (j
BAHEL, ( Botan. ) plante annuelle du Malabar. Différens
noms que les botaniftes lui ont donnés. Lieux où elle croît.
Suppl. 1.749. b. Sa defcription. Ses qualités & ufages. Erreur
de Linnæus. Ibid. 750. <7.
BAHEL SCULLl, ( Botan. ) arbrifleau épineux. Vertus de
fa racine & de fes feuilles. II. 14. b.
BAHEM, ( Critiq. facr.) explication de ce mot tiré du
livre des Machabées. II. 15. a.
BAHIR fillujlre. Deux livres de ce nom chez les Juifs.
II. 13. a.
BÂHU, efpece de coflre. Voyeç les planches du coffre-
tier, vol. III.
BAHURIM, ( Géogr. facr.) village allez près de Jérufalem.
Suppl. 1.730. b.
BAJA, ( Botan. ) nom brame d’une efpece de liferon. Ses
noms en différentes langues. Lieux où croit cette plante. Sa
defcription. Ses qualités & ufages. Suppl. I. 730. b.
BAIE, différence entre une baie & un golphe. VII. 732. b.
Baie , ( Archit. ) tableau de baie. XV. 806. b. Baie dans
un mur. XVII. 374. a.
BAJET, ( Conchyl.) efpeced’huitre ainfi nommée parles
Negres onalofes du Sénégal. Auteurs qui en ont donné la
figure. Lieux où on la trouve. Sa defcription. Suppl. 1. 731. b.
B ajet , {Jean ) anatomifte. Suppl. I. 408. b.
BAIGNEUR. Obfervation fur les chanfons des perfonnes
qui fervoient aux bains chez les anciens. II. 13. b.
Baigneur , Étuvifte. Voyez vol. VIII. des planch. article
Perruquier , pl. 9 & fuivantes.
BAIGNEUX- LES - JUIFS, ( Géogr. ) petite ville de Bour-
gogne. Origme de fon furnom j pertonnages di langues dont
elle eft la patrie. Autres faits hiftoriques concernant cette
Ville. Suppl. I. 731. a.
BAIGNOIRE, cuve de cuivre rouge. Sa defcription &
les dimenfions. Comment les baignoires font placées dans
les bauis. II. 13. b. Elles fe font quelquefois de bois. Baignoires
fixes & mobiles dans les thermes des anciens. Ibid.
. ¿YtfSb ^ens I I ce mot en terme ,de droit. Bail à ferme,
r -°^er' ,^llrée des baux. Baux pa: devant notaire, &
7ùn'^/V^* ^es en de vive voix. Biens
d°nt on peut faire des baux. Obligation & droits de celui
qui fait le baü. A quoi eft engagé le fuccefleur du proprié-
taire. II. 10. a. Engagement du fermier ou locataire. Ce qu’on
appelle tacite réconduflion. Bail à rente. En quoi il différé de
l ’emphytéofe. Autres fignifications du mot bail. Ibid. b.
Bail t fens de cet axiome qui dit, que morts & mariages
rompent tous baux & louages. XI. 697. b. Relief de bail.
XIV. 66. b. Converfion du bail conventionnel en judiciaire.
IV. 166. b. Efpece de bail à cens d’héritage, appellé contrat
libellaire chez les Romains. IV. 125. b. Bail emphytéotique.
V. 380. a y b._6cc. Bail à rentes qu’on appelloitprécaire. XIII.
267. b. Bail à rentes, appellé fieffe en Normandie. VI. 717. <7.
Bail à ferme. VI. 309. at b. Renouvellement d’un bail àferme.,
XIII. 839. b. Bail à cheptel. III. 293. b. Bail à vie. V. 381. b%
Bail ou garde d’enfans mineurs. V il. 487. b. XIV. 66. b.
BAILLEMENT, remede d’Hippocrate contre le bâille—
ment- Sa caufe félon l’ancien fyftême. Autre explication plus
fatisfaifante.il. 17. a.
Bâillement : origine de l’ufage de faire le figne de la croix
fur la bouche de celui qui bâille. X. 343. b. Caufê & effet
du bâillement. Suppl. IV. 610. a.
B â illem e n t o u H i a t u s , ( Gramm.-) comment on y a remédié
dans toutes les langues. L ’élifion fe pratiquoit même
en profe chez les Romains. Dans quel cas nous en faifons
ufage. U. 17 . <7. Ufage des lettres euphoniques. Pourquoi nous
difons quelquefois l'on pour on. Le v des Grecs étoit quelquefois.
euphonique. Hiatus formé par les voyelles nafales j
comment il eft corrigé. Ibid. b. Le b & le d font aufli des
lettres euphoniques. H. 18.47.
Bâillement y hiatus : en quoi ilconflfte. II. 310. 42. Cicéron
blâme Théopompe, pour avoir porté jufqu’à l’excès le foin
d’éviter le concours des voyelles. V. 323. a. Obfervations
fur les bâillemens dans notre profe. V . 309. b. Voye[ HlATUS.
VIII. 198.47 , b. — 200. a.
BAILLET, ( Adrien ) Suppl. IV. 3 6. b. 3 66. a.
B AILLEUL , différence du chirurgien au bailleul dans la
maniéré de juger de certaines maladies. IV. 434. b.
BAILLI, ( Hift. mod. 6» Jurifp. ) officier chargé de rendre
la juftice dans un bailliage. Etymologie de ce mot. Origine
des baillis. Offices en Angleterre, qui répondent à ceux des
baillis. Prérogatives que les anciens baillis poffédoient. Celles
qui leur reftent à prélent. II. 18.47. Baillis feigneuriaux./éh/. b.
Bailli ou Baillif. Origine 8c premier établiffement des
baillifs en France. IX. 304.47. XIL 909. b. Hifloire de l’office
des baillifs & fénéchaux. XV. 12. 47. Divers baillift qui
avoient leurs lieutenans. IX. 304. b. Création de quatre bail-,
lifs royaux. Augmentation de ce nombre. Baillifs établis par
les feigneurs. IX. 16. a. Les baillifs royaux faifoient autre-'
fois les fondions de procureurs du fo i , dans les affaires de
leur territoire. XII. 22. b. Anciennement les baillifs & fénéchaux
venoient rendre leurs comptes en la chambre des
comptes, & elle nommoit à leurs offices. III. 784.47. Les
baillifs & fénéchaux qui avoient féance & voix délibérative
au parlement, furent privés de la voix délibérative, comme
il paroît par une ordonnance de 1291. XII. c. b. 6. a. Les
baillifs 8c fénéchaux étoient révocables autrefois. IV. 898. a.
Les baillifs 8c fénéchaux font des officiers d’épée, 8c doivent
être nobles. VL 27. a. Contrôleur des baillifs 8c fénéchaux.
IV. 131. b. Leurs clercs. III. 324. a. Baillifs du palais.
803. b. 806.42. Obfervations fur cette charge ancienne. Suppl.
IV. 663. b. o g !
B ailli , ( Hift. mod. ) grade ou dignité dans l’ordre de
Malthe. Baillis conventuels , 8c baillis capitulaires. H. 18. b.
BAILLIAG E , origine de la diftinâion des grands, petits
8c moyens bailliages. XII. 909. b. Rôle des bailliages 8c féné-
chauflees au parlement de Paris. 26. 42.
BAILLIAGERES yiufiices. IX. 931 b.
BAILLON, {Jurifp. crimin. ) ulage que la juftice en fait
à l’égard de quelques criminels. Réflexions contre cet ufage.
Suppl. I. 731. a.
BAINS. ( ArchïteÜure) Bains naturels, bains artificiels. II.
18. b. Ancien ufage des bains publics. Bains chauds connus du
teins d’Homere. Defcription de ces bains par Vitruve. Ceux
qui étoient joints aux gymnafes ou paleftres. Ceux qui en
étoient féparés. Arrangement ou dilpofltion des.diversappar-
temefis des bains. Ibid. 19.47. Les anciens fe baignoient avant
le fouper. Ils fe faifoient frotter d’huile, &c. au fortir du
brin. Brins des Romains. Heure de leur ouverture. Prix
qu’on payoit pour y entrer. Les bains des femmes étoient
entièrement féparés de ceux des hommes. Changemens arrivés
à cet égard dans la fuite. Soins des magiftrats 8c des empereurs
, pour remédier aux défordres qui fe commettoient
dans les bains. Ibid. b. Brins particuliers des anciens Romains.
Ce que font chez nous les brins publics fur la riviere. Ce
que nous appelions brins domeftiques. Appartement qui leur
eft deftiné. On y place deux baignoires 8c deux lits, 8c ils
doivent avoir un petit jardin particulier. Décorations de ces
appartemens- Ibid. 20. a.,
B a i n , {Hijî, anc.) balneum. Bain que chaque particulier
Moi