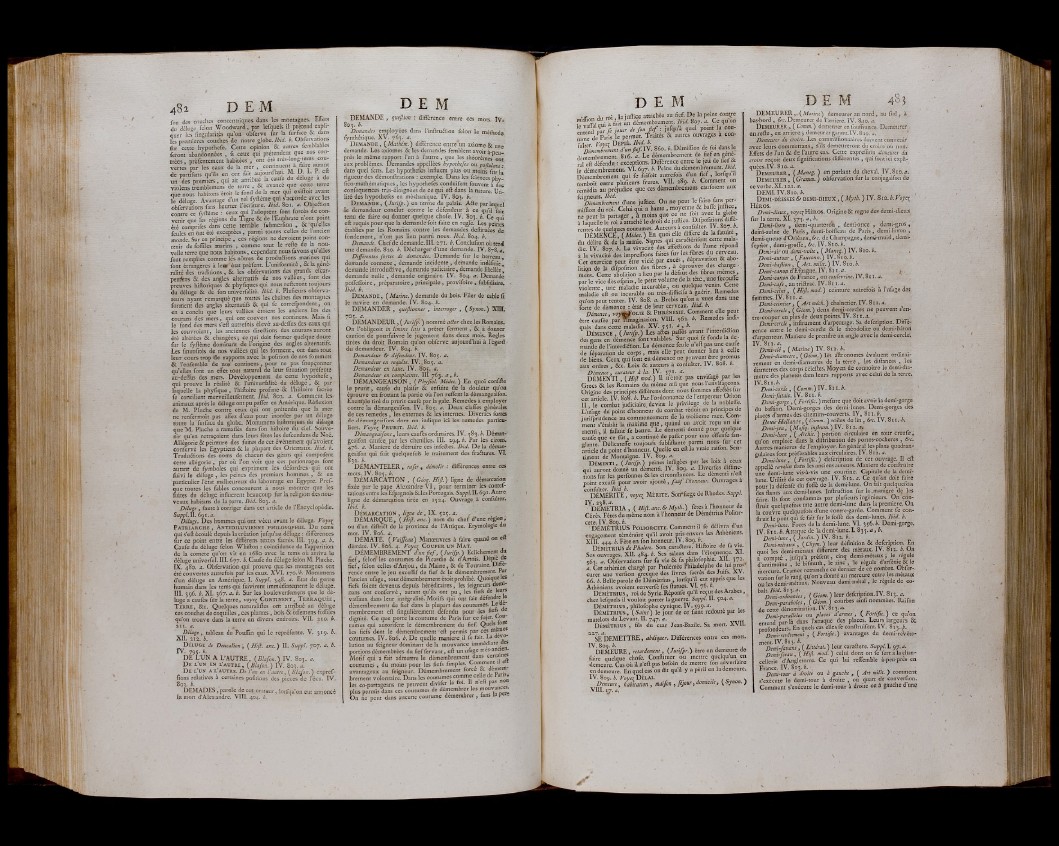
D E M
fon des couches concentriques dans les montagnes. Effets
du déluge félon Woodwara, par lefquels il prétend expliquer
les Angularités qu’on obferve lur la furfàce & dans
les premières couches de notre globe, lbid. b. Observations
fur cette hypothefe. Cette opinion & autres femblables
feront abandonnées , fi ceux qui prétendent que nos contrées
, préfentement habitées , ont été tres-long-tems couvertes
par les eaux de la mer ». conj£HenÎ / ap ta.A
de partifans qu’ils en ont fait aujourd’hui. M. D. L. r. eft
un des premiers, qui ait attribué la caule du déluge à de
violens tremblemens de terre , & avance qne cette terre
crue nous habitons étoit le fond de la mer qw exiftoit avant
le déluge. Avantage d’un tel fyfteme qui s accorde avec les
obfervanons fans heurter l’ecnmre. M fo i. «. Objeôion
contre ce fylléme : ceux qui l'adoptent font forcés de convenir
que les régions du Tigre & de l'Euphrate nont point
été comprifes dans cette terrible lubmerfion , 6c‘quelles
feules en ônt été exceptées, parmi toutes celles de l'ancien
monde. Sur ce principe , ces régions ne dévoient point contenir
defoffües marins , comme tout le refte de la nouvelle
terre que nous habitons, cependant nous favons qu elles
font remplies comme le’s nôtres de produirions marines qui
font étrangères à leur* état préfent. L’uniformité, & la généralité
des traditions, & les obfervanons des grands efear-
penfens & des angles alternatifs de nos vallées, font des
preuves hiftoriques & phyfiques qui nous relieront toujours
du déluge & de fon univerfalité. lbid. b. Plufieurs obferva-
tcurs ayant remarqué que toutes les chaînes des montagnes
forment des angles alternatifs & qui fe correfpondent, on
en a conclu que leurs vallées étoient les anciens lits des
courans desr mers, qui ont couvert nos continens. Mais fi
le fond des mers s’eft autrefois élevé au-deffus des eaux qui
les couvroient, les anciennes direéhons des courans auront
été altérées & changées ; ce qui doit former quelque doute
fur de iyftême dominant de l’origine des angles alternatifs.
Les iinuoiités de nos vallées qui les forment, ont dans tout
leur cours trop de rapports avec la pofirion de nos fommets
& l’enfemble de nos continens, pour ne pas foupçonner
qu’elles, font un effet tout naturel de leur fituation préfente
au-deffus des mers. Développement de cette hypothefe,
qui prouve la réalité & l’uiiiverfalité du déluge, & par*
laquelle la phyfique , l’hiftoire profane-8c l’hilloire facrée
fe concilient merveilleufement. lbid. 802. p i Comment les-
animaux après le déluge ont pu paffer en Amérique. Réflexion
de M. Pluche contre ceux qui ont prétendu que la mer
ne renfermoit pas affez d’eau pour inonder par un déluge
toute la furface du globe. Monumens hiftoriques du déluge
queTVl. Pluche a ramaffés dans fon hiftoire du ciel: Souvenir
qu’en retraçoient dans leurs fêtes les defeendans de Noé.
Allégorie & peinture des fuites de cet événement qu’avoient
conlervé les Egyptiens & la plupart des Orientaux. lbid. b.
Traduôions des noms de chacun des géans qui compofent
cette allégorie , par où l’on voit que ces perfonnages font
autant de iymboles qui expriment les défordres qui ont
fuivi le déluge, les peines des premiers hommes , & en
particulier l’état malheureux du labourage en Egypte. Pref-
?ue toutes les fables concourent à nous montrer que les
ùites du déluge influèrent beaucoup fur la religion des nouveaux
habitans de la ferre. lbid- 803. a.
Déluge , faute à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. il. 6911 a.
Déluge. Des hommes qui ont vécu avant le déluge. Voye^
P a t r ia r c h e , A nt é d ilu v ie n n e ph il o so ph ie . D u tems
?iui s’eft écoulé depuis la création jufqu’au déluge : différences
ur ce point entre les différens textes facrés. lll. 394. ,4. b.
Caufe du déluge félon Whifton : coïncidence de l’apparition
de la comete qu’on vit en 1680 avec le tems où arriva le
déluge univerfel. UL 677. b. Caufe du déluge félon M. Pluche.
IX. 480. a. Obfervation qui prouve que Tes montagnes ont
été couvertes autrefois par les eaux. XVI. 170.'b. Monumens
d’un déluge en Amérique. I. Suppl. 348. a. Etat du genre
humain dans les tems qui fuivirent immédiatement le déluge.
UI. 396. b. XI. 367. a. b. Sur les bouleverfemens que le déluge
a caufés fur la terre., voyez C o n t in e n t , T e r r a q u é e ,
T e r r e , & c. Quelques naturaliftes ont attribué au déluge
ces couches de coquilles, ces plantes, bois & offemens fofliles
qu’on trouve dans la terre en divers endroits. VII. 210. b.
211. a.
Déluge, tableau du Pouflin qui le repréfente. V. 319. b.
XII. 212. b.
D é luge de DeucaHon ; ( Hijt. une. ) II. Suppl. 707. a. b.
IV. 795. b.
DE L’UN A L’AUTRE, ( Blafon.) IV. 803. a.
De l ’u n en l’a u t r e , (Blafon.) IV. 803.a.
D e L UN A X a u t r e . De l’un en l autre, ( Blafon. ) expref-
fions relatives à certaines pofuions des pièces de 1 écu. IV.
- 8oî -b. . ,
DEMADES, parole de cet orateur, lorfqu’on eut annoncé
la mort d’Alexandre. VIII. 404. b.
D E M
DEMANDE, queftion .* différence entre ces mots. IV<
-03. b.
Demandes employées dans l’inftruâion félon' la méthode
fynthétique. XV. 763. a.
D e m a n d e , (Mathém.) différence entre un axiome & une
demande. Les axiomes .& les-demandes femblent avoir à-peu-
près le même rapport l’un à l’autre, que les théorèmes ont
aux problèmes. Demandes appellées hypothefes ou poflulata •
dans quel fens. Les hypothefes influent plus ou moins fur là
rigueur des démonftrations : exemple. Dans les fciences phy-
fico-mathématiques, les hypothefes conduifent fouvent à des
conféquences trgs-éloignées de ce qui eft dans la nature. Utilité
des hypothefes en méchanique. IV. 803. b. ■
D em an d e , ( Jurïfp. ) en terme de palais. Aâe par lequel
-le demandeur conclut contre le défendeur à ce qu’il foie
tenu de faire ou donner quelque chofe. IV. 803. b. Ce qui
eft requis pour que la demande foit faite en réglé. Les peines
établies par les Romains contre les demandes deftituees de
fondement, n’ont pas lieu parmi nous. lbid. 804. b.
Demande. Chef de demande. III. 271. b. Conclusion où tend
une demande. 820. b. Décharger d’une demande. IV. 878. a.
Différentes fortes de demandes. Demande fur le barreau,
demande connexe, demande incidente, demande indéfinie,
demande introduâive, demande judiciaire, demande libellée,
demande nulle , demande originaire. IV. 804. a. Demande
poffeffoire, préparatoire, principale, provifoire , fubfidiaire. •
lbid. b.
D em an d e , ( Marine.) demande du bois. Filer de cable fi
le navire en demande. JV. 804. b.
DEMANDER , quèftionner , interroger , ( Synon. ) XQL
705. a.
DEMANDEUR, ( Jurifp'. ) nommé aêtor chez les Romains.
On l’obligeoit in limine luis à prêter ferment, & à donner
caution de pourfuivre le jugement dans deux mois. Réglés
tirées du droit Romain qu’on obferve aujourd’hui à l’égard
du demandeur. IV. 804. b.
Demandeur 6» défendeur. IV. 803. a.
Demandeur en requête. IV ..805. a.
Demandeur en taxe. IV. 805. a.
Demandeur en complainte. III 763. a, b.
DÉMANGEAISON, ( PhyfioL Médec.) En quoi confifte
le prurit, caufe du plaifir & enfuite de la douleur qu’on
éprouve en frottant la partie où l’on reffent la démangeaifon.
Exemple tiré du prurit caufé par la gale. Remedes à employer
contre la démangeaifon. IV. 805; a. Deux daffes générales
de ces remedes, les externes & les internes. Diverîes fortes
de démangeàifons dont on indique ici les remedes particuliers.
Voyc^ Pr u r it . lbid. b.
Démangeaifons, leurs caufés ordinaires. IV. 583. b. Démangeaifon
caufée_ par les chenilles. III. 294. b. Par les cirons.
476. a. Maniéré de détruire ces infeétes. lbid. De la démangeaifon
qui fuit quelquefois le traitement des fra&ures. VI.
832. b.
DÉMANTELER, rafer, démolir : différences entre ces
mots.. IV. 803. b.
DÉMARCATION , ( Géog. Hift. ) ligne de démarcation
fixée par le pape Alexandre V I , pour terminer les contei-
tations entre les Efpagnols 8cles Portugais. Suppl.H. 691. Autre
ligne de. démarcation tirée en 1324. Ouvrage, à confulter.
lbid. b.
D ém a r c a t io n , ligne de, IX. 323. a. „
DÉMARQUE, (Hift. anc.) nom du chef d’une région,
ou d’un diftriâ de la province de l’A trique. Etymologie du
mot. IV. 806. a. - •
DÉMATÉ. ( Vaiffeau) Manoeuvres à faire quand on eft
démâté. IV. 866. a. Voyez C o u p e r u n M a t .
DÉMEMBREMENT d'un fief, (Jurïfp.) Ecüchement du
fief, feloif les coutumes de Picardie 8c d’Artois. Pépié de
fief, félon celles d’Anjou, du Maine, 8c de Touraine. ©hpr
rence entre le jeu exceffif de fief 8c le démembrement. Par ^
l’ancien ufage, tout démembrement étoit prohibé. Quoique les
fiefs foient devenus depuis héréditaires, les feigneurs doroi-
nans ont confervé, autant qu’ils ont pu, les nefs de leu«
vaffaux dans leur intégralité. Motifs qui ¡prit fait défendre le
démembrement de fief dans la plupart des coutumes. Le démembrement
eft finguliérement défendu pour -les fiefc de
■ dignité. Ce que porte la coutume de Paris fiir ce fujer. G?u"
tûmes qui autorifent le démembrement du fief. Quels font
les fiefs dont le démembrement 'eft permis par ces mènies
coutumes. IV. 806. b. De quelle maniéré, il fe fait. La dévolution
au feigneur dominant de la mouvance immédiate aes
portions démembrées du fief fervant, eft un ufage tres-ancien»
Motif qui a fait admettre le démembrement dans certai
coutumes , du moins pour les fiefs Amples. Comment 1
avantageux au feigneur. Démembrement forcé 8c dém
brement volontaire"Dans les coutumes comme celle de Pans,
les co-partageans ne peuvent divifer la foi. Il n eft P
plus permis dans ces coutumes de démembrer les mouvanc«.
On ne peut dans aucune coutume démembrer, fans la p«-
D E M D E M 4S3
An roi, la juftice attachée au fief. De la peine éontre
f 1 <n>l nui a fait un démembrement, lbid. 807. a. Ce qu on
muni >“"■ */">/'/ ; Épi ‘>uel esi ¥ Éunie de Paris le permet. Traités & autres ouvrages à coo-
IV. 860. b. Démiffion de foi dans le
L démembrement. V I 697. Peine du démembfement. lbid.
Démembrement qui fe faifoit autrefois d un fief, lorfqutl
tomboîf entre plufieurs fireres. VII. 189. b. Comment on
remédia au préjudice que ces démembremens caufoient aux
%imtmbri«irnt d’une juflice. On ne peut lefaire-fansper-
miflion du roi. Celui qui a haute, moyenne & baffe juitice,
ne peut la partager , à moins que ce ne A l t n j g M B S
à laquelle le roi a attaché' le droit de juflice. DifpofitmrçSdtffé-
rentes de quelques coutumes. Auteurs a çonlnUer IV.807. .
DÉMENCE, ( Médec. ) En quoi elle dtffere.de la fatuité,
du délire & de la manie. Signes qui caraBérifent cette maladie.
IV. 807. b. La vivacité des affeélions de 1 ame répond
à la vivacité des impreffions faites fur les fibres du cerveau.
Cet exercice peut être vicié par excès , dépravation & abo-
litiqn de la dSpofition des fibres, à épr-Oliver des change-,
biens. Cette aiolition a lieu par le défaut des fibres, mêmes,
par le vice dés efprits, le petit volume de la tête, une fecouffe
violente, une maladie incurable, ou quelque: venin. Cette
maladie eft ou incurable ou très-difficile à guérir. Remedes
qu’on peut tenter. IV. 808. a. Brebis quon a vues dans une
forte de démence : état de leur cerveau. Ibid. b.
Dimnct, vâyèâFouE & Phrénhsie. Comment elle peut
être caufée par ranagination. VIII. 56a. b. Remedes indiqués
dans cette maladie. XV. ççi. u , b. ,
DÉMENCE , (JurM.) Les aftes paffés avant l .nterdiaion
des gens en démence font valables. Sur quoi fe fonde la demande
de l’interdiftion. La démence feule n’eft pas une caufe
de féparation de corps, mais elle peut donner lieu à celle
de biens. Ceux qui font en démence ne peuvent être promus
aux ordres, &c. Loix 8c auteurs à conlulter. IV. oo». t>.
Démence, curateur à la. IV. 371. a.
DÉMENTI, (Hift mod.) Il netoit pas envifagé par les
Grecs 8c les Romains du même oeil que nous l’envifageons.
¡Origine des principes différens dont nous fommes affectes fur
cet article. IV. 808. b. Par l’ordonnance de l’empereur Othon
I I , le combat judiciaire, devint le privilège de la noblefle.
L’ufage du point d’honneur du combat réduit en principes de
jurifprudence au commencement de la troifieme race. Gomment
s’établit la maxime que, quand on avoir reçu un démenti
s il falloif fe battre. Le démenti donné pour quelque
caufe que ce fût, a continué de paffer pour une offenle ian-
clante. Délicateffe toujours fubfiftante parmi nous fur cet
article du point d’honneur. Quelle en eft la vraie raifon. sentiment
deMontaigne. IV. 809. a. W W
Démenti , ( Jurifp. ) peines infligées par les I01X à cèuic
qui auront donné un démenti. IV. 809. a. Diverfes diftinc-
tions fur les perfonnes 8c les circonftances. Le démenti n elt
point exeufé pour avoir ajouté, fauf rHonneur. Ouvrages à
cônfultér. lbid b. W B . j o 1
DÉMÉRITE, voyei Mérité. Son'fiege de Rhodes. Suppl.
IYDE3METRIA , ( Hift. anc. b Myth. ) fêtes à l’honneur de
Cérès. Fêtes du même nom à l’honneur de Démétrius Folior-
DÉMÉT^ÏÙS Po l io r c è t e . Comment il fe délivra d’un
engagement téméraire qu’il avoit pris envers les Athéniens.
XUl. 444. ¿.Fêteen fon honneur.IV. 809. ^. .
D ém é tr iu s de Phalere. Son caraftere. Hiftoire de fa vie.
Ses ouvrages. XII. §1 b. Ses talens dans l’éloquence. XI.
<63. a. Obfervations fur fa vie & fa philofoplue. Xll. 372.
a. Cet athénien chargé par Ptolémée Philadelphe de lui procurer
une veriion grecque des livres facrés des Juits. a .
66. b. Belle parole de Démétrius , lorfqu’il eut appris que les
. Athéniens avoient renverfé fes ftatues. VI. 76. b.
D ém é tr iu s , roi de Syrie. Réponfe qu’il reçut des Arabes,
chez lefquels il vouloit porter la guerre. Suppl. II. 3° 4-a-
D ém é t r iu s , philofophe cynique.IV. 399.
D ém é t r iu s , (Saint) le jour de ce faint redouté par les
matelots du Levant. II. 747. a.
D ém é tr iu s , fils du czar Jean-Bazile. Sa mort. A VU.
227. a. _
SE DEMETTRE, abdiquer. Différences entre ces mots.
IV. 809 .b. * ,
DEMEURE, retardement, (Junfpr.) être en demeure de
faire quelque chofe. Conftituer ou mettre quelqu’un en
demeure. Cas où il n’eft pas befoin de mettre fon adverfaire
en demeure. En quel cas on dit qu’il y a pérd en la demeure.
IV. 809. b : Voyez D É LA I . , . . . , c v
Demeure, habitation, mai fon , féjour, domicile, ( Synon. )
VIII. y . a.
DEMEURER ,x( Marine) demeurer au nord , au fud, à
baç-bord , &c. Demeurer de l’arriere. IV. 8.10. a.
Demeurer, ( Comm.) demeurer en fouffrance. Demeurer*
enxefte, en arriéré ; demeurer garant.IV.8io.'a.
Demeurer du croire. Les commiflionnaircs doivent convènir
avec leurs commcttans, s ils demeureront du croire où non:
Effets de l’un & de l’autre.cas. .Cette exprefiiôn demeurer du
croire reçoit deux lignifications différentes, qui font ici expliquées.
IV. 810. a. •
D em eurer , ( Maneg. ) ert parlant du cheval. IV. 810. a.
D em e u r e r , (Gramm.) obfervation fur la colijugaifon de
ce verbe. XI. 121. a.
DUJEtlMVLIl.. IIVV..O 8I1O0.. bb.. ’ »
Demi-déesseS 6* d em i-d ieu x , ( Myth. ) IV. oio.btVoye^
H é r o s . s . . . . .
Demi-dieux, voye\ H éro s . Origine 8c regne des demi-dieux
fur la terre. XI. 373. b. . ;
Demi-livre , demi-quarteron , demi-once , demi-gros,
demi-aulne de Paris, demi-boiffeau de Paris, demi-lirron,
demi-queue d’Orléans, &c. dé Champagne, (jemi-muid, demi-
feprier, demi-gr®ffe, 6*c. IV. 8x0. b.
Demi-air ou demi-volte, (Maneg.) IV. 810. b.
Demi-autour, ( Fauconn.) IV. 810. b.
Demi-baftion, ( Art. milit. ) IV. 810. b.
Demi-canon d’Eipagne. IV. 811^.
Demi-canon de France , ou coulevrine. IV. 811. à.
Demi-cafe, au tri&rac. IV. 811. a. .
Demi-ceint, ( Hift. mod. ) ceinture autrefois à l’ufage dei
femmes. IV. 811. a.
Demi-ceintier , ( Art méch. ) chaînetier. IV. 81.1. a.
Demi-cercle, ( Géom. ) deux demi-cercles ne peuvent s’en-
tre-couper en plus de deux points. 1V. 8 il.«*. ‘ ,
Demi-cercle, inftrument d’aipentage. Sa deferiptioü. Différence
entre le demi-cerdle & le théodolite ou demi-bâton
d’arpenteur. Maniéré de prendre un angle avec le demi-cercle’.
lV .8 n .fr .
Demi-clé , (Marine) IV. 811. b.
Demi-diametre, ( Géom. ) lès à’ftronomes évaluent ordinairement
en demi-diametrès de la terre , les diftances , les
diamètres des corps céleftès. Moyen de connoître le demi-diametre
des planetès dans leurs rapports avec celui de la terre.
IV.811.*.
Demi-corde, (Comm.)IV. 811. é*
Demi-futaie. IV. 811. b. * ■• •
Demi-gorge, ( Fortifie. ) mëfure que doit avoir la demi-gorgé
du baftion. Demi-gorges des demi-lunes. Demi-gorges des
places d’armes des chemins-couverts. IV, 811. b.
Demi-Hollande, (Comm. ) toiles de lin, Grc. IV. 811 . b.
Demi-jeu, (Mufiq. inftrum. ) IV. 812. a>
Demi-lune , (' A'rchit. ) portion circulaire en tour creiife ,'
qu’on emploie dans la diftribution dés portes-cocheres , &c.
Àufres maniérés de l’employer. En général les plans quadran-
gulaires font préférables aux circulaires. IV. 812 .a.
Demi-lune , (Fortifie.) deferiprion de cet ouvrage. Il eft
appellé ravehn dans les anciens auteurs. Maniéré de conftrùiré
u n e demi-lune vis-à-vis une courtine.' Capitale de la denu-
lune. Utilité de cet ouvrage. IV. 812. a. Ce qu’on doit faire
pour la déferife du foffé de la demi-lune. On fait quelquefois
des flancs aux demi-lunes. Inftruélion fur la^maniçre de les
faire. Ils font condamnés par plufieurs ingénieurs. On con-
ftruit quelquefois une autre demi-lune dans la première. On
la couvre quelquefois d’une contre-garde. Comment fe con-
ftruit' le pont qui fe fait fur le foffé des demi-lunes. lbid. b.
Demi-lune. Faces delà demi-lune. VI. 336.b. Demi-gorge.
IV. 811. 1 Attaque de la demi-lune. I. 833. a , b.
Demi-lune, (Jardin.) IV. 812. b.-
Demi-métaux, (Chyrn.) leur définition & defcription. En
quoi les demi-métaux différent des métaux. IV. 812. b. On
i compté , jufqu’à préfent, cinq demi-métaux î le régue
d’antimoine , le bifmuth, le zinc , lé régule darfénjc & le
mercure. Cramer retranche ce dernier de cé nombre. Obfer-.
vation fur le rang qu’on'a donné au mercure entre les métaux
ou les demi-métaux. Nouveau demi-métal, le régule de cobADald
Jd.%m L , ( G tm .) leur <fcfciipriob.IV 813 a.
Demi-paraboles, ( Géom.) courbes amfinommées. Raifon
4 e cette dénomination. IV. 813. a •
Demi-paralleles ou places d am e s , ( Fortifie. ) ce quon
entend par-là dans l’attaqué des places. Leurs largeurs &
profondeurs. En quels cas elles fe Conftruifent. IV. 813.,*.
Demi-revêtement | ( Fortifie.'.) avantages du demi-reVête-
ment.lV.813. é. '
Demi-favans, ( Littéral. ) leur carattete. Suppl. I. 97. a.
Demirfceau, ( Hift. mod. ) celui dont on le fert a la chancellerie
d’Angleterre. Ce qui lui reffemble à-peu-prés en
France. IV. 81-3. 4.-v . I
Demi-tour à droite ou à gauche , ( Art milit. ) comment
s’exécuta le demi-tour à droite , ou quart de converfion.
Comment s’exécute le demi-tour à droite ou à gauche dune