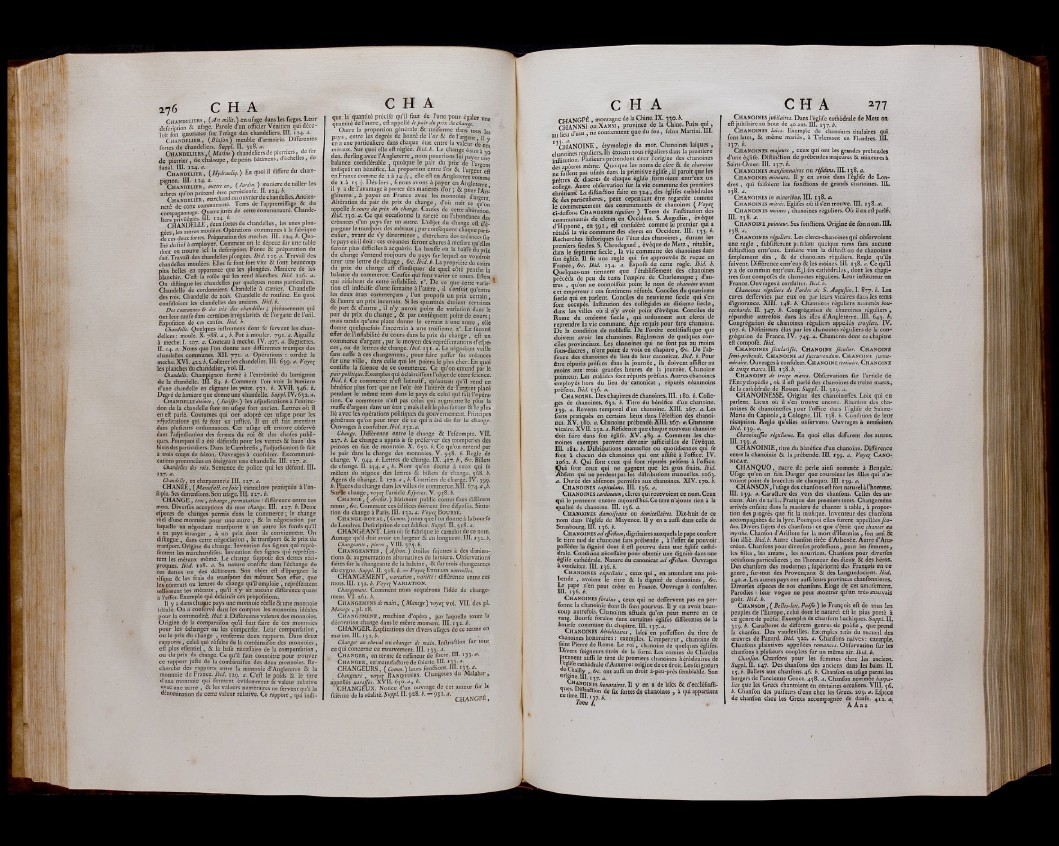
2 .7 6 CHA C h a n d e l i e r s , {Art milit.') en ufage dans les fieges. Leur
defcription & ufage. Parole d’un officier Vénitien quidéce-
loit fon ignorance, fur l’ufage des chandeliers. III. 124. a.
C h a n d e l ie r , ( B la fon) meuble d’armoirie. Différentes
fortes de chandeliers. Siippl. II. 318. a.
CHANDELIERS, ( Manne 1 chandeliers de pierriers, de ter
de pierrier, de chaloupe, ne petits bâdmens,d échelles, de
^ ’ chandelÎeb.^ ( Hydraul'uj. ) En quoi il diffère du cbam-
^‘^Chandelïer^ mtrn » , CM in . ) manière de tailler les
arbres qu’on prétend être pemicieufe. II. .
C h a n d e l ie r , marchand ou ouvrier de chandelles. Ancienneté
de cette communauté. Tems de 1 apprentiflage & du
compagnonage. Quatre jurés de cette communauté. Chande-
^CI^AND^LLE, deuxfortes de chandelles, les unes plongées
les autres moulées. Opérations communes à la fabrique
de ces deuxfortes. Préparation des meches. III. 124. 6. Qualité
du fuif à employer. Comment on le dépece fur une table
dont on trouve ici' la defcription. Fonte & préparation du
fuif. Travail des chandelles plongées. Ibid. 12 £.rf. Travail des
chandelles moulées. Elles ie font fort vite & font beaucoup
plus belles en apparence que les plongées. Maniéré de les
blanchir. C’eft la rofée oui les rend blanches. Ibid. 126. a.
On diftingue les chandelles par quelques noms particuliers.
Chandelle de cordonniers. Chandelle à carrier. Chandelle
des rois. Chandelle de noix. Chandelle de roufine. En quoi
confiftoient les chandelles des anciens. Ibid. b.
Des couronnes & des iris des chandelles ; phénomènes qui
ont leur caufe dans certaines irrégularités de l’organe de l’oéil.
Expofition de ces caufes. Ibid. b.
Chandelle. Quelques inftrumeris dont fe fervent les chandeliers:
moule. X. 788. a , b. Pot à mouler. 791 .a. Aiguille
à meche. I. 207. a. Couteau à meche. IV. 407. a. Baguettes.
II. 14. a. Noms que l’on donne aux différentes trempes des
chandelles communes. XII. 771. a. Opérations : tordre la
meche. XVI. 422.6. Colleter les chandelles. III. 639. a. Voyc{
lés planches du chandelier, vol. IL
Chandelle. Champignon formé à l’extrémité du lumignon
de la chandelle. Iü. 84. b. Comment l’on voit la lumière
d’une chandelle en clignant les yeux. «31. b. XVII. 346. b.
Degré de lumière que donne une chandelle. Suppl.TV. ôyi.a.
C h a n d e l l e éteinte, ( Jurifpr.) les adjudications à l’extinction
de la chandelle font un ufage fort ancien. Lettres où il
en eft parlé. Coutumes qui ont adopté cet ufage pour les
adjudications qui fe font en juilicé. Il en eft fait mention
dans plufieurs ordonnances. Cet ufage eft encore obfervé
dans l’adjudication des fermes du roi & des clïofes publiques.
Pourquoi il a été défendu pour les ventes & baux' des
biens des particuliers. Dans leCambrefis , l’adjudication fe fait
à trois coups de bâton. Ouvrages a confulter. Excommunications
prononcées en éteignant une Chandelle. IU. 127. a.
Chandelles des rois. Sentence de police qui les défend. Iü.
127. a.
Chandelle, en charpenterie III.127. rf.
CHANÉE, ( ManufaEl. enfoie') cànnelure pratiquée à l ’en-
fuple. Ses dimenfions. Son ufage. Hl. Î27. b.
CHANGE, troc t ¿change, permutation : différence entre ces
mots. Diverfes acceptions du mot change. III. «27. b. Deux
efpeces de changes permis dans le commerce ; le change
réel d’une monnoie pour une autre ; & la négociation par
laquelle un négociant tranfporté à un autre les fonds qu’il
a en pays étranger , a un prix dont ils conviennent. On
diftingue, dans cette négociation , le tranfport & le prix du
tranfport. Origine du change. Invention des fignes qui repré-
fentent les marchandifes. Invention des fignes qui repréfen-
tent les métaux même. Le change fuppofe des dettes réciproques.
Ibid. 128. rf. Sa nature confine dans l’échange de
Ces dettes ou des débiteurs. Son objet eft d’épargner le
rifque & les frais du tranfport des métaux. Son effet, que
les contrats ou lettres de change qu’il emploie , repréfentent
tellement les métaux , qu’il n y ait aucune différence quant
à l’effet. Exemple qui éclaircit ces propofitions.
Il y a dans chatoie pays une monnoie réelle & une monnoie
idéale. On a confetvè dans les comptes les monnoies idéales
pour la commodité. Ibid. b. Différentes valeurs des monnoies.
Origine de la comparaifon qu’il faut faire de ¿es monnoies
pour les échanger ou les cdmpenfer. Leur compenfation,
ou le prix du change , renferme deux rapports. Dans deux
rapports, celui qui réfulte de la Combinaiion des monnoies |
eft plus effentiel,. & la bafe néceffaire de la compenfation,
ou du prix du change. Ce qjÿiÎ faut connoître pour trouver
ce rapport jufte de la comoinaifon des deux monnoies. Recherche
des rapports entre là monnoie d’Angleterre & la
monnoie de France. Ibid. 129. a. C’eft le poids & le titre
dune monnoie qui forment évidemment fa valeur relative
avec une autre , & les valeurs numéraires ne fervent qu’à la
dénomination de cette valeur relative. Ce rapport, qui indi-
C H A
que la' quantité précife qu’il faut de l’une pour égaler une
quantité de l’autre, eft appellé le pair du prix du change.
Outre la proportion générale & uniforme dans tous les
pays, entre les degrés de bonté de l’or & de l’argent il y
en a une particulière dans chaque état entre la valeur dé ces
métaux. Sur quoi elle eft réglée. Ibid. b. Le change étant à 20
den. fterling avec l’Angleterre, nous pourrions lui payer une
balance confidérable , quoique le pair du prix de l’argent
indiquât un bénéfice. La proportion entre l’or & l’argent eft
en France comme de 1 à 1475, elle eft en Angleterre comme
de 1 à 15 y. Dès-lors, fi nous avons à payer en Angleterre
il y a de l’avantage à porter des matières d’or ; & pour l’Angleterre
, à payer en France avec les monnoies d’argent
Altération du pair du prix du change, d’oii naît ce <m’on
appelle le cours du prix du change. Caufes de cette altération.
Ibid. 130. rf. Ce qui occafionne la rareté ou l’abondance des*
créances.d’un pays fur un autre. L’objet du change eft d’épargner
le tranfport des métaux ; par conféquent chaque parti-
culier, avant de s’y déterminer, cherchera des créances fur
le pays où il doit : ces créances feront cheres à mefure qu’elles
feront plus difficiles à acquérir. La hauffe ou la baiffe du prix
du change s’entend toujours du pays fur lequel on voudroit
tirer une lettre de change , 6>c. Ibid. b. La propriété du cours
du prix du change eft d’indiquer de quel côté penche la
balance du commerce. Caufes qui font varier ce cours. Effets *
qui réfultent de cette inftabilitè. i°. De ce que cette varia- *
tion eft indécife d’une femaine à l’autre, il s-enfuit qu’entre
les deux états commerçans , l’un propofe un prix certain,
& l’autre un prix incertain. Si les quantités étoient certaines
de part & d’autre , il n’y auroit point de variation dans'le
pair du prix du change, & par conféquent point de cours ;
mais tandis qu’une place donne le certain à une autre , elle
donne quelquefois l’incertain à une troificmc. 20. Le fécond
effet de l’inftabilité du cours dans le prix dû change , eft un
commerce d’argent, par le moyen des repréfentations d’efpe-
ces, ou de lettres de change. Ibid. 13' 1. a. Le négociant veille
fansceffe à ces changemens, pour faire pafler fes créances
fur une ville, dans celle qui les paiera le plus cher. En quoi
confifte la fcience de ce commerce. Ce qu’on entend par le
pair politique. Exemples qui éçlairciffent l'objet de cette fcience.
Ibid. b. Ce commerce n eft lucratif, qu’autant qu’il rend un
bénéfice plus fort que ne l’eût été l’intérêt de-1 argent placé
pendant le même tems dans le pays de celui qui fait l’opération.
Ce commerce n’eft pas celui qui augmente le plus la
maffe d’argent dans uri’ état ; mais il eft le plus favant & le plus
lié avec les opérations politiques du gouvernement. Principes
généraux qu’on peut tirer de ce qui a été dit fur le change.
Ouvrages à confulter. Ibid. 13 2. a.
Change. Différence entre le change & l’efcomptc. VIL
227. b. Le change a appris à fe préferver des tromperies des
princes en fait de monnoie. X. 650. b. Ce qu’on entend par
le pair dans le change des monnoies. V. 958. b. Réglé de
change. V. 944. b. Lettres de change. IX. 417. b , &c. Billets
de change. II. 254. a , b. Nom qu’on donne à ceux qui fe
mêlent au négoce des lettres oc billets de change. 768. b.
Agens de change. I. 172. a , b. Courtiers de change. IV. 399I
b. Places du change dans les villes de commerce. XII. 674. rf, b.
Suivie change, voye^ l’article Efpeces. V. 958. 6. -
C h a n g e , {Archit. ) bâtiment public connu fous différens
noms, &c. Comment ces édifices doivent être difpofés. Situation
du change à Paris. III. 132. rf. Voyez Bourse.
C hange-r o y a l , {Comm. ) nom que l’on donne à la bourfe
de Londres. Defcription de cet édifice. Suppl. II., 318. a.
CHANGEANT. Lieu où fe fabrique le camelot de ce nom.
Aunage qu’il doit avoir en largeur oc en longueur. III. 132.6.
Changeante, pierre, VIII. 375.6.
C hangeantes , ( AJlron. ) étoiles fujettes à des diminutions
& augmentations alternatives de lumière. Obfcrvations'
faites fur la changeante de la baleine, -& fur trois changeantes
du cyene. Suppl. 11.318.6. — Voye[ Etoiles nouvelles.
CHANGEMENT, variation, variété: différence entre ces
mots. III. 132.6. Voye^ V ar ia t io n.
Changement. Comment nous acquérons l’idée de changement.
VI, 261.6..
C hangemens de main, {Manege") voye^ vol. VII. des pl.
Manege , pl. 18.
C hangement, machine d’opéra , par laquelle toute là
décoration change dans le même moment. Iü. 132. 6.
CHANGER. Explications des divers ufages de ce terme en
marine, Iü. 132.6.
Changer un cheval ou changer de main. Inftraflion fur tout
ce qui concerne ce mouvement. Iü. 133. a.
t CHANGER, en terme de raffineur de fucre. III. 133. a.
C han g e r, en'manufaéturede foierie. III. 135. a-
CHANGEURS, ( Comm. ) leurs fondons. III. 133. a.
i Changeurs , voyez B a n q u i e r s . Changeurs du Malabar,
appelles xarajfes. XvII. 650. rf, 6. . .
CHANGEUX. Notice d’un ouvrage de Cet auteur fur la
fcience de la réalité. $uppl. II. 928.6. — 932, a. q j^ G P É
CHA C H A 277
C H A N G P É , montagne de la Chine. IX. 330.6. _
CH A N N S Í ou X a n s i , province de la Chine. Puits qui,
au lieu d’eau, ne contiennent que du feu, félon Martini. III.
* 3£hÀNOINE , étymologie du mot. Chanoines laïques ,
chanoines r¿uliers.Ils étoient tous réguliers dans la première
inftitution. Plufieurs prétendent tirer l’origine des chanoines
des apôtres même. Quoique les noms de clerc & de chanoine
ne fuffent pas ufités d?ns la primitive églife , il paroît que les
prêtres & diacres de chaque églife formoient entr’eux un
collège. Autre obfervation fur la vie commune des premiers
chrétiens*. La diftinélion faite en 324, des églifes cathédrales
& des particulières, peut cependant être regardée comme
le commencement des communautés de chanoines ( Voye{
ci-deffoi« C h a n o in e s réguliers ) Tems de l’inftitution des
communautés de clercs en Occident. S. Auguftin, évêque
d’Hipponé, en 3 9 1 , eft confidéré comme le premier qui a
rétabli la vie commune des clercs en Occident. III. 133. 6.
Recherches hiftoriques fur l’état des chanoines , durant les
premiers fiedes. S. Chrodegand , évêque de Metz rétablit,
dans le feptieme fiede, la vie commune des chanoines dans
fon églife. Il fit une regle qui fut approuvée & reçue en
France, &c. Ibid. 134. a. Expofé de cette regle. Ibid. Jt.
Quelques-uns tiennent que l’établiffement des chanoines
précéda de peu de tems l’empire de Charlemagne ; d’au-
ties , qu’on ne connoiffoit point le nom de chanoine ayant
cet empereur : ces fentimens réfutés. Conciles du quatrième
fiede qui en parlent. Conciles du neuvième liede qui s’en
font occupés. Inftitution des collégiales au dixième fiede,
dans les villes où il n’y avoit point d’évêque. Conciles de
Rome du onzième fiecle , qui ordonnent aux clercs de
reprendre la vie commune. Age requis pour être chanoine.
De la condition de nobleffe. De l’ordre ecdéfiaflique que
doivent avoir les chanoines. Réglemens de quelques conciles
provinciaux. Les chanoines qui ne font pas au moins
fous-aiacres, n’ont point de voix en chapitre, &c. De l’ab-
feuce des chanoines du lieu de leur canonicat. Ibid. b. Pour
être réputés préfens dans la journée, ils doivent aflifter au
moins aux trois grandes heures de la journée. Chanoine
pointeur. Les malades font réputés préfens. Autres chanoines
employés hors du lieu du canonicat , réputés néanmoins
préfens. Ibid. 136. a.
C h a n o in e . Des chapitres de chanoines. IÜ. 180. 6. Collèges
de chanoines. 632. 6. Titre du bénéfice d’un chanoine.
139. rf. Revenu temporel d'un chanoine. XIII. 267. a. Les
forts pratiqués en certains lieux dans l’éleâion des chanoines.
XV. 380. rf. Chanoine prébendé. XIII. 267. a. Chanoine-
vicaire. XVII. 232. <1. Réfidence que chaque nouveau chanoine
doit faire dans fon églife. XV. 489. a. Comment les chanoines
exempts peuvent devenir jufticiables de l’évêque.
III. 181. 6. Diftriputions manuelles ou quotidiennes qui fe
font à chacun des chanoines qui ont aftifté à l’office. IV.
XJ962. 6. Qui font ceux qui font réputés préfens à l’office.
Qui font ceux qui ne gagnent que les gros fruits. Ibid.
Abfens qui ne perdent pas les diftributions manuelles. 1063.
rf. Durée des abfences permifes aux chanoines. XIV. 170.6.
C h a n o in e s capitulons. III. 136. a.
C h a n o in e s cardinaux, clercs qui recevoient ce nom.Ceux
qui le prennent encore aujourd’hui. Ce titre n’ajoute rien à la
qualité de chanoine. III. 136. a.
C h a n o in e s damoifeaux ou domicellaires. Dix-huit de ce
nom dans l’églife de Mayence. Il y en a auffi dans celle de
Strasbourg'. IH. 136.6.
C h a n o in e s ad ejfc&um, dignitaires auxquels le pape conféré
le titre nud de chanoine fans prébende , à l’effet de pouvoir.
pofféder la dignité dont il eft pourvu dans une .églife cathédrale.
Condition néceffaire pour obtenir une dignité dans une
églife cathédrale. Nature du canonicat ad effeilum. Ouvrages
à confulter. III. 136.6.
C h an o in e s expcElahs , ceux qui, en attendant une. prébende
, avoient le titre & la dignité de chanoines, &c.
Le pape n’en peut créer en France. Ouvrage à confulter.
III. 136.6. h
C h a n o in e s forains , ceux qui ne deffervent pas en per-
fonne la chanoiniè dont ils font pourvus. Il y en avoit beaucoup
autrefois. Chanoines àôuels qu’on peut mettre en ce
rang. Bourfe foraine dans certaines églifes différentes de la
bourfe commune du chapitre. III. 13 7. rf.
C h a n o in e s héréditaires, laïcs en poffeffion du titre de
chanoines honoraires : exemples. L’empereur, chanoine de
feint Pierre de Rome. Le roi, chanoine de quelques églifes.
Divers feigneurs titrés de la forte. Les comtes de Chatelus
f,¿e"nent auff‘ fe titre de premiers chanoines héréditaires de
I egUfe cathédrale d’Auxerre : origine de ce droit. Les feigneurs
oe Chailly ,,6'c. Ont aiiffi un droit à-peu-près fcmblable. Son
©ugine.lll. 137.«.
^©ïnes honoraires. Il y en a de laies & d’eccléfiafti-
ques. Diftinfrion de fix fortes de chanoines , à qui appartient
ce titre. III. 137, ¿
Tome I, ’ s-
C h a n o in e s jubilaires. Dans l’églife cathédrale de Metz on
eft jubilaire au bout de 40 ans. III. 137. 6.
C h a n o in e s laïcs. Exemple de chanoines titulaires qui
font laïcs, & même mariés, à Tirlemont en Flandres. ÎIL
* j l b-
C h a n o in e s majeurs , ceux qui ont les grandes prebendes
d’une églife. Diftinilion de prébendes majeures & mineures à
Saint-Omen III. 137.6.
C h a n o in e s manfionnaires ou r{fidens. IÜ. 138. a.
C h a n o in e s mineurs. Il y en avoit dans l’églife de Londres
, qui faifoient les fondions de grands chanoines. 11L
138. rf.
C h a n o in e s in minoribus. III. 138. a.
C h a n o in e s mitrés. Eglifes où il s’en trouve. Iü. 138. a.
C h a n o in e s moines, chanoines réguliers. Où il en eft parlé.'
m . 138. rf.
C h a n o in e pointeur. Ses fondions. Origine de fon nom. IIL }&a- , '
C h a n o in e s réguliers. Les dercs-chanoines qui obfervoient
une réglé , fubfiitcrent pendant quelque tems fans aucune
diftindton entr’eux. Enluite vint la diftind'.on de chanoines
Amplement dits , & de chanoines réguliers. Réglé qu’ils
fuivent. Différence entr’eux & les moines. 111. 138. a. Ce qu’il
y a de commun entr’eux. Égides cathédrales, dont les chapitres
font compofés de chanoines réguliers. Leur inftituteur en
France. Ouvrages à confulter. Ibid. b.
Chanoines réguliers de l’ordre de S. Auguftin. I. 877. 6. Les
cures deffervies par eux ou par leurs vicaires dans les tems
d’ignorance. XIIL 148. 6. Chanoines réguliers nommés 60«-
cachards. II. 347. 6. Congrégation de chanoines réguliers ,
répandue autrefois dans les ifles d’Angleterre. III. 643. 6.
Congrégation de chanoines réguliers appelles croifiers. IV.
507. b. Définiteurs élus par les chanoines réguliers de la congrégation
de France. IV. 745. a. Chambres dont ce chapitre
eft compofé. Ibid.
C h a n o in e s fécularijes. C h a n o in e fécülier. C h a n o in e
femi-prébendé. C h a n o in e adfuccunendum. C h a n o in e Jumu-
méraire. Ouvrages à confulter. CHANOINE tertiaire. C h a n o in e
de treize marcs. III. 138.6.
CHANOINE de treize marcs. Obfervations fur l’article de
l’Encyclopédie, où il eft parlé des chanoines de treize marcs,
delà cathédrale de Rouen. Suppl. II. 319. a.
CHANOINESSE. Origine des chanoineffes. Loix qui en
parlent. Lieux où il s’en trouve encore. Réunion des chanoines
& chanoineft'cs pour l’office dans lYglife de Sainte-
Marie du Capitole, à Cologne. IIL 138. 6. Condition de leur
réception. Réglé qu’elles obfervent. Ouvrages à confulter.
Ibid, 139. rf,
Chanoineffes régulières. En quoi elles différent des autres.
III. 139. rf.
CHANOINIE , titre du bénéfice d’un chanoine. Différence
entre la chanoiniè & la prébende. Iü. X39. a. Voye[ C a n o -
NICAT.
CHANQUO, nacre de perle ainfi nommée à Bengale.'
Ufage qu’on en fait. Danger que couroient les filles qui n’a-,
voient point de bracelets de chanquo. III 139. a.
CHANSON, l’ufagè des chanfons eft fort naturel à l’homme.'
III. 139. rf. Carafrore des vers des chanfons. Celles des anciens.'
Airs de table. Pratique des premiers tems. Changemens
arrivés enfuite dans la maniéré de chanter à table » à proportion
des progrès que fit la mufiqüe. Inventeur des chanfons
accompagnées de la lyre. Pourquoi elles furent appellèes feo»
lies. Divers fujets des chanfons : ce que c’étoit que chanter au
myrthe. Chanfon d’Ariftote fur la mort d’Hermias, fon ami &
fon allié. Ibid. b. Autre chanfon tirée d’Athenée. Autre d’Ana*
créon. Chanfons pour diverfes.profeffions, pour les femmes,
les filles, les amans, les nourrices. Chanfons pour diverfes
occafions particulières ; en l’honneur des dieux & des héros.
Des chanfons des modernes ; fupériorité des François en ce
genre, fur-tout des Provençaux & des Languedociens. Ibid.
140. rf. Les autres pays ont auffi leursprovinces chanfonnieres.
Diverfes efpeces de nos chanfons. Eloge de cet amufemenr.
Parodies : leur vogue ne peut montrer qu’un très-mauvais
goût. Ibid. b.
C h a n s o n , ( Belles-lett. Poéfte) le François eft de tous les
peuples de l’Europe, celui dont le naturel eft le plus porté à
ce genre de poéfie. Exemples de chanfons bachiques. Suppl. n .
3:9.6. Carafteres de différens genres de poéfie, que prend
la chanfon. Des vaudevilles. Exemples tirés du recueil des
oeuvres de Panard. Ibid. 320. a. Chanfons naïves': exemple.
Chanfons plaintives appellèes romances. Obfervation fur les
chanfons à plufieurs couplets fur un même air. Ibid. b.
Chanfon. Chanfons pour les femmes chez les anciens.
Suppl. II. 147. Des chanfons des anciens dans les bains. II.
15.6. Ballets aux chanfons. 46. 6. Chanfon enufàge parmi les
bergers de l’ancienne Grece. 458. a. Chanfon nommée harpa-
lice que les Grecs chantoient en certaines occafions. VIII. 56.
6. Chanfon des puifeurs d’eau chez les Grecs. 209. a. Efpece
1 de chanfon chez les Grecs accompagnée de danfe. 412, a,
A A a a