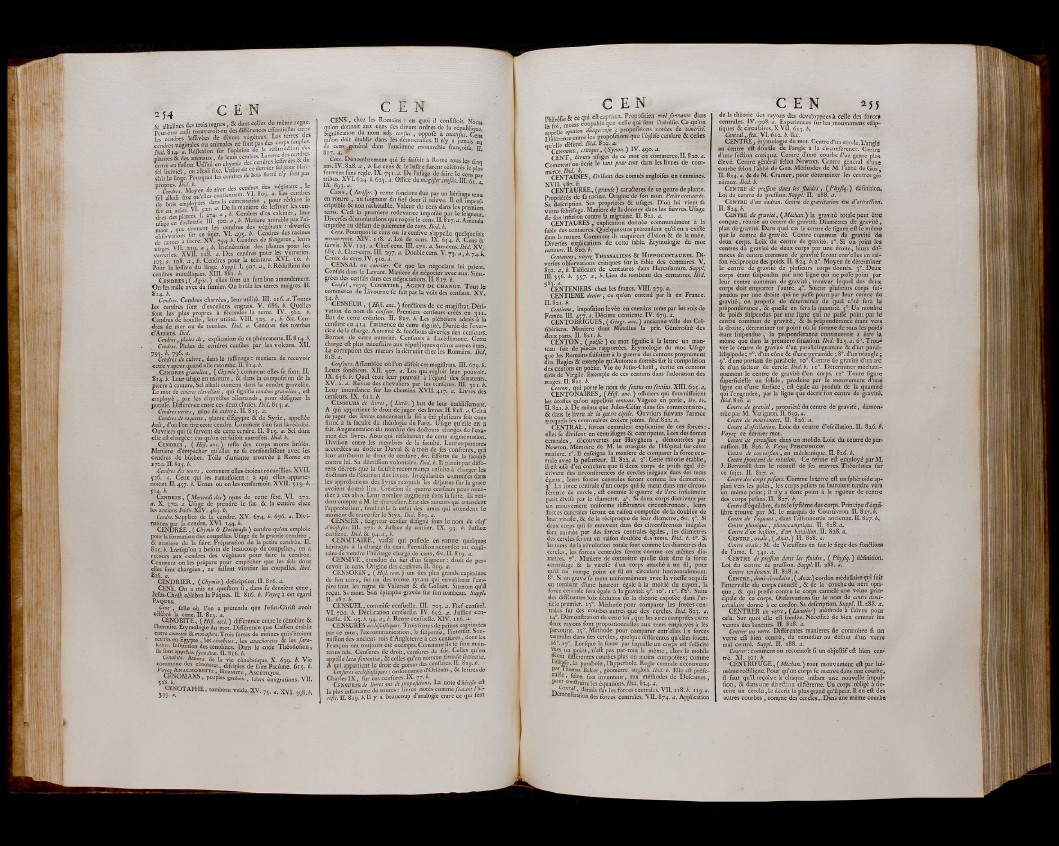
2 j4 C E N
& alkalines t e trois régnés, & dans celles du même regtle.
Peut-être auOE trouveroiton des dlfFèrences effennelles entre
les cendres lèfllvêes de divers végétaux. Les terres des
vendres végétales ou animales ne font pas des corps unp es.
Jtii. 8x4. a. Réflexion fur l’opinion de a
plantes & des animaux, de leu rs cendres. La 1 _ & (]u
entre en iùfion.Utilité en chimie des c ... M ¡jlan-
fel lixiviel, ou alkali fixe. § §M
chir le linge. Pourquoi les cendres de bots flotte n y tout pas
PI0S " Moyen de tirer d« «ndres des veg au x le
fol alkali f a f l J Î fX X ? r e n . I L ? p ô u r ^ r é d t S e le
de bois employ ^ la maniere de leffiver les cen-
j ' en xcie-. -jü ^ S b Cendres d’os calcinés , leur
Îfage en Lcimalie. lII. ,oo. a , b. Matière attirable par l’aimant
q u e 'donnent les cendres des végétaux : diverfes
Sîvd tions fur ce Met. VI. 495-1 Cendres des meutes
de cannes à fucre. XV. 794. b. Cendres de fougeres , leurs
vfages. VII. 219. a , *. Incinération des plantes pour les
verreries, XVIl. 128. *. Des cendres pour les verreries.
103.«; 108. a t b. Cendres pour la teinture. XVI. 10. b.
Pour la leffive du lii^e. Suppl. L 997. a , b. Réduction des
■cendres métalliques. XIII. 881, b. ,
C endres ; ( Agric.) elles font un fort bon amendement.
On les mêle avec du fumier. On brûle les terres maigres. II.
814. b. %
¿iWw/Cendres charrées, leur utilité. III. 210. a. Toutes
les cendres font d’excellens engrais. V. 686. b. Quelles
. font les plus propres à féconder la terre. IV. 562. b.
Cendres de houille, leur utilité. VIII. 323. a , b. & c. Cendres
de mer bu de tourbes. Ibid. a. Cendres des tourbes
.d’Amiens. Ibid.
Cendres y pluies de, explication de ce phénomène. II. 814. b.
Cendres. Pluies de cendres caufées par les volcans. XII.
795. b, 796. a.
Cendres de cuivre, dans le raffinage : maniere de recevoir
cette vapeur quand elle retombe. II. 814. b.
C endres gravelées, ( Chymie) .comment elles fe font. II.
814. b. Leur ufage en teinture, & dans la compofition de la
Eierre a cautere. Sel alkali contenu dans la cendre gravelée.
e mot de cineres clavellati, qui fignifie cendres gravelées, eft
employé , par les chymiftes allemands, pour défigner la
potafle. Différence entre ces deux chofes. Ibid. 815.4.
Cendres vertes, mine de cuivre. IL 815. a.
Cendres de roquette , plante d’Égypte & de Syrie,, appellée
kali.y d’où l’on tire cette cendre. Comment s’en fait la récolte.
Ouvriers qui fe fervent de cette cendre. II. 815. a. Sel dont
elle eft chargée : cas qu’on en faifoit autrefois. Ibid. b.
C endres , ( Hifi. une. ) refte des corps morts brûlés.
Maniere d’empêcher qu’elles ne fe confondirent avec les
cendres de bûcher. Toile d’amiante trouvée à Rome en
z 702. IL 815. b.
Cendres des morts, comment elles étoient recueillies. XVII.
526. 4, Ceux qui les ramaffoient : à qui elles -apparte-
noient. IT. 457. b. Urnes où on les renfermoit. XVII. 513.*.
514- h :
Cendres, (Mercredides) tems de cette fête. VI. 272.
a. X. 370. a. Ufage de prendre le fac & la cendre chez
les anciens Juifs. XÎV. 469. b.
Cendre. Supplice de la cendre. XV. 674. b. 676, a. Divinations
par la cendre. XVI. 144. b.
CENDRÉE, ( Chymie & Docimafie ) cendre qu’on emploie
pour la formation des coupelles. Ufage de la grande cendrée ,
& maniere de la faire. Préparation de la petite cendrée. II.
S15. A. Lorfqu’on a befoin de beaucoup de coupelles, on a
recours aux cendres des végétaux pour faire la cendrée.
Comment on les prépare pour empêcher que les fels dont
elles font chargées, ne faffent vitrifier les coupelles. Ibid.
816. a.
CENDRIER, ( Chymie) defeription. II. 816. a.
CENE. On a mis en queftion f i , dans fa derniere cene,
Jefus-Chrift célébra la Pâques. II. 816. b. Voye^k cet égard
Pâques.
Cene , falle où l’on a prétendu que Jefus-Chrift avoit
célébré la cene. IL 813. a.
CÉNOBITE, ( Hift. eccl. ) différence entre le cénobite &.
l’hermite. Étymologie du mot. Différence que Caffien établit
entre couvent & monaflere. T rois fortes de moines quis’étoient
retirés en Égypte , les cénobites, les anachorètes OC les. fara-
battes. lnftitution des cénobites. Dans le code Théodofien,
ils font appelles fynoditat. II. 816. b.
Cenobite. Auteur de la vie . cénobitique. X. 639. I Vie
eommuae des cénobites, difciples de fa'rnt Pacôme. 615. b.
’ S » « » , A scétique. ’
S A t ’ Pe'lp 6™Ws ’ ¡ ¡ ¡ l Émigrations. VIL
399E? OTAPHE ' ,0mbMU ™ de-XV’ 7V I 39?**-
CEN CENS, chez les Romains : en quoi il confiftoit. Noms
qu’on donnoit aux cens des divers ordres de la république.
Signification du nom adj. cen fus , oppofé à incenfus. Cens
quon doit établir dans les démocraties. Il n’y a jamais eu
de cens-général dans l’ancienne monarchie françoife. II
817. a.fW
Cens. Dénombrement qui fe faifoit à Rome tous les ci no
ans. IV. 828. a , b: Le cens & le luftre furent célébrés le plus
fouvent fans regle. IX. 751. a. De l’ufage de faire le cens par
tribus. XVI. 624. b. 625. a. Office du magifler ccnfûs.lH. 61 a
IX. 893. a.
C ens , ( Jurifpr. ) rente foncière due par un héritage tenu
en roture , au feigneur du fief dont il releve. Il eft imprescriptible
& non ràchétàble. Valeur du cens dans les premiers
tems. C’eft la première redevance impoféè par le feigneur.
Diverfes dénominations que reçoit le cens. H. 817. a. Amende
impofée au défaut de paiement de cens.,Ibid. b.
Cens. Pourquoi le cens ou la cenfive s’appelle quelquefois
menüe-rente. XIV. 118. a. Loi de cens. IX. 654. b. Cens &
fervis. XV. 123. a. Chef-cens. III. 27t. a. Sur-cens .Ibid. XV.
685. b. Cher-cens. III. 297. a. Double cens. V. 73.4 , b. 74.*.
Croix de cens. IV. 510.4.
CENSAL ou courtier. Ce que les négocians lui paient.
Cenfals dans le Levant. Maniere de négocier avec eux. Simagrées
des cenfals dans ces négociations. U. 817. b.
Cenfal, voyer COURTIER , AGENT DE CHANGE. Tout le
commerce de Livourne fe fait par la voix des cenfaux. XV.
34. b.
CENSEUR , ( Hiß. anc. ) fondions de ce magiftrat. Dérivation
du nom de cenfeur. Premiers cenfeurs créés en 311.
But de cette création. II. 817. b. Les plébéiens admis à la
cenfure en 414. Eminence de cette dignité. Durée de l’exercice
de la charge. Autorité & fondions diverfes des cenfeurs.
Bornes de cette autorité. Cenfeurs à Lacédéinone. Cette
charge eft plus néceffaire aux républiques qu’aux autres états.
La corruption des moeurs la détruifit chez les Romains. Ibid,
818.4.
Cenfeurs. Affemblée où l’on élifoiteesmagiftrats. III. 679. b.
Leurs fondions. XII. 907. a. Loi qui régloit leur pouvoir.
IX. 656. b. Quel étoit leur pouvoir à l’égard des fénateurs.
XV. 2. 4. Revue des chevaliers par les cenfeurs. III. 31 i.b.
Leur intendance fur les chemins. XVII. 417. 4. Livres des
cenfeurs. IX. 611. b.
C en seu rs de livres, (Littér.) but de leur établiffemenr.
A qui appartient le droit de juger des livres. II. 818. 4. Celui
déjuger des livres concernant la foi a été plufieurs fois confirmé
à la faculté de théologie de Paris. Ufage qu’elle en a
fait. Augmentation du nombre des dodeurs chargés de l’examen
des livres. Abus qui réiulterent dé cette augmentation.
Divifion entre les membres de la faculté. Lettres-patentes
accordées au dodeur Duval & à trois de fés confrères, qui
leur attribuent le droit de cenfure, &c. Efforts de la faculté
contre lui. Sa démifiion volontaire. Ibid. b. Il paroît par diffé-
rens décrets que la faculté recommença enfuite à charger les
dodeurs de l’examen des livres. Irrégularités commifes dans
les approbations des livres auxquels les difputes fur la grâce
avoient donné lieu. Création de quatre cenfeurs pour remédier
à ces abus. Leur nombre augmenté dans la fuite. Ils rendent
compte à M. le chancelier. Etat des auteurs qui attendent
l’approbation, femblable à celui des ames qui attendent le
moment de traverfer le Styx. Ibid. 819.a.
CENS1ER, feigneur cenfier défigné fous le nom de chef
d'hbßifes.'- III. 271. b. Juftice dp cenfier. IX. 93. b. Juftice
ceniiere. Ibid. 8c 94.4 , b.
CENSITAIRE, vaffal quijpoffede en roture quelques
héritages à la charge du cens. Permiffion accordée au cenfi-
taire de vendre l’héritage chargé de cens, &c. II. 819. a.
CENSIVE, étendue du fief d’un feigneur : droit de percevoir
le cens. Origine des cenfives. II. 819. 4.
CENSORIN, {Hiß. rom.) un des plus grands capitaines
de fon tems, fut un des trente tyrans qui envahirent l’empire
fous les regne de Valerien & de Gallien. Surnom qu’il
reçut. Sa mort. Son épitaphe gravée fur fon tombeau. Suppl.
II. 287. b.
CENSUEL, commife cenfuelle. III. 703.4. Fief cenfuel.
VI. 7Ö0. b. Déclaration cenfuelle. IV. 692. a. Juftice cenfuelle.
IX. 93. b. 94. ayb. Rente cenfuelle. X IV. 116. a.
CENSURES eccléfiafiiques. Trois fortes de peines exprimées
par ce mot; l’excommunication, la fufpenfe, l’interdit. Sou-
miffion des anciens rois d’Angleterre à ces cenfures, dont les
François ont toujours été exempts. Comment ils fe font maintenus
tels. Cenfures de droit, cenfures de fait. Celles quon
appelle lata fententiee , & celles qu*on nomme ferenda: fintentia.
A qui appartient lé droit de porter des cenfures. 11. 819. b.
Cenfures ecclefiafiiques : ordonnance d’Orléans, & lettres de
Charles IX , fur ces cenfures.IX. 77. b.
C ensures de livres OU de propofittons. La note aherefie elt
h plus infamante de toutes : livres notés comme ¡/celant tkhg.
réfie. n. 8x9. é.U y a beaucoup d analogie entre ce qui lent
CEN CEN miïvite & ce oui eft captieux. Propolition mal fonçante fans
fl. foi moins coupable que celle qui fent l'Iiéréfie. Ce qu on
aDDclle opinion dangtreuf. ; proposions notées de tcmfmc.
Tmférenceentre les propofitions que 1 égltfe cenfure 8c celles
qu’elle défend. Ibid. 8ao a.
C e n s u r e , cmrfue, (Synon. ) IV. 490. a.
CENT ¿ v e r s ufages de ce mot en commerce. II. 826.4.
Commen/’on écrit le tant pour cent dans les livres de commerce.
Ibid. b.
CENTAINES, divifion des comtés angloîfes en centaines.
XVII. 587. E
CENTAURÉE, (grande ) carafteres de ce genre de plante.
Propriétés de fa racine. Origine de fon nom. Petite centaurée.
Sa defeription. Ses propriétés & ufages. D’où lui vient fa
vertu fébrifuge. Manière de la donner dans les fievres. Ufage
de fon infùfion contre la migraine. II. 821. a.
CENTAURES, explication donnée communément à la
fable dés centaures. Quelques-uns prétendent qu’il en a exifté
dans la nature. Comment ils naquirent d’Ixion & de la nuée.
Diverfes explications de cette fable. Etymologie du mot
centaure. II. 820. b.
Centaures y voyeç T hessaliens & Hippocentaures. Diverfes
obfcrvations critiques fur la fàble des centaures. V»
892. 4, b. Tableaux de centaures dans Herculanum. Suppl.
IU. 356. b. 357. a, ¿.Lieu du tombeau des centaures. Ibid.
983.4.
CENTENIERS chez les francs. VUI. 279. a.
CENTIEME denier, ce qu’on entend par là en France.
11.821.*.
Centième, impofition levée en certains tems par les rois de
France. III. 457.4. Décime centième. IV. 679. a.
CENTOBRIGUES, (Géogr. anc.) ancienne ville des Cel-
fibériens. Maniere dont Métellus la prit. Générofité des
•deux parts. II. 821. b.
CENTON, ( poéfie ) ce mot fignifie à la lettre un manteau
fait de pièces rapportées. Etymologie du mot. Ufage
que les Romains faifoient à la guerre des centons proprement
dits. Réglés & exemple qu’Aufone a donnés fur la compofition
des centons en poéfie. vie de Jéfns-Chrift, écrite en centons
tirés de Virgile. Exemple , de ces centons dans l’adoration des
mages. II. 821. b.
Centon, qui porte le nom de fextus ou fextius. XIII. 625. a,
CENTONAIRES, {Hfifi. anc. ) officiers qui foumiffoient
les étoffes qu’on appelloit centons. Végece en parle, liv. iv.
II. 821. b. De même que Jules-Céfar dans fes commentaires,
& dans le livre de la guerre civile. Ouvriers fuivans l’armée
auxquels les centonaires étoient joints. Ibid. 822. a.
CENTRAL, forces centrales: explication de ces forces:.
elles fe divifent en centrifuges & centripètes. Loix des forces
centrales, découvertes par Huyghens , démontrées par
Newton. Mémoire de M. le marquis de l’Hôpital fur cette
matière. i°. Il enfeigne la maniere de comparer la force centrale
avec la pefanteur. II. 822.4. 20.Cette théorie établie,
il eft aifé d’en conclure que fi deux corps de poids égal décrivent
des circonférences de cercles inégaux dans des tems
égaux, leurs forces centrales feront comme les diamètres.
3°. La force centrale d’un corps qui fe meut dans une circonférence
de Cercle, eft comme le quarré de l’arc infiniment
petit divifé par le diametre. 40. Si deux corps décrivent par
un mouvement uniforme différentes circonférences, leurs
forces centrales feront en raifon compofée de la doublée de
leur viteffe, & de la réciproque de leur diametre, bc. 50. Si
deux corps qui fe meuvent dans des circonférences inégales
font animés par des forces centrales • égales, les diamètres
des cercles feront en raifon doublée dus tems. Ibid. b. 6°. Si
les tems de la révolution totale font comme les diamètres des
cercles, les forces'centrales feront comme ces mêmes diamètres.
70. Maniere de connoître quelle doit être la force
centrifuge & la viteffe d’un corps attaché à un fil, pour
qu’il ne rompe point ce fil en circulant horizontalement.
'8°. Si un grave fe meut uniformément avec la viteffe acquife
en tombant d’une hauteur égale à la moitié du rayon, la
force centrale fera égale à la gravité. 90. io°. x x°. f i ”. Suite
des différentes loix déduites de la théorie expofée dans l’article
premier. 13°. Méthode pour comparer les forces centrales
fur des courbes autres que des cercles. Ibid. 823. a.
140. Démonftration de cette lo i, que les aires comprifes entre
deux rayons font proportionnelles aux tems employés à les
parcourir. 150. Méthode pour comparer entr’elles les forces
centrales dans des cercles, quelque différentes qu’elles foient.
l6°-17°. Lorfque la force par laquelle-un corps eft follicité
vers un point, n’eft pas par-tout la même , alors le mobile
décrit différentes courbes plus ou moins compofées; comme
£Îe > la parabole, l’hyperbole. Réglé centrale découverte
Baker, géometre anglois. Ibid. b. Elle eft préfé-
*c » félon fon inventeur, aux méthodes de Defcartes
pour conftruire les équations. Ibid. 824. 4.
T \ A trn * l É l l l fur les forces centrales. VII. 118. b. 119.4.
m°nftration des forces centrales. VII. 874. à. Application
de la tliéorié des rayons des développées à célle des force*
centrales. IV, 908. 4. Expériences fur les mouvemens elliptiques
& circulaires. X VII, 613. b.
Central y feu.. VI. 612. b. &c.
CENTRE, étymologie du mot. Centre d’un cercle.L’angld
au centre eft double de l’angle à la circonférence. Gentre
d’une feélion conique, Centre d’une courbe d’un genre plus
élevé. Centre général félon Newton. Centre général d’une
courbe félon l’abbé de Gua. Méthodes de M. l’abbé de Gua,
II. 824.4.8c de M. Cramer, pour déterminer les centres gé?-
néraux. Ibid. b.
C entre de prejfion dans les fluides > ( Phyfiq. ) définition*
Loi du centre de preflion. Suppl. II. 288. a.
C entre d’un cadran. Centre de gravitation ou d’attraélion»
11.824.*.
C e n t r e de gravité y ( Méchan.) la gravité totale peut être
conçue, réunie au centre de grayité. Diamètres de gravité,
plan de gravité. Dans quel cas le centre de figure eft le même
que le centré de gravité. Centre commun de gravité 'de
deux corps. Loix du centre de gravité. i°. Si on joint les
centres dé gravité de deux corps par une droite, leurs dif*
tances du centre commun de gravité feront entr’elles en raifon
réciproque des poids. II. 824. *. 20. Moyen de déterminer
le centre de gravité de plufieurs corps donnés. 30. Deux
corps étant fufpendus par une ligne qui ne paffe point par
leur centre commun de gravité, trouver lequel des deux
corps doit emporter l’amie. 40. Soient plufieurs corps fufpendus
par une droite qui ne paffe point par leur centre de
gravité, on prôpofe de déterminer de quel côté" fera la’
prépondérance, & quelle en fera la quantité. 5 °. Un nombre
de poids fufpendus par une ligne qui ne paffe point par lé
centre commun de gravité, & la prépondérance étant vers
la droite, déterminer un point où la fomme de tous les poids
étant fufpéndue, la prépondérance continuerait à être la
même que dans la première fituation. Ibid. 825. 4. 6°. Trou«
ver le centre de gravité d’un parallélogramme & d’un parai-;
lélipipede; 70. d’uncône & d’une pyramide ; 8°. d’un'trianglej
90. d une portion de parabole. io°. Centre de gravité d’un arc
- & d’un feiteur de cercle. Ibid. b. 1 x°. Déterminer méchaniÎuement
le centre de gravité d’un corps. 120. Toute figure
uperficielle ou folide, produite par le mouvement d’unë
ligne ou d’une furface, eft égale au produit de la quantité
qui l’engendre, par la ligne que décrit fon centre de gravité:
Ibid. 826.4.
Centre de gravité, propriété du centre de gravité, démontrée
par M. Varignon. II. 830. a.
■ Centre de mouvement. II. 826. a.
Centre dofcillation. Loix du centre d’ofcillafion. H. 826. B,
Voye^ ce dernier mot. .
Centre de percujfion dans un mobile. Loix du centre de per-
cuifion. Iï. 826. *. Voye[ Percussion.
Centre de converfion, en méchanique. II. 826. *.
Centre fipontané de rotation. Ce terme eft employé par M.
J. Bernoulli dans le recueil de fes oeuvres. Théorèmes fur
ce fujet. II. 827. 4.
Centre des corps pefans. Comme la terre eft un fphéroïde ap-
plati vers les pôles, les corps pefans ne fauroient tendre vers
un même point; il n’y a donc point à la rigueur de centre
des corps pefans. II. 827. *.
Centre d’équilibre, danslefyftême des corps. Principe d’équilibre
trouvé par M. le marquis de Courtivron. II. 827.*.
Centre de Vequant, dans l’aftrônomie ancienne. II. 827. *.
Centre phonique , phonocamptique. II. 828. a.
Centre d'un baftion, d’un bataillon. IL 828. a.
CENTRE, ovale, ( Anat.) II. 828. a.
Centre ovale: M. de Vieuffens en fait le fiege des- fondions
de l’ame. I. 341. a.
C e n t r e de preflion dans les fluides , ( Phyfiq. ) définition.'
Loi du centre de preflion. Suppl. I I. 288. 4.
Centre tcndineux.il. 828.4.
C entre , demi-circulaire, (Anati) cordon médullaire qui fuit
l’intervalie du corps cannelé, & de la couche du' nerf optique
, & qui preffe contre le corps cannelé une veine principale
de ce corps. Obfervations fur le nom de centre demi-
circulaire donné à ce cordon. Sa defeription. Suppl. II. 288. a.
CENTRER un verre, ( Lunetier) méthode à fuivre pour
cela. Sur quoi elle eft fondée. Néceflhé de bien centrer lés
verres des lunettes. II. 828. a.
Ceritrer un verre. Différentes maniérés de connoître fi un
verre eft bien centré, de remédier au défaut d’un verre
mal centré. Suppl. II. 288. a.
Centrer : comment on reconnoît fi un obje&if eft bien centré.
XI. ioi. *.
CENTRIFUGE, (Méchan.) tout mouvement eft par lui-
même re&iligne. Pour qu’un corps fe meuve dans une courbe,
il faut qu’il reçoive à chaque inftant une. nouvelle impul-
fion, & dans une dire&ion différente. Un corps obligé à de-
Icrire un cercle, le décrit le plus grand qu’il peut. Il en eft des
autres courbés , connue des cercles... Dans une même courbe