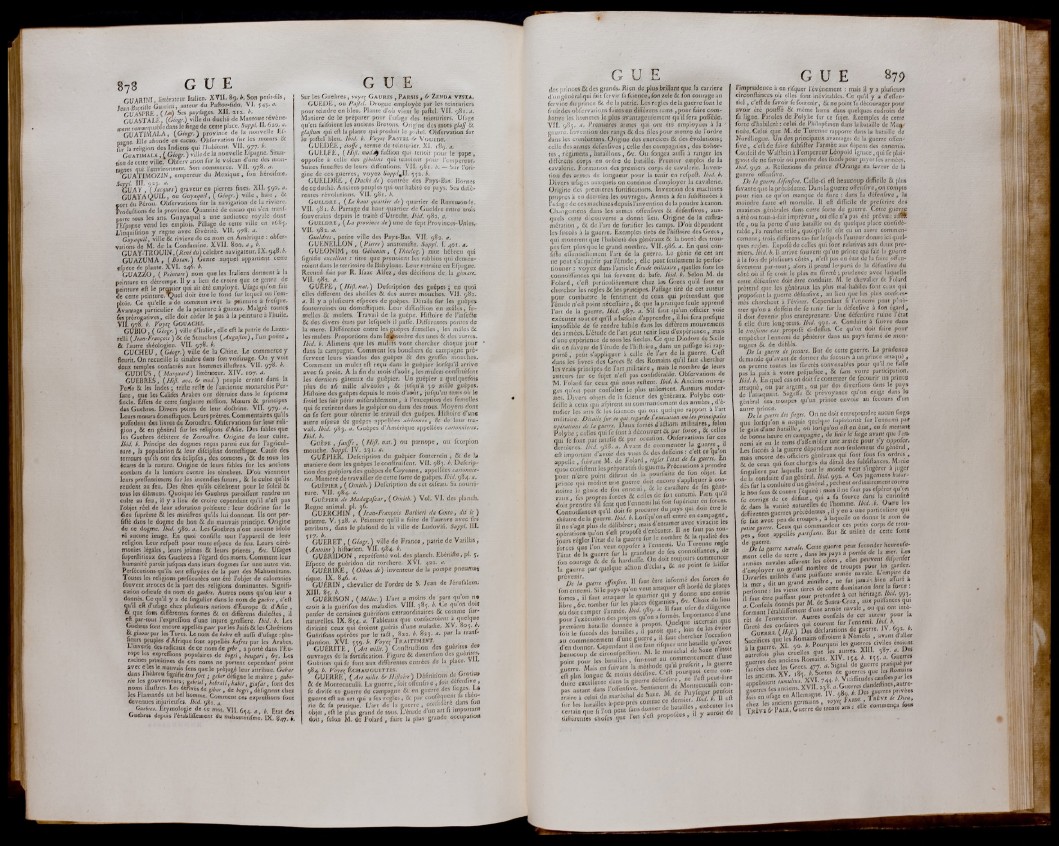
8 7 8 GUE GtfARINl« littérateur Italien. X V I I . 89, h. Son petit-fil*,
Ouarioi, auteur du PaAor-fido. V I . 5 4 3 -
G I/ a S pR E , ( />) Ses payfage*. X II. a i a. b.
C l/A S T A L C , (Géogr.) ville du duché de Mantoue é v é n e ment
remarquable dan* le fiege de cette place. Suppl. 11 6 a a //.
G U A T IM A L A , (Géogr.) province de la nouvelle Ll-
oazne. Elle abonde en cacao, Ohlervation (\tr le* niomirs oc
«.k ja religion de* Indien* qui l'habitent. V il, 977, é,
G u a t im a la , f Géogr. ) ville de la nouvelle Efpagnc. Situation
de cette ville. Obforv ation fur le volcan dI une des montagnes
qui renvironnenr. Son commerce. V I I . 970. a.
G U A 1 ÏM O Z IN , empereur du M e x iq u e , fon béroilmc.
Suppl. HT. 9 *3 ' . . e v î t - A
G U A Y , ( Jacques) graveur en pierre* fine*. A i l , «>90. a.
G U A Y A ( ¿ V I L , ou Guyaquil, ( Géogr. ) v ille , baie , 6c
port du Pérou. Obfervation* fur la navigation de la rivicre.
Produûion* de la province. Quantité de cacao qui s’en trunf-
porte tou* le* an*. Guayaquil a une audience royale dont
i’Efpagnc vend le* emploi*. Pillage de cette ville en 16©3.
L'inuuifition y règne avec févérité. V i l . 978. a.
Guyaquil. ville 6c rivière de ce nom en Amérique : obfer-
vations de M. de la Condaminc, X V I I . 800. a , b.
G U A Y -T R O U IN , {/Uni du) célébré navigateur. IX. 9 4 A
G U A Z U M A , LBotan.) Genre auquel appartieqt cette
efpece de plante. X V I . i/ fi. b.
G Ü A Z Z O , ( Peinture) nom que le» Italien* donnent a la
peinture en détrempe. 11 y a lieu de croire que ce genre de
peinture eA le premier qui ait été employé, l/fage uu on lait
de cette pc in tu rc .^ u el doit être le fond fur lequel on I emploie.
C e qu'elle a de commun avec la peinture ê frelque.
Avantage particulier de la peinture à guawo. Malgré toutes
fe» prérogatives, elle doit céder le pa* â la peinture à Inuile,
V IL o Æ b . Voye[ G o VACHE. #
G U B IO , ( G/ocr, ) ville d’Italie, e lle e il la patrie de Lazza-
relli ( Jean-François) & de Stcuclms (Augu flin), l'un poète ,
6c l’autre théologien. V II. 978. b.
G U CH E U , (Géogr.) ville de la Chine. Le commerce y
fleurit. On recueille le cinabre dan* fon voifinage. On y voit
deux temple* confacré* aux homme* ilhiAres. VU, 978. b.
G U D lü S , ( Marquard) littérateur. X IV . 107.
G UEBRES, ( / / ÿ . anc. fr mod, ) peuple errant dan* la
Pcrfe 6c le* Inde* ; trille relie de l’ancienne monarchie Périme
, que les Calife* Arabes ont détruite dan* le fojitieme
fiecle. M e ts de cette fanglante million. Mqeur* 6c principes
des Guebre*. Divers point* de leur doârine. V i f . 979'
Leurs moeurs domefliques. Leurs prêtre*. Commentaire* qu’il*
poffedent des livre* de Zoroallre. Obfervation* fur leur religion
, 6c en général fur les religions d’Afie. Des fable* Que
tes Guebres débitent de Zoroallre. Origine de leur culte.
Ibid. b. Principe des dogmes reçus parmi eux fur l’agriculture
, la population 6c leur difciplinc domcAique. Caufe de*
terreurs qu ils ont des éclipfe*, des cometes, 6c de tou* le*
écart* de la nature. Origine de leurs fable* fur le* ancien*
combats de la lumière contre les ténèbres. D ’où viennent
leurs prelTcntimens fur les incendies futur*, 6c le culte qu’ il*
rendent au feu. Des fêtes qu’ils célèbrent pour le foleil 6c
tous les élémens. Quoique le* Guebre* paroiffent rendre un
culte au fieu, il y a lieu de croire cependant qu’il n’ell pa*
l ’objet réel de leur adoration préfente ; leur doûrine fur le
dieu luprime 6c le* minillre* qu’il* lui donnent. Ils ont per-
fifté dan* le dogme du bon 6c du mauvais principe. Origine
de ce dogme. Ibid. 980. a. Les Guebres n ont aucune idole
ni aucune image. En quoi conlille tout l’appareil de leur
religion. Leur refpeél pour toute efpcce de feu. Leur* cérémonies
légales, leur* jeûnes 6c leur* prières, t/c. Ufages
fuperllitieux des Guebre* à l’égard de* morts. Comment leur
humanité paroitjufque* dans leur* dogmes fur une autre vie.
Persécutions qu il* ont elfuyéc* de la part des Mabométan*.
Toutes le* religion* perfécutée* ont été l’objet de calomnie»
fou vent atroce* de la part de» religion* dominantes. Signification
odieufe du nom de guebre. Autre» nom* qu’on leur a
donnés. C e qu’il y a de fingulier dan* le nom de guebre, c’cA
^u’il cft^d’ulage^chcz plufieur* nation* d’Europe 6c d’Alie
que fon* différente* forme* 6c en dilfércns dialcétc*, il
eu par-tout l’expreflion d’une injure greffier«, Ibid. b. Les
Guebres font encore appeJ)é»ga//r par les Juif* 6c le* Chrétiens
6c giaour par le» Turc*. Le nom de kebre eil auiïi d’ufage ; plu»
fleurs peuples d’Afrique font appcllé* kafret par les Arabe*.
L mverfe «les radicaux de ce nom de gebr, a porté dans l’Europe
k s exprcffions populaires de bogri, bougari, Oc. Le*
racines primitives de ces nom* ne portent cependant* point
j VCC 8 S m?uv?js i*n‘ 8UC le préjugé leur attribue. Gabar
dans lTiébrcu fignifie tire fort ; geber defigne le maître ; aube,
nn les/ gouverneurs- * * * / , fo ra itI kabir, giafar, font dci
noms iHuflre*. Le* déFivé* de gibor, de bogri , défignent chez
Je* Flamand* un bel homme. Comment ces expreSfion* font
devenue* injurieufcs. Ibid. 9H1, a.
Ou,bru. Etymologie de ce nm . VII. t . Etat de,
Guebres depuis 1 établiUeiaent du maboméiifme. IX. 847. b.
GUE Sur les G u eb re * , voycr G a u r e s , P a r s i* , t/ Z e n d a v e s t a .
G U K D E , ou Paßei. Drogue employée par les teinturier*
pour teindre en bleu. Plante d'où vient le paflcl. V I I , 981. a.
Maniéré de le préparer pour l’ufagc des teinturiers, Ufage
qu’en faifoient les anciens Bretons. Origine des mots glajf &c
glaflurn qui c il la plante qui produit le paÆel, Obfervation fur
le paflel bleu. Ibid. b. royet P a s t e l /■/ V o u cd e .
G U ED I ÎE , étoffe, terme de teinturier, X I, 189, a.
G U E L F E , {H ill, modjèf Iaélion qui renoir pour le p ap e,
oppofée U celle des gibelins qui tenoient pour l’empereur.
Suites funcflcs de leur# diffenUon*. V IL 981. b. — Sur l’origine
de ce s guerres, v o y e z Suj>pl%l l , b.
G U E LD K E , ( Duché de ) contrée de# Pays-Bas, Borne#
de ce duché. Ancien» peuple# qui ont habité ce pays. Se* différente
» révolutions. V IL 981, b.
G u ë ld rE , ( Le haut quartier d e ) quartier de Rurctaonde,
V I I . 981, b. Partage du haut quartier de Gueldrc entre trois
fouverain* depuis le traité d'Otreehr. Ibid. 98a. a.
G u e lu k e , (Z tf province d e) une de fept Provinces-Unies^
V I I . 98a. a.
Gueldrcs, petite ville des Pays-Bas. V I I . 98a, a.
G U E N E L lO N , ( Pierre ) anatomiAc. Suppl. I. 401. a.
G U E O N 1M , ou Gihonim, ( Thiolog. ) mot hébreu qui
fignifie excellent : titre que prenaient les rabbin# qui demeu-
roient dan* le territoire de Banvlone, L eur retraite en Efjiagne.
Recueil fait par R. Ifaac A l le z , de* décifions de la gitnarc.
VIL 98a, «».
G U Ê P E , ( Hiß. nat.) Defcrîption des guêpes ; en quoi
elles different des abeilles 6c des autres mouches. V II, 98a,
a. Il y a plufieur» efpeces de guêpes. Détail» fur les guêpe*
foutcrrcities ou domcAique*, Leur diAinélion en mêles , ferne
lies 6c mulet*. T ravail de la guêpe, HiAoire de l’infeéle
6c des divers état* par lefquel* il paffe. Différentes pontes de
la merc. Différence entre le* guepes fem elles , les mêles 6c
les mulets Proportion# dans lâpomb rc des une s 6c de* autre*.
//*/</, b. Alimens que le* mulets von t chercher chaque jour *
dans la campagne. Comment le* bouchers de campagne pré-
fervent leur* viandes des guipes 6c des grofTe# mouche».
Comment un mulet eA reçu dans le guêpier lorfqu’il arrive
a vec fa proie. A la fin du moi* d’a o û t , le* mulets conAruifent
les dernier* gêteaux du guêpier. Un guêpier a quelquefois
plus de 16 mille alvéoles , 6c jufqu’é 30 mille guêpes.
HiAoire des guêpes depuis le moi* ci’aoû t, jufqu’au tems ou le
froid les fait périr miférablemcnt, â l’exception des femelles
qui le retirent dan* le guêpier ou dans des trous. Moyens dont
on le fort pour obtenir le travail des guêpes. HiAoire d’une
autre efpcce de guêpes appellée# aérienne e , 6c de leur travail.
Ibid. 983. a. Guêpes d’Amérique appellée* canonnières.
Ibid. b. v ' ,
Guß.p e , faufjfc, ( Hiß. nui. ) ou parnope, ou fcorpion
mouche, Suppl. IV . 1 3 1. a.
GUÊPIER. Defcrîption du guêpier fbnterrcin, oc de h
maniéré dont le* guêpes le conitruilcnf. V IL 983, b. Defcrip-
tion des guêpier* des euéjie# de Cay enne, appellée# canonnières.
Manière de travailler de cette forte de guipes. Ibid. 984, a.
G u ê p ie r , ( Ornith.) Defcrîption de cet oifoau. Sa nourriture.
V IL 984. a.
G u ê p i e r de Madagafcar, (Ornith.) V o l. V I , de* pJanch,
Regne animal, pl. 30.
G U ER CH IN , ( Jean-François Barbieri da Cento, dit l e )
peintre. V . 3*8. a. Peinture qu’il a faite de l’aurore avec fo»
attribut», dan* le plafond de la ville de Ludovlfi, Suppl. III.
^ G U È R E T , ( Géogr. ) v ille de F ran c e , patrie de Varilla»,
( Antoine ) hiflorien. VII. 984. b. „ . ,
G U É R ID O N , reprilenté vol. des plancb, EbémAc, pl. f ,
Efpece de guéridon dit torchère. X V L 4a*. a.
G U É R IK E , ( Othon de) inventeur de la pompe pneumat
tique. IX. 846. a. .
G U É R IN , chevalier de l’o rdre de S, Jean de Jérufalcm.
X I IL 8<, b. , .
G U É R ISO N , (Médec.) I/art a moin# de part q uon no
croît à la guérifon de* maladie«. VIII. 383. b. i . e q uon doit
penfer de certaines guérifon* extraordinaires qc comme fur-
naturelle«. IX . » " . a. Tableaux que confacroient à quelque
divinité ceux qui étoient guéris d’une maladie, a v . ooç . .
Guéhlons opérées par le ta d , 8aa. b. 8*3. a, par la tranl-
planrion. X V L 559, b. W M T r a i t em e n t .
G U É R IT E , ( Art rnilit. ) ConlïruQiion de* guérite# de#
ouvrages de la fortification. Figure 6c dimenûon des guérit es.
Guérites qui fo font aux différentes entrées de la place. -
984, b. Payer ÉCHAUGUETTE». , >. , . a
G U E R R E , ( Art milit. 1/ Hißoire) Définitions de GrOUUt
Sc de MontccucuUi, La guerre,'foit offenfive , Ion o e ten tr $
le divife en guerre de campagne 6c en guerre des neges. .
guerre cA un art qui a fo# réglés, 6c par c onléf/ent la ihêo-
n e 8c fa pratique’ L'art de la g u e r r e , confulcri dan» fon
objet y cil le plu« grand de tou«, L ’btudc d’un art fi im p ô t.
d o it , félon M. de Folard , faire la plu« grande occupation
GUE lie princes 6c des grand*. Rien plu* brillant que la carrière
/un général qui fait forvir fit foicnce, fon zelc6c ton courage au
ilnc grand».de plus d'un fa fon au
for vice du prince 6c de la patrie, L .s regle* de la guerre font le
Iruit de* obforvaiion* faites en différens tem s , pour faire combattre
les hommes le plu# avantageufément qu’il fora pofliblc.
V IL 985. a. Premieres armes qui ont été employée* h la '
guerre. Invention des rang* 6cde# files pour mettre de l'ordre
dans les combatían*. Origine de* exercices 6c de* évolution* ;
celle des armes défenfivc* ; celle des compagnies, de* cohorte*
, régimen*, bataillons, t/c. O u fongea auiïi a ranger le*
différens corps en ordre de bataille. Premier emploi de la
cavalerie, Formation de* premiers corps de cavalerie. Invention
des arme* de longueur pour la tenir en refpeél. Ibid. b.
D iv er s ufages anaquel* on continue d’employer la cavalerie.
Origine de* premieres fortifications. Invention des machine*
propres à en détruire les ouvrages. Arme* à feu fubAituées ê
P ’ ufage de ces machine* depuis l’invention de la poudre à canon.
Changement» dans les armes offenfive* U défenfives, auxquels
cette découverte a donné lieu. Origine de la caAra-
métation , 6c de l’art de fortifier les camps. D ’où dépendent
le# fuccê* a la guerre. Exemples tirés de l’hiAoirc des G re c s ,
qui montrent que l’h abiletéqesgénéraux6c la bonté de* troupes
fort plus que le grand nombre. V I I . $96. a. En quoi con-
AAe effentiellement l’art de la guerre. L e génie de cet art
ne peut s’acquérir par l’é tu d e , elle peut feulement le perfectionner
î v o y e z dans l’article Etude militaire, quelles font le*
connoiffance* qui lui fervent de bafo. Ibid. b. Selon M. de
F o la rd , c’cA particulièrement chez les Grecs qu'il faut en
chercher le* regles 6c le* principe*. Faffagc tiré de cet auteur
pour combattre le fontiment de ceux qui prétendent que
l ’étude n’cA point néceffaire, 6c que la pratique foule apprend
l ’art de la guerre. Ibid. 987. a. S’il faut qu’un officier voie
exécuter tout ce qu'il a befoin d'apprendre, il lui fora prefque
impoflible de fe rendre habile dan* les différens mouvemens
des armées. L’étude de l’art peut tenir lieu d’expérience, mais
«l'une expérience de tous le* fíceles, C c que Diodore de Sicile
dit en faveur de l'étude de rii’.Aoire, dans un paffage ici /apporté
, peut s’appliquer à celle de l’art de la guerre, C cfi
dan» les livres des Grecs 6c des Romains qu il faut chercher
1e* vrai* principe* de l’art piílítaírc , mai* le nombre de leur*
auteurs fur cc fujet n’eA pas confidérablc. Obfcrvations de
M . Folard fur ceux qui nous reAcnt. Ibid. b. Ancien# ouvrage*
qu’on peut confulrer le plus utilement. Auteurs moderne*.
Divers objets de la foicnce des généraux. Polybe con-
fcille à ceux qui afpirent au commandement de# armée#, d è-
tudier les arts 6c les foicnce* qui ont quelque rapport a 1 art
militaire. Détails fur ce qui regarde léxecution ou Us principales
oplratwm d , la ¿ lum . Deu x fo n e , d ■Mon, militaire«, fa Ion
Polyb e ; telle» mil fe font !i tlicouvert 8t liar fo r c e , 8c celle«
nui fc font par linefle 8c par peralten. Oiifcrvatitw» fur c e .
entière». Ùnd. oB3 . a. Avant de commencer la g u e r re , il
c li important d'avoir de» vue» 8c de» delfom* t e clt ce qu on
ap pelle, foivant M. de P olard, nfefe «Vwt i c la $u,r„. En
quoi confident le» préparatifs de guerre. Précaution» i nrendre
pour n'éirc point dillrait de la poutfuite de fon obiet. Le
prince qui médite une guerre ( fa t encore «appliquer Ii con-
noitre le génie de fon enn emi, 8c le caraétere de fe» génér
a u x , fo« propre, force» 8c ee lle. de fon ennemi. Parti q u d
doit prendre / il fent que l'ennemi lui (bit fupéricur en force».
Connoiffance» qu'il doit fe procurer du iray» qui doit être le
théâtre de la guerre. 1M . b. Lorfqu on ed entre en campagne,
il ne »'agit plus de délibérer; mai» d entamer avec vivacité c .
opération, qu'on .'c d propofé d'exécuter. 1 ne g “ P "
iour» régler l'état de la guerre fur le nombre 8c la qualité de»
force» que l’on veut onpofer a l’ennemi. Un Tureimc regle
l é i a t d c l a guerre fur la grandeur de fe» eonnoiflânees, de
fou courage 8c de fa lurdiciTc. On düií¿ 0^ “ V
la guerre par quelque aéUon d’e d a t , 8c ne potnt fe lamer
Í H vtrn óffenfm. Il faut être teformé de« force. de
première bataille donnée a propos. Q q . ¿vitcr
'foi. le fuccê» de» b ata ille ., ,1 paren qu > " “ ^
au commencement d'une g u e r re , d faut chereiwr
d'en donner. Cependant il ne faut rifqucr une batadte qua ve
beaucoup de ciieonfpeflioii. M. le m a r c e lu ld e S a x e n ir o u
point pour les bataille», fuw o u t au tommcMCunem d u e
pa«’ aiuant^dan» IViffctifive. Sratimeii^^X^íuyf^tar* pcnnáít HBÉmI II ii yu,wk ie
a:
G U E «79
l'imprudence à en rifquer l'événement ; mai* il y a plufieur«
circonAances où elle# lont inévitable*. C e qu’il y a d’effen-
t ic l , c’cA de favoir fo fbutenir, 6c ne point fo décourager pouf
a voir été pouffé 6c même battu dan* quelque» endroits dd
la ligne. Parole* de Polybe fur ce fujet. Exemple» de cette
forte d'habileté : celui de Fhilopémcn dans la bataille de Man-
tinéc. Celui mie M. de Ttircnnc rapporte dans la bataille de
Nordlingue. Un des principaux avantage* de la guerre offen-
A v e , c’cA de faire fubfiAer l'armée aux dépens des ennemi»*
Cou foi! de WalAcin h l’empereur Léouold Ignace, nui le plai-
gnoit de ne favoir où prendre des lonas pour payer fo* armées.
Ibid. 99o. a. Réflexions du prince d v r a n g e en laveur de la
guerre offenfive.
D e la guerre défenfivc. Celle-ci cA beaucoup difficile & plu*
favante que la précédente. Dans la guerre offenfive. on compte
pour rien ce qu’on manque de taire : dans la dérenfive , la
moindre faute eil mortelle» Il eA difficile de preferiré des
maxime» générale* dans cette lorie de guerre. C e tte guerre
a été ou tour-â-fait imprévue, ou elle n’a pas été prévue a fïw
tôt . ou la perte d’une bataille ou de quelque place confidé-
r a b lc ,r a rendue te lle , quoiqu’elle'eût eu un autre commencement
; trois différens ca» fur lefquel* l’auteur donne ici quelques
regles, Expofé de celles qui lont relatives aux deux premier
». Rid. b. 11 arrive fouvent «u’un prince oui fait la guerre
á Ja foi» de plufieur» cô té s , n’eu nas en état de la faire offen-
fivcment par-tout j alors il premi le* parti ds la délenfive dû
côté où il le croît Je plu* eu iûreté ; prudence avec laquelle
cette défenfivc doit être conduite, M. le chevalier de Folard
prétend que les généraux les plus mal-habiles font ceux qui
propofont la guerre défenfivc, au lieu que les plus confom*
mes cherchent a l’éviter. Cependant fi l’ennemi peut pénétrer
qu’on a deffein de fc tenir fur la défenfivc á fon égard,
il doit devenir plus entreprenant. Une délenfive ruine l'état
fi elle dure long-tems, Ibid. 991. a. Conduite à fuivre dan#
le troifurne cas propofé ci-dc(tus. C e qu’on doit faire pouf
empêcher l'ennemi de pénétrer dan* un pay* formé de montagne*
6e de défilé*. . . _ . ,
D e la guerre de fecours. But de cette guerre, La prüdcnco
demande qu’avant de donner du focours ê un prince attaqué g
on prenne toute* le* fûreté* convenable* pour qu il ne raflé
pa# la paix ê votre préjudice, 6e fan» votre participation.
Ibid. b. En quel cas on doit le contenter de lecourir un prince
attaqué, ou par argent, ou par des divcrfioo* dan* le pays
de ¡V aqu an t, Sageffe 6e prévoyance quon exige dans le
général de*,troupe# qu’ un prince envoie au fceour» dun
autre prince. .;»• , . _
j ) e \a suerrc ges fieges. O n ne doit entreprendre aucun liego
au c lorfqu’on a acquis quelque fupêrionté fur l’ennemi par
le gain dune bataille, où iorlqu’on eA en état, en fo métrant
de bonne heure en campagne, de finir le ficgc avant que I en»
nemi ait eu le tems d'affembler une armée pour s v oimofor.
Le* fuccés à la guerre dépendent non-feulement du général,
n u » encore de« officiers généraux mû font fou. f iw w * w »
8c de ceux oui font charge» du détail de» fobfirtance«. M.me
fineulicre par laquelle tout le monde veut »ingérer 4 juger
dcTa conduire d'un général. Ibid. 991. a. Ce» jugemen. hatar-
dé. for la conduite d’un général, pèchent ordinairement coinre
le bon fon# & contre l’équité ; mai» il ne faut pas efpércr m m
fo corrige de ce défaut, qui a fa fourcc dan» la curiofié
8c dans Ta vanité naturelle« de l liomme, Ibid. b. Outre le»
différentes guerre, précédente», il y e n a une particulière qui
fo fait avec peu de troupe», 4 laquelle on donne le nom de
M i l , eutrrt. Ceux qui commandeur ce* petit* corps de tmu-
pe* ’ font appcllé* partijam. But 8c utilité de cette forte
ÍCI ¡T u \aurrt naval1. Cette guerre peur ( fo n d e r beureiifo-
niaiit celle de terre , dan. l e W » a P ortie de la mer. U .
armée* navale» affûtent le» c i t e » , elle» peuven dilp.nfor
d'emolover un grand nombre de troupe» pour le* gode r.
O iv e r f« utilité» d'une puiffante armée navale L empire de
la mer dit un grand minillre, n e fut jamos bien affuré a
ocrfoim’e : le* vieux titre* de cette domination font la fo r c e .
four être puiffant pour prétendre 4 cet héritage. Ib,d. 99].
a Confeil* Sonné* par M. de Sam a-C rui. aux puiffance» qui
forment l’établiffement d’une armée navale, ou qui ont inté-
de l’cmreteoir. Autre, eonfed» de cet auteur pour la
lürcté de» corfaire* qui courent fur I ennemi. Ibid. b.
ê o r l u é . M É Ue* déelaranon. de guerre. IV . 691. b.
Sacrifice» que le» liomain* offroient 4 Néméf» , avant d'aller
wicrim-e» q , pour(iUO\ jc * guerres civile* ctoitne
cher. le . Grec». 4 7 ufcrev» S7o' rtÍe-* s ‘of c *g' uderer eI *M quÊe Jesnomam*
,aCP*PcIl^S S it”um^uhufs v v5CitV.«E.87;4e4.G' ucWrre»cUnWd elline#»,au trlec‘-
t " ' v ' r / l > x ; T C ? c l ’ t S f i - elle commença fou.