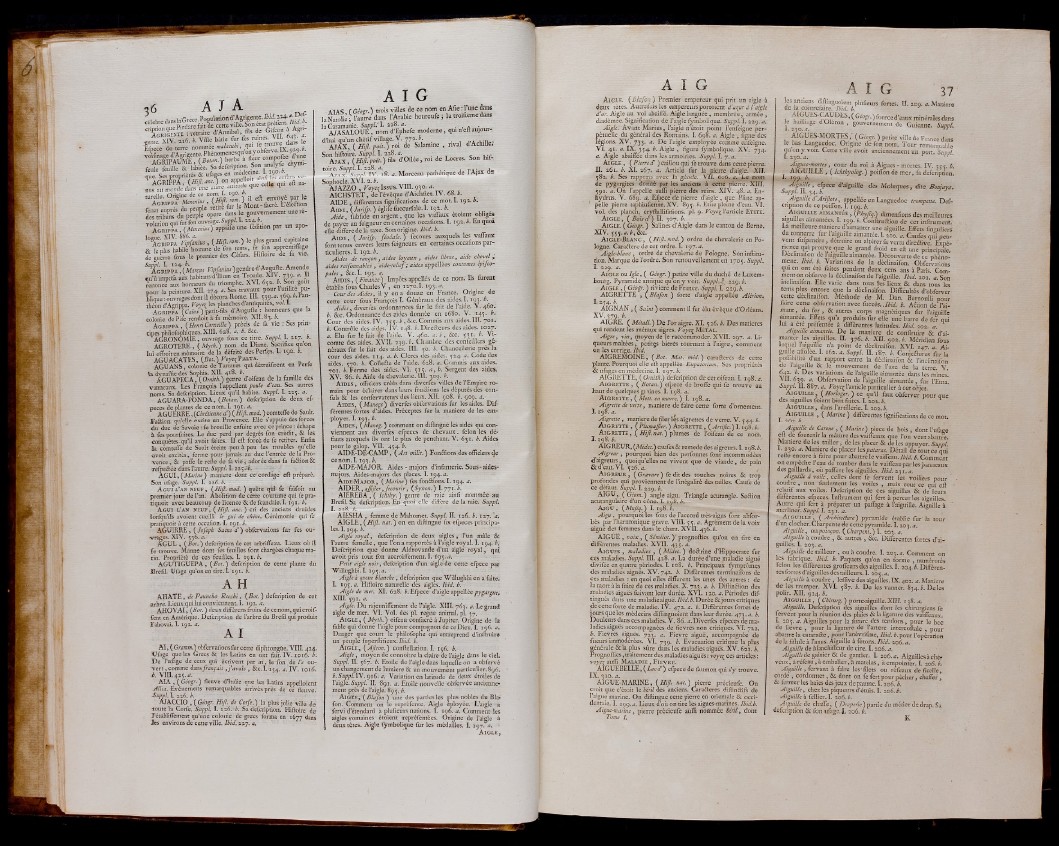
H AJA
SMW i fm SSI «„«c. XIV. » 6 . 1 Ville bâtie f e | g f B g | ¡ £ le
Efpece de-terre nommée malacubi, _q _t,/'/,Pve TY 020 b.
f e Ä i t r iife S a c / e fc r ip t io n . Son analyfe chynnqne.
Ses propriétés & nfages en TOeft
nanus
an monde dans une autre
■«relie. Origine de o= nom I. .90. *- |
A grippa Ï M t t g g g K L . o n t - facré. k c i t io n
l i l l S , p eV e opere dans le gouvernement uneré- iilli “ B v f l a W a « f i ä S W 8 iep f 8ran<' g f l
& le plus habile homme de Ton tems, ^ fo n apprentiffage
de guerre fous le premier des Céfars. Hiftoire de fa vie.
^'■■&êàÈ0 î Marc;« Vipfanius ) gendre ti’Augufte. Amende
«u’il impöfa aux habbans d’Ilium en Troade XIV. 739. g. U
renonce aux honneurs du triomphe: XVI. 65a. i. Son gout
pour la peinture. XU. ¡ ¡ g | Ses travaux pour lutihte publique
i-ouvragesdont il décora Rome. III. 339.». 369. ¿.Panthéon
d’Agrippa. V les planches d antiquités, vol.1.
Agrippa f Cafe ) pfet-fils d'Augufle : honneurs que la
colonie de Pile rendoit à fa mémoire. XII. 83. b.
A g r ip p a , (HenriCorneille) précis de fa vie : Ses principes
phiiofophiques. XIII. 628. a. b. 8cc. ,
AGRONOMIE, ouvrage fous ce titre. Suppl. 1. 217^ b-
AGROTERE , ( Myth.) nom de Diane. Sacrifice quon
lui offroiten mémoire de la défaite des Perfes. L -190. b.
AGUACATES, (Bot.) Voye^P a lta .
AGUANS, colonie deTartares qui détruifirent en Ferle
la dynafoe des'Sophis. XII. 418. b.
AGUAPECA, ( Ornith.) genre doifeau de la famille des
vanneaux. Les François 1 appellent poule d'eau. Ses autres
noms. Sa defcripdon. Lieux qu’il habite. Suppl. I. 225. a.
AGUARA-PONDA, (Botan. ) defcripdon de deux efpeces
de plantes de ce nom. I. 191. a. S H S s B
AGUERRE, (Chrétienne d| ( Hiß. mod. ) comteffe de Sault.
Faûion qu’elle excite en Provence. Elle s’appuie des forces
du duc de Savoie :fe brouille enfuite avec ce prince : échape
I fes pourfuites. Le duc perd par degrés fon crédit, & les
conquêtes-qu’il avoit faites. Il eft forcé de fe retirer. Enfin
la comteffe de Sault éteint peu à peu les troubles qu’elle
avoit excités, ferme pour jamais au duc l’entrée delà Provence,
& paffe le refte de fa vie i adorée dans fa fà&ion &
refpe&ée dans l ’autre. Suppl. 1. 22 ^¿.
AGUI, ( Marine ) maniéré dont ce'cordage eft préparé.
Son ufage. Suppl. I. 226. b. r
A g v i l’a n neuf , (Hiß. mod. ) quête qùL fe faifoit au
premier jour de l’an.’ Abolition de cette coutume qui le pra-
tiquoit avec beaucoup de licence & de fcandale.1.191. b.
A gu i l’an n e u f , (Hiß. anc. ) cri des anciens druides
lorfqu’ils avoient cueilli le gui de chêne. Cérémonie qui fe
pratiquoir à cette occaiion. I. 191. b.
AGÜIRRE, (Jofeph Sains d.') obfervations fur fes ouvrages.
XIV. 536.a.
AGUL , (Bot. ) defcripdon de cet arbriffeau. Lieux où il
fe trouve. Manne dont fes feuilles font chargées chaque matin.
Propriété de ces feuilles. I. 191. b.
AGUTIGUEPA, (Bot.) defcripdon de cette plante du
JBrefil. Ufage qu?on en dre. 1.191. b.
A H
AHA TE , dePauncho Recçhi3 (Bot,) defcripdon de cet
arbre. Lieux qui lui conviennent. I. 102. a,
AhO VA I , (Bot/) deux différens fruits de ce nom, qui croif-
font en Amérique. Defcripdon de l’arbre du Brefil qui produit
l ’ahovai. 1.192. a.
A I
A l , (Gramm.')obfervadonsfur cette diphtongue. YIII. 424.
Ufage que les Grecs & les Latins en ont fait. IV. 1016. b;
De l’ufage de ceux qui écrivent par ai, le fon de l’e ouv
e r t, comme dans français, j'avais , &C.I. i«4. a. IV . 1016.
i . VII1.4M-*-
AIA , (Géogr.) fleuve d'Italie que les Latins .appelloient
A Ilia. Evénemens remarquables arrivés près de ce fleuve.
Suppl. 1. 226. b.
ÂJACCIO , X Géogr. Hiß. de Corfe.) la plus jolie ville de
toute la Corfe. Suppl. I. fi6.'b. .Sa defcripdon. Hiftoire de
l'établiffement qu’une colonie de grecs forma en 1677 dans
ies environs de cette Yille. Ibid. 227. a.
A I G
AIAS ( Gcoer. ) trois villes de ce nom en Afie : l’une ¿âne
liNatohè ; l'autre dans l’Arabie heureufe; la tro.freme dans
h Caramanie. Suppl.' I. 228. a.
AJASALOUE, nom d’Ephefe moderne, qui n eft aujourd'hui
qu’un chérif village. V . 772-¿- . . pA ,
AJÀX, ( Hifi.poét. ) roi de Salamme , rival d Achille.
Son hiftoire. Suppl. I. 2.2.8. a. ■•
A j a x , (Hifi.poét.) fils dOïlée, roi de Locres. Son hif-,
toire. Suppl. 1. 228. a. . . . ,
A ja le. Süppi. IV. 18. a. Morceau pathétique de lA ja x ne
Sophocle. XVI. 2. b. __
AJAZZO , Voye{ Issus. VIII. 930. a.
AICHSTET, de l’évêque d’Aichftet. IV . 68. b.
A ID E , différentes fignifications de ce mot. 1. 192. b.
A id e , (Jurifp. ) égîilefuccuriale.I.192. b.
Aide, lubfide en argent, que les vaffaux étoient obligés
de payer au feigneur en certaines occafions. I. 192. b. En quoi
elle différé de la taxe. Son origine. Ibid. b.
A id e , ( Jurifp. féodale. ) fecours auxquels les vaffaux
font tenus envers leurs feigneurs en certaines occafions particulières.
1 . 192. b. ,
Aides de rançon, aides loyaux , aides libres, aide cnevet ,
aides raifonnables , aiderrelief; aides appellées coutumes épifeo-
pales , Scc. I. 193. a.
A id e s , (Finance) Impôts appellés de ce nom. Ils turent
établis fous CharlesV , en 1270.1.193.a.
Cour des Aides, il y en a douze en France. Origine de
cette cour fous François I. Généraux des aides. 1. 193- b.
Aides, diverfes ordonnances fur le fait de l’aide. V . 460.
b. &c. Ordonnance des aides donnée en 1680. V. 145. b.
Cour des aides. IV. 355. b, & c. Commis aux aides. III. 701.
b. Contrôle des aides. IV. 148. b. Directeurs des aides. 1027.
a. Elu fur le fait de l’aide. V. 460. a. b , &c. 531. b. Vicomte
des aides. XVII. 239.1. (.hambre des conieillers^ généraux
fur le fait des aidés. III. 50. b. Chancellerie près la
cour des aides. 114. a. b. Clercs des aides. 524. a. Code des
aides. 370. b. Colle&e de l’aide. 628. a. Commis aux aides.
701. ¿.Ferme des aides. VI. 515. a , b. Sergent des aides.
XV. 86. b. Aide de chevalerie. III. 309. b.
Aides , officiers créés dans diverfes villes de l’Empire romain
pour éclairer dans leurs fondions les députés des confuís
& les confervateurs des lieux. XII. 908. b. 909. a.
Aides, (Manege) diverfes obfervations fur les aides. Différentes
fortes d’aides. Préceptes fur la maniere de les employer.
1 . 103. b.
Aides, (Maneg.) comment on diftingue les aides qui conviennent
aux diverfes efpeces de chevaux, félonies défauts
auxquels ils ont le plus de penchant. V . 631. b. Aides
pour le galop. VII. 454. b.
AIDE-DÉ-CAMP, (Art milit. ) Fondions des officiers <]e
ce nom. 1 . 193. b.
AIDE-MAJOR. Ajdçs - piajors d’infanterie. Sous-aides-
majors. Aides-majors des places. 1. 194. a.
A ide-Major, ( Marine) fes fondions.1. 194. a.
AIDER., aßßer t fecourir, (Synon. ) 1. 771. b.
AIÉREBA, ( Ichthy. ) genre de raie ainfi nommée au
Brefil. Sa defeription. En quoi elle diftere de la raie. Suppl.
I.228; A ^ - ^ 7 "
AIESHA , femme de Mahomet. Suppl. IT. 126. b. 127. a.
AIGLE, (Hiß. nat.) on en diftingue fix efpeces principales.
1 . 194. b.
Aigle royal, defeription de deux aigles, -l’un mâle &
l’autre femelle, que l’on a rapportés à l’aigle royal. I. 194. b.
Defeription que donne Aldrovande d’un aigle royal, qui
avoit pris tout fon accroiffement. I. i05. ii.
Petit aigle noir, delcription d’un aigle de cette efpece par
Willughbi. 1 . 195. a.
Aigle à queue blanche, defeription que Willughbi en a faite.
I. 195. a. Hiftoire naturelle des aigles. Ibid. b.
Aigle de mer. XI. 628. b. Efpece d’aigle appellée pygargue.
XIII. 591. a.
Aigle. Du ràjeuniffement de l’aigle. XIII. 763. «t. Le grand
aigle de mer. VI. Vol. des pl. regne animal, pl. 37.
A ig l e , (Myth.) oifeau confacré à Jupiter. Origine de la
fable qui donne l’aigle pour compagnon de ce Dieu. I. 196. a.
Danger que court le philofophc qui entreprend d’inftruir®
un peuple fuperftitietix. Ibid. b.
A ig l e , (Aflron.) conftellation. I. 196. b.
Aigle, moyen de connoître la claire de l’aigle dans le ciel.
Suppl. ü . 367. b. Etoile de l’aigle dans laquelle on a obfervé
un changement de lumière & un mouvement particulier; 896.
b. Suppl. IV. 916: a. Variation en latitude de deux étoiles de
l’aigle. Suppl. II. 891. a. Etoile nouvelle obforvée ancienne-,
ment près de l’aigle. 895. b,
A ig ï e , (BlaJ'on) une des parties les plus nobles du Bla-
fon. Comment' on le repréfente. Aigle éployée. L’aigle a
fervi d’étendard il plufieurs nations. 1. 196. a. Comment les
aigles romaines étoient repréfentées. Origine de l’aigle à
deux têtes. Aigle fymbolique fur les médailles. I. 197. a. -
A ig l e ,
A I G
A ig l e . (Blafon) Premier empereur qui prit un aigle à
deux tètes. Autrefois les empereurs portoient d’azur à l ’aigle
d’or. Aigle au vol abaiffé. Aigle ianguée, membrée, armée ,
diadêmée. Signification de l’aigle fymbolique. Suppl. I. 229. a.
Aigle. Avant Marius, l’aigle n’éroit point l’enfeigne perpétuelle
du général des Romains. I. 698. a. Aigle , ligne des
légions. XV. 733. a. De l’aigle employée comme enfeigne.
V l. 41. a. IX. 354. b. Aigle , figure fymbolique. XV. 734.
a. Aigle abaiffée dans les armoiries. Suppl. I. 7. a.
A ig l e , ( Pierre tT ) caillou qui fe trouve dans cette pierre.
II. 261. b. XI. 267. a. Articlé fur la pierre d’aigle. XIT.
582. b. Ses rapports avec la géode. VIL Le nom
de pygargites doriflé pat les anciens à cette pierre; XIII.
591. a. On l’appelle auffi pierre des reins. XIV. 48. a. En-
nydrus. V. 689. a, Efpece de pierre d’aigle, que Pline ap-
1 pelle pierre taphiufienne. XV. 895. é. Etite pleine d’eau. VI.
vol. des planch. cryftallifations. pl. 9. Voye%_ l’article E t i t e I
A i g l e , ( Boisd’ ) II. 307. b.
A ig l e . ( Géogr. ) Salines d’Aigle dans le canton de Berne.
XIV. ^^.a.b,oLc.
A ig l é -B l a n c , ( Hiß. mod. ) ordre de chevalerie en Pologne.
Carà&ere de cet ordre. I. 197. a.
Aigle-blanc , ordre de chevalerie de Pologne. Son inftitu-
rion. Marque de l’ordre. Son renouvellement en 1705. Suppl.
I. 229. a.
A i g l e ou Igle, ( Géogr. ) petite ville du duché de Luxembourg.
Pyramide antique qu’on y voit. Suppl. J. 229. b.
A ig l e , (Géogr;) riviere de France. Suppl. I. 22 a.b.
AIGRETTE , (Blafon ) forte d’aigle appelfoe Alèrion.
1 . Ï Ï 4. *.
A IGN AN , ( Saint ) comment il fut élu évêque d’Orléans.
XV. 379. b.
AIGRE ( Met a II. | De l’or aigre. XI. <>26. b. Des matières
qui rendent les métaux aigres. Voye^ M ét al.
Aigre, vin, moyen de le raccommoder. XVII. 297. a. Liqueurs
maltées, petitçs bieres tournant à l’aigre, comment
on les corrige. Ibid.
AIGREMOINE, ( Bot. Mat. mèd. ) caraélerés de cette
plante. Pourquoi elle eft appellée Eupatorium. Ses propriétés
& ufages en médecine. I. 197. b.
AIGRETTE, ( Ornith.) defeription de cet oifeau. I. 198. a.
A i g r e t t e , ( Botan. ) efpece de broffe qui fe trouve au
haut de quelques gt aines. I. 198. a.
A i g r e t t e , ( Mett. en ceuvre. | I. 198. a.
Aigrette de verre , maniéré de faire cette forte d’ornement.
1 . 198. a.
Aigrette, maniéré de filer les aigrettes de verre. V . 344. b.
A i g r e t t e , (Plumaßer. ) A i g r e t t e , (Artific.) 1. 198. b.
A i g r e t t e , ,( Hifi.nat.) plumes de l’oiféaü de ce nom.
1 . 198. b.
AIGREUR, (Médec.) caufes& remede des aigreurs. 1. 198.^.
Aigreur, pourquoi hien des perforines font incommodées
d’aigreurs, quoiqu’elles ne vivent que de viande, de pain
& d eau. VI. 526.*.
A ig r e u r , ( Gravure ) fe dit des touches noires & trop
profondes qui proviennent de l’inégalité des tailles. Caufe de
ce défaut. Suppl. I. zzo. b.
AIGU , ( Géom. ) angle aigu. Triangle acutangle. Seflion
acutangulaire d’un cône. 1.19S. b.
A i g u , (Mufiq.) 1. 198.b."
Aigu, pourquoi les fons de l’accord très-aigus font abfor-
bés par l’harmonique grave. VIII. 55. a. Agrément de la voix
aiguë des femmes dans le chant. XVII. 436. b.
AIGUË , voix, ( Seméiot. )' prognoftics qu’on en tire en
différentes maladies. XVII. 43 5. a.
A i g u ë s , maladies , ( Médec. ) dôéirine d’Hippocrate fur
ces maladies. Suppl. III. 428. a. La durée d’une maladie aiguë
divifée en quatre périodes. 1. 108. b. Principaux fymptômes
des maladies aiguës. XV. 742. b. Différentes terminaifons de
ces maladies : en quoi elles diffèrent les unes des autres : de
la mort à la fuite de ces maladies. X. 723. a. b. Diftinétion des
maladies aiguës fuivant leur durée. XVl. 120. a. Périodes difi
tingués dans une maladie aiguë. Ibid. b. Durée & jours critiques
jle cette forte de maladie. IV. 472. a. b. Différentes fortes de
ëurs que les médecins diftihguoiëiït dans leur durée. 473. a. b.
ouleurs dans ces maladies. V . 86. a. Diverfes efpeces ae maladies
aiguës accompagnées de fievres non critiques. VI. 722.
b. Fievres aiguës. 723. a. Fieyre aiguë, accompagnée de
fueurs immodérées, v l. 739. b. Evacuation critique la plus
générale &la plus sûre dans les maladies aiguës. X V. 621. b.
Prognoftics, traitement des maladies aiguës : voye^ ces articles :
voyez aufli M a l a d ie , F i e v r é .
AÎGUEBELLE, (Lacd’ ) efpece de faumon qui s’y trouve.
IX. 310. a.
AlGUE-MARINE, (Hiß. nat.) pierre précîeufe. On
croit que c’étoit le béril des anciens. Caraéleres diftinôifs de
l’aigue marine. On diftingue cette pierre en orientale & occidentale.
I. 199.0. Lieux d’où on tire les aigues-marines. Ibid.b.
Aigue-marine, pierre précieufe aüïfi nommée béril, dont
Tome I.
A I G 37
les anciens diftmguoient pliifieurs fortes. II. 209. a. Maniéré
de la .contrefaire. Ibid. b.
« ^ » ( Géogr.) fource d’eaux minérales dans
I 2 0 * gG ’ gouvernement de Guienne. Suppl.
AiGUES-MORTES, ( Géogr. ) petite ville de France dans
le bas Languedoc. Origine de fon nom. Tour remarquable
qu on y voit. Cette ville avoit anciennement un port. Suppl
I.230 .a. _ ir
Aigues-mortes, cour du roi a Aiguës - mortes. IV. 3ce. b.
AIGUILLE § ( Ichthyolog. ) poiffon de mer, fa defeription.
T. I99. fi.; - .
AtguiUc, efpece d’aiguille des Môluques, dite Bouiaya.
Suppl. II. 34. b. " . J
Aiguille d Arifiote, appellée en Languedoc trompette. Def-
cription de ce poiffon.I. 190.b.
• a i^ a ntée , (Phy/îq.) dimenfions des meilleures
aiguilles aimantées. I. 199. b. Conftruflion de cet inftrument
La meilleure mamere d’aimanter une aiguille. Effets finmliers
du tonnerre fur 1 aiguiüe aimantée. I. 200. Caules qui peuvent
lulpendre, détruire ou altérer fa vertu dirèôive Expé-
nence qui prouve que le grand froid en eft une principale.
JJeciinauon dé 1 aiguille aimantée. Découverte de ce phénff-
mene. Ibid. b. Variations de la déclinaifon. Obfervatiohs
qui en ont été faites pendant deux cens ans à Paris. Comment
on obferve la déclinaifon de l’aiguille. Ibid. 201. a. Son
iriclinaifon. Elle varie dans tous les lieux 6c dans tous les
tems plus encore que la déclinaifon. Difficultés d’obferver
cette déclinaifon. Méthode de M. Dan. Bernoulli pour
faire cette obfervation avec ûiccès..Ibid. b. A&ion de l’ai-
mant, du fer , & autres corps magnétiques fur l’aiguille
aimantée. Effets qu’a produits fur elle une barre de fer qui
1 a été préfentée a différentes latitudes. Ibid. 202. a.
Aiguille aimantée. De la maniéré de conflruire & d’ai-
manter les aipilles. H. 376. b. XII. 002. b. Méridien fous
lequel 1 aiguille n’a point de déclinaifon. XVI. 147. a. 1 1
gUÜ-1f.,afÎoIt e- I^i ‘ a‘ Suppl- II. 187. b. Conjeftures fur la
Ç° l.i. ... un rapport entre la déclinaifon 8c l’inclihaifon
de 1 aiguille 8c le mouvement de Taxe de la terre. V
642. b. Des variations de l’aiguille aimantée dans les mines".
V il. 639. a. Obfervation de l’aiguille aimantée, fur l’Etna.
Suppl. H. 887. a. Voyez l’article particulier à cét objet.
A ig u i l l e , ( Horloger. ) ce qu’il faut obferver pour que
des aiguilles foient bien faites. 1 .202. b.
A ig u i l l e , dans l’artillerie. 1. 202. b.
A i g u i l l e , ( Marine ) différentes fignifications de ce mot.
I. 202. b.
Aiguille de Carene, ( Marine) piece de bois , dont l’ufage
eft de foutenir la mâture des vaifleaux que l’on veut abattre.
Maniéré de les tailler, de les placer 8c de les appuyer. Suppl.
I. 230. a. Maniéré de placer lespataras. Détail de tout ce qui
refte encore a faire pour abattre le vaiffeau. Ibid. b. Comment
on empêche l’eau de tomber dans le vaiffeau-par les panneaux
des gaillards, où paffent les aiguilles. Ibid. 231. a.
Aiguille à voile, celles dont fe fervent les voilièrs pour •
coudre, non feulement les voiles , mais tout ce qui eft
relatif aux voiles. Defeription de ces aiguilles 8c de leurs
différentes efpeces. Infiniment qui fort à percer les aiguilles.
Autre qui fert à préparer un paffage à l’aiguille. Aiguille à
merliner. Suppl. I. 231. a.
A ï g u i l l e , | ArchiteSure) pyramide établie fur la tour
d un clocher. Charpente de cette pyramide. 1. 203. a.
Aiguille, ou poinçon. (Ckarpent.) I. 203. a.
Aiguille à coudre , 8c autres , 8cc. Différentes fortes d’aiguilles.
I. 203. a.
Aiguille de tailleur , ou à Coudre. I. 203.a. Comment on
les fabrique. Ibid. b. Paquets qu’on en forme , numérotés
félon les différentes groffeurs des aiguilles. I. 204. b. Différentes
fortes d’aiguilles des tailleurs. I. 205. a.
Aiguille à coudre , leffive des aiguilles. IX. 402. a. Maniéré
de les tremper. XVI. 587. b. De les vanner. 834. b. De les
polir. XII. 914. b.
A i g u i l l e , (Chirurg.) porte-aiguille.XUI. 138. a.
Aiguille. Defeription des aiguilles dont les chirurgiens fe
fervent pour la réunion dès plaies 8c la ligature des vaifleaux.
I. 205. a. Aiguilles pour la future des tendons, pour le bec
de lievre , pour la ligature de l’artere intercoftale , pour
abattre la cataraôe, pour l ’anévrifme, Ibid. ¿.pour l’opération
de la fifhile à l’anus. Aiguille à fêtons. Ibid. 206. a.
’ “ » “ » s , a cmuuinrer. l. 200. v;
Aïguille s fervant à faire les-filets ou refeaux de ficelle,
còrde , cordonnet, 8c dont on fe fert pour pêcher, chaflef ,
8c fermer les baies des jeux depaume. 1 .206. b.
Aiguille, chez les piqueurs d’étuis. I. 206. b.
Aiguille à fellier. I. 206. b.
Aiguiüe de chaffe, ( Draperie) partie du métier de drap. Sa
defeription 8c fon ufage. J. 206. b.
K