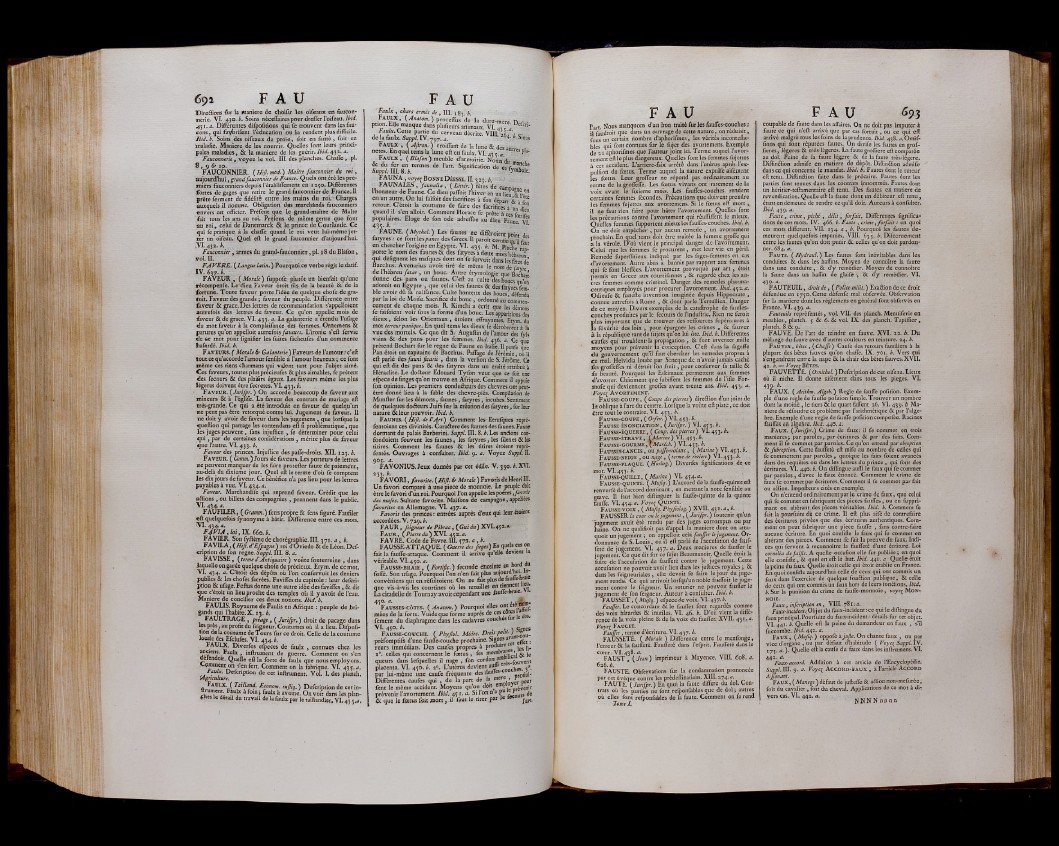
69a F A U F A U
Directions fur la maniere de chòifrt les oifeaux en feilCo linerie.
VI. 430. b. Soins néceffaires pour dreffer l’oifeau. Ibid.
431. a. Différentes difpofitions qui fe trouvent dans les fau*-
cons, qui faytmfent l’éducation ou la rendent plus difficile.
Ibid. b. Soins des oifeaux dq proie, foit en fante, foit en
maladie. Maniere de les nourrir. Quelles font leurs principales
maladies, 8c la maniere de les guérir. Ibid. 43a. a.
Fauconnerie t voyez le vol. III des planches. Chaffe, pl.
8 , 9 & 10.
FAUCONNIER. ( Hifl. mod. ) M^tYe fauconnier du roi ,
aujourd’hui, grand fauconnier de France* Quels ont été; les premiers
fauconniers depuis l’établiffement en 1250. Différentes
fortes de gages que retire le grand fauconnier de France. 11
prête ferment de fidélité entre les mains du roL* Charges
auxquels il nomme. Obligation' des marchands fauconniers
envers cet officier. Préfent que le grand-maître de Malte
fòt tous les ans au roi. Préfens de même genre que font
au roi, celui de Danemarck & le prince de Courlande. Ce
qui fe pratique à la chaffe quand, le roi veut lui-même jet-
ter un oifeau. Quel eft le grand fauconnier d’aujourd’hui.
¿VI. 432. b.
Fauconnier, armes du grand-fauconnier, pl. 18 du Blafon,
.vol. H.
FA VERE. ( Langue latin. ) Pourquoi ce verbe régit le datif.
IV. 637. b.
FAVEUR , ( Morale) fuppofe plutôt un bienfait qu’une
récompenfe. Le'dieu Faveur étoit fils, de la beauté & de la
fortune. Toute faveur porte l’idée de quelque chofe.de gratuit.
Faveur des grands ; faveur du peuple. Différence entre
faveur & grâce. Des lettres de recommandation s'appelaient
autrefois des lettres de faveur. Ce qu’on appelle, mois de
faveur & de grâce. VI. 433. a. La galanterie a étendu l’ufaee
du mot faveur à la complaifance des femmes. Ornemens &
parures qu’on appelloit autrefois faveurs. L’ironie s’eft fervie
de ce mot pour lignifier les fuites facheufes d’un commerce
hafardé. Ibid. b.
F a v e u r s . ( Morale 6 * Galanterie ) Faveurs de l’amour : c’efl
tout ce qu’accorde l’amour fenfible à l’amour heureux ; ce font
même ces riens charmans qui valent tant pour l’objet aimé.
Ces faveurs, toutes plusprecieufes 8c plus aimables, le prêtent
des fecours 8c des plaifirs égaux. Les faveurs même les plus
légères doivent être fecretes. VI. 433. b.
F a v e u r . ( Jurifpr.) On accorde beaucoup de faveur aux
mineurs 8c à l’égufe. La faveur des contrats de mariage eft
très-grande. Ce qni a été introduit en faveur de quelqu’un
ne peut pas être rétorqué contre lui. Jugement de faveur. Il
ne doit y avoir de faveur dans les jugemens, que lorfque la
queftion qui partage les contendans en fi problémadque, que
les juges peuvent, fans injuftice , fe déterminer pour celui
qui, par de certaines conudérations, mérite plus de faveur
que 1 autre. VI. 43 3. b.
Faveur des princes. Injuftice des paffe-droits. XII. 123. b.
F a v e u r . ( Comm.) Jours d e faveurs. Les porteurs de lettres
ne peuvent manquer de les faire protefter faute de paiement,
au-delà du dixième jour. Quel e f t le terme d’où fe comptent
les dix jours de faveur. Ce bénéfice n’a pas lieu pour les lettres
payables à vue. VI. 434. a.
Faveur. Marchandée qui reprend faveur. Crédit que les
a&ions, ou billets des compagnies , prennent dans le public.
VI.434.tf.
FAUFILER, ( Gramm.) fenspropre & fens figuré. Faufiler
'eft quelquefois fynonyme à bâtir. Différence entre ces mots.
VI. 434.a.
FA V IA, loi, IX. 660.
FAVIER. Son fyftêi
Son iyftême de chorégraphie. HT. 371. a , b.
- (n?/Ê d’Efpagnt•) roi d’Oviedo & de Léon. I
FAVILA f " Ü H Def-
cription de fon regne. Suppl. III. 8. a.
FA VISSE, ( terme d’Antiquaire ) voûte fouterreine, dans
laquelle on garde quelque chofe de précieux. Etym. de ce mot.
VI. 434. a. Cétoit des dépôts où l’on confervoit les deniers
publics 8c les chofes facrées. Faviffes du capitole : leur deferi-
ption & ufage. Fcftus donne une autre idée des faviffes, 8c dit
que c’étoit un lieu proche des temples où il y avoit de l’eau.
Maniéré de concilier ces deux notions. Ibid. b.
FAULIS. Royaume de Faulis en Afrique : peuple de brigands
oui l’habite. X. 13. b.
FAULTRAGE , prèage, ( Jurifpr.") droit de pacage dans
les prés, au profit du feigneur. Coutumes où il a lieu, fiifpofi-
iion de la coutume de Tours fur ce droit. Celle de la coutume
locale des Efdufes. VI. 434. b.
FAULX. Diverfes cfpeces de faulx , connues chez les
!u r eiîf‘ - a!* * >Qftruraenr de guerre. Comment on s’en
oerendoit. Quelle eft la forte de faulx que nous employons,
comment on s’en fert. Comment on la fabrique. VI. 433. a.
raulx. Defcription de cet infiniment. Vol. I. des planch.
Agriculture.
F a u l x . ( Taïlland. Econom. ruftiq.) Defcription de cetin-
S ï l î i S à fo,n î avoine- ° n voit dans les planf
hes le détail du travail de la faulx par le taillandier, VI. 43 %.a.
Faulx, chars armés de, III. 183.b.
’ ( Anat0™-) proceffus de la dure-mere r w -
ption. Elle manque dans plufieurs animaux. VI. a
Faulx,.Cette partie du cerveau décrite. V III.-iL '. <>.
de la faulx. Suppl. IV. 797. a. T ■ ^,ni»
F a u ix , M t o Æ croi'ffant de la lune & des
netes. En quel tems la lune eft en fàulx. VI. 42 e. a P
. F a u lx , ( Blafon ) meuble d’armoirie. Noms du 1
l Î i u T i " “ de “ Signlfica,ion
F AUNA j vey<ç B o n n e D é e s s e . II. 3 23 .b. ’ . -
FAUNALES , fdunalia , ( Lit ter. ) fêtes de canm«
l’honneur de Faune. Ce dieu paffoit l’hiver en un lieE R f î
en un autre. On lui faifoit des facrifices à fon départ & ' r
retour. C’étoit la coutume de faire des facrifices à un H-0"
quand il s’en alloit. Comment Horace fe prête àcesforY
populaires. Eloge de fon ode adreffée au dieu Faune. V?
FAUNE. Y Mythol. ) Les faunes ne différoient point Â
latyres : ce font les panes des Grecs. Il paroît certainWil fa..r
en chercher 1 origine en Egypte. VI. 433. b. M., Pioche r e porte
le nom des faunes & des fatyresàdeux mots hébreux
qui défignent les mafques dont on fe fervoit dans les fêtes de
Bacchus. Avenarius avoit tiré de même le nom de fatvre
de l’hébreu fatar , un bouc. Autre étymologie que Bochart
donne des s pat,,pans ou Wu faunes.uuu». v C’eft « « au tune culte ues-desboucs noiics qu’on
qu'oh
adoroit en Egypte , que celui des faunes & des fatyres fem-
ble avoir oir dû fa naiffance. Culte honteux des boucs, défendu
défendu
par la loi de Moïfe. Sacrifice du bouc, ordonné au commencement
de chaque mois. R. Kimchi a écrit que les démons
fe fàifoient voir fous la forme d’un bouc. Les apparitions des
dieux, félon les Orientaux, étoient effrayantes. Etym. du
mot terreur panique. En quel tems les dieux te dérobèrent à la
vue des mortels. Ce que dit S. Augüftin de l’amour des fyh
vains & des pans pour les femmes. Ibid. 436. a. Ce que
prétend Bochart fur le regne de Faune en Italie. Il penfe que
Pan étoit un capitaine de Bacchus. Paffage de Jérémie, ou il
eft parlé des faun't ficarii, dans la verfion de S. Jérôme. Ce
qui eft dit des pans 8c des fatyres dans un traité attribué à
Héradite. Le doéteur Edouard Tyfon veut que ce foit une
efpece de finges qu’on trouve en Afrique. Comment il appuie
fon opinion. Les premiers conduâeurs des chevres ont peut-
être donné lieu à la fable des chevre-piés. Compilation de
Munfter fur les démons, faunes, fatyres, incubes.Sentiment
de quelques do&eurs Juifs fur la création des fatyres, fur leur
nature oc leur pouvoir. Ibid. b.
F a u n e s . ( Hifl. de l’Art) Comment les Etrufqaes repré-
fentoient ces divinités. Caraôere des ftatues des faunes. Faune
dormant du palais Barberini. Suppl. m . 8. b. Les andens con-
fondoient fouvent les faunes, les fatyres, les filenes 8cles
titires. Comment les faunes 8c les ritires étoient repré-
fentés. Ouvrages à confulter. Ibid. 9. a. Voyez Suppl. II.
905. tf.
FAVONIUS. Jeux donnés par cet édile. V. 390. b. XVI.
^ A V O R I , favorite. {Hijl. & Morale ) Favoris de Henri III.
Un favori comparé à une piece de monnoie. Le peuple doit
être le favori d’un roi. Pourquoi l’on appelle les poètes, favoris
des mufes. Sultane favorite. Maifons de campagne, appellecs
favorites en Allemagne. VI. 437. a. , .
Favoris des princes: entrées auprès d’eux qui leur étoient
accordées. V. 7^9. b.
FAUR , feigneur de Pibrac, (Gui du) XVL4J*.*
F a u R , { Pierre du ) XVI. 452. a.
FAVRE. Code de Favre. III. 572. a , b.
FAUSSE-ATTAQUE. ( Guerre des juges) En quels Cas on
fait la fauffe-attaque. Comment il arrive qu’elle devient la
véritable. VI. 430. a. , . .
F a u s s e - b r à i e , ( Fortifie. ) fécondé enceinte au bord d
foffé. Son ufage. Pourquoi l’on n’en fait plus aujourdmiu
convéniens qui en réfultoient. On ne fait plus de faulle-l)
~ue vis-à-vis les courtines'où les tenailles que â-courtines ou tes tenaines eenn tiennent^ iy^r.
La citadelle de Tournay avoit cependant une faufle-braie.
4 * F a u s s e s - C ô t e s . ( Anatom. ) Pourquoi elles ont été »W
. mées de la forte. Vuideque forme auprès de cesc^Otes
fement du diaphragme dans les cadavres couchés lur
V L 41®* , 1.. \ Ciencs
F a u s s e -c o u c h e . ( Phyfiol. Médec. Droit polit. J * ou.
préfomptifs d’une faune-couche prochaine. Signes av^ .
reurs immédiats. Des caufes propres à produire _ jes jj.
celles qui concernent le foetus , fes memb^,^ ^ je
quleeuurrss ddaannss lleeffqquueelllleess iill nnaaggee ,, ffoonn ccoorrddoonn om f vent
placenta. VI. 430. b. 20. Uutérus devient a^® ^
"nr lui-même une caufe fréquente des ' produi-
>ifférentes caufes qui , de la part de » m__i’ gr pour
fent le même accident. Moyens qu’on doit 6 ,/ni^venir
E
prévenir Î’avortement. Ibid. 451. tf. Si l’on n a P° de
8c que le foetus foit mort, il faut, le tirer pa* »
F À U
Part. Nous manquons d’un bon traité fur les fauffes-couches :
il faudrait que dans un ouvrage de cette nature, on réduisit,
fous un certain nombre d’aphorifmes, les vérités incontefta-
bles qui font connpes fur le fujet des avortemens. Exemple
de 21 aphorifmes que l’auteur joint ici. Terme auquel l’avor-
tementeftleplus dangereux. Quelles font les femmes fujettes
à cet accident. L’arriere-fàix arrêté dans l’utérus après l’ex-
pulfion du foetus. Terme auquel la nature expulfe aifément
fes foetus. Leur groffeur ne répond pas ordinairement au
terme de la eroffeffe. Les foetus vivans ont rarement de la
voix avant le fixieme mois. Les fauffes-couches rendent
certaines femmes fécondes. Précautions que doivent prendre
les femmes fujettes aux avortemens. Si le foetus eft mort,.
il ne faut rien faire pour hâter l’avortement. Quelles font
les précautions contre l’avortement qui réufliffent le mieux.
Quelles femmes, fupportent mieux les fauffes-couches. Ibid. b.
On ne doit empêcher , par aucun remede , un avortement
prochain. En quel tems aoit être traitée la femme groffe qui
a la vérole. D’où vient le principal danger de l’avortentent.
Celui que les femmes fe procurent, met leur vie en péril.
Remede fuperftitieux indiqué par les fages-femmes en cas
d’avortement. Autre abus a bannir par rapport aux femmes
qui fe font bleffées. L’avortement provoqué par art, étoit
permis en Grece aux courtifannes, 8c regardé chez les autres
femmes comme criminel. Danger des remedes pharmaceutiques
employés pour procurer Tavortement. Ibid. 43 2. a.
Odieufe 8c funefte invention imaginée depuis Hippocrate ,
connue autrefois à Rome , 8c dont parle Tertullien. Danger
de ce moyen. Divers exemples de la cataftrophe de faufles-
couches produites par le fecours de l’induftrie. Rien ne ferait
plus important que de trouver des reffources fupérieures à
la févérité des loix , pour épargner les crimes , 8c fauver
à la république tant de fujets qu’on lui ôte. Ibid. b. Différentes
caufes qui troublent* la propagation , 8c font inventer mille
moyens pour prévenir la conception. C’eft dans la fageffe
du gouvernement qu’il faut chercher les remedes propres à
ce mal. Helvidia louée par Sénequc de n’avoir jamais caché
fes groffeffes ni détruit ion fruit, pour conferver fa taille 8c
fa beauté. Pourquoi les Eskimaux permettent aux femmes
d’avorter. Châtiment que fubiffent les femmes de l’iile For-
mofe qui deviennent groffes avant trente ans. Ibid. 433 .a.
Voyc{ A v o r t e m e n t .
FAUSSE-COUPE, ( Coupe des pierres) direction d’un joint de
lit oblique à l’arc du ceintrc. Lorfque la voûte eft plate, ce doit
être tout le contraire. VI. 433. b.
F a USSE-COUPE , ( Orfev. ) VL 433. b.
F a u s s e é n o n c i a t i o n , {Jurifpr. ) VI. 433. b.
F a u s s e - é q u e r r e , ( Coup, des pierres) VI. 433. b.
F a USSE-ÉTRAVE , l Marine ) Vl. 433. b.
F à USSE-GOURME , * Marich. ) VI. 43 3. b.
F a USSES-LANCES , ou pajfc-volans, ( Marine) VI. 433. b.
F à USSE-NEIGE , ou nage, (terme de riviere) Vl. 433. b.
F a u s s e -p l a q u e . {Horlog?) Diverfes fignifications de ce
mot. VI. 433. b.
F a USSE-QUILLE , ( Marine ) VI. 434. tf.
F a u s s e - q u in t e . ( Mufiq.) L’accord de lafauffe-quinteeft
renverfé de l’accord dominant, en mettant la note fenfible au
grave. Il faut bien diflinguer la fauffe-quinte de la quinte
fauffe. VI. 434. <1. Voye{ Q u in t e .
F a u s s e -v o i x , ( Mufiq. Phyfiolog. ) XVII. 431. tf, b.
FAUSSER la coür ou le jugement, ( Jurifpr. ) foutenir qu’un
'jugement avoit été rendu par des juges corrompus ou par
haine. On ne qualifioit pas d’appél la maniere dont on atta- I
quoit un jugement ; on appelloit cela faujfer le jugement. Ordonnance
ae S. Louis, où il eft parlé de l’accufation de fauf-
feté de jugement. VI. 437. tf. Deux manieres de fauffer le
jugement. Ce que dit fur ce fujet Beaumanoir. Quelle étoit la
fuite de l’accufation de fauffeté contre le jugement. Cette
accufation ne pouvoit avoir lieu dans les juftices royales j 8c
dans les feigneuriales , elle devoit fe faire le jour du jugement
rendu. Ce qui arrivoit lorfqu’un noble fauffoit le jugement
contre le feigneur. Un roturier ne pouvoit fauffer le
jugement de fon feigneur. Auteur à confulter. Ibid. b.
FAUSSET, ( Mufiq. ) efpece de voix. VI. 437. b.
Faufiet. Le concordant 8c le fauffet font regardés comme
des voix bâtardes 8c inutiles. VI. 46. b. D’où vient la différence
de la voix pleine 8c de la voix du fauffer. XVII. 431. a.
Voyei F a u c e t .
Faufiet, terme d’écriture. VI. 437. b.
FAUSSETÉ. ( Morale ) Différence entre le menfonge,
l’erreur 8c la fauffeté. Fauffeté dans l’efprit. Fauffeté dans le
coeur. VI. 438. <1.
FAUST, ( Jean ) imprimeur à Mayence. VIII. 608. a.
626. b. . ..
FAUSTE. Obfervations fur la condamnation prononcée
par cet évêque contre les prédeftinatiens. XIII. 274. a.
FAUTE. ( Jurifpr. ) En quoi la faute différé du dol. Contrats
où les parties ne font refponfables que de dol ; autres
.où elles font refponfables de la faute. Comment on fe rend
Tome I,
F A U 693
coupable de faute dans les affaires. On ne doit pas imputer à
faute ce qui n’eft arrivé que par cas fortuit, ou ce qui eft
arrivé malgré tous les foins de la prudence. Ibid. 438. a. Omif-
fions qui lont réputées fautes. On divife les fautes en grof-
fieres, légères 8c trés-légeres. La faute groificre eft comparée
au dol. reine de la faute légère 8c de la faute très-légere.
Diftinâion admife en matière de dépôt. Diftinftion admife
dans ce qui concerné le mandat. Ibid. b. Fautes dont le tuteur"
eft tenu. Diftinélion faite dans le précaire. Fautes dont les
parties font tenues dans les contrats pinommés. Fautes dont
un héritier-teftamentaire eft tenu. Des fautes en matière de
revendication. Quelle eft la faute dont un débiteur eft tenu,
étant en demeure de rendre ce qu’il doit. Auteurs à confulter.
Ibid. 439. tf.
Faute, crime, péché , délit, forfait. Différentes lignifications
de ces mots. IV. 466. b. Faute , crime, forfait : en quoi
ces mots différent. VIL 134. a , b. Pourquoi les fautes demeurent
quelquefois impunies. VIII. 633. b. Difccrnement
entre les fautes qu’on doit punir.8c.celles qu’on doit pardonner.
684. <t.
F a u t e . ( Hydraul. ) Les fautes font inévitables dans les
conduites 8c dans les baffins. Moyen de connoître la faute
dans une conduite , 8c d’y remédier. Moyen' de connoître
la faute dans un baffm de glaife -, 8c d'y remédier. VI.
439. tf.
FAUTEUIL, droit de, (PoUce milit. ) Exa&ion de ce droit
défendue en 1750. Cette défenfe mal obfervée. Obfervation
fur la maniéré dont les réglemcns en général font obfervés en
France. VI. 439. a.
Fauteuils repréfentés, vol. VIL des plarich. Menuiferie en
meubles, planch. 3 8c 6. 8c vol. IX. des planch. Tapiffier,
planch. 8 8c 9.
FAUVE. De l’art de teindre en fauve. XVI. 22. b. Du
mélange du fauve avec d’autres couleurs en teinture. 24. b.
F a u v e s , bêtes, ( Chajfe) Caufe des retours familiers à la
plupart des bêtes fauves qu’on chaffe. IX. 701. b. Vers qui
s’engendrent entre la napc 8c la chair des bêtes fauves. XVII.
42. b. —- Voyez B ê t e s .
FAUVEÎr £. ( Omithol. ) Defcription de cet oifeau. Lieux
où il niche. Il donne aifément dans tous les pieges. VL
439. b.
FAUX. ( Arithm. Algeb.) Réglé de fauffe pofitiôn. Exemple
d’une régie de fauffe pofition funple. Trouver un nombre
dont la moitié, le tiers 8c le quart faffent 26. VI. 439.'b Maniéré
de réfoudre ce problème par l’arithmétique 8c par l’alge-
bre. Exemple d’une règle de fauffe pofition compofée. Racines
fauffes en algèbre. Ibid. 440. a.
F a u x . {Jurifpr.) Crime de faux: il fe commet en trois
maniérés; par paroles, par écritures 8c par des faits. Comment
il fe commet par paroles. Ce qu’on entend par obreption
8c fubreption. Cette fauffeté eft mife au nombre de celles qui
fe commettent par paroles, quoique les faits foient avancés
dans des requêtes ou dans les lettres du prince , qui font des
écritures. VI. 440. b. On diftingue auffi le faux qui fe commet
par paroles, d’avec le faux énoncé. Comment le crime de
faux fe commet par écritures. Comment il fe commet par fait
ou aftion. Impofteurs cités en exemple.
On n’entend ordinairement par le crime de faux, que celui
qui fe commet en fabriquant des pièces fauffes, ou en fuppri-
mant ou altérant, des pièces véritables. Ibid. b. Comment fe
fait la pourfuite de ce crime. Il eft plus aifé de contrefaire
des écritures privées que des écritures authentiques. Comment
on peut fabriquer une piece fauffe , fans contre-faire
aucune écriture. En quoi confifte le faux qui fe commet en
altérant des pièces. Comment fe fait la preuve du faux. Indices
qui fervent à reconnoitrc la fauffeté d’une écriture. Loi
cornelia de falfis. fi. quelle occafion elle fut publiée; en quoi
elle confifte, & quel en eft le but. Ibid. 441. a Quelle étoit
la peine du faux. Quelle étoit celle qui étoit établie en France.
En quoi confifte aujourd’hui celle de ceux qui ont commis un
faux dans l’exercice de quelque fonftion publique, 8c celle
de ceux qui ont commis un faux hors de leurs fondions. Ibid.
b. Sur la punition du crime de fauffe-monnoie, voye{ M o n -
NOIE.
Faux , infeription en, VIII. 781; a.
Faux-incident.\Ob\et du faux-incident :-ce qui le diftingue du
faux principal.Pourluite du faux-incident: détails fur cet objet.
VI. 441. b. Quelle eft la peine du demandeur en faux , s’il
fuccombe. Ibid. 442. a.
F a u x , ( Mufiq. ) oppofé à jufle. On chante faux, ou par
vice d’organe , ou par défaut d’habitude ( Voyc{ Suppl. IV.
173. tf. ). Quelle eft la caufe du faux dans les inftrumens. VT.
442. tf.
Faux-accord. Addition à cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. ÜI. 9. tf. Voyei A c c o r d - f a u x , à l’article A c c o r d
dijjonant.
F a u x , ( Manege) défaut de jufteffe 8c aflion non-mefurée ;
foit du cavalier, foit du cheval. Applications de ce mot à divers
cas. VL 442. tf. 1
NNN N n nnn