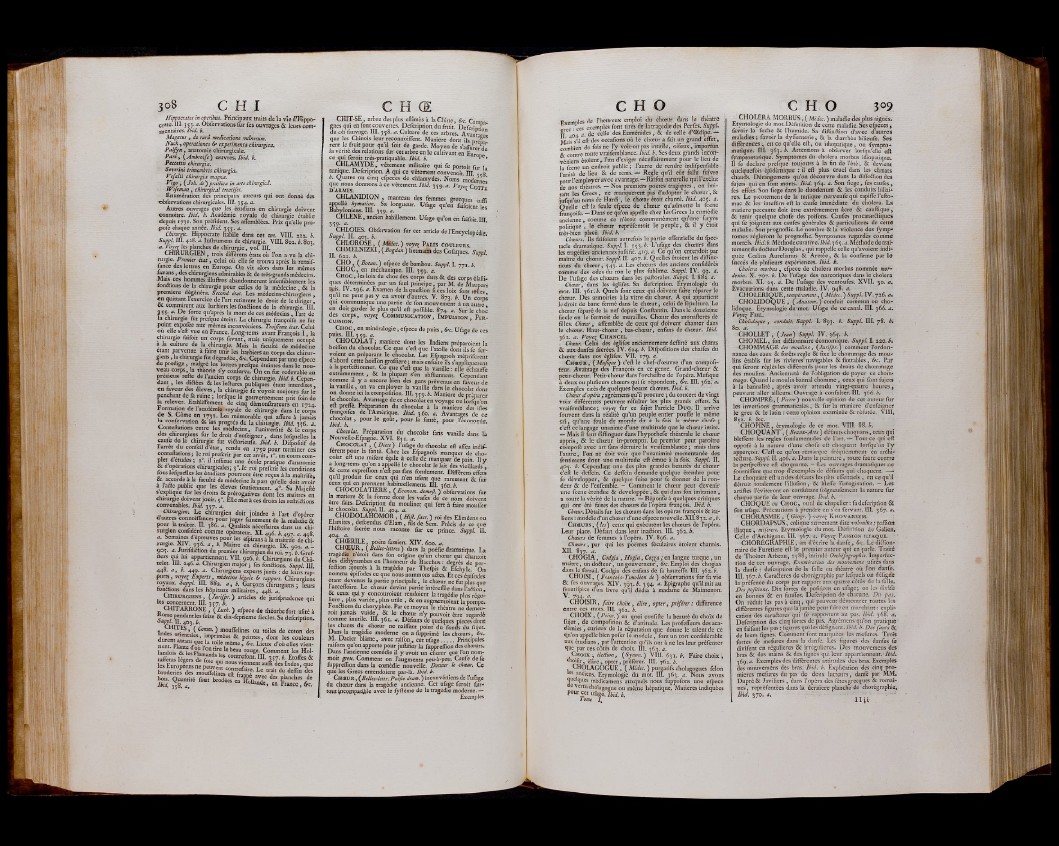
308 C H I
Hippocrates inoperibus. Principaux traits delà vie cPHippo-
crate. III. 3«. a. Obfervationsfor íes ouvrages & leurs commentaires.
Ibid. b.
Magatus , de rarâ médicationè vulnerum.
Nuck, operaciones 6» experimenta chirurgien.
Palfyn, anatomie chirurgicale.
Pare y ( Ambroife ) oeuvres. Ibid. b,
Peccettii chirurgia.
Severini trhnembris chirurgia,
Vefalii chirurgia magna.
Vigo , ( Joh. de') p raíl ica in arte chirurgicâ.
Wifeman , chirurgical treatifes.
Énumération des principaux auteurs qui ont donné des
-«bfervations chirurgicales. III. 3 34. a.
Autres ouvrages que les étudians en chirurgie doivent
connoître. Ibid, b. Académie royale de chirurgie établie
depuis 1731. Son préiident. Ses affemblées. Prix quelle pro-
polc chaque année. Ibid. 333. a.
chirurgie. Hippocrate habile dans cet art. VIII. 212. b.
Suppl. Ifl. 428. a. Inftrumens de chirurgie. VIH. 802. b. 803.
5 ies Ranchesà f chirurgie, vol. HL
CHIRURGIEN, trois différens états où l’on a vu la chi-
■rargie. Premier ¿tat , celui où elle fe trouva après la renaif-
fance des lettres en Europe. On vit alors dans les mêmes
favans, des chirurgiens admirables 8c de très-grands médecins.
ccs gommes dluilres abandonnèrent infenfiblement les
-ronchons de la chirurgie pour celles de la médecine, 8c la
première dégénéra. Second état. Les médecins-chirurgiens,
en quittant. 1 exercice de l’art retinrent le droit de le diriger,
& commirent aux barbiers les fondions de la chirurgie. III.
355-f- De forte qu’après la mort de ces médecins , l’art de
la chirurgie fut prefque éteint. La chirurgie françoife ne fut
point expofée aux mêmes inconvéniens. Troifume état. Celui
ou elle sert vye en France. Long-tems avant François I , la
chirurgie fàifoit un' corps fàvant, mais uniquement occupé
a la culture de la chirurgie. Mais la faculté de médecine
étant parvenue à faire unir les barbiers au corps des chirurgiens
, la chirurgie fut dégradée, &c. Cependant par une efpece
de prodige, malgré les lettres prefque éteintes dans le nouveau
corps, la théorie s’y conferva. On en fut redevable au
précieux refte de l|ncien corps de chirurgie. Ibid. b. Cependant,
les dictées 8c les leétures. publiques étant interdites,
en faveur des éleves, la chirurgie fe voyoit toujours fur le
penchant de fa ruine ; lorfque le gouvernement prit foin de
k relever. Etabliffement de cinq démonftrateurs en 1724.
Formation de 1 académie, royale de chirurgie dans le corps
f e en_I73I* I*oi mémorable qui aflùre à jamais
k confervation & les progrès de la chirurgie. Ibid. 336.
Conteftanons entre les médecins, l’univerfité & lé corps
des chirurgiens fur le droit d’enfeigner, dans lefquellesïa
caule de la chirargie fut viCtorieufe. Ibid. b. Difpofitif de
1 arrêt du confeil d’état, rendu en 1730 pour terminer ces
contentions; le roi preferit par cet arrêt, i°. un cours com-
E j , études 3 2 . il inftitue une école pratique d’anatomie
oc d opérations chirurgicales; 3 °.le roi prelcrit les conditions
lous lefqueiles les étudians pourront être reçus à la maitrife,
& accorde à la faculté de médecine la part qu’elle doit avoir
à lafte public que les éleves foutiennent. 40. Sa Maiefté
s explique^fur les droits & prérogatives dont les maîtres en
chirurgie doivent jouir. 30. Elle met à ces droits les reftriCtions
convenables. Ibid. 337. a.
Chirurgien. Le chirurgien doit joindre à l’art d’opérer
d autres connoiffimces pour juger fainement de la maladie &
pour la traiter. H. 386. *. Qualités néceflaires dans un chirurgien
confideré comme opérateur. XI. 496. b. 497. 408
*. Semaines d épreuves pour les afpirans à la maîtrife de chi-
rurgie. XIV. 926. a , b. Maître en chirurgie. IX. 902. a. -
905. a. JunfdiCtion du premier chirurgien du roi. 73. b. Greffiers
qui lui appartiennent. VII. 926. b. Chirurgie^ du Châ-
teiet. LU. 246.a. Chirurgien major; fes fondions. Suppl. III.
448. a, b. 449. a. Chirurgiens experts jurés : de leurs rapports,
voyez Experts y médecine Ugale & rapport. Chirurgiens
royaux. Suppl.LU. 882. a , b. Garçons chirurgiens ; leurs
ronchons dans les hôpitaux militaires, 448. a.
C h i r u r g i e n s , ( Jurifpr. ) articles de jurisprudence qui
les concernent. III. 3 37. b.
CHITARRONE, (luth. ) efpece de théorbe fort ufité à
c °m? P e n n ie s f«ze & dix-feptieme fiecles.Sa defeription.
vuppl- IL 403. b. v
Tnri« S C°mm' ) mouffelines ou toiles de coton des
d u r e n t^ 1 eS> VnPri.™ées & peintes, dont les couleurs
nent Plante à’^ i» t(?de même, &c. Lieux d’où elles vien-
landois & les F|U n f*!6 eau rou8e* Comment les Hol- ÜÜ lé gw s^ T e 1151-S conlrefon‘ HL 337- Etoffes &
les Europfens ne l ü « T L t ^ T
broderies des mouffelines dlî d<f n df m pfi r°at pl - ppl ¡8I1¡
C H OE
CHIT-SE, arbre des plus eftimés à la Chine, &c. Camna'
gnes qui en font couvertes. Defeription du fruit. Defcrimül
du chi fauyage. III. 338. *. Culture de ces arbres. Avantages
que les Chinois leur reconnoiffent. Maniéré dont ils prén
rent le fruit pour qu’il foit de garde. Moyen de s’afTurer rll'
ia vérité des relations fur cet arbre en le cultivant en Eurnn
ce qui feroit très-pratiquable. Ibid. b. °e»
CHLAMYDE, vêtement militaire qui fe portoit fur la
tunique. Defeription. A qui ce vêtement convenoit. III a e 8
b. Quatre ou cinq efpeces de chlamydes. Noms moderne^
que nous donnons à ce vêtement. Ibid. 3 39. a. Voyer Cn-r-rr-
d ’a r m e s .
CHLANIDION , manteau des femmes grecques suffi
appel é hymation. Sa longueur. Ufage qu’en fàifoient les
Babyloniens. III. 339. a.
CHLENE, ancien habillement. Ufage qu’on en faifoit III
339. a.
CHLOIES. Obfervation fur cet article de l’Encyclopédie
Suppl. II. 403. b. r
CHLOROSE, ( Midec. ) voyez P a l e s c o u l e u r s .
II ( Boëdan ) hetmafft des Cofaques. Suppl.
CHO, ( Botan. ) efpece de bambou. Suppl. ï. 771. b.
CHOC, en méchanique. III. 339. a.
C h o c , les loix du choc des corps durs & des corps élafli-
ques déterminées par un feul principe, par M. de Mauperè
tjus. IV. 296. a. Examen de la qneflion fi ces loix font telles
quil ne peut pas y en avoir dWres. V. 873. b. Un corps
qui communique une partie de fon mouvement à un autre
en doit garder le plus qu’ü eft poffible. 874. a. Sur le choc
des corps, voyez C o m m u n ic a t io n , Im p u l s io n , P e r c
u s s io n .
C h o c , en minéralogie, efpece de puits, &c. Ufage de ces
puits. UL339. *•
, CHOCOLAT ; maniéré dont les Indiens préparaient la
boiflon du chocolat. Ce aue c’eft que l’atolle dont ils fe fer-
voient en préparant le chocolat. Les Efpagnols mépriferent
d abord cette boiffon groffiere; mais enfuite ils s’appliquèrent
à la perfectionner. Ce que c’eft que la vanille : elle échauffe
extrêmement , & la plupart s’en abftienncnt. Cependant
comme il y a encore bien des gens prévenus en faveur de
la vanille, on va employer la vanille dans le chocolat dont
on donne ici la compofition. III. 3 39. b. Maniéré de préparer
le chocolat. Avantage de ce chocolat en voyage ou lorfqu’on
eft preffé. Préparation du chocolat à la maniéré des ifles
françoifes de 1 Amérique. Ibid. 3 60. a. Avantages de ce
chocolat, pour le gout, pour la fanté, pour ,l’économie.
Ibid. b.
Chocohu^ Préparation du chocolat fans vandle dans la
Nouvelle-Efpagne. XVI. 831. a.
C h o c o l a t , ( Dieu ) 1 ufage du chocolat eft aflez indlf-
férent pour la fanté. Chez les Efpagnols manquer de chocolat
eft une mifere égale à celle de manquer de pain. Il y
a long-tems qu’on a apuellé le chocolat le lait des vieillards,
8c cette expremon n eft pas fans fondement. Différens effets
qu il produit fur ceux qui n’en ufent que rarement & fur
ceux qui en prennent habituellement. III. 360. b.
CHOCOLATIERE, (Econom. domejl. ) obfervarions fur
la matière & la forme dont les vafes de ce nom doivent
être faits. Description du moulinet qui fert à foire mouffer
le chocolat Suppl. II. 404. a.
CHODOLAHOMOR, ( Hift. facr. ) roi des Eliméens ou
EJamites, defeendus d’Elam, fils de Sem. Précis de ce que
1 hiftoire facrée nous raconte fur ce prince. Suppl. IL
404. a.
CHCERILE, poëte famien. XTV. 600. a.
CHCÉUR, ( Èelles-lettres ) dans la poéfie dramatique. La
tragédie n etoit dans fon origine qu’un choeur qui chantoit
des dithyrambes en l’honneur de Bacchus : degrés de per-
feétion ajoutés à la tragédie par Thefpis & Efchyle. On
nomma épifodes ce que nous nommons aftes. Et ces épifodes
étant devenus la partie principale, le choeur ne fut plus que
l’acceffoire. Le choeur devint partie intéreffée dans faftion,
& ceux qui y concouraient rendoient la tragédie plus régulière,
plus variée, plus utile, & en augmentoient la pompe.
Fonctions du choryphée. Par ce moyen le tliéatre ne demeurait
jamais vuide, & le choeur n’y pouvoit être regardé
comme inutile. III. 361. *. Défauts de quelques pièces dont
les chants du choeur ne naiffent point du fonds du fujet.
Dans la tragédie moderne on a fupprimé les choeurs, &c.
M. Dacier blâme, avecraifon, cet ufage Principales
raifons qu’on apporte pour juftifier la fuppreffion des choeurs.
Dans l’ancienne comédie il y avoit un choeur que l’on nom-
moit grex. Comment on l’augmenta peu-à-peu. Caufe de fo
fuppreffion dans la comédie nouvelle. Donner le choeur. Ce
que les Grecs entendoient par-là. Ibid. b.
C h oe u r , (Belles-lettr. Poe fie dram. ) inconvéïliens de l’ufoge
du choeur dans la tragédie ancienne. Cet ufoge feroit for-
tout Incompatible avec le fyftême de la tragédie moderne. —
Exemples
CHO CHO FvPrtiolcs de l’heiireux emploi du thceilr dans lé théâtre ,
7* _ ?ccs exemples font tirés de la tragédie des Perfes. Suppl.
II 404 a- de cede des Euménides, oc de celle d’OEdipe. —
Mais s’il eft des occafions où le choeur a foit un grand- effet ,
combien de foisne l’y voit-on pas irtiitile, oifeux, itnporfün
& contre toute vraifemblance. Ibid. b, Ses deux grknds incorf-
véniens étoient, l’un d’exiger nécéffairément pour le lieti de
la feene un endroit public ;• Fautre de rendre indifpenfable
l’unité de lieu & de tems. — Régie qu’il eut follü fïrfvre
pour l’employer avec avantage.— Rai fon naturelle qui Fèxfclut ;
de nos théâtres. — Nos premiers poètes tragiques , en Îmi-
taiit les Grecs, ne manquèrent pas d’adopter le choeur, & .
jüfqu’àu tems de Hardi, lé choeur étcüt chanté. Ibid. 40 <. a. |
Quelle eft la feule efpece de choeur qu’admette la feene
françoife. — Dans ce qu’on appelle chez les Grecs la coritéoîé ,
ancienne, comme ce n’étoit communément qd’uné fatyre
politique , lé choeur repréfentoit le peuple, 8c il y étoit j
très-bien placé. Ibid. b. _ „ . , :
Choeurs. Ils fàifoient autrefois la partie effentielle du fpec- j
tacle dramatique. Suppl. I. 133.^ L’ufage des choeurs dans
les tragédies mfeiennes juftifié. 41 p. a. Ce qu’on entendoit par j
maître du choeur. Suppl. II. 407. b. Quelles étoient les diftinc-
tions du choeur, 343. a. Les choeurs des anciens confidérès
comme dès odes du ton le plus fublime. Suppl. IV. 99. a. j
De l’ufage des choeurs dans les paftorales. Suppl. I. 882. a.
Choeur, dans les églifes. Sa defeription. Etymologie du
mot. III. 361.' b. Quels font ceux qui doivent foire réparer le
choeur. Des armoiries à la vitre du choeur. A qui appartient
le droit de banc fermé dans le choeur, celui de fépulture. Le
choeur féparé de la nef depuis Conftantin. Dans le douzième
fiecle on le fermoit de murailles. Choeur des monafteres de
filles. Choeur, aiTemblée de ceux qui doivent chanter dans
le choeur. Haut-choeur, bas-choeur, enfons de choeur. Ibid.
362. a. Voyez C h à NCEL.
l Choeur. Celui des églifes anciennement deftiné' aux chants
8c aux-danfes faCrées. IV. 624. b. Difpofitions des chaifes dii
choeur-dans nos églifes. VII. 179. a.
C h oe u r , ( Mufique ) c’eft le chef-d’oeuvre d’un compofi-
feur. Avantage des François en ce genre. Grand-choeur 8c
petit-choeur. Petit-choeur dans l’ofcheftre de l’opéra. Mufique
à deux ou plufieurs choeurs qui fe répondent, vc. III. 362: a.
Exemples cités de quelques Beaux choeurs. Ibid. b.
Choeur d'opéra ; agrémens qu’il proaire ; du concert de vingt
voix différentes peuvent réfulter les plus grands effets. Sa
vraifemblance; voyez fur ce fujet l’article Duo. Il arrive
fouyent dans la réalité qu’un peuple entier pouffe le même
cri, qu’une foule de monde dit a la fois la même chofe ;
c’eft ce langage unanime d’une multitude que le choeur imite.
— Mais il fout diftinguer dans l’hypothefe théâtrale le choeur
appris, 8c le choeur in-promptu. Le premier peut paraître
compofé avec art fans détruire la vraifemblance ; mais dans
l’autre, l’on ne doit voir que l’unanimité momentanée des
fentimens dont une multitude eft émue à la fois. Suppl. II.
403. b. Cependant une des plus grandes beautés du choeur
c’eft le dcflcin. Ce deffein demande quelque étendue pour
fe développer, Sc quelque fuite pour fe donner de. la rondeur
8c de l’enfemble. — Comment le choeur peut devenir
une feene étendue 8c développée, 8c qui dans fon imitation,
a toute la vérité de la nature. — Réponie à quelques critiques
qui ont été faites des choeurs de l’opéra françois. Ibid. b.
Choeur. Détails fur les choeurs dans les opéras françois 8c italiens
: modèle d’iïn choeur d’une efpece nouvelle. XII. 8 3 2. a, b.
C h oe u r s , {les) ceux qui exécutent les choeurs de l’opéra.
Leur place. Défout dans leur inaâion. III. 362. b.
Choeurs de femmes à l’opéra. IV. 896. a.
Choeurs', par qui les poèmes féculaires étoient chantés.
XII. 837. a.
CHOGIA, Codgia, Hogia, Cozga ; en langue turque, un
maître, un dofteur, un gouverneur, &c. Emploi dés chogias
dans le ferrail. Codgia des enfons de fa hauteffe. Ut. 362. b.
CHOISI, ( François-Timolion de) obfervarions fur fa vie
8c fes ouvrages". XIV. 393 . b. 394. a. Epigraphe qu’il mit au
frontifpice d un livre qu’il dédia à madame de Maintenon.
M 794- *•
CHOISIR, faire choix , élire , opter y préférer: différence
entre ces mots. IH. 362. b.
CHOIX, ( Feint. ) en quoi confifte la beauté du choix de
fujet, de compofition 8c d’attitude. Les prbfeffeurs des académies
, curieux de la réputation que donne le talent de cé
qu’on appelle bien pofer le modèle, font un tort confidérable
aux étudians, par l’attention qu’ils ont à ne les leur préfenter
que par ces côtés de choix. III. 363. a.
C h o i x ; éleflion, ( Synon. ) VllI. 631. b. Faire choix -,
unoifir élire, opter, préférer. III. j6 i. b. - •
CHOLAGOGUE, ( Médec. ) purgatifs cholagogues félon
s anciens. Etymologie du mot. III. 363. a. Nous avons
quelques médicamens auxquels nous fuppofons une efpece
e vertu cholagogue Ou même hépatique. Matières indiquées
pour cet ufaee. Ibid, b,
lome /,
CHOLERA MORBUS, ( Médec. ) maladie des plus aiguës»
Etymologie du mot. Définition de cette maladie. Ses efpeces >
fevbir là foc h ü 8c 1 humide. Sa diftinRion d’avec d’autres
maladies ; fovoir la dyffenterie, & la diarrhée bilieufe. Ses
différences , en ce qu’elle eft , ou idiopatique, ou fympto-
matique. III. 363. b. Attentions à obfcrver lorfqu’eHe eft
fyrtiptontarique. Symptômes dit choiera morbus idiopatique»
Il fe déclare prefque toujours à la fin de l’été, 8c devient
quelquefois épidémique : il eft plus cruel dans les climats
chauds. Dérangemerts qu’on découvre dans la diffeâion des
fujets qui en iont morts. Ibid. 364. a. Son fiege, fes caufes,
fes eftets. Son fiege dans le duodénum 8c les conduits biliai«
res. Le picotement de la tunique nerveufe qui tapiffe l’efto-
mac ,8c les inteftins eft la caufe immédiate du choiera. La
matière peccante doit être extrêmement âcre 8c cauftique,
8c tenir quelque chofe des poifons. Caufes procatarRiques
qui fe joignent aux caufes générales 8c particulières de cettô
maladie, don prognoftic. Le nombre 8c la violence des fymp*
tomes régleront le prognoftic. Symptômes regardés comme
mortels, lbïd.b. Méthode curative. Ibid. 363. a. Méthode de traitement
du doReur Douglasqui rappelle celle qu’avoient indiquée
Goelius Aurelianus 8c Aretée, 8c la confirme par le
lüccès de plufieurs expériences. Ibid. b.
Choiera morbus, efpece de choiera morbus nommée moi-
dexin. X. 707. b. De l’ufoge des narcotiques dans le choiera
morbus. XI. 23. a. De l’ufage des ventoufes. XVII. 30. a.
Evacuations dans cette maladie. -IV. 948. a.
CHOLERIQUE, tempérament, ( Médec. ) Suppl. IV. 726. a•
CHOLIDOQÜE , ( Anatom. ) conduit commun ou cho-
lidoque. Etymologie du'mot. Ufage de ce canal. III. 366. a.
Voyez F i e l .
- Cholidoque , conduit. Suppl. I. 893. b. Suppl. Iü. 78. bi
80. a.
CHOLLET, (Jean) Süppl. IV, 363. b.
CHOMEL, fon dictionnaire économique. Suppl. I. 22o.b*
CHOMMAGE des moulin! , (Jurifpr. ) comment l’ordonnance
des eaux 8c forêts réglé 8c fixe le chommage des moulins
établis für les rivières- navigables 8c flottables, &c. Par
qui feront réglés les différends pour les droits de chommage
des moulins. Ancienneté de l’obligation de payer ce chom«
mage. Quand le moulin bannal chomme , ceux qui font fujet9
à la bannalité, après avoir attendu vingt-quatre heures,
peuvent allêr ailleurs.. Ouvrage à confulter. III. 366. b.
CHOMPRÉ, ( Pierre )- nouvelle opinion de cet auteur fur
les invérfions'grammaticales, 8c fur la maniéré d’enfeigner
le grec 8c le- latin : cette opinion examinée 8c réfutée. VllL
832. b. 8cc.
CHOPINE, étymologie- de ce mot. VIII. 88. b.
CHOQUANT, ( Beaux-Arts ) défauts choquans, ceux qui
bleffent les réglés fondamentales de l’art.— Tout ce qui eft
oppofé à la nature d’une chofe eft choquant lorfqu’on l’y
apperçoit. C’eft ce qu’on- remarque fréquemment en archi-
teatirç.Suppl. II. 406. a. Dans la peinture, toute foute contre
la perijjeftive eft choquante. — Les ouvrages dramatiques ne
fourniffent que trop d’exemples de défouts qui choquent. — '•
Le choquant eft un des défauts les plus effentiels , en ce qu’il
détruit totalement l’illufion, 8c bleffe • l’imagination. - Les
artiftes l’éviteront en confultant foigneufement la nature fur
chaque partie de leur ouvrage. Ibid. b.
CHOQUE ou C h o c , outil de chapelier : fa defeription &
fon ufage. Précautions à prendre en s’en fervant. III. 367. <z»
CHORASMIE| (Géogr. ) voyez Khovarezm.
CHORDAPSUS, colique autrement dite volvulûs; paffioit
iliaque, mifercre. Etymologie du mot. Définition de Galien;
Celle d’Archigene. III. 367. «. Voyez P a s s io n i l ia q u e .
CHORÉGRAPHIE, art d’écrire la danfe, &c. Lé dictionnaire
de Furetiere eft le preiiiier auteur qui en parle. Traité
de Thoinet Arbeau, 1388, 'intitulé Orchéfographie. Imperfection
de cet ouvrage. Enumération des mouvemens ,ufités dans
la danfe : defeription dé la- folle ou théâtre où Fon danfe.
III. 367. b. Carafteres de chorégraphie par lefquels on défigrfe
la préfence du corps par rapport aux quatre côtés de la falle.
Despojitionf. Dix lortes de pofirions en ufage; on les divifè
en bonnes 8c en fouffes. Defeription de chacune. Du pas.
On réduit les pas à cinq, qui peuvent démontrer routes les
différentes figures que la jambe peut foire en marchant : explication
des caraCteres gui fe rapportent au pas. Ibid. 368. a.
Defeription des cinq fortes de pas. Agrémens qu’on pratique
en faifant les pas : figures qui les défignent. Ibid. b. Des fauts 8c
de leurs fignes. Comment font marquées-les-mefures. Trois
fortes de mefures dans la danfe. Les figures des danfes fe
divifent en régulières 8c irrégulières. Des mouvemens des
bras 8c des mains 8c des fignes qui leur appartiennent. • Ibid.
369; a. Exemples des différentes attitudes des bras. Exemples
des mouvemens des bras. Ibid: b. Explication des cinq premières
mefures du pas de deux lutteurs, danfé par MM.
Dupré8c Javiliers , dans l’.opéra desfêtesgrecques 8c romaines,
repréfentées dans la dernier,e planche de chorégraphie^
Ibid, 370. a, < . ..;w.