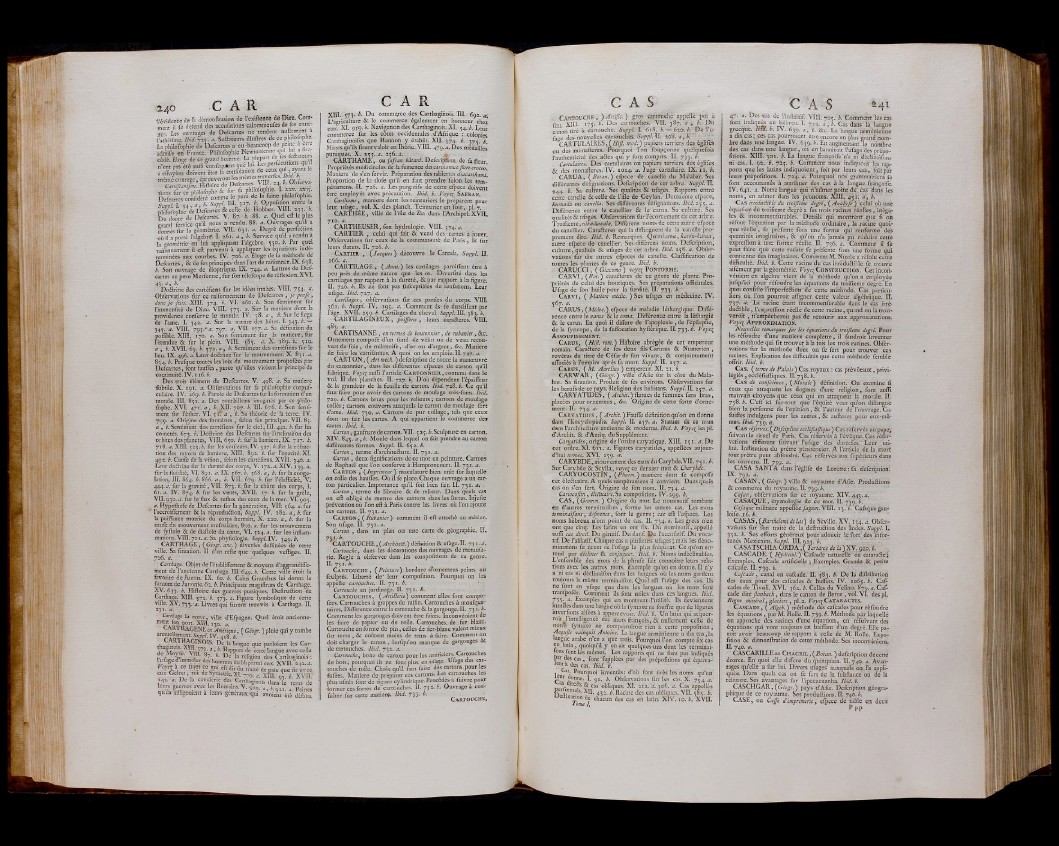
240 C A R .
Tévidence de fa démonftration de l’exiftence de Pieu. Com-
nent il fe défend des accufations calômnieufes de fcs ennenu's.
Les ouvrages de Defcartes ne tendent nullement à
Tathéifme. Ibid. 723. a. Se&ateurs iUüftres de ce pjulofophe.
La philofophie de Defcartes a eifïëaueoup de peine a etre
admife en France. Philofophie Nèwtonienne
cùclè. Éloge de ceue.J&lOge a e ccee ggrraannda homme 'U ' ¡ d
n’ont pas été aúífi eônféqufcns que lui. Les per ^ .
a eiïùyées doivent être la confolatioh de c e y qu., ayant le
•même courage, éprouveront les memes «•« . q > A _
CatiJùm&J.,Hlftoire de Defcartes. VIII. * 4. Obferva-
tioris fur c e pltiofophe & fur fa plulofophte. I.
Defcartes coniîddré comme le pere de la famé phdofoplue.
çl)nn, T ft. A b. Suppl. III- 317- b- Oppofmon entre la
Phflofopiùe de Defcartes & celle (le Hobbcs.VlII. 233. 41
C d S de Defcartes. V. 87.-4.JI. «Q u e l eft le plus
grand fervice qu’il nous a rendu. 88. u. Ouvrages qu.l a
donnés fur la géométrie. VII. 631. a. Degre de perfeibon
■où il a porté Palgebr« I. 261. a , 4. Service qu il a rendu i
la géométrie en lui appliquant l’algèbre. 550. b. Par quel
Taifonnement il eft parvenu à appliquer les équations indéterminées
aux courbes. IV. 706. ¿.'Éloge de la méthode de'
Defcartes, & de fes principes-dans l’art de raifonner. IX. 638.
b. Son ouvrage de dioptrique. IX. 744. a. Lettres de Defcartes
au pere Merfenne, fur fon télefeope de réflexion. XV L
43. a , b.
DoCirine des cartéfiens fur les idées innées. VIII. 754. a.
Obfervations fur-ce ràifonnement de Defcartes , je penfe,
donc je fuis. XIII. 374. b. VI. 260. b. Son fentiment fur
l’imménfité de Dieu. VIII.- 375. a. Sur la maniere dont la
providence cOnferve le monde. IV. 38. a , b. Sur le fiëge
de l’anie. I. 342. a. Sur la nature des bêtes. I. 343. b. —
343. a. VIII. 793.* a. 797. a. VII. 177.a. Sa définition du
poffible. XIII. 170. a. Son fentiment fur la maticre;fur
l’étendue & fur le plein. 'VIII.. -3.83. a. Xy 18 9^.. 31Q.
a , b. XVII. 69. b'. 372. a t b: Sentiment des cartéhensfur le
lieu. IX. 496. a. Leur doôrinc Tur le mouvement: X. 831. a.
83'4.- b. Prefque toutes les loix du mouvement propofées par
Defcartes, font fauffes, parce qu’elles violent le principe de
-continuité. IV. 116. b.
Des trois élémens de Defcartes. V.' 498.- a. ;Sa matière
fubtile. X. 191. a. OBfervátions fur fa philofophie corpuf-
culaire. IV. 269. b. Parole de Defcartes fur la formation d’un
mondé. III. 831. a. Des tourbillons imaginés' par ce philo-
fophe. XVI. 471. a y ¿.(XII. 707.'b. 111. 676. b. Son fentiment
fur l’éthcr. VI. 31* a , ¿.-Sathéorie de la terre. IV.
•799. a. Origine des fontaines , félon fes principes. VII. 83.
a y ¿. Sentiment dés cartéfiens fur lé ciel¡ III. 442. b. fur les
cometés. 673. ¿.rDoilrine des Defcartes fur l'inclinaifon-des
orbites des planetes, VIII, 630. ¿/forja lumière, IX. 717. b.
’718. a. XHI. 3 23. b. fur les couleurs, IV. 327. b. fur la réfraction
des rayons de lumière, XIII:. 892. b. fur l’opacité. XI.
-492. b. Caufe de la vifion, félon lés cartéfiens. XViL 340. a.
•Leur do&rine fur la dureté des córps, V. 172. a. XIV. 139. a.
furia fluidité, VI. 891. a. IX. 367. b. 368. a , b, fur la congélation,
III. 864. b. 866. a, b. VII. 679. b. fur l’élaíticité, V:
444. a. fur la gravité, VII. 873. b; fur la chûte des corps, I.
Î i . a. IV. 874. b. fur les vents, XVII. 17. ¿. fur la-grêle,
VII. 930. a. fur le flux 8c reflux des eaux de la mer..VI. 903.
. a. Hypothefe de Defcartes fur la génération, VII: 364. a. fur
* l’accroiflement & la réproduñion; Suppl. IV. 182. a , b. fur
la puiffance motrice du corps humain, X. 220. a , b. fur la
caufe du mouvement mufculaire, 850. a. fur les-mouvemehs
de fyfiole & de diaflole du coeur, VI. 324. a. fur les- inflammations.
VIIL 7 n . a.-Sa phyfiologie. Suppl. IV. 349. ¿.
CARTHAGE, ( Géogr, aùc. ) aiverfes deilinées- de cette
ville. Sa fitiiadon: Il n’en .reile que quelques veíliges. II.
726. a. ;
Carthage. Objet del’établiffement & moyens d’aggrandiffe-
ment de l’ancienne Carthage. III. 649. b. Cette ville étoit la.
favorite de JunOn. IX. 6a. b. Caïus Gracchus lui donna le
furnom de Junóme. 62. b. Principaux magiftrats de Carthage.
XV. 633. b. Hiiloire. des guerres-puniques. Deftruétion de
Carthage. XIH. 372. b. 373. a. Figure fymbolique de cette
ville. XV. 733.-a. Livres qui forent trouvés à Carthage. II.
431. a.
Carthage la neuve, ville d’Efpaene. Quel étoit aneienne-
roent fonport. XIII. 130. -
ARTHAGENE en Amérique, ( Géogr. ) pluie qui y tombe
annuellement. Suppl. IV. M fr. •- ■
♦ v . o ^ De la langue-que-párloient les Car-
» a » ^- Rapport ée cette langue avec celle
» a M i 1 « religión des- Carthaginois e
1 ufage d immoler des hommes établi parmi eux. XVII. 140. a.
Voy,t a ce ftjet ce « i dit du tmité de paix que fit avec
™ m deSyracufe.XI.77!i. x fe . 9,. 4. XVII.
P p De la cav=k " e t e . CarrhàgiuoU dansée tems de
leurs guerres arec les Romaios.V. 920... 4. 5I1 „ peines
quils rnfligeoienr a leurs généraux -qui avoient été défaits.
CAR XHI. 373* Dii commence des Carthaginois. TH. 692. ai
L’agriculture & le commerce également en honneur chez
eux. XI. 939- b. Navigation des Carthaginois. XI. 34.^. Leur
commerce fur les cotes occidentales.d’Afrique : colonies
Carrhaginoifes que Hannon y établit. XII. .374. .b. 373. ¿,m
Mines qu’ils firentvaloir en'Ibèrie. VIII. 479.fl. Des médailles
puniques. X.. 23 3..a- 2:3.6; a.
CÂRTHAME, ou jafran bâtard. Defcripïion de fa fleur.
Propriétés médicinales-de Ja femence du carüiamus flore croceo.
Maniéré 'de s’en fervir. Préparation des tablettes diacarthami.
Proportion de la dofe qu’il en faut prendre félon, les tem-
péramens. II. 726. a. Les purgatifs de cette efpece doivent
être employés avec précaution. Ibid. b. Vôy'e^ Sa fran.
. i Carthame, maniéré dont les teinturiers le préparent pour
leur ufage, vol. X. des .planch. Teinturier en ‘foie, pl.. 7.
CARTHÉE, ville ¿ie l ’iile de Zia dans l’Archipel. XVIL
CARTHEUSER, fon hydrologi e. VIII.. 374. a.
CARTIER , . celui qui ^ t & vend des • cartes'à jouer.
Obfervations for ceux -ae la communauté de Paris,‘ & for
leurs flatuts. II. 726. b. .
C artier y . {.Jacques') découvre • le' Canada. Suppl. U.
.i 66. a.
CARTILAGE,; ( Anat. ) les> cartilages paroiflent être à
peu près .de.même nature que les-os.' Diverfité dans les
cartilages par rapport à la'dureté, & j)ar rapport à la figure.
II. 726. b.. Ils ne font pas fofceptibles de.fenfations,. Leur
ufage.. Ibid::727. a.
. Cartilages , obfervations fur .ces parties , du corps. VIII,
361 ; b. Suppl. IV. 193- zg 'Comment, ils'-fe.dur.ciflent par
Page. XVII. 259. ¿. Carrilages du cheval. Sùppl ïil. 383. b.
CARTILAGINEUX, poijfons , leurs ; caraâeres. VIII.
•483. a.
•CARTISANNE , en termes de boutonnier, de rubanier, &c.
Ornement compofé d’un fond- de vélin ou de veau recouvert
de foie, de milanoife,-d’or.ou d’argent, &c. Maniéré
de faire les cartifànnes. A quoi on les emploie. II. 727. a.
CARTON, ( Art méch. ) aefeription de toute la manoeuvre
du cartonnier, dans les différentes efpeces de carton qu’il
fabrique. Voye%_ aufli l’arricle C a rtonn ie r , contenu dans le
vol. II-des planches.' II. 727. ¿; D ’oii dépendent l’épaifleur
&. la grandeur de la feuille de carton. Ibid. .728. b. Ce qu’il
faut faire pour avoir des cartons de moulage très-forts. Ibid.
729. b. Cartons bruts pour les relieurs ; cartons de moulage
collés; cartons couverts auxquels le carton dé-moulage fert
d’ame. -Ibid. 730. a. Cartons de pur collage, tels que ceux
dont on fait les cartes. A qui appartient le commerce des
cartes. Ibid. b.
Carton, gaufrurede carton. VII. 323.¿.Sculpture en carton.
XIV. 843. a , b. Moule dans lequel on fait prendre au carton
différentes formes. Suppl. II. 6.3 2. b.
Carton, terme - d’arcniteéhire. II. 731. a.
Canon, deux fignifleations de ce mot en peinture. Cartons
de Raphaël que l’on confervè à Hamptoncourt. II. 731. a.
C a r to n , ( Imprimeur ) maculature bien unie for laquelle
on colle des haulfes.- Où il fe place. Chaque ouvrée a un carton
particulier. Importance qu’il foit bien fait. IL 731. a.
Carton y terme de libraire & de relieur. Dans quels cas
on efl obligé de mettre des cartons dans les livres. Injuile
.prévention où l’on eft à Paris contre les livres où l’on ajoute
ces cartons. II. 731. a.
C a rto n.;{ Rubanier) comment il efl attaché au métier.
Son ufàge. II. 731 .a.
Carton , dans un plan ou une carte de .géographie. II.
71i.b .
CARTOUCHE, {ArckiteSl.) définition & ufage.II. 731. «*.
Cartouche, dans les décorations des ouvrages de menuife-
rie. Réglé à obferver dans les compofitions de ce genre.
II. 731. b.
C a r to u ch e , (Peinture) bordure d’ornemens peints ou
fculptés. Liberté de* leur compofition. Pourquoi on les
appelle cartouches. II. 731. ¿.
Cartouche en jardinage. II. 731. b.
C a rto uch es , ( Artillerie) comment' elles font compo-
fées. Cartouches à grappes de raifin. Cartouches à moufque-
taires. Différence entre la cartouche & la gargouge. II. 731* ¿*
Comment les gargouges doivent être foites. Inconvénient dé
les faire de papier ou de toile. Cartouches^ de. fer blanc.
Cartouche en forme dé pin, celles de fer-blanc valent mieux
fur terre; 8c coûtent moins de tems à faire. Comment on
doit charger le canon, lorfqu’on manque de gargouges ©c
de cartouches. Ibid. 73 2. a.
■ Cartouche, boîte de carton pour les artificiers. Cartouches
de bois; pourquoi ils ne font plus, en ufage. Ufage des cartouches
de toile. Choix qu’il faut faire des cartons,ppur les
fofées. Maniéré de-préparer ces cartons. Lés cartouohes les
plus ufités font de figure cylindrique. Procédés a fmvre pour
former cçs fortes de cartouches. IL 7 3 1 Ouvrage à con-
fulter.for cettp matière». Ibid. 733; b. -
C artouche,
CAS C AS p C a r t o u c h e , ) Artifice ) gros càriouche appelle put à
feu. XHI- 173■ b- Des cartouches. V il. 387. a , ¿.-Du
canon tiré à cartouche. Suppl I. 618. b. — 620. b. De Vu-
fâge des-noüyelles earrbuchéi.^SupplAV.-^208. ajE ^ ' *
CÀRTULAIRES, ( Hift. mod. ) papiers terriers, des églifés
ou des monafteres.- Pourquoi l’on' foupçonne quelqiiefois
l’authenticité des aâes qui y forjt compris. II. 733. b.
Cartulaires. Des' cartulaires ou papiers terriers des églifes
8c des monafteres. IV. 1024. a. Juge cartiilaire. IX. 11. ¿;
CARUA, ( Botan. j efpece de eanellë du Malabar, Ses
différentes délignations. Defcriptiori de cet arbre. Sûppl. II.
244. b. Sa culture. Ses qualités 8c ufagès. Rapports entre
cette canelle 8c celle de l’iïle de Ceylan. Deuxième efpece,
htrundu ou cànella. Sçs différentes aéfighârions. Ibid. 2 3 3 . a.
Différence entre le caiiellier 8c le carna. Sa cultùrë. Ses
qualités & ufages. Obfervations for l’écorcement de cèt arbre.
Troifieme, nïkâduwala. Différens noms de cette autre efpeee
du canellier. Carafteres qui la diftinguent de la canelle proprement
dite» Ibid. b. Remarques. Quatrième, katoù-ka'ruà,
autre efpece dé canellier. Ses différens noms. Defcription,
culture, qualités 8c ufages de cet ùrbrè. Ibid. 2 3 6 . à. Ôbfef-
vations fur dix autres éfpeces de canelle. Claudication de
toutes les plantes de ce genre. Ibid. b.
■ CARUjCCI, ( Giacomo ) voyei PôNTORME.
: CARVI, (Bot.) carafteres de ce génre de plante» Propriétés
de celui des boutiques. Ses prépafatioiis officinales.
Ufage de fon huilé pour la fordité. II. 733. b.'
CARVI, ( Matière rnédic. ) SeS ufâges en médecine'. IV.
3^7- a-
CARUS > (Médec.y efpece de maladie léthargique. Différence
entre le cams 8cle «M«fl. Différence entre la léthargie
8c le carus. En quoi il différé de l’apoplexie, de Tépilepue,
de la fyncope, de la foffocation hyfterique. II. 7 3 3 . b'. Voye{
Assoupissement.
C a r u s , (Hift. rom.) Hiftoire abrégée de cet empereur
romain. Caraélere de les deux fils Carinus 8c Numerien,
revêtus du titre de Céfar de fon vivant’, 8c conjointemènt
aflbciés à l’empire après fa mort. Suppl. II. 2 3 7 . a.
C a r u s , (M. Aurelïus) empereur. XI. 21. b.
CARWAR, ( Géogr. ) ville d’Afie for la côte du Mala-
ijar.- Sa fituation. Produit de fes environs. Obfervations for
les boeufs de ce pays. Religion des habitans. Suppl. IL 257. a.
CARYATIDES,- (Archit.) ftatues de femmes fans bras,
.placées pour ornemens, 6*c. Origine de cette forte d’ornement.
TL- 7 3 4 . A;-
C à r y a t id e s , ( Archit. ) Fauffe définition qu’on en donné
dans l’Encyclopédie. Suppl. II. 2 3 7 . a. Statues dé ce nom
dans l’arelnteicurë ancienne 8c moderne. Ibid. b. Voyeç les pl.
d’Archit. 8c d’Antiq. du Supplément.
Caryatides, origine de l’ordre'carÿatique. XIII. 13 r. a. De
Cet ordre. XI. 6 it : a. Figures caryatides, appellées aujourd’hui
termes. XVI. 139. a.
CARYBDE, mouvement des eaux- du Carybde.VII. 731 .b.
Sur Carybde 8c Scylla , voyeç ce dernier mot 8c Charybde.
CARYOCOSTlN, . ( Pharm. ) maniéré dont fe compofe
cet éleâuaire. A quels tempéramens il convient. Dans 'quels
cas on s’en fert. Origine de fon nom. IL 7 3 4 . à.
Cariocoftin , élefluaire. Sa compofition. IV. 299. b.
CAS, ( Gramm. ) Origine du mot. Le'nominatif tombant
èn d’autres- terminaifons , forme les autres cas. Les mots
terminaifonsy dêfinence, font le genre; cas eft l’efpece. Les
noms hébreux n’ont point de cas. II. 734. a. Les grecs n’en
ont que cinq:- Les latins en ont fuie. Du nominatif, appeilé
aufli cas direfl. Du génitif. Du datif ©e l’accufatif Dii Vocatif.
De l’ablatif. Chaque cas a pluficùfs ufages ; mais lès dénominations
fe tirent de l’ufage le plus fréquent. Ce qu’on entend
par décliner 8c conjuguer. Ibid. b. ri oms indéclinables.
L’enfemble des mots de la phrafe fait connoître leurs relations
avec les autres mots. Exemple qu’on en donne. Il n’y
a ni cas ni dêclinàifon 'dans les langues où' les noms gardent-
toujours la même terminaifon. Quel eft l’ufage des cas. Ifs
ne font en ufage que dans les langues où les mots font
tranfpofés. Comment ils font utiles dans ces langues. Ibid.
7 3 3 . a. Exemples qui en montrent-l’utilité. Ils deviennent
inutiles dans une laftgtié où la iyntaxe ne fouffre que de légères
inverfions aifées^à appercevoir. Ibïd. b. Un latin quîacquer-
roKJ’*,lte^'5e,.n(:e f d'|s mots françois, 8c nullement celle de
notre fyntaxe né comprëndroit rien à cette propofitiôrt |
dugufte vainquit Antoine. La langue arménienne a dix C'aS, la
langue arabe n’en a'.q’ue trois. Pourquoi l’on compte fix Cas
*n. latin, quoiqu’il y en ait quelques-uns dont les terminaisons
font les mêmes. Les rapports qui ne font pas indiqués
Par des cas, font'fübplées par des prépofitions qui équiva-
lent à des cas. Ibid. b.
| Pourquoi inventés : d’où font tirés les noms qu’on
ur donne. I. pi. ¿. Obfervations for les cas. X. 734. a.
as direfls 8c cas obliques. XI. 212. ¿'. 306. a. Cas appelles
perionnçls.XH. 432. b. Racine des cas obliques. VII. 383. b.
nation'de chacun des cas en latin. XIV. io. b. XVIL
lome I,
47. a. Des Cas de lMnfinitif. VIII. 703. b. Comment les cas
font m diques çn hébreu..I. 7.2a. a, ¿. Cas dàris îâ* langue
■grecque. J4» . 4. IV. 639. e , 4. (8éc. La languerarméniehne
a dix cas; ces cas pourraient.étre.encore en plus grand nombre
dans une langue. IV, .639. 4'. En augmentant le nombre
des cas dans une langue, on -en banniroit l’iifage des prépo-
fitioné. XIII. 301. ¿.La langue françoife n’a ni décUnaiions
-ni eas.'-I. 92.-¿. 723; ’b. Comment nous ihtfiqùônÿ lés rapports
que les. latins indiquoient, foit par leurs -ç^s, foit parleurs
prépofitions. I. 724» a. Pourquoi rtôs‘ gràmïuairieris fe
font.accoutumés à.attribuer des cas à la langue françoife.
IV. 641. à. Notre langue: qui' ñ’ndmet pomt^dé^cáS“dañs les
noms, en admet dans les proncims. XIII. 43ir. 'al, %
C a s irréductible du tfoïjième degré, ( Anâlyfe) célüî oti une
équation dû troifieme degré à fes trois ràcihéS réelles, inégales
& ineommenforables. Détails qui montrent que fi oh
réfout l’équation par la méthode ordinaire, la racine quoi-
que réelle^ fe, prefente fous une forme qui renferme des
quantités imaginaires, 8 c qü’on n’a jamais pu réduire cette
expreflion à une forme réelle. II. 7 3 6 . à. Comment il fe
peut faire qué cette racirié fe préfente fous une forfoe qui
contienne des imaginaires. Comment M. Nicole a réfôlu cettë
difficulté. Ibid. b. Cette racine du cas irrèduélible fe trouvé
aifémentpar la géométrie. Voye^ C o n s t r u c t io n . Cet inconvénient
en algebre vient de la méthode qu’on à employée
jufqu’ici pour réfoudre les équations du troifieme degré. En
quoi conlifteTimperfeâion de cette méthode. Cas particuliers
où. l’on pourroit aflîgner cette valeur algébrique. II»
737.- a. La racine étant incoinmenforable dans lé cas .irréductible
, l’expreflion réelle de cette racine, quand on la trouvèrent
, n’empêeheroit pas de recourir aux approximations.
Voyc{ A p pr o x im a t io n .
Nouvelles remarques fur les équations du troifieme degré. Pour
les réfoudre d’une maniéré complette, il faudroit inventer
une méthode qui fît trouver à la fois les trois racines. Obier-
vations for la méthode dont on fe fert pour trouver ces
racines. Explication des difficultés que cette méthode femblé
offrir. Ibid. b.
Ca s. ( terme de Palais ) Cas royaux : cas ptévôtaux /privilégiés
, eceléfiaftiques. II. 7 3 8 . b.
C as de confidence, ( Motàle ) définition. On examine fi
ceux qui attaqueht les dogmes d’une religion, font aufli
mauvais citoyens que ceux qui en attaquent la morale. II:
7 3 8 . b. C’eft ici fur-tout qixe l’équité veut qu’on diftingue
bien la perfonnê dé l’opinion, & l’auteur de l’ouvrage. Ca-
foiftes indulgens pour les autres, & aufteres pour eux-mêmes.
Ibid. 7 3 9 . a.
C a s réjervés. (Difciplir.c eetléfiafiique) Cas féfery.ês'àifpape;
foivant le rituel de Paris.’ Cas réfervés. à l’évêque. Ces réler-
vations -diftërtent foivant' í’úfáge des dtoeefés. Leur utilité.
Inftitution du prêtre' pénitencier. A l’article de la mort
tout prêtre peut abfoudre. Cas réfervés aux fupérieurs dans
les eouvens. II. 7 3 9 . a. ?
CASA SANTA dans î’églife de Lorétte : fa • defcription.
IX. 7 9 2 . A.
CASA“N , ( Géogr. ) ville.8 c royaume d’Afié. Productions
8c commercé du róyáume. II. 739. ¿. •
Cafan,: obfervations for ' cè royaume. XIV. 4 4 3 . a.
CASAQUE, étymologie' de ,ce mot. II. 7 3 9 . b.
Cdfaque militaire appellée fiagum. VIII. 1 3 . b. Cafaque gau-
loife.jo. b.
CASAS, (Barthelemide las) de Séville. XV. 134. a. Obfer-
vàtioris for fon traité de là. déftruCtion des- Indes. Suppl. I»
332. b. Ses efforts généreux pour adoucir le forf des infortunés
Mexicains.Suppl. III. 9 2 3 . ‘b.
CASATSCHIA-ORDA, ( Tartares de la ),XV. 9 2O . b.
CASCADE. ( Hydràüt) Csfcadë "na'türéíle“ OU cafarade^
Exemples. Cafeade artificielle ^Exemples. Grande 8c petite
cafcaae. II. 7 3 9 . ¿.
Cafihade, canal en cafeade. II. 3 8 3 . b. De’la diftribution
des eaux pour des eafeades 8 c buffets. IV. 1 0 6 3 . ¿. Caf-
eades de Tivoli. XVI. 3 6 2 . b. Celles du Velino. 8 7 9 » a. Cai-
eade dite ftanbach, dans le canton de Berne, vol. VI. des pl.
Regne minéral, glaciers, pl. a. Voyeç C a ta r a c t e s .
.C a s ca d e , ( Algeb. ) méthode des eafeades pour réfoudre
les équations, par M. Rolle. II. 7 3 9 . b. Méthode par laquellé
on approche des racines d’une équation, en réfolvant des
équations qui vont toujours en baiffant d’un degré. Elle par 1
roit avoir beaucoup de rapport à celle de M; Rolle. Expo-
fition 8 c démonftration de cette méthode. Ses inconvéniens»
II. 7 4 0 . A.
CASCARILLE ou C h a cr il , ( Botan. ) defcription de cette
écorce. En quoi elle différé du quinquina. II. 740. a. Avantages
qu’elle a for lui. Divers ulages auxquels Oh . l’a appliquée.
Dans quels cas on fe fert de la fobftancé où de la
teinture. Ses avantages for l’ipecaeuanha. Ibid. b:
CASCHGAR, (Géogr.) pays'd’Afie. Defcriptioil géographique
de ce royaume. Ses productions. II. 740. b.
CASE, ou Cafifie d’imprimerie, efpece de table en deux
P pp