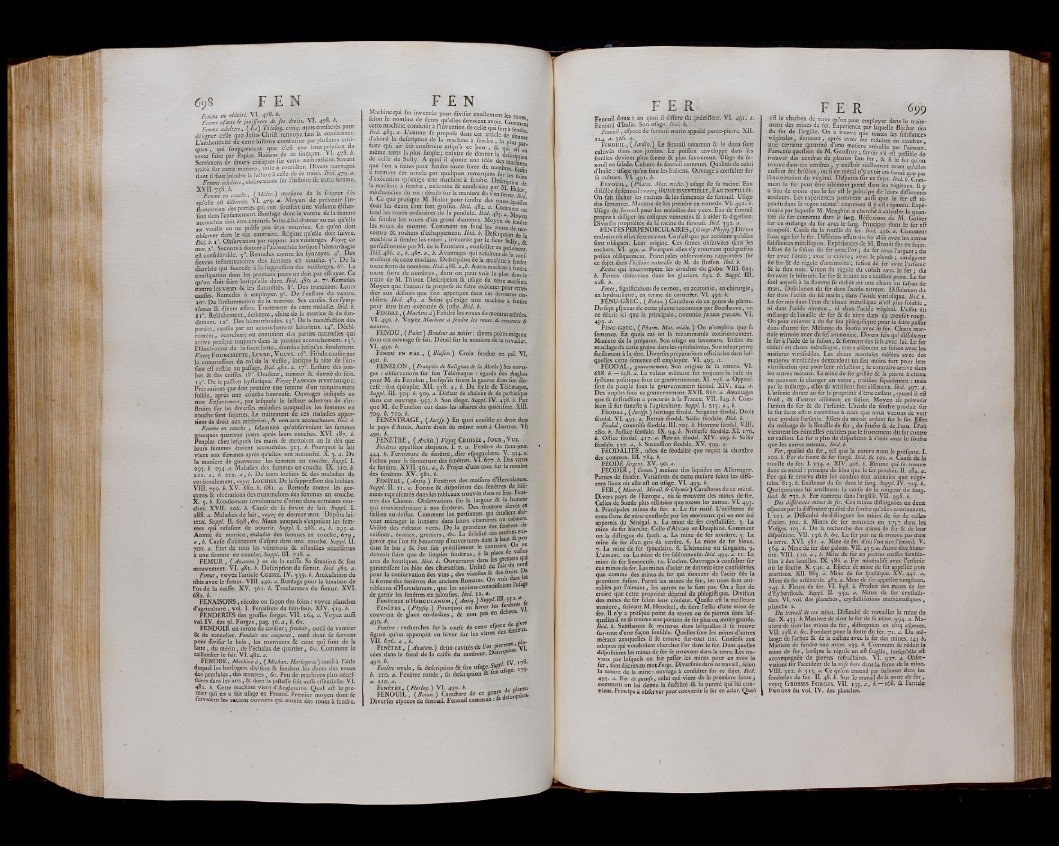
111
69S F E N
■ 1
Ftmmt tn viduifi. VI. 478. *■ , . ,
Femme ufante & jouijfante de [es droits. V1. 470. b.
Femme adultéré, (La) Thèolog. critiq. mots confacrés pour
déligner celle que Jefus-Chrift renvoya fans la condamner.
L’authenticité de cette hiftoire combattue par plufieurs critiques
, qui foupçonnent que c’eft une interpolation du
texte faite par Papias. Raifons de ce foupçon. VI. 478. é.
Sentimens de divers critiqués fur cette authenticité. Savant
traité fur cette matière, utile à consulter. Divers, ouvrages
dont il faut joindre la leélure à celle de ce traite. Jb,d 479. a.
Femme adultéré, obfervations fur Uuftoire de cette femme.
XVII. 7?8. b. . . , . . .
Femme en couche, (Medec.) manière de la foigner des
qu’elle eft délivrée. VI. 479- g M°yen de prévenir 1 inflammation
des parties qui ont fouffert une violente diften-
fion dans l’enfentemenr. Bandage dont le ventre de la femme
accouchée doit être entouré. Soins à lui dofiner au cas qu’elle
ne veuille ou ne puilfe pas être nourrice. Ce qu’on doit
obferver dans le cas contraire.-Régime qu’elle doit fuivre.
Jbid.b. i°. Obfervation par rapport aux vuidanges. Voye^ ce
mot. z°. Secours à donner à l’accouchée lorfque l’hémorrhagie
eft confidérable. 30. Remedes contre les fyncopes. ^4°. Des
fievres inflammatoires des femmes en couche. 50. De la
diarrhée qui fuccede à la fuppreflion des vuidanges. 6°. La
conftipation dans les premiers jours ne doit pas effrayer. Ce
qu’on doit faire lorfqu’eile dure. Ibid. 480. a. 70. Remedes
contre les vents 8c les flatuofités. 8°. Des tranchées. Leurs
caufes. Remedes à employer. 90. De l’enflure du ventre.
io°. De l’inflammation de la matrice. Ses caufes. Ses fymp-
tômes 8c divers effets. Traitement de cette maladie. Ibid. b.
i i ° . Relâchement, defeente, chûte de la matrice 8c du fondement.
12°. Des hémorrhoïdes. 130. Delà tuméfa&ion des
parties, caufée par un accouchement laborieux. 140. Déchirement,
écorchure ou contufion des parties naturelles qui
arrive prefque toujours dans le premier accouchemenr. 130.
Dilacération de la fourchette, étendue jufqu’au fondement.
Voyei F o u r c h e t t e , L e v r e , V u l v e . i 6 ° . Fiftule caufée par
la compreffion du col de la veifie, lorfque la tête de l’enfant
eft reftée au paffage. Ibid. 481. a. 170. Enflure des jambes
8c des cuiffes. 180. Douleur, tumeur 8c dureté du fein.
190. De la paflion hyftérique. Voye| P a s s i o n h y s t é r i q u e .
Précautions que doit prendre une femme d’un tempérament
foible, après une couche heureufe. Ouvrages indiqués au
mot Enfantement, par lefquels le lefteur achèvera de s’in-
ftruire fur les diverfes maladies auxquelles les femmes en
cbuche font fujettes. Le traitement de ces maladies appartient
de droit aux médecins, & non aux accoucheurs. Ibid. b.
Femme en couche , folemnité qu’obfervoient les femmes
grecques quatorze jours après leurs couches. XVI. 187. b.
Peuples chez lefquels les maris fe mettoient au lit dès que
leurs femmes étoient accouchées. 313. b. Pourquoi le îait
vient aux femmes après qu’elles ont accouché. X. 3. a. De
la maniéré de gouverner les femmes en couche. Suppl. I.
493. b. 294. a. Maladies des femmes en couche. IX. 210. b.
n i . a, b. 212. a , b. De leurs lochies 8c des maladies de
cet écoulement, voye^ L o c h i e s . De la fuppreflion des lochies.
VIII. 730. b. XV. 680. b. 681. a. Remede contre les gerçures
8c ulcérations des mammelons des femmes en couche.
X. 3. b. Ecoulement involontaire d’urine dans certaines couches.
XVII. 206. b. Caufe de la fievre de lait. Suppl. I.
288. a. Maladies de lait, voye| ce dernier mot. Dépôts laiteux.
Suppl. IL 698, &c. Maux auxquels s’expofent les femmes
qui refufent de nourrir. Suppl. I. 288. a, b. 295. a.
Atonie de matrice, maladie des femmes en couche, 679 ,
a , b. Caufe d’aliénation d’efprit dans une couche. Suppl. II.
700. a. Etat de tous les vêtemens 8c uftenliles néceffaires
à une femme en couche. Suppl. III. 718. a.
FEMUR, (Anatom.) os de la cuiffe. Sa fituation 8c fon
mouvement. VI. 481. b. Defcription du fémur. Ibid. 482. a.
Fémur, voyez l’article C u i s s e . IV. 539. b. Articulation du
tibia avec le fémur. VIII. 440. a. Bandage pour la luxation de
l’os de la cuiffe. XV. 361. b. Trochanters du fémur. XVI.
682. b.
FENAISONS, récolte ou façon des foins : voyez planches
d’agriculture, vol. I. Fenaifons du fain-foin. XIV. 519. b.
FENDERIES des groffes forges. VII. 164. a. Voyez auifi
vol.IV. des pl. Forges, pag. 36.a , b. bc.
FENDOIR en terme de cardier ; fendoir, outil de vannier
8c de tonnelier. Fendoir ou couperet, outil dont fe fervent
poür divifer le bois , les tourneurs 8c ceux qui font de la
latte, du mérin, de l’échalas de quartier, bc. Comment le
taillandier le fait. V I.'482. a.
FENDRE, Machine à , ( Méchan. Horlogerie) outil à l’aide
duquel les horlogers divifent 8c fendent les dents des roues
des pendules , des montres , bc. Peu de machines plus néceffaires
dans les arts, 8c dont la jufteffe foit aufli effenticlle. VI.
482. b. Cette machine vient d’Angleterre. Quel eft le premier
qui en a fait ufage en France. Premier moyen dont fe
fervoient lés anciens ouvriers qui eurent des roues à fendre.
F E N
Machine qui fut inventée pour divifer exactement les roi»*
félon le nombre de dents qu’elles de voient avoir. Comm?’
cette machine conduifit à l’invention de celle qui fort à W M M O p I M g p Ü dans ce. Ü É f Ü l
dabord la defcription de la machine à fendre, la plnS «7
faite qui. ait été conftruite jufau’à ce jour , 8c qui e<f
même tems la plus funple; enfuite de donner la deferint'6™
de celle de Sully. A quoi il ajoute une idée des machi
que l’on a faites pour fendre toute forte de nombres EnfiS
il, termine cet article par quelques remarques fur 1^ f0- n
d’exécution qu’exige une machine à fendre. Defcription T
la machine à fendre , exécutée 8c conftruite par M. Hui
méchaqicien du roi : détails fur la maniéré de s’en fervir w j
b. Ce que pratique M. Hulotjpour fendre des roues épaiffe*
dont les dents iont fort grofles. Ibid. 484. a. Comment
fend les roues ordinaires de la pendule. Ibid. 483. a. Move*
de fendre les roues d’un grand diamètre. Moyen de fendre
les rouqs de montre. Comment on fend les roues de rencontre
8c rochets d’échappement. Ibid. b. Defcription de là
machine à fendre les roues , inventée par le fleur Sully &
perfectionnée par M. de la Fautriere , confeiller au parlement
Ibid. 486. a , b. 487. a , b. Avantages qui réfultent de la conf-
truélion de cette machine. Defcription de la machine a fendre
toute forte de nombres. Ibid. 488. a,b. Autre machine à fendre
toute forte de nombres , dont on peut voir le-plan dans le
traité de M. Thiout. Defcription 8c ufage de cette machine
Moyen que l’auteur fe propofe de faire exécuter pour remédier
aux défauts que l’on apperçoit dans ces dernieres machines.
Ibid. 489. a. Soins qu’exige une machine à fendre
pour être bien exécutée 8c jufte. Ibid. b.
F e n d r e , (Machinea) Fendre les roues de montres arbrées.
VI. 490. b. Voyez Machine à fendre les roues de rencontre b
montres.
FENDU, (Point) Brodeur au métier: divers points inégaux
dont cet ouvrage fe fait. Détail fur la maniéré de le travailler.
VI. 490. b.
F e n d u e n p a l , ( Blafon ) Croix fendue en pal. VI.
490. b.
FENELON, ( François de Salignac de la Mothe ) Ses ouvrages
: oblervations fur fon Télémaque : égards des Anglois
pour M. de Fenelon , lorfqu’ils firent la guerre dans fon dio-
cefe : fon épitaphe. XII. 358. a ± b. Du ltyle de Télémaque;
Suppl. III. 305. b. 309. a. Défaut de chaleur 8c de pathétique
dans cet ouvrage. 953. b. Son éloge. Suppl. IV. 438. b. Part
que M. de Fenelon eut dans les affaires du quiétilme. XIQ.
709. b. 710. b.
FENESTRAGE, (Jurifp.) En quoi confifte ce droit dans
le pays d’Aunis. Autre droit du même nom à Chartres. Vil
490. b.
FENÊTRE, ( Archit. ) Voyt{ C r o i s é e , J o u r , V u e .
Fenêtres appellées abajours. I. 7. a. Fenêtre de faux-jour.
444. b. Fermeture de fenêtre,.dite efpaenolette. V. 954.c.
Fiches pour la fermeture des fenêtres. V I . 677. b. Des vitres
de fenêtre. XVII. 361. a , b. Projet d’une taxe fur le nombre
des fenêtres. XV. 581. b.
F e n ê t r e , (Antiq.) Fenêtres des maifons d’Herculanum.
Suppl. II. 11. a. Forme 8c difpofition des fenêtres de bâri-
mens repréfentés dans les tableaux trouvés dans ce lieu. Fenêtres
des Chinois. Obfervations fur la largeur 8c la hauteur
qui conviendroient à nos fenêtres. Des frontons élevés en
faillies au-deffus. Comment les perfonnes qui étudient do*"
yent ménager la lumière dans leurs chambres ou cabinets.
Utilité des rideaux verts. De la grandeur des fenêtres ae
cuifines, écuries, greniers, bc. La folidité des ^ exi”
geroit que l’on fit beaucoup d’ouvertures dans le haut oc pe
dans le bas ; 8c l’on fait précifément le contraire. un n
devroit faire que de fimples fenêtres, à la place de v
arcs de boutiques. Ibid. b. Ouvertures dans les greniers q
garantiffent les blés des charanfons. Utilité de 1 air du n ^
pour la confervation des vins, des viandes 8c des trui .
la forme des fenêtres des anciens Romains. On voit
tableaux d’Herculanum, que les anciens connoifloient iuia&c
de garnir les fenêtres en jaloufies. Ibid. 12. a.
F e n ê t r e s d ’H e r c u l a n u m , ( Antiq. ) Suppl. 1U- 3 5 * V
F e n ê t r e , (Phyfiq. ) Pourquoi en hiver les , .n yj,
couvrent de glace en-dedans, 8c non pas en de
Fenêtre : recherches fur la caufe de cette efpece d e j
figuré qu’on apperçoit en hiver fur les vitre6 des
VII. 676. a , b. • rfitix a pla*
F e n ê t r e , (Anatom.) deux cavités de 1 °i.P!-erDtion. VL
cées dans le fond de la caiffe du tambour. Defcnp
490. b. 1 ry, 178.
Fenêtre ovale, fa defcription 8c fon ufage. Supp •
b. 210. i Fenêtre ronde , fa defcription g «» » * n
a. 210. a.
F e n ê t r e , (Horlog.) VL 490. b. à plante-
FENOUIL, (Boun.) Caraftere de ce genre «
Diverfes efpeces de fenouil. Fenouil commun : I»
F E R
Fenouil doux en quoi il différé du précédent. VI. 491. <7.
Fenouil d’Italie, Son ufage. Ibid. b.
Fenouil, èfpecc de fenouil marin appellé perce-pierre. XII.
124. a. 326. a. • v ' '" f .
F e n o u i l , (Jardin.) Le fenouil commun 8c le doux font
cultivés dans nos jardins. Le poiffon enveloppé dans fes
feuilles devient plus ferme 8c plus favoureux. Ufage du fenouil
en falade. Culture du fenouil commun. Qualités de celui
d’Italie : ufage qu’en font les Italiens. Ouvrage à confulter fur
fa culture. VL 491. b.
F e n o u i l , (Pharm. Mat. midic.) ufage de fa racine. Eau
diftillée defénouil : voye^ H u i l e e s s e n t ie l l e , E a u d i s t i l l é e .
On fait fécher les racines 8c les femences de fenouil. Ufage
des femences. Maniéré de les prendre en remede. VI. 491. b.
Ufage du fenouil pour les maladies des yeux. Eau de fenouil
propre à difliper les coliques vénteufes & à aider la digeftion.
Diverfes propriétés de la racine de fenouil. Ibid. 392. a.
FENTES PERPENDICULAIRES, ( Géogr. Phyfiq. ) Divers
endroits où elles fe trouvent. Ce n’eft que par accident qu’elles
font obliques. Leur origine. Ces fentes obfervées dans les
rochers. Vl. 492. a. Pourquoi elles, s’y trouvent quelquefois
pofées obliquement. Principales obfervations rapportées fur
ce fujet dans l'hifloire naturelle de M. de Buffoii. Ibid. b.
•Fentes qui interrompent les couches' du globe. VIII. 623.
b. Fentes obfervées dans les glaciers. 692. b. Suppl. III.
228. b.
Fente, fignifications de ce mot, en anatomie, en chirurgie,
en hydraulique, en terme de cornetfer. VI. 492. b.
FÉNU-GREC, (Botan.) Caraélere de ce genre de plante.
De fept pfpeces de cette plante reconnues par Boerhaave, on
ne décrit ici que la principale, nommée feenum greccum. VI.
l'ENU-GREC, ( Pharm. Mat. médit. ) On n’emploie que fa
femence. En quels cas on la recommande extérieurement.
Maniéré de la préparer. Son ufage en lavemens. Utilité du
mucilage de cette graine dans les ophthalmies. Son odeur porte
facilement à la tête. Diverfes préparations officinales dans lef-
quelles cette femence eft employée. VI. 493. a.
FÉODAL, gouvernement. Son origine 8c fa nature. VI.
688. b. — 698. a. La valeur militaire fut toujours la bafe du
fyftême politique fous ce gouvernement. XI. 756. a. Oppref-
iion du peuple fous le gouvernement féodal. XIV. 144. a.
Des impôts fous ce gouvernement. XVII. 867. a. Avantages
que fa deftruétion a procurés à la France. VU. 849. b. Combien
il fut fu.nefte a l’agriculture. Suppl. I. 215. a , b.
F é o d a l , ( Jurifp. ) héritage féodal. Seigneur féodal. Droit
féodal. VI. 493. a. Retrait féodal. Saifie féodale. Ibid. b. •
Féodal, commife féodale. III. 703. b. Homme féodal. VIII.
280. b. Juftice féodale. IX. 94. b. Nobleffe féodale. XI. 176.
b. Office féodal. 417; a. Retrait féodal. XIV. 209. b. Saifie
féodale, ç27. a, b. Succefiion féodale. XV. 599. a.
FÉODALITÉ, aétes de féodalité que reçoit la chambre
des comptes. III. 784. b.
FÉODÉ fergent. XV. 90. a.
FÉODER, ( Comm. ) mefure des liquides en Allemagne.
Parties de féoder. Variations de cette mefure félon les diffé-
rens lieux où elle eft en ufage. VI. 493. b.
FER, ( Minéral. Métall. & Chymie) Carafteres de ce métal.
Divers pays de l’Europe , où le trouvent des mines de fer.
Celles de ¡Suede plus eftimées que toutes les autres. VI. 493.
b. Principales mines de fer. 1. Le fer natif. L’exiftence de
cette forte de mine conftatée par les morceaux qui en ont été
apportés du Sénégal. 2. La mine de fer cryftallifée. 3. La
mine de fer blanche. Celle d’Alvare en Dauphiné. Comment
on la diftingue du fpath. 4. La mine de fer noirâtre. La
mine de fer d’un gris de cendre. 6. La mine de fer bleue.
7. La mine de fer fpéculaire. 8. L’hématite ou fanguine. 9.
L’aimant. 10. La mine de fer fablonneufe. Ibid. 494. 4 .11. La
mine de fer limoneufe. 12. L’ochre. Ouvrages à confulter fur
ces mines de fer. Les mines d’acier ne doivent être confidérées
que comme des mines de fer qui donnent de l’acier dès la
première fufion. Parmi les mines de fer, les unes font atti-
rables par l’aimant, les autres ne le font pas. On a lieu de
croire que cette propriété dépend du phlogiitique. Divifion
des mines dé' fer félon leur couleur. Quelle en la meilleure
manière, fuivant M. Henckel, de faire l’effai d’une mine de
fer. Il n’y a prefque point de terres ou de pierres dans lef-
quellesil ne le trouve une portion de fer plus ou moins grande.
Ibid. b. Subftances 8c matières dans lefquelles il fe trouve
fur-tout d’une façon fenfible. Quelles font les mines d’autres
métaux auxquelles il fe trouve fur-tout uni. Confeils aux
adeptes qui voudraient chercher l’or dans le fer. Dans quelles
difpofitions les mines de fer fe trouvent dans la terre» Les travaux
par lefquels on fait paffer les mines pour en tirer le
fer, font décrits au mot Forge. Diveriités dans ce travail, félon
la nature de la mine : ouvrage à confulter fur ce fujet. Ibid.
495. a. Fer de gueufe, celui qui vient de la première fonte j
comment on lui donne la duétilité 8c la pureté qui lui convient.
Principe à obferver pour convertir le fer en acier. Quel
F E R 6 9 9
eft le charbon de terre qu’on peut employer dans le traite-
ment des m,nés de fer. Expérience par laquelle Bêcher tira
du fer de l argille. On a trouvé que toutes les febftances
végétales, donnent, après avoir été réduites en cendres
une certaine quannte dune matiete atritable par l’aimant!
Fameufe queftion de M. Geoffroy ; favoir s’il eft poflible de
trouver des cendres de plantes fans fer , 8c fi le fer qu’on
trouve dans ces cendres , y exiftoit réellement avant qu’elles
euffent été bridées, ou fi ce métal n’y avoit été formé que par
l’incinération du végétal. Difputes fur ce fujet. Ibid. b. Comment
le fer peut être aifément porté dans les végétaux. 11 y
a lieu de croire que le fer eft le principe de lèurs différentes
couleurs. Les expériences prouvent aufli que le fer eft répandu
dans le regne animal : comment il y eft répandu. Expérience
par laquelle M. Menghini a cherché à calculer la quantité
de fer contenue dans le fang. Réflexions de M. Gefner
fur ce mélange du fer avec le fane. Principes dont le fer eft
compofé. Caufe de la rouille du ter. Ibid. 496. a. Comment
l’eau agit fur le fer. Différens effets du fer allié avec les autres
fùbftances métalliques. Expériences de M. Brandt fur ce fujet.
Effets dé la fufion du fer avec l ’or ; du fer avec l’argent; du
fer avec l’étain; avec le cuivre; avec le plomb ; amalgamé
de fer & de régule d’antimoine ; fufion du fer avec l’arfenic
8c le flux noir. Union du régule du cobalt avec le fer ; du
fer avec le bifmuth. Le fer 8ç Te zinc ne s’uniffent point. Le fer
feul expofé à la flamme fe réduit en une chaux ou fafran de
mars. Diffolution du fer dans l’acide nitreux. Diffolution du
fer dans l’acide du fel marin ; dans l’acidé vitriolique. Ibid. b.
Le fer mis dans l’état de chaux métallique n’eft plus foluble ,
ni dans l’acide nitreux , ni dans l’acide végétal. L’effet du
mélange de limaille de fer 8c de nitre dans un creufet rougi.
On peut enlever à du fer fon phlogiitique pour le faire paflér
dans d’autre fer. Mélange du loufre avec le fer. Chaux martiale
triturée avec du fel ammoniac. Divers fels qui diflolvent
le fer à l’aide de la fufion, 8c forment des fels avec lui. Le fer
réduit'en chaux métallique, entre aifément en fufion avec les
matières vitrifiables. Les chaux martiales mêlées avec des
matières vitrifiables demandent un feu moins fort pour leur
vitrification que pour leur réduction ; le contraire arrive dans
les autres métaux. La mine de fer grillée 8c la pierre à chaux
ne peuvent fe changer en verre , traitées féparément : mais
par le mélange, elles fe vitrifient fort aifément. Ibid. 497. a.
L’arfenic donne au fer la propriété d’être caflant, quand il eft
froid, 8c d’entrer aifément en fufion. Moyen de prévenir
l’union du fer 8c de l’arfenic. L’acide du foufre produit fur
le fer deux effets contraires à ceux que nous venons de voir
que produit l’arfenic. Effets du miroir ardent fur le fer. Effet
du mélange de la limaille de fer , du foufre 8c de l’eau. D’où
viennent les étincelles excitées par le frottement du fer contré
un caillou. Le fer a plus de difpofition à s’unir avec le foufre
que les autres métaux. Ibid. b.
Fer, qualité du fer, tel que la nature nous le préfente. I.
100. b. Fer de fonte 8c fer forgé. Ibid. 8c 101. a. Caufe de la
rouille du fer. I. 23 4. a. XIV. 406. b. Bitume qui fe trouve
dans ce métal : principe du bleu que le fer produit. II. 284. a.
Fer qui fe trouve dans les cendres tant animales que végétales.
813. b. Exiftence du fer dans le fang. Suppl. IV. 725. b.
Quelques-uns lui attribuent la caufe de la rougeur du iàng.
Ibid. 8c 731. b. Fer contenu dans l’argillè. VII. 998. b.
Des différentes mines de fer. .Ces mines diftinguées en deux
efpeces par la différente qualité du foufre qu’elles contiennent.
I. 101. a. Difficulté de aiftinguer les mines de fer de celles
d’acier. 102. b. Mines de fer trouvées en 1737 dans les
Vofges. 103. b. De la recherche des mines de fer 8c de leur
difpofition; VII. 136. b. &c. Le fer pur ne fe trouve pas dans
la terre. XVI. 581. a. Mine de fer d’où l’on tire l’émeril. V.
364. a. Mine de fer dite galene. VII. 43 3. a. Autre dite hématite.
VIII. 110. a , b. Mine de fer en petites maffes fembla-
bles à des lentilles. IX. 386. a. Fer minéralifë avec l’arfenic
ou le foufre. X. 541. a. Efpece de mine de fer appelléë pois
martiaux. XII. 883. a. Mine de fer fpathique. XV. 441. a.
Mine de fer arfénicale. 482. a. Mine de fer appelléetungfteen.
743. b. Fleurs de fer. Vl. 838. b. Produit des mines de fer
d’Eybenftock. Suppl. II. 932. a. Mines de fer cryftalli- ,
fées. VI. vol. des planches, cryftalli Cations mathématiques,
planche l
Du travail de ces mines. Difficulté de travailler la mine de
fer. X. 433. b. Maniéré de tirer le fer de fa mine. 99*4. a. Maniéré
de tirer les mines de fer, diftinguées en cinq efpeces.
Vil. 138. b. &c. Fondant pour la fonte du fer. 71. a. Du mélange
ae l’arbue 8c de la caftine avec le fer des mines. 143 b.
Maniéré de fondre une mine. 239. b. Comment fe réduit la
mine de fer, lorfque le régule en eft fragile, lorfqu’eile eft
accompagnée de pierres réfraâaires. VI. 917. a. Obfervations
fur l’accident de la mife hors dans la fonte de la mine.
VIII. 312. b. 313. a. Ce qu’on entend par ballotter dans les
fonderies de fer. II. 48. b. Sur le travail de la mine de fer,
voyei G r o s s e s F o r g e s . VU. 135.a , b.— 168. 8c l’article
F o r g e s du vol. IV. des planches.