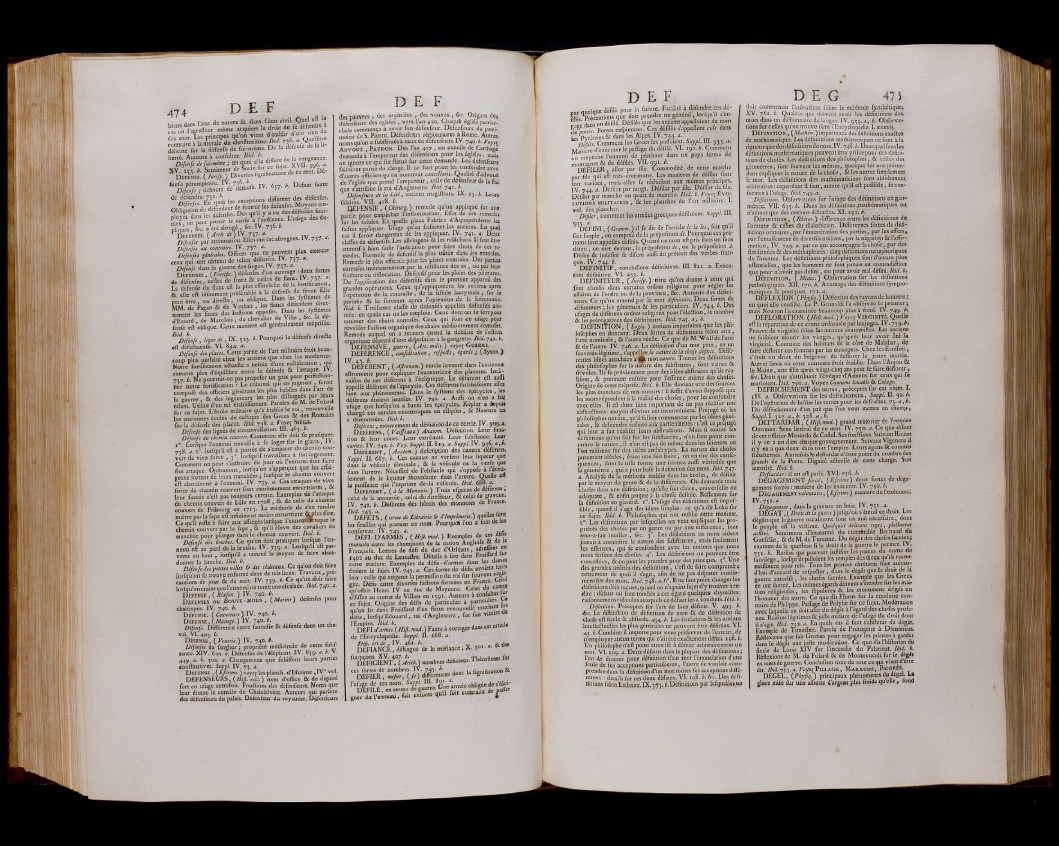
474 D E F
, n, vtat ¿c nature & dans l’état civil. Quei J j
”!> l’aereflcur même acquiert le droit de fc dcfendr
xvDír,s^ ~ Difenfe
péremptoire. IV. 736. % IV- «57. ui- TDìAi&fauutt ffaaute
de défendre. 73 „ ceptl0n, différent de» définis.
¡ S s|ÿrtSferrLWasc ““d“' pliques, Oc. a été a b r o g éOc. IV.736.É.
j ^ l Î ln 'É .K n l é t é a b r o g é « . IV. W
*¡$¡$¡1 fé t*2» .lO B c« 7que ne peuvent plus exercer
J / c î o t X ^ u de .cllesVenfe.. IV 737- «•
Défenfc dans la guerre des ficecs. I V. 737. <*• f
D e fe n s e s , ( Fortifie.') défcnfcs d un ouvrage : deux fort«
de défenfes, celles de front 8c celles de flanc. IV* 737.
La défenfc du flanc cft la plus effenne e de la fortification,
& elfc ëft infiniment préférable à la defcefc de frrmc Elle
peut être, ou direde, ou oblique. Dans les fyftemesoe
SlM de Pagan fit de Vauban , les flancs défendent dircc
S t r h X Î d - baftions oppofés. Dam l e syf t éms
d’Errard , de Marolois, du chevalier de Ville , O c .u a e
fenfe eft oblique. Cçtte maniéré eft généralement méprifét.
mù L f . , lime de , IX. 5x3. t. Pourquoi la défenfc direae
' ^ “ I p J r r . 'à V p a r t l e de fart militaire é.oit beaucoup
plus parfaite chez les anciens que chez k s moicmv.
m Notre fortification hSildle a befom d une réification , qui
remette plus d'équilibre g entre la m défenfc 8c l'attaque D
g
1 a f ..... i. n.rwiAÎor un nrix DOUt DCriCCtlOi
n « notre fomficadon ? Le tribunal qu, cn iugero r feroit
compofé dès officiers généraux les plus babdes dans 1 art de
la guerre, 8c des ingénieurs les plus diflingufe PV •«“ "
talens. Utilité d’un tel établiffement. Paroles de M. deFolard
fur « Met. L'école miliuire qu'a établie le ro., renouvelle
le . anciennes écoles de ta8ique des Grecs & des Romains
fur là défenfc des places. Uni 738. x. Voya SiêGE.
Défenfc des lignes de circonvallation. 111. 4^5
Défenfc du chemin couvert. Comment elle doit fe pratiquer.
i°. Lorfque orlquc l’ennemi i ennemi travaille iravauiv 4 * *fe v loger —-fur -—le a
glacis, IV.
« 1. a",1. .lorfuu’il e vi cft il i à portée Ln 73de e s'emparer omrvirnF ni!du 1
chemin coule
®* f
vert de
vive force , 3’ . lorfqull travaillera à fon logement,
Comment nent onpeut on peut sinwmrcs’inftruire «du « jour où l'enncrm ----- doit - - - S
faire
fou attaque. Opérations, lorfqu’on s apperçoit que les affié
geans fortent de leurs tranchées ; lorfque le chemin couvert
fft abandonné à l'ennemi. IV. 739- -• Ces attaques de vive
force du chemin couvert font extrêmement mcurineres , OC
leur fuccés n’eft pas toujours certain. Exemple, dn attaque
du chemin couver, de Lille-en .708 . Sc d c ^ ÿ ' «
D E F
des pauvres , des orphelins , des veuves , Oc. Origine de»
défenfeurs des églifes , vers l’an 4*°* CharnÆ églife patriar-
chalc commença à avoir fon défenfeur. Défenfeurs du patrimoine
de S. Pierre. Défenfeurs régionnaires à Rome. Autres
noms qu’on a fubftitués à ceux de défenfeurs. IV. 740. b. Voyt1
Ad v o u é , P a t r o n . Dès l’an 407 , un concile de Carthage
demanda à l’empereur des défenfeurs pour les églifes : mai»
on ignore ce qui fut ftatué fur cette demande. Les défenfeur»
faifoicnt partie du clergé. 11 ne faut point les confondre avec
d’autres officiers qu’on nommoit cancellarii. Qualité d’advoué
de l’églife que prend l’empereur, celle de défenfeur de la foi
que s'attribue le roi d’Angleterre. Ibid. 741. b.
Défenfeurs de la Cité, anciens magiftrats. LX. 13. b. Leur»
falaires. VIL 418. b.
DÉFENSIF, ( Chirurg. ) remede quon applique fur une
partie pour empêcher rinflammation. Effet de ces rcmedes
lur les folides. En quelle place Fabrice d’Aquapendente le»
faifoit appliquer. Ulàgc qu’en faifoicnt les anciens. En quel
cas il feroit dangereux de les appliquer. IV. 741. 4. Deux
claflcs de défenfifs. Les aftringens fie les rclâchans. Il faut être
attentif à bien faifir l’indication pour faire choix de ces remèdes.
Formule de défenfif la plus ufitée dans les entorfes.
Remede le plus efficace pour les plaies contufcs. Des partie*
contufes intérieurement j>ar la réfiftancc des os , ou par leur
fraéluré ou diflocation. Défcnfif pour les plaies des jointures.
De l’application des défenfifs dans le premier appareil des
grandes opérations. Ceux qu’appliquoient les anciens après
l’opération de la cataraéfe, de la fiftule lacryma c ; fur le
perinée 8c le ferotum après l’opération de la lithotomie.
ibid. b. Troificme clafle de défenfifs appcllés défenfifs animés
: en quels cas on les emploie. Ceux dont on fe fert pour
ranimer des chairs contufcs. Ceux qui font en ufage pour
réveiller l’aétion organique des chairs médiocrement contufes.
Remede auquel on a recours quand la débilité de l’aâion
rganique dépend d’une difoofition à la gangrène. Ibid. 74a. b.
DÉFENSIVE, guerre, ( Art. mdit. ) « GuiRRE.
DÉFÉRENCE, confidéralion, refpcÛs, égards i (Synon.)
DÉFÉRENT, ( Aflronom.) cercle inventé dans l’ancienne
aftrohomie pour expliquer l’excentricité dcs pUnctes. lnclb-
naifon de ces déférens à l’édiptiquc. Le déférent eft aufft
appcllé déférent de l’épicycle. Ces déférens fausfaifoicnt aile*
■ . i l . ____ I. net mirvclflfi . le»
couvert ac uuc c« ~ , 7 r. nAr.
couvert de Fribourg en 1713. Le: méthode de «*» « “ «
maître par la fape cft infiniment moins meurtricre ficplus lure.
Ce qu’il refle à faire aux affligés lorfque l’ennemwitmquc le
chemin couvert par la fape , & qu'il éleve des «vahers de
tranchée pour plonger dans le chemin couvert. Ibid. b.
Définit det brechtt. Ce qu'on doit prauquer lorfque 1 ennemi
cil au pied de la brcchc. IV. 739. .. Lorfquil eft parvenu
au haut, lorfqu’il a trouvé le moyen de fiure aban-
donner la brcchc. Ibid. b. .
Défenfc des petites villes 0 des chauaux. Ce au on doit taire
lorfqu’on fe trouve enfermé dans de tels lieux. Travaux , précautions
de jour 8c de nuit. IV. 739. b.Ce
lorfqu’on craint que l’cnncmi ne tente uneefealade. Ibid. 740. *.
D é fe n s e , ( Blafon. ) IV. 740. b. _ . ■
D é fe n s e s o u R o u t e - h o r s , ( Marine ) défenfes pour
Chaloupes. IV. 740. b.
D é fe n s e . ( Couvreurs ) IV. 740. b.
D é f e n s e , ÏManege.) IV. 740. ^.
n/r../*. /.ntrib. fanrdtfie
DEFENSE, tmaneee. )iv . 74».y.,
Défenfc. Différence entre fantaifie 8c défenfe dans un cheval
VI. 403. b.
D é fe n s e , (Vénerie.) IV. 740. b.
Défenfes du fanglicr ; propriété médicinale de cette *u®‘"
tance. XIV. 6oo. 0. Défenfes de l’éléphant. IV. 839. a. b. V.
449. a. b. 50a. a. Changemens que fubiffent leurs parties
COnftitUtÎVeS, SunnI IV nu A
*.Vàiiangemcns luuineiu
Suppl. IV. 73. a.
, ( Escrime. ) voye^ lcs planch. d’Efcrime, IV* vol.
D é fe n s e , f
DÉFENSE
DEFLW&EURS, (Hift. ecel.) nom d’office 8c de dignité
fort en ufage autrefois. Fondions des défenfeurs. Noms que
leur donne le concile de Chalcédoine. Auteurs qui parlent
des défenfeurs du palais. Défenfeur du royaume. Défenfeurs
bwn aux phénomenet 6 a „ i le fyftéme des épicyelet,!»
déférens etoient inutiles. IV. 74a. a. Auffi on n en a fait
ufage que lorfqu’on a banni les épicycles. Képler a depuis
changé ces cercles excentriques en ellipfes , 8c Newton les
a démontrées. Ibid. b.
Déférent, mouvement de déviation de ce cercle. AV. 909.4.
Déférens, ( Vtijfeaux) Anatom. Définition. Leur iitua-
tion fie leur cours. Leur extrémité. Leur fubftance. Leur
cavité. IV. 74a. b. Voy. Suppl. II. 819. a. Suppl. IV. 936. a, b.
Dé fé ren t, (Anatom.) defeription des canaux deterens.
Suppl. II. 687. b. Ces canaux ne verfent leur liqueur que
dans la véficulc féminale, Sc la véficule ne la verfe que
dans l’uretre. Néceffué de l’obftacle qui s’oppofe à 1 écoulement
de la liqueur fécondante dans l’uretre. Quelle eft
la puiffance qui l’exprime de-la véficule. Ibid. 688.0.
D îfÉ ren t, ( i la Monnoie.) Trois efoeces de déférens,
celui de la monnoie, celui du dircâeur, ÔC celui du graveur.
IV. 74a. b. Déférens des hôtels des monnoies de France.
Ibid. 743. a.
DÉFETS,
DJÈFÉTS , (irnnt de librairie & d:Imprimerie.) quelle« fiml
les feuille» qui portent ce nom. Pourquifi l’on a Win de la
feuilles qL- r -----
C°DÉFl- D 'A RM is t ( Hifi. mod. ) Exemple» de ce» défo
mutuels entre le» champion» de la nation Angloife K oc
Françoifc. Lettre» de défi du duc d'Orléans, adreffiej en
;40a au duc de Lancaûre. Détails à lire dans FronBar
cette matière. Exemples de défis-d’armes dont les
étoient le fujer. IV. 743. a. Ces fortes de défis »voient leu
loix : celle qui exigeoit fe permiifion du roi fut fouvent y*
gée. Défis entre diverfes faflions formées en France, ^e
qu’offrit Henri IV au duc de Mayenne. Celui du corme
d’Effex au comte de Villars en 159«. Auteurs à coniulter >
ce fujet. Origine des défis de particulier 4 particulier-
qu’on lit dans Froiffard d’un ftatut rcnimveüé toucivmt
défis, lorfqu’Edouard, roi d’Angleterre, fut fait view
l’Empire, ibid. b. article
DÉFI d'armes ( Hifl. mod. ) Faute à corriger dans cet a
de l’Encyclopédie. Suppl. II. 688. a.
Défi, cri de , IV. 461. b. ■ _ _ , „ a. ¿e»
DEFIANCE, diftingué de la méfiance, X. 301'
b r e . défie,ens-Théorêm.» t e
ce& d: » « r - * - h m 1
l’ufage de ces mots. Suppl. III. obligée de s’éloi-
DEFILÉ, en terme d ^ " eÆ ¿ I t coiurJu de
gner de l’ennemi, feit enforte qu» »w« vwa* 4
D E F
J.nc lin défilé. Défilés que les anciens appelloicnt du nom
K L , Portes cafpiennes. Ces défilés s’appellent cols dans
les Pyréné« 8c dans les Alpes. IV. 744. e. .
nklts Comment les Grecs les paffoicnt. Suppl. III. 935.0.
Maniéré d’cxicutcr le paffage du défilé. VI. 191. b. Comment
011 empêche l’ennemi de pénétrer dans un pays terme de
montagnes 6c de défilés. VII. 991, ,
DÉFILER, aller par file. Commodité de cette marche
par file qui eft très-commune. Les maniérés de défiler font
fort varices, mais elles fê réduifent aux mômes principes.
IV. 744. Défiler par rangs. Défiler par file. Défiler de file.
Défiler par manche ou quart de manche. Ibid. b. Voyçi E v o l
u t i o n s m i l i t a i r e s , & les planches de l’art militaire. 1.
vol. des planches. ... . V • ' . _ . TÎT
Défiler, comment les armées grecques défiloicnt. buppt. ni.
9 ,Î)ÉFINI, ( Gramm.) il fc dit de l'article le la les, foit qu'il
foit fimple, ou compofe de la prépofition ¿¿. Pourquoi ces prénoms
font appellés définis. Quand un nom eft pris dans un iens
défini, on met devant, la prépofition de, ou la prépofition a.
Défini 8c indéfini fc difent aufli du prétérit des verbes fran-
çois. IV. 744. b. _ , ~
DÉFINITIF, concluions définitives. III. 8a 1. a. Exécution
définitive. VI. 233. b. . ...
DÉFINITEUR, (Jurifp.) titre quon donne à ceux qiu
font choifis dans certains ordres religieux pour régler les
affaires de l’ordre ou de la province, 8cc. Autorité des dérini-
tcurs. Ce qu’on entend par le mot définitoirc. Deux fortesde
définiteurs ; les généraux 8c les particuliers. IV. 744. b. Des
ufiges de différons ordres religieux pour l’éleftion, le nombre
8c les prérogatives des définiteurs. Ibid. 745. a, b.
DÉFINITION, ( Logtq. ) notions imparfaites que les phi-
lofophes en donnent. Deux fortes de définitions félon eux,
l’une nominale, 8c l’autre réelle. Ce que dit M. Wolfdclunc
8c de l’autre. IV. 746. a. La définition d’un mot peut, en un
fens très-légitime, s’appeller la nature delà chofe définie. Différentes
idées attachées 4 é£t niot nature. Toutes les définitions
des philofophes fur la nature des fubftances, font vaines 8c
frivoles. Ils fe préviennent pour des idées abftraites qu ils réa-
lifcnt, 8c prennent enfuite pour l’effencc même des chofcs.
Origine de cette méprife. Ibid. b. Elle devient une des fources
les plus étendues de nos erreurs : il fuffit d’avoir fuppofé que
■ les mots répondent à la réalité des chofes, pour les confondre
avec elles. Il cft donc bien important de ne pas réalifer nos
abftraâions : moyen d’éviter cet inconvénient. Préjugé ou les
philofophes ont été, qu’il faUojt commencer par les idées générales
, oc defeendre enfuite aux particularités : c’eft ce préjuge
qui leur a fait réalifer leurs abftraûions. Mais fi toutes les
définitions qu’on fait fur les fubftances, n’en font point con-
noître la nature, il n’en eft pas de môme dans les fcienccs où
l’on raifonne fur des idées archétypes. La nature des chofes
purement idéales, étant une fois fixée, on en tire des confé-
qucnces, dont le tiffu forme une fcience auffi véritable que
la géométrie, qui a pour bafe la définition des mots. Ibid. 747.
a. Analyfc de fa méthode établie dans les écoles, de définir
par le moyen du genre 8c de la différence. On demande trois
chofes dans une définition j qu’elle foit claire, universelle ou
adéquate, 8c enfin propre 4 la chofe définie. Réflexions fur
la définition en général. i°. L’ufage des définitions cft impof-
fiblc, quand il s’agit des idées fimplcs : ce qu’a dit Loke fur
ce fujet. Ibid. b. Philofophes qui ont oublié cette maxime.
a°* Les définitions par lefquclles on veut expliauer l'es propriétés
des chofes par un genre ou par une différence, font
tout-4-fait inutiles, Oc. 3“. Les définitions ne nous aident
jamais à connoitre la nature des fubftances, mais feulement
les eflcnces, qui fc confondent avec les notions que nous
nous faifons des chofcs. 40. Les définitions ne peuvent être
contcftécs, 8c on peut les prendre pour des principes. 50. Une
des grandes utilités des définitions, c’cft de faire comprendre
nettement de quoi il s’agit, afin de ne pas difputer inutilement
fur des mots. Ibid. 748. a. 6°. Il ne faut point changer les
définitions déjà reçues, quand on n’a point fujet d’y trouver 4 redire
: défaut où font tombés 4 cet égard quelques chymiues:
raifonnemens ridicules auxquels ce défaut les a conduits. Ibid. b.
Définition. Préceptes fur l’art de bien définir. V. 493. b.
Oc. La diftinéMon de définition de nom 8c de définition de
chofe eft futile 8c abfurdc. 494. b. Les fenfations 8c les notions
intcllcéluelles les plus générales ne peuvent être définies. VI.
43. b. Combien il importe pour nous préferver de l’erreur, de
n employer aucun terme qui n’ait été exaélement défini. ip8. b.
Un philofophe n’eft point autorifé 4 définir arbitrairement un
mot. VI. 109. a. Deux défauts dans la plupart des définitions ;
l’un de donner pour définition d’un mot rénonciation d’une
feule de fes acceptions particulières, l’autre de vouloir comprendre
dans la définition d’un mot toutes fes acceptions différentes
: détails for ces deux défauts. VI. 108. b. Oc. Des définitions
félon Lcïbnitz. IX. 373. b. Définitions par lefquellcson
D E G 4 71
doit commencer l’inflru&ion félon la méthode {ymliétiquc.
XV. 762. b. Qualités que doivent avoir les définitions des
mots dans un diâionnairc de langue. IV. 959.a , b. Obferva-
tions fur celles qu’on trouve dans l’Encyclopédie. I. xxxvij.
D é f i n i t i o n , (Mathém.)1 importance des définitions exa&es
de mathématique. Les défiuititions mathématiques ne font à la
rigueur que des définitions de nom. IV. 748. b. Dans qqel fens les
définitions mathématiques peuvent être prifes pour des définitions
de chofcs. Les définitions des philofophes, 8c celles des,
géomètres, font fouvent les mômes, auotquc les uns prétendent
expliquer la nature de la chofe, 8c les autres Amplement
le mot. Les définitions des mathématiciens font absolument
arbitraires : cependant il faut, autant qu’il eft poifible, fe conformer
à l’ufage. Ibid. 749. a.
Définition. Obfervations fur l’ufage des définitions ert géométrie.
VII. 633. b. Dans les définitions mathématiques on
n’admet que des notions diftinélcs. XI. 252V b.
D é f i n i t i o n , (Rhétor.) différence entre les définitions de
l’orateur 8c celles du dialeâicicn. Différentes fortes de définitions
oratoires, par l’ènumération des parties, par les effets»
par l’entaffcment de diverfes notions, par la négation 8c l’affirmation,
IV. 749. a. parce qui accompagne la chofe, par des
fitnilitudcs 8c des méthaphorcs : cinq définitions métaphoriques
de l’homme. Les définitions philofophiques font d’autant plus
effenticlles, que les hommes ne font jamais en contradiction
que pour n’avoir pas défini, ou pour avoir mal défini. Ibid. K
D é f in i t io n » ( Médec. ) Oblervation fur les définitions
pathologiques. XII. 170. b. Avantage des définitions fympto-
matiques & pratiques. 171. a.
DEFLEXION. (Phyfia.) Déflexion des rayons de lumière :
en quoi elle confiftc. Le P. Grimaldi l’a obfervée le premier ;
mais Newton l’a examinée beaucoup plus 4 fond. IV. 749. w
DEFLORATION. (Hifi. mod.) Voyt* V i r g i n i t é . Quelle
eft la réparation de ce crime ordonnée par les juges. IV» 739. b.
Preuve de virginité félon les anciens anatomiftes. Les anciens
ne faifoicnt mourir les vierges, qu’après leur avoir ôté la
virginité. Coutume des habitans de la côte de Malabar, de
faire déflorer ces femmes par les étrangers. Chez les Écoffois,
c’étoit un droit du Seigneur de déflorer la jeune mariée.
Autres lieux où cette coutume étoit établie. Dans l’Aniou 8c
le Maine, une fille après vingt-cinq ans peut fe faire.dé/lorer *
Oc. Droit que s’attriouoit l’évêque d’Amiens fur ceux qui fe
marioient. Ibid. 750. a. Voyez Coutume louable 8c Culage»
DÉFRICHEMENT des terres, préceptes fur cet objet. I*
188. a. Obfervations fur les défricncmcns, Suppl. II. 30. b.
De l’opération de brûler les terres pour les défricher. 73. a t b.
Du défrichement d’un pré que l’on veut mettre en champ,
Suppl. t. 327. «, b. 328. a, b.
DEFTARDAR, (Hifi.mod.) grand tréforier de 1 empiré
Ottoman. Sens littéral de ce mot. IV. 750. a. Ce que difent
de cet officier Méninski 8c Caftel. Scs fonftions. Suivant Ricant
il y en a un dans chaque gouvernement. Suivant Vigenere il
n’y en a que deux dans tout l’empire. Leurs agens 8c commis
fubaltcrnes. Autrefois le deftardar n’étoit point du nombre des
grands de la Porte. Dignité aéhielle de cette charge. Soii
autorité. Ibid. b.
Deftardar: il en cft parlé. XVI/756. b. „
DEGAGEMENT forcé, (Efcrimc) deux fortes de dégagement
forcés: maniere de les exécuter. IV. 750. b.
DÉGAGEMENT volontaite, ( Efcrimc ) maniere de 1 exécuter,
lV .7 j1 .tf
Dégagement, dans la gravure en bois. IV. 751. a.
DEGAT j (Droit de la guerre) jufqu’où s’étend ce droit. Les
dégâts que la guerre occafionne font un mal néceffaire, dont
le peuple eft la viftime. Quidquid délirant reges, pleÜimtur
acmvi. Sentimcns d’humanité du connétable Bertrand du
Guefclin, 8c de M. deTurenne. Du dégât des chofes facréesç
examen de la queftion fi le droit de la guerre le permet. IV.
7 0 . b. Rai fon qui pouvoit juftificr les païens du crime de
facrilegc, lorfqu’ds pilloient les temples des dieux qu ils recon-
noiffoient pour tels. Tous les princes chrétiens font aujourd’hui
d’accord de refpeétcr, dans le dégât que le droit de 14
guerre autorifé, les chofes facrécs. Exemple que les Grecs
en ont donné. Les mêmes égards doivent s’étendre fur lésinai?
fons religieufes, les fépulcres 8c les mojiumens érigés en
l’honneur des morts. Ce que dit Florus fur la conduite contraire
de Philippe. Paffage de Polybe fur ce fujet. Modération
avec laquelle on doit ufo* du dégât 4 l’égard des chofes profa-
| nés Raifons légitimes 8c jufte mefure de l’ufage du droit dont
il s’agit. Ibid. 752. a. En quels cas il faut s’abftenir du dégât.
Exemple de Timothée. Parole de Protogcne 4 Déinétrius.
Réflexions que fait Grotius pour engager les princes4 garder
dans le dégât une jufte modération. Ce que dit l’hiftonen du
ficcle de Louis XIV fur l’incendie du Palatinat. Ibid. b.
Réflexions de M. de Folard & de Montecuculi fut le dêgli
en temsde guerre. Conclufion tirée de tout ce qui vient d’être
dit. Ibid.7 ^ .a. Voye{P i l la g e , Maraude, Picorée.
DEGEL, (Phyfiq.) principaux phénomènes du dégel. La
glace rniic fur une aiuctte d’argent plus froide quelle, fond