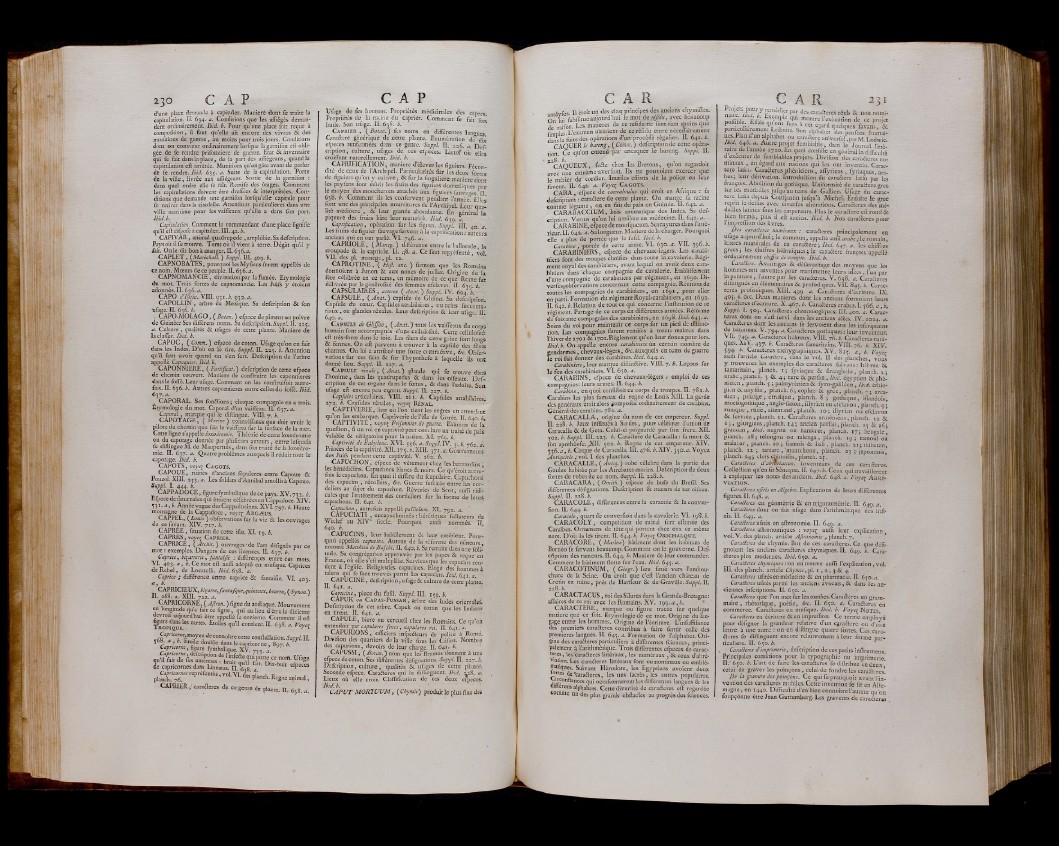
2 } o C A P CAP d’une place demande à capituler. Maniéré dont fe traite la
capitulation. II. 634. a. Conditions que les affiégés demandent
ordinairement. Ibid. b. Pour qu’une place foit reçue à
compofirion, il faut qu’elle ait encore des vivres oc des
munitions de guerre, au moins pour trois jours. Conditions
dont on convient ordinairement lorfque lagarnifon eft obligée
de fe rendre prifonniere de guerre. Etat & inventaire
qui fe fait dans la place, de la part des aflîégeans, quand la
capitulation eft arrêtée. Munitionsqu’ongâteavantde parler
de fe rendre. Ibid. 63 5. a. Suite de la capitulation. Porte
de la ville, livrée aux aflîégeans. Sortie de la garnifon :
dans quel ordre elle fe foit. Remife des ôtages. Comment
les capitulations doivent être dreffées & interprétées. .Conditions
que demande une garnifon lorfqu’elle capitule pour
fe retirer dans la citadelle. Attentions particulières dans une
ville maritime pour les vaiffeaux qu’elle a dans fon port.
Ibid.b. • .
Capitulation. Comment le commandant d’une place fignifie
qu’il eft dilpotë à capituler. III. 42. b.
CAPIVÂR, animal quadrupède, amphibie. Sa defcription.
Pays où il fe trouve. Tems où il vient à terre. Dégât qu’il y
fait. On le dit bon à manger. II. 636.4.
CAPLET , (Maréchall. ) Suppl. III. 409. b.
CAPNOBATES, pourquoi les Myfiens furent appellés de
ce nom. Moeurs de ce peuple. II. 636.4.
CAPNOMANCIE, divination par la fumée. Etymologie
du mot. Trois fortes de capnomancie. Les Juifs y étoient
adonnés. II. 636.4.
CAPO à'illria. Vm. 931. 3. 932.4.
CAPOLLÏN , arbre du Mexique. Sa defcription & fon
ufage.TI. 636. 3.
1 CAPO-MOLAGO | ( Botan. ) efpece de piment ou poivre
de Guinée: Ses différens noms. Sa defcription. Suppl. II. 225.
4. Culture, qualités Sc ufages de cette plante. Maniéré de
la claffer. Ibid. 3.
CAPOC, (Comm.) efpece de coton. Ufage qu’on en fait
dans les Indes. D’où on le tire. Suppl. II. 225. 3. Attention
qu’il faut avoir quand ori s’en fert. Defcription de l’arbre
appellé Capoquicr. Ibid. b.
CAPONNIERE, ( Fortificat.) defcription de cette efpece
de chemin couvert. Maniéré de conftruire les caponnieres
dans le foffé. Leur ufage. Comment on les conftruiloit autrefois.
II. 636.3. Autres caponnieres outre celles du foffé. Ibid.
637.4.
CAPORAL. Ses fondions ; chaque compagnie en a trois.
Etymologie du mot. Caporal d’un vaiffeau. II. 637. 4.
Caporal, marque qui le diftingue. VIII. 7. 3.
CAPOTAGE, ( Marine ) connoiffance que doit avoir le
pilote du chemin que fait le vaiffeau fur la furface de la mer.
Cette ligne s appelle loxodromie. Théorie de cette loxodromie
ou du capotage donnée parpliifieurs auteurs, entre lefquels
fe diftingue M. de Maupertuis, dans fon traité de la loxodromie.
II. 637. 4. Quatre problèmes auxquels il réduit tout le
capotage. Ibid. 3.
CAPOTS, voyçi C agots.
CAPOUE, ruines d’anciens fépulcres entre Capoue &
PouzoL XIII. 253.4. Les foldats d’Annibal amollis à Capoue.
Suppl. I. 444. 3.
CAPPADOCE, figure fymbolique de ce pays. XV. 732. 3.
Efpecede faturnales qui étoient célébrées en Cappadoce. XIV.
531.4, 3. Année vague desCappadociens. XVI. 797.3. Haute
montagne de la Cappadoce, voyez A rgæus.
C APPEL, (Louis ) obfervations fur la vie & les ouvrages
de ce lavant. XIV. 717. 3.
CAPRÉE , fituation de cette ifle. XI. 10. 3.
CAPRES, voyc^ C âprier.
CAPRICE, (Archit. ) ouvrages*de l’art défignés par ce
mot : exemples. Dangers de ces licences. II. 637. 3.
Caprice, bizarrerie, fantaifie ; différençes entre ces mots.
VI. 403. 4 , 3. Ce mot eft aufli adopté en mufique. Caprices
de Rebel, de Locatelli. Ibid. 638. 4.
Caprice j différence entre caprice & fantaifie. VI. 403.
4 , 3. ’ A '
CAPRICIEUX, bizarre, fantafque, quint eux, bourru, ( Synon.)
II. 268. 4. XIH. 722. 4. *
CAPRICORNE, ( Afiron. ) figne du zodiaque. Mouvement
: ce figne, qui au lieu d’être le dixième
:tre appelle le onzième. Comment il eft
Etoiles qu’il contient. II. 638. a. Voyez
le connoître cette conftellation. Suppl. II.
uble dans le capricorne, 897. 3.
fymbolique. XV. 733. a.
don del’infe&e qui porte’ce nom. Ufage
t . Sfe m : bruit fle capricornes dans Luinæus. II. q6u3’i8l fait. Dix-huit efueees 4 eipeces
Capricornes repréfentés, vol. VI. des nbnrh - ,
planch. 76. planch. Regne animal,
CAPRIER,' caraâeres de ce*cnre de -plante, n. 6,8. ».
Ufage de fes boutons. Propriétés médicinales des captes
Propriétés de la racine du câprier. Comment fe fait
huile. Son ufage. II. 63.8. 3. “ l0n
C âprier , ( Botan. ) fes noms en différentes langues.
Cara&ere générique de cette plante. Enumération de dix
efpeces renfermées dans ce genre. 'Suppl. II. 226. a. Defcription,
culture, ufages de ces efpeces. Lieu* où elles
croiffent naturellement. Ibid. b. ,
CAPRIFICATION, maniéré d’élever les figuiers. Fécondité
de ceux de l’Archipel. Particularités fur les deux fortes
de figuiers-qu’on y cultive, & fur .la finguliere maniéré dont
les payfans font mûrir les fruits des figuiers domeftiques par
le moyen des moucherons attachés aux figuiers fauvages II
638. 3. Comment' ils les confervent pendant l’année, ¿les
font une des principales nourritures de l’Archipel. Leur qualité
médiocre , & leur grande abondance. En général la
piquure des fruits hâte leur maturité. Ibid. 639. a.
Caprification, opération fur les figues. Suppl. III. p i g
Les fruits du figuier fauvage fervent à la caprification .‘ auteurs
anciens qui en ont parlé. VI. 746. a.
CAPRIOLE, I Maneg. ) difiérence entre la ballotade la
croupade & la capricle. II. 48. 4. Ce faut repjréfenté , vol.
VII. des pl. manege,pL 12.
CAPROT1NE, ( Hïft. anc. ) furnom que les Romains
donnoient à Junon & aux noncs de juillet. Origine de la
fête célébrée en ce tems, en mémoire de ce que Rome fût
délivrée par la générofité des femmes efclaves. H. 630. 3
CAPSULAIRES, artères ( Anat. ) Suppl. IV. 604. 3.
CAPSULE, (Anat.) capfùle de Gliflbn. Sa defcription.
Capfule du coeur. Capfules atrabilaires, ou reins fuccentu-
riaux, ou glandes rénales. Leur defcription & leur ufage. Il,
640.4.
C a p su le de Glijfon, (Anat. ) tous les vaifleaux du corps'
humain font accompagnés d’une cellulofité. Cette cellulofité
eft très-forte dans le foie. Les filets de cette gaine font longs
& fermes. On eft parvenu à trouver à la capfiile des filets
charnus. On lui i attribué une force contra&ive, &c. Obfervations
fur ces faits & fur l’hypothefe à laquelle1 ils ont
donné lieu. Suppl. IL 227. 4.
I C apsule rénale, (Anat.) glande qui fe trouve dans
rhommfe, dans les quadrupèdes & dans les oifeaux. Defcription
de cet organe dans le foetus, & dans l’adulte. Son
ufage eft encore peu cqpnu. Suppl. II. 227. 3.
Capfules articulaires. VUI. 261. 3. Capfules atrabilaires,
272. 3. Capfules rénales, voye^ Rénal.
CAPTIVERIE, lieu où l’on rient les negres en attendant
qu’on les embarque. Captiverie de l’ifle de Corée. II. 640. 3.
CAPTIVITÉ, voyez Prifonnier.de guerre. Examen de la
queftion, fi un roi en captivité peut conclure un traité de paix
valable & obligatoire pour la nation. XI. 769. 3. .
Captivité de Babylonc. XVI. 556. a. Suppl. IV. 3 .3. 762. à.
Princes de la captivité. XII. 175. 3. XIII. 371.4. Gouverneurs
des Juifs pendant cette captivité. V. 262. 3.
CAPUCHON, efpece de vêtement chez les bernardins *
les bénédi&ins. Capuchons blancs & noirs. Ce qu’êtoit autrefois
le capuchon. En quoi il diffère du fcapulaire. Capuchons
des capucins, récollets, &c. Guerre fufeitée entre les'cor- ’
de iers au fujet du capuchon. Rêveries de Scot, aufli ridicules
que l’entêtement des cordeliers fur la forme de leurs
capuchons. II. 640. 3. r
Capuchon, autrefois appcllé palliolum. XI. 792. a.
CÀPUCIÀTI , encapuchonnés : hérétiques fe&ateurs de
•Wiclef au XIVe fiecle. Pourquoi ainfi ■ nommés. II.
640. 3.
CAPUCINS, leur habillement & leur extérieur. Pourquoi
appellés capucins. Auteur de la réforme des mineurs,
nomme Matthieu de Bafchi. II. 640.3. Sa retraite dans une foli-
tude. Sa congrégation approuvée par les papes & reçue en
France, où elle s’eft multipliée. Services que les capucins rendent
à l’églife. Religieufes capucines. Eloge des hommes à
talens qui fefont trouvés parmi les capucùis. Ibid. 641.4.
CAPUCINE, defcription, ufage & culture de cette piaiite.
II. 641. 4. . •!.
Capucine, piece du fufil. Suppl. III. 1 | p f|
CÀPUK ou Capa s -Pus sa r , arbre des Indes orientale?.
Defcription de cet arbre. Capuk ou coton que les Indiens
en tirent. II. 641. 4. ■
CAPULE, biere ou cercueil chez les Romains. Ce qu’on
en™ 0lt par capulares fenes, capulares rei. II. 641. a.
UAPURIONS, officiers infpeâeurs de policé à Rome.
Divifion des quartiers de la ville fous les Céfars. Nombre
des capurions, devoirs de leur charge. II. 641. 3.
CAPUSSI, ( Botan. ) nom que les Brames donnent a une
efpece de coton. Ses différentes défignations. Suppl. II. 227.3.
Defcription, culture, qualités & ufages de cette planté.
Seconde efpece. Cara&eres qui la diftinguent. Ibid. 228. <*•
Lieux où elle croit. Clarification de ces deux efpeces.
Ibid. b.
ÇAPUT MORTUUM , ( Chymie) produit le plus fixe des
en longitude qu’a
devroit aujourd’hui ê
figuré dans les cartes.
T ropique.
Capricorne,, moyen «
568. a , 3. Etoile do
Capricorne, figure
Capricorne, deferip
qu’il fait de fes antei
CAR l v f I I étoit un des cinq principes des anciens chymiftes.
On lui fubftitue aujourd’hui le mot de réfidu, avec beaucoup
de raifon. Les matières de ce réfidu'ne font rien moins que
f noies L’examen ultérieur de ce réfidu entre néceffairement
dans la fuite des opérations d’un'procédé régulier. II. 641. 3.
CAQUER le hareng, ( Comm. ) defcription de cette opération.
Ce qu’on entend par encaquer le hareng. Suppl. II.
Û”CA Q U E U X ^ ,fe&e chez les Bretons, qu’on regardoit
avec une extrême averfion. Ils ne pouvoient exercer que
le métier de cordier. Inutiles efforts de la poliçe en leur
faveur. II. 64a. ^ Voyez CAGOTS. 5 |
CAR A, efpece de convolvulus qui croît en Afrique : fa
defcription : caraétere de cette plante. On mange fa racine
comme légume, on en fait du pain en Guinée. II. 642. a.
CARABACCIUM, bois aromatique des Indes. Sa defcription.
Vertus qu’on lui attribue en médecine. II. 642. a.
CARABINE, efpece de moufqucton. Ses rayures dans l’intérieur.
II. 64a. 4. -Salongueur. Maniéré delà charger. Pourquoi
elle a plus de portée que le fufil. Ibid. b.
Carabine , portée de cette arme. VI. 630. a. VIL 396. 3.
CARABINIERS, efpece de chevaux-légers. Les carabiniers
font des troupes choifies dans toute la.cavalerie. Régiment
royal des carabùiiers, avant lequel on avoir deux carabiniers
dans chaque compagnie de cavalerie. Etabliflemcnt
d’une compagnie de carabiniers par régiment, en 1690. Di-
verfes#obfervations concernant cette compagnie. Réunion de
toutes les compagnies de carabiniers, en 1691, pour aller
en parti. Formation du régiment Royal-carabiniers, en 1692.
II. 642.3. Relation de tout ce qui concerne l’inftitütiqn de ce
régiment. Partage de ce corps en différentes armées. Réfdrme
de foixante compagnies des carabiniers, en 1698. Ibid. 643.4.
Soins du roi pour maintenir ce coips fur un pied de dfiiinc-
tion. Les compagnies furent remifes à trente maîtres dans
l’hiver de 17O1 & 1702. Règlement qu’on leur donna pour lors.
Ibid. 3. O11 appelle encore carabiniers ün certain nombre de
gendarmes, chevaux-légers,, &c. auxquels en tems de guerre
Fe roi foit donner des carabines. Ibid. 644. a.
Carabiniers, leur marque diflinétive. VIII. 7. 3. Leçons fur
le feu des carabiniers. V l. 630. a.
CARABINS, efpece de chevaux-légers : emploi de ces
compagnies: leurs armes. U. 644. 3.
Carabins, en quoi confiftoit ce corps de troupes. II. 781.3.
Carabins les plus fomeux du regne de Louis XIII. La garde
des généraux étoit alors $ompofée ordinairement de carabins.
Général des carabins. 782. a.
CARACALLA, origine du nom de cet empereur. Suppl.
II. 228. 3. Jeux inftitués à Sardes, pour célébrer l’union de
Caracalla & de Geta. Celui-ci poignardé par fon frere. XII.
502. 3. Suppl. III. 223. 3. Caraélere de Caracalla: fa mort &
fon apothéofe. ^ÜI. 502. 3. Regne de cet empereur. XIV.
336.4.3. Cirque de Caracalla. III. 476. 3.XIV. 35.0.a■. Voyez
Antiquités } vol. I des planches.
CARACALLE, (Antiq.) robe célèbre dans la partie des
Gaules habitée par les Atrebates morins. Defcription de deux
fortes de robes de ce nom. Suppl. II. 228.3.
CARACARA, (Omith.) efpece de bufe du Brefil. Ses
différentes défignations. Defcription & moeurs de ‘cet oifeau.
Suppl. II. 228.3.
CARACOLE, différences entre la caracole & la conver-
fion. II. 644. 3.
Caracole, quart dé converfion dans la cavalerie. VI. 198.3.
CARACOLY, compofition de métal fort eftimée des
Caraïbes. Ornemens de tête qui portent chez eux ce même
nom. D’où ils le's tirent. II. 644.3. Voyez O richalqu e .
CARACORE, (Marine) bâtiment dont les habitans de
Bornéo fe fervent beaucoup. Comment on lé gouverne. Defcription
des rameurs. II. 644. 3. Maniéré de leur commander.
Comment le bâtiment flotte fur l’eau. Ibid. 645. a.
CARACOTINUM, ( Géogr.) lieu fitué vers l’embouchure
de la Seine. On croit que c’eft l’ancien château de
Crétin en ruine, près de Harfleur & de Graville. Suppl. II.
228.3.
CARACTACUS, roi des Silures dans laGrahde-Bretagne:
affaires de ce roi avec les Romains. XV. 199.4,3. •
CARACTERE, marque ou figure tracée fur quelque
-matière que ce foit. Etymologie de ce mot. Origine du langage
entre les hommes. Origine de l’écriture. L°nfuffifance
aes premiers cara&eres contribua à faire fentir celle des
premières langues. II. 645.4. Formation de l’alphabet. Origine
des caractères particuliers à différentes fciences, principalement
à l’arithmétique. Trois différentes efpeces de caractères
, lés^carafteres littéraux, les numéraux , & ceux d’abré-
■viation. Les carafteres littéraux font ou nominaux ou emblê-
matiques. Suivant Hérodote, les Egyptiens avoient deux
lortes de'fcarafteres, les uns focrés,les autres populaires.
V<rA°nk ‘nces qui occafionnerent les différentes langues & les
èrens alphabets. Cette diverfité de caraéïcres eu regardée
comme un des plus grands obftacles au progrès des fciences.
CAR 231 naux * |tldes ^ara^erés réels & non nomipoffiblc
Effais qu'ôm°fahs
Ibid. 646. a. Autre projet femblable, dans le Journal littéraire
de 1 année t 7ao. En quoi conftfte en général la difficulté
d exécuter de femblables projets. Divifion des caraficres nóí
minaux , eu égard aux nations qui les ont inventés. Carac*
teçe latin. Caraéleres phéniciens -, âffyriens , fyriaques, arabes
; leur dérivation. Introduction du caraftere latin par les
françois. Abolition du gothique. Uniformité du cara&ere grec
fur les médailles jufqu’au tems de Gallien. Ufaee du carac-
tere latin depuis Conftantin jufqu’à Michel. Enfuite le grec
reprit le delius avec diverfes altérations. CaraCteres des mè-
da.lles latines fous les empereurs. Plus le cara&ere eft rond &
bien forma, plus il eft ancien. Ibid. b. Nos caraéleres pouf
1 imprefliqn des livres.
Des caraEleres numéraux : carafteres principalement en
ulage aujourdhiiij le commun, appelle aufli arabe;le romain*
lettres numerales de ce caraftere ; Ibid. 647. a. les chiffres
grecs; les chiffres hébraïques; le caraétere francois appelle
ordinairement chiffre dé compté. Ibid. 3.
CaraElerc. Avantages & défovarftage des moyens que les
hommes ont inventés pour tranfmertre leurs idées l’un par
la peinture, l’autre par les cara&eres. V. 638. 4. Cara&eres
diltnigues en élémentaires & profodiques. VII. 845.3. Caracteres
^ profodiques. XIII. 499 a. Cara&eres d’écriture. IX.
Deux manieres dont les anciens formoient leurs
caraCteres d’écriture. X. 467. 3. CaraCteres arabes. I. 566.4 , b,
Suppl. I. 503. CaraCteres chronologiques. III. 400. a. Carac*
teres dont 011 soit fervi dans les anciens aCtes. IV. 1024. 4,
CaraCteres dont les anciens fe fervoient dans les inferiptions
de batimens. V. 794, a. CaraCteres gothiques: leur inventeur.
VIL 749 4. Caracteres hébreux. VIII. 76.3. CaraCteres runi-
ques. XiV. 437. 3. CaraCteres fomaritains. VIII. 76: b. XIV.
594. 3. Caracteres tachygrapiûqùes. XV. 815. 4 , 3. Voyez
aulli l’article Carailere, dans le vol. II des planches, vous
y trouverez les exemples des caraCteres fuivans: hébreu 8c
lamaritain, planch. 1 ; fyriaque & ftranghelo, planch. 2 ;
arabe, planch. 3 8c 4 ; turc 8c perfan, Ibid. égyptien 8c phénicien
, planch. 5 ; palmyrénien 6c fyro-galiléen, Ibid. éthio-
pien 6caoylhn , planch. 6; cophte &. grec, planch. ¡¡¡t arca-
dien, pélalge, étrul'que, planch. 8 ; gothique, iflandois*
moelogotluque , anglo-faxon, illyrien ou efclavon , planch. 9 ;
rumque, rùii'e, allemand , planch. 10 ; illyrien ou efclavon
8c feryien,planch. 11. CaraCteres arméniens, planch. 12 8ç
13; géorgiens,planch. 14; ancien perfan,planch. 15 8C 16;
granüan, Ibid. nagrou ou hani'crer, planch. I7;.bengale,
planch. 18; telongou ou talenga, planch. 19; tamoul ou
malabar, planch. 20; fiamois 8c bali, planch. 2i;rhibetan,
planch. 22 ; tartare, ‘manteheou, planch. 23 ;• japonnois,
planch. 24; clefs chinoifes, planch. 25.
CaraEleres d’abÆviation. Inventeurs dé ces caraCteres.
ColleCtion qu’en fit Sénequc. II. 647.3. Ceux qui travaillèrent
à expliquer les notes des anciens. Ibid. 648. a. Voyez A brév
ia t io n .
CaraEleres ufités en Algebre. Explications de leurs différentes
figures. II. 648.4.
CaraEleres en géométrie 8c en trigonométrie. H. 649. m
, CaraEleres dont on fait ufage dans l’arithmétique des infi»
nis. II. 649. 4.
CaraEleres ufités en aftronomie. II. 649. 4.
CaraEleres aftronomiques : voyez au“ 1 leur explication
vol. V. des plancli. article Afironomie , planch. 7. • *
CaraEleres de chymie. But de ces caraCteres. Ce que défi*
gnoient les anciens caraCteres chymiques. II. 649. 3. Caracteres
plus modernes, Ibid. 650. a.
CaraEleres chymiques : on en trouve aufli l’explication, vol.
III. des planch. article Chymie, pl. 1 , 2 , 3 & 4.
CaraEleres ufités en médecine 8c en pharmacie. II. 650.4.
CaraEleres ufités parmi les anciens avocats, 8c dans les an*
ciennes inferiptions. II. 650. a.
CaraEleres que Fon met fur les tombes. CaraCteres en grammaire,
rhétorique, poéfie, II. 650. 4. CaraCteres en
commerce. CaraCteres en mufique. Ibid. b. Voyez N o te s .
CaraEleres en écriture 8c en impreflion. Ce terme employé
pour défigner la grandeur relative d’un cgraCtere ou d’une
lettre à une autre : on en diftingue quatre fortes. Ces caraCteres
fe diftinguent encore relativement à leur forme particulière.
IL 650.3.
CaraEleres d'imprimerie, defcription de ces petits inftrumens
Principales conditions pour la typographie ou imprimerie!
II.' 650. 3. L’art de faire les cara&eres fediftribue en deux*
celui de graver les poinçons, celui de fondre les cara&cres*.
De la gravure des poinçons. Ce qui fe pratiquoit avant l in!
vention des cara&eres mobiles. Gette invention fe fit en Allemagne,
en 1440. Difficulté’ d?en bien connoître Fauteur qu’on
foupçônne être Jean Guttemberg. Les graveurs de caracteres