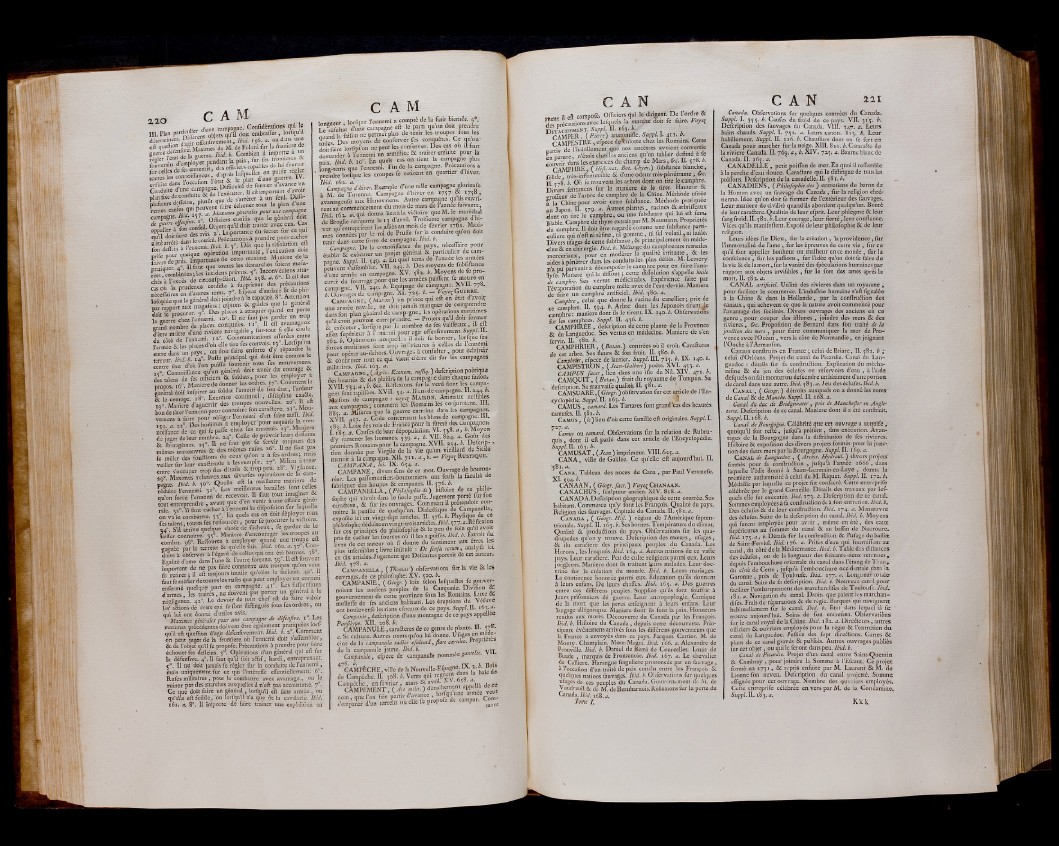
„ o C A M
ï r1“
eft 9“* " i i Maximes de M. de FoUtd fur la manière de
8 '^ l w M l f l euerre. Ibid. h. Combien il importe a un
fiir celles de le» ennemis, s iefiruelte on puifle régler
toutes les connoiiTance j P. j , Q (¡-[mc guerre. IV .
enluite dans 1 occaf“>" **“¿ iffic„lt/de former d’avance un
Conduite d une c* Vexécuter 11 elt important d'avoir
m É t m i f í m S m S S S m s S , i L fem. p u »
plufteurs faire échouer tout le plan d’une
rentes califesq p MaJams M a t i t pour mu campamç
campagne. W ‘ 57- g | le gènérai
i C i t t n H Objets qu’il doit traiter avec eux. Cas
S S p Æ “ ¿ avis, a . Importance du fecret fur ce qu.
a S d0í i a° leconfeiLPrécautionsà prendre pourcacher
aétéarreté mi ¡p D è s que la réfoluaon eft
fe nour quefque dpération importante, l’exécution don
P • P^nrlq Imoortance de cette maxime. Maniere de la
TSuer É II faut que toutes les démarches (oient mefumes,
comlnnèeslles ^cidem prévtw. 5°. ^iconvèniens^uarhA
«! à l’excès de circonfpeéhon. Ibid. 158. a. 6 . 11 elt aes
W Ê Ê s^ r^ ig s s s s ^ ^
^ nombre de places conquifes. n " . Il eft avantageux
? a m ^ f d Î L nv“ er= navigable , fur-tout f. elle coule
1 S .A dé l’enn-mi. ta°. Communications affûtées entre
i l l i l l i « elle tire fes convoist g g M B g i
tém daS un pays, on doit faire enforte d y répandre a
entre oans u y, r , principal qm doit etre comme le
ceiiue fixe d oit Pon puiffe^ foutenir tous fes mouvement
ïc° ConnoiiTance qu’un général doit avoir du courage &
dL udens de fes orficiers & foldats, pour les employer a
v/t° Mnnie’re de donner £83 H les ordres. 17 . Comment 1- “ an'foldat l’amoffr de foi état, l’ardeur
le le courage. rS°. Exercice continuel , dtfcipbne ex afc
inte Maniere d’aguerrir des troupes n?U™|g- g » & eft_
139 % ~i° Des hommes à employer’pour acquenrla g p
m è m é f « v r Jà “ &1 g m ém r r u f e .
fe mêler des fouillons de ceux qu on a aTesordresf. ma s
veiller fur leur exaffitude a les remplir. 27 ^ S g f c f & i
entre s’occuper trop des détails 8c trop peu. 28 ■ Vigilance.
ao°. Maximes relatives, aux dîverfes opérations de la cam-
29 T.;J l or.o. Quelle eft la meilleure maniere de
rélifire 1 énnemu a i9- Ces meilleures balailte font celte
qu’on force l’ennemi de.recevoir. Il faut tôut imaginer Sc
tout entreprendre , avant que d e v e n ir a une1 affame1 gêné-
taie 22“ U faut cacher à 1 ennemi la difpofinon fur laquelle
on va le combattre. 33°. En quels cas on
fes talens, toutes fés feffources, pourfe procurer
34“. S’il' arrive quelque chofe de fâcheux, fe garder de le
faiffer contioltre. 33”. Minière d’encourager les troupes au
combat. 36°. Reflource à employer quand une troupe elt
gagnée parla terreur 8c qu’elle fuit. Ibii. 160.1.37 .Con-
luite à obferver à l’égard decelles qui ont été battues. 38 .
Egalité d’ame dans l’une 8c l’autre fortune. 39 . Il eft fouvent
Important de ne pis «tire connotare aux troupes quon veut
fe retirer; il eft toujours inutde quelles- ta facnent. 40 . B
feutfe méfier de toutes les rufes que peut employer un ennemi
enfermé Oueltpie part en campagne. 4? • Lo! « T ““ ” “
d’armes, les traités, ne do.vent pas porter nn
négligence. 42“. Le devoir de tout, chef eft de faire valoir
lélalions de c'euxqm fe-font difïngués fous fesordres, ou
qui lui ont donné q utiles avis. r . 0 T
Maximes générales pour une campagne de défenjiye.i . LCS
maximes précédentes doivent être également pratiquées lorl-
qu’il eft queffion d’agir défenfivemerit. Ibid. b. 2 . Comment
on peut juger de la frontière où l’ennemi doit s auembler,
& de l’objet qu’il fe propofe. Précautions à prendre pour faire
échouer (es defleins. 30. Opérations d’un général qui eft fur
la dèfenftve. 40. Il faut qu’il foit aétif, hardi, entreprenant.
|H II né doit jamais fe régler fur la conduite de l’ennemi,
mais uniquement fur ce qui l’intéreffe effentiellement. 6°.
Ru fes militaires, pour le combattre avec avantage , ou le
ruiner par des marches auxquelles il n’eft pas accoutumé. 7’
Ce que doit faire un général, lorfqu’il eft fans armée, ou
qu’efte eft foible, ou lorfqu’il n’a que de la cavalerie. Ibid.
161* a. 8°. Il irüporte de faire traîner une expédition en
C A M
longueur, lorfque l’ennemi a compté de la fmir bientdt. o”.
Lerefutet d’une campagne eft le para quon doit prendre
onand la faifon ne permerpte de temr t e troupes fous les
S 1 Des moyens de conferver fes conquêtes. Ce quon-
doit faire lorfqu’on ne peut les conferver. Des cas ou .1 finit
demander à ?ennemi tin armiftree 8c traiter enfmte pour la
S ibid. b. 10”. En quels cas on tient la campagne plus
long-tems que l’ennemi. Fin de la campagne. Précautions a
prendre lorfque t e troupes fe tentent en quarner dlnver.
U‘cam tX “ 'd'Uv,r. Exemple d’une telle campagne glorieufe
à M. de Turenne. Campagne d’hiver en 1757 « 17S?
avantageufe aux Hanovriens. Autre campagne qu ils ouvrirent
mi commencement du mois de mars de 1 ann-e forçante,
Ibid 162. a. qui donna lien à la viéloire que M. le maréchal
de Broglie remporta le 13 d’avril. Trolfieme campagne d hiver
quWp rirent les alliés au mois de février 1761. Maximes
données par le roi de Pruffe fur la conduite qu on doit
tenir data cette forte de campagne. Ibid. b.
Campagne. De la connoiiTance du pays, néceflaire pour
établir 8c exécuter un projet général 8c particulier de campagne.
Suffi. U. 549- “ . En quel rems de 1 année les armées
peuvent s’iffembler. VII. 249. 1 Des moyens de fobfiftance
K e armée en campagne. XV. ,82. “ o y ^ de fe procurer
du fourrage pour que les années puiffent fe mettre en
camnaene VU. 249. i. Équipage de campagne. XVII. 778.
* Ouvrages de campsgne.\Î 7M- *■ - ^ G u e r r e .
C a m p a g n e , (Marme) un prince qm eft en état davoir
une armée navale, ne doit jamais manquer de comprendre
dans fon plan général de campagne, les opérations
qu’il croit pouvoit entreprendre. — Protêts qu d doit former
le exécuter , lorfque par lè nombre de fes vatffeaux, il eft
affez fuperieur à l’snneim pour agir offenfivement. Suppl. II.
> , .„.vnntsil 1: il rlnir fe borner. lorfque fes « lie * « tp cB ooe - I l» P ° u r ‘lSl r - - -
162. b. Opérations auxquelles il doit fe borner, lorfque les
forces maritimes font trop inférieures a celles de 1 ennemj
pour opérer au-dehors. Ouvrages à confolter pour éclaircit
l e confirmer tout ce qui vient dètre dit fur t e campagnes
militaires. Ibid. 163- a- . , . . . , .
C a m p a g n e , (Agric. Econom. rujliq. ) description poétique
des beautés & des plaifirs de la campagne dans chaque foifon.
XVII 724 a b. &c. Réflexions fur le verd dont les campa-
gnes font tapiffêes. XVII. campagne. II. 244. A
Maifons de campagne : voy^ M a is o n . Animaux nudibles
aux campagnes; comment t e Romains les conjurount. HI.
88c. a. Milercs que la guerre entraîne dans t e campagnes,
y v n . 431. a. Code concernant les biens de campagne, lit.
381. i. Loix des rois de France pour la fureté des campagnes.
1 18c. a. C a u fe s de leur dépopulation. VI. 538. a , b. Moyen
d’y ramener t e hommes. 539. n, b. VII. 824. a. Gout des
premiers Romainspour la campagne. XVII. 234. b. Defcrip- •
tïbn donnée par Virgile de la vie qu un vieillard de bicde
menoit à la campagne6 XII. 7 . 1 . a , b . - Voy'l R u s t iq u e -
■ CAMP A N A , ldi. IX. 634. a.
CAMPANE, divers fens de ce mot. Ouvrage de bouton-
nier. Les paffementiers-boutonniers ont feuls la faculté de
fa b r iq u e r des houpes 8c campanes. II. 576. é.
CAMPANELLA, (Philojàphit de) hiftoire de ce philo-
fophe qui vivoit dans le fiecle paffé. Jugement porté for Ion
caraétere 8c fer fes ouvrages. Comment il prétendoit con-
notae la penfée de quelqu’ un. Dialcftique de Campanella,
expoféc ici en vingt-fept articles. II. 570. b. Phyfuçe de ce
philofophe déduite en ving£-troisarticte./éii/. 377. n.Rênexion
fur ces principes de philofophle 8c le peu
pris de cacher t e fources ou il t e a piufes. Ibid. b. Extrait du
livre de cet auteur où il donne du fentiment aux êtres les
plus infenfibles ; livre intitulé : De fenfu rerum analyfé ici
en dix articles. Jugement que Defcartcs portoit de cet auteur.
C a m p a n e l l a , ( ThomasA obfervations iiir la vie 8c les
ouvrages, de ce philofophe. XV. s 20. b.
CAMPANIE, {Gèogr.) loix lëlon lefquelles_fe gouver-
noient les anciens peuples de la Campante. Divifton g
gouvernement de cette province fous les Romains. Luxe oc
molleffe de fes anciens habitans. Les éruptions du Véluve
ont bouleverfé les rians côteauxde ce pays. Suppl. II. 163.a.
Campante , deferiotion d’une montagne de ce pays appeuee
Pauftlype. XII. 208. b. „
CAMPANULE, caraâeres de ce genre de plante. 11. |7°-
a. Sa culture. Autres noms qu’on lui donne. U fa g e s en médecine
de la campanula radice efulentâ, flore caruleo. stop
de la campanule jaune. Ibid. b. ,, -ytT
Campanule, efpece de campanule nommée gw
47eAMPÊCHE, ville de la Noitvelle-Efpagnc- K . 2. i. Bms
de Campèche. II. 308. | Vents qui régnent dans la baie
Campecne, en février, mars & avril. . cc
9CBAMPPEMPENTR mMP9|iP « Sveut
CAN CAN »eut il eft cofflpofé. Officiers qui le dirigent De l’ordre &
de* précautions avec lefouels la marche doit fe faire. | g | g
D é t a c h e m e n t . Suppl. II.
CAMPER, ( Pierre) anatpmifte. Suppl. I. 411. b.
CAMÎESTRE | efpece déculotté chez les Romans. Cette
rtie de l’habillement .que'nos ancêtres avoient convertie
en parure, n’étoit chez les anciens qu’un tablier deftiné à le
couvrir dans les exercices du champ de Mars, U. 578. b.
CAMPHRE, (Hifl‘ nat- Wh Chym.) fubftance blanche,
folide très-inflammable 8i d’une odeur très-pénétrante, &c.
II Ç7& b. Où fc trouvent les arbres dont on tire le camphre.
Divers fèntimens fur la maniéré de le tirer. If auteur &
croffeur de l’arbre de camphre de la Chine. Méthode ufitee
a la Chine pour avoir cette fubftance. Méthode pratiquée
au Japon. II. 579* Autres Pentes racines &arbrilTeaux
dont on tire le camphre, ou une fubftance qui lui eft fem,
blable. Camphre de thym extrait par M. Neumann. Propriétés
du camphre. Il doit être regardé comme une fubftance particulière
qui n’eft ni réfine, ni gomme , ni fel volatil t ni huile.
Divers ufages de cette fubftance,& principalement en médecine
8c en chirurgie. Ibid. b. Mélange du qapiphreauxremedes
mcrcurinux, pour en modérer la qualité imtame, 6c t e
aider à pénétrer dans t e eonduitste plus délies. M. Lemery
n’a pil parvenir à décompofer le campWe pour en faire 1 ana-
lvfe Matière qui le diffout ; cette diffolution s appelle huile
de camphre. Ses vertus médicinales. Expérience faite par
l ’évaporation du camphre mêlé avec de l’eau-de-vie. Maniéré
de faire un camphre artificiel. Ibid. 580.a.
Camphre, celui que donne la racine du canellier; prix de
ce camphre. II. 594. b. Arbre dont les Japonois tirent^e
camphre : maniéré dont ils le tirent. IX. 140. b. Obfervations
fur les camphres. Suppl. II. 436- b- I , , _
CAMPHRÉE, description de cette plante de la Provence
& du Languedoc. Ses vertus en médedine. Maniéré de s’en
fervir. D. 580. b. y ^ ~ ^
CAMPHRIER, ( Botan.) contrées ou u croit. Caractères
de cet arbre. Ses fleurs 8c fon fruit. D. 580. b.
Camphrier, efpece de laurier. Suppl. III. 715. b. IX. 140. b.
CAMPISTRON, ( Jean-Galbert) poëte. XVI. 453. a.
CAMPUS facer, lieu dans une ifle du Nil. XIV. 471. b.
CAMQUIT, ( Botan.) fruit du royaume de Tonquin. Sa
N 'defeription. Sa mauvaife qualité. II. 581.«. H B I
CAMSUARE, (Géogr.) obfervation fur cet ^icle de 1 Encyclopédie.
Suppl.IÏ. 163. b. ■
CAMUS , camard. Les Tartares font grand cas des beautés
camufes. II. 581. b. . . . •
C am u s , (/f)lieu d’où cette famille eft originaire. Suppl. I.
Camus ou camard. Obfervations fur la relation de Rubru-
quis, dont il eft parlé dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppi. n. 163. b.
CAMUSAT, ( Jean ) imprimeur. VIIL 625.4*.
CANA, ville de Galilée. Ce qu’elle eft aujourd’hui. II.
]ç8l. 4t. • -
Cana. Tableau des noces de Cana, par Paul Veronefe.
XI. 594. b.
CANAAN, (Géogr. facr.) Voye^CHANAAN.
CANACHUS , fculpteur ancien. XIV. 818. a.
CANADA.Defcription géographique de cette contrée. Ses-
habitans. Commerce qify Font les François. Qualité du pays.
Religion des fauvages. Capitale du Canada. H. 581.4*.
C a n a d a , ( Géogr. Hifl. ) région de l’Amérique fepten-
frionale. Suppl. II. 163. b. Ses bornes. Température du climat.
Qualité 8t produirions du pays. Obfervations fur les quadrupèdes
qu’on y trouve. Delcription des moeurs, ufages,
8c du caraélere des principaux peuples du Canada. Les
Hurons, les Iroquois. Ibid. 164. a. Autres nations de ce vafte
pays. Leur caraûere. Peu de culte religieux parmi eux. Leurs
jongleurs. Maniéré dont ils traitent jpurs malades. Leur doctrine
fur la création du mondé. Ibid. b. Leurs mariages.
La continence honorée parmi eux. Éducation qu’ils donnent
à leurs enfims. De leurs chaffes. Ibid. 165. a. Des guerres
entre ces différens peuples. Supplice qu’ils font fouftrir à
¿eurs prifonniers dé guerre. Leur anrropophagie. Cantique
de la mort que les peres enfeignent à leurs enfans. Leur
langage allégorique. Maniéré dont ils font la paix. Honneurs
rendus aux morts. Découverte du Canada par les François.
Ibid. b. Hiftoire du Canada, depuis cette découverte. Principaux
événemens arrivés fous les différens gouverneurs que
la France a envoyés dans ce pays. Jacques Cartier. M. de
Monty. Champlain. Mont-Magni. Ibid. 166. a. Alexandre de
Prouville. Ibid. b. Daniel de Hémi de Courcelles. Louis de
Buade , marquis'de Frontenoie. Ibid. 167. a. Le chevalier
de Callicre. Harangue finguliere prononcée par un fauvage,
à l’occafion d’un traité de paix conclu entre les François 8c
quelques nations fauvages. Ibid. b. Obfervations fur quelques
ufages de ces peuples du Canada. Gouvernement de M. de
Vaudreuil & de M. de Beauharnois. Réflexions fur la perte du
Canada. Ibid. 168.4*.
Tome /,
Canada. Obfervations fur quelques contrées du Canada.'
Suppl. I. 355. b. Caufes du froid de ce pays. VII. 315. b;
Defcription des fauvages du Canada. V l l l 347. a. Leurs
bains chauds. Suppl. ï. 752. a. Leurs canots. 813. b. Leur1
habillement. Suppl. II. 116. b. Chauflùre dont on fe fert en
Canada pour marcher fur la neige. XIII. 811. b. Câtarafte de
lariviere Canada. H. 769.4*, b. XlV. 725, a. Baume blanc de
Canada. II. 165.4** * ,
CANADELLE , petit poiffon de mer. En quoi il reffemble
à la perche d’eau douce. Caraftere qui le diftingue de tous les
poiffons. Defcription de la canadelle. II. 581 .L
CANADIENS * ( Philofophie des ) entretiens du baron de
la Hontan avec un fauvage du Canada, fur la religion chrétienne.
Idée qu’on doit fe former de l’extérieur des fauvages.
Leur maniéré de civilité quand ils abordent quelqu’un. Bonté
de leur caraftere. Qualités de leur efprit. Leur phlegme 8c leur
fangfroid. II. 581. ¿.Leur courage, leur fierté, leur confiance^
Vices qu’ils manifeftent. Expofé de leur philofophie 8c de leur
religion. -
Leurs idées fur Dieu, fur la création , la providence, fut1
l’immortalité de l’ame, fur les épreuves de cette v ie , fur ce
qu’il faut appellcr bonheur ou malheur en ce monde, fur la
confcience , fur lespaflions, fur l’idée qu’on doit fe faire de
la vie 8c de la mort, (ur la vanité des fpéculations humaines par
rapport aux objets invifibles, fur le fort des ames après la
mort. 11. 582.4*.
CANAL artificiel. Utilité des rivieres dans un roÿàtimé ,
pour faciliter le commerce. L’induftrie humaine s’eft flgnalée
à la Chine 8c dans la Hollande, par la conftruélion des
canaux, qui achèvent ce que la nature avoit commencé pour
l’avantage des fociétés. Divers ouvrages des anciens en ce
genre, pour couper des ifthmes , joindre des mers 8c des
rivieres, &c. Propofition de Bernard dans ion traité de la
jonSion des mers , pour faire communiquer la mer de Provence
avec l’Océan, vers la côte de Normandie, en joignant
l’Ouche à l’Armanfon.
Canaux conftruits en France ; celui de Briare, II. 582. b |
celui d’Orléans. Projet du canal de Picardie. Canal du Languedoc
: détails fur fa conftru&ion. Explication du média-
nifme 8c du jeu des éclufes ou réfervoirs d’eau, à l’aide
defquels on fait monter ou defeendre un bâtiment d’une portion
de canal dans une autre. Ibid. 583.41. Jeu des éclufes.Ibid. b.
C a n a l , ( Géogr. ) détroits auxquels on a donné les noms
de Canal 8c de Manche. Suppl. II. 108. a.
Canal du duc de Bridgewater, près de Manchefter en Angle-
terre. Defcription de ce canal. Maniéré dont il a été conftruit.
Suppl. II. 168. b.
Canal de Bourgogne. Célébrité que cet ouvrage a acquife J
quoiqu’il foit refté, jufqti’à préfent, fans exécution. Avantages
de la Bourgogne dans la diftriburion de fes rivières.
Hiftoire 8c expofition des divers projets formés pour la jonction
des deux mers par la Bourgogne. Suppl. II. 169. a.
C a n a l de Languedoc , ( Archit. Hydraul. ) divers projets'
formés pour fa conftruftion , jufqu’à l’année 1666, dans
laquelle l’édit “donné à Saint-Germain-en-Laye , donna la
première authenticité à celui de M. Riquet. Suppl. II. 172. b.
Médaille par laquelle ce projet fut confacré. Cette entreprife
célébrée par le grand Corneille. Détails des travaux par lesquels
elle fin exécutée. Ibid. 172. ù. Defcription de ce canal.
Sommes employées à fa conftruétion 8c a fon entretien. Ibid. b.
Des éclufes 8c de leur conftruétion. Ibid. 174. a. Manoeuvre
des éclufes. Suite de la defcription du canal. Ibid. b. Moyens
qui furent employés pour avoir, même en été, des eaux
Supérieures au fommet du canal 8c au baflin de Nauroure.
Ibid. 175.4*, b. Détails fur la conftruétion 8c Tufage dubafiùz
de Saint-Ferriol. Ibid. 176. a. Prifcs d’eau qui fourniffent au
canal du côté de la Méditerranée. Ibid. b. Table des diftances
des éclufes, ou de la longueur des foixante-deux retenues ,
depuis l’embouchure orientale du canal dans, l’étang de Thau,
du côté de Cette , jufqu’à l’embouchure occidentale dans la
Garonne, près de Touloufe. Ibid. 177. a. Longueur totale
du canal. Suite de fa defcription. Ibid. b. Nouveau canr.l pour
faciliter l’embarquement des marchandifes de Tonloufe. Ibid.
181.4*. Navigation du canal. Droits que paient les marchandifes.
Frais de- réparations 8c de régie. Barques qui naviguent
habituellement lut le canal. Ibid. b. État dans lequel il fe
trouve aujourd’hui. Soins de fon entretien. Obiervatiôns
fur le canal royal de la Chine. Ibid. 182. a. Direéteurs, autres
officiers 8c ouvriers employés pour la régie 8c l’entretien du
canal du Languedoc. Juftice des fept direétions. Cartes 8c
plans de .ce canal gravés 8c publiés. Autres ouvrages publiés
fur cet objet, ou qui le feront dans peu. Ibid. b. '
Canal de Picardie. Projet d’un canal entre Saint-Quentin
& Cambray, pour joindre la Somme à l’Efcaut. Ce projet
formé, en 2731, 8c repris enfuite par M. Laurent 8c M. de
Lionne fon neveu. Defcription du canal projetté. Somme
allignée pour cet ouvrage. Nombre des Quvriers employés.
Cette entreprife célébrée en vers par M. de la Condamine.
Suppl. II. 183.4*,
Khh,