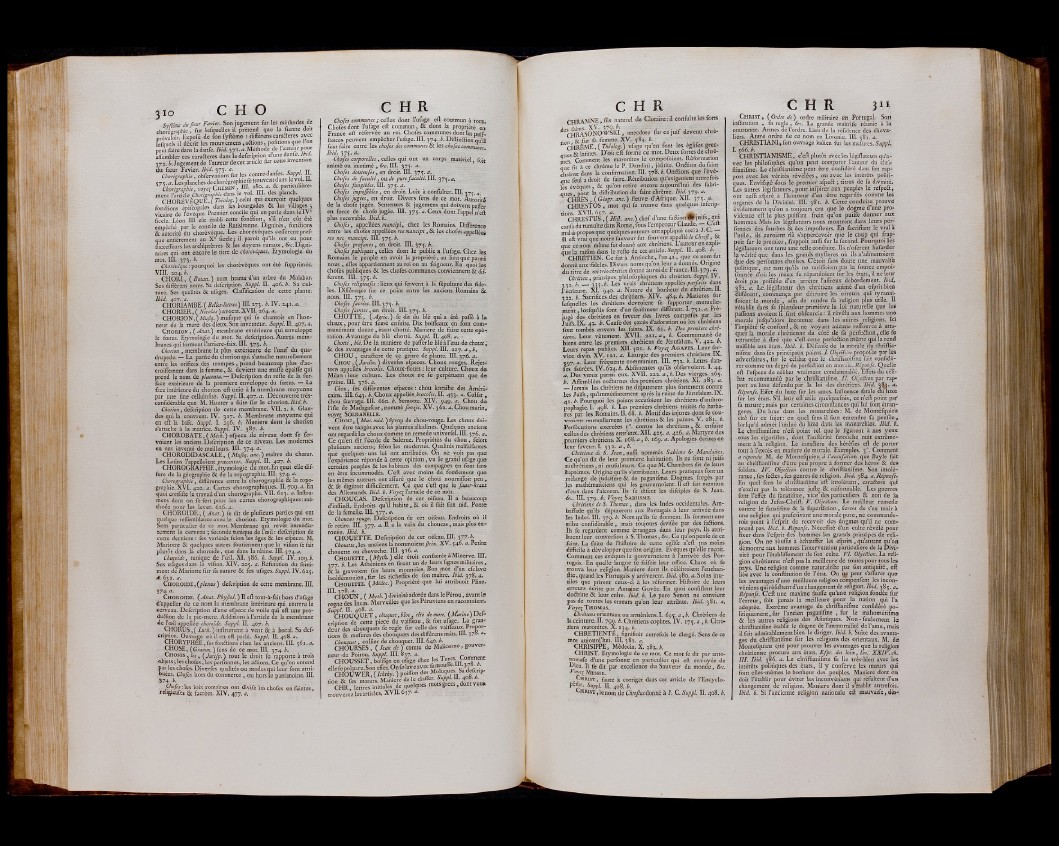
3 i o C H O C H R
Sviléme du fleur Favier. Son jugement fur les méthodes de
chorégraphie, fur lefquelles il prétend que la fienne doit
prévaloir. Expôfé de ion fyftême : différens caralteres avec
lefquels il décrit les mouvemens, allions, pofitions que l’on
peut faire dans la danfe. 7éi</. 371. a. Méthode de l’auteur pour
affembler ces caraâeres dans la defcription d’une danie. lbid.
372. b. Jugement de l’quteur de cet article fur cette invention
du fieur Favier. Ibid. 373. a. , TT
Chorégraphie, obfervations fur les contre-danfes. Suppl. II.
575. É Lesplanches de chorégraphie fe trouventrians^le vol IL
horïpaphu, voyR C h em in , III. 280. .. & pamculiére-
mcnt l'article ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ S S dans le roi. HL des planch.
CHORÉVÊQUE.! Thtoiog.) celui qui exerçoit quelques
fonfüons épifcopales dans les bourgades & les villages ;
vicaire de l’évéque. Premier concile qui en parle dans le IV
ficcle. Léon RI eût établi cette fonction, s’il n’en eût été
empêché par le concile de Ratisbonne. Dignités, fonllions
& autorité du chorévêque. Les chorévêques cefferent pref-
que entièrement au Xe fiede; il paroît qu’ils ont eu pour
fucceffeurs les archiprêtres & les doyens ruraux, Dignitaires
qui ont encore le titre de chorévêques. Etymologie, du
mot. III. 373. b.
Chorévêque : pourquoi les chorévêques ont été fupprimés.
VIII. 204. b. \ w
• CHORl, ( Botan. ) nom brame d un arbre du Malabar.
¡Ses différens noms. Sa defcription. Suppl. II. 406. b. Sa 'culture.
Ses qualités & ufages. Claflification de cette plante.
lbid. 407. a.
. CHORIAMBE. ( Bellcs-lettres) III. 273. b. IV. 241. a.
CHORIER, ( Nicolas ) avocat. XVII. 264. a.
CHORION, mufique qui fe chantoit en l’honneur
de la mere des dieux. Son inventeur. Suppl. II. 407. a.
Ch o rio n, ( Anat.) membrane extérieure qui enveloppe
le foetus. Etymologie du mot. Sa defcription. Autres membranes
qui forment l’arriere-faix. IIL 373. b.
. Chorion , membrane la plus extérieure de l’oeuf du quadrupède.
— La partie du chorion qui s’attache naturellement
entre les orifices des trompes, prend beaucoup plus d’ac-
croiffemem dans la femme, & devient une maffe épaifle qui
prend le nom de placenta. — Defcription du refte de la fur-
face extérieure de la première enveloppe du foetus. — La
face intérieure du chorion eft unie à la membrane moyenne
par une fine cellulofité. SuppL II. 407. a. Découverte très-
confidérable que M. Hunter a faite fur le chorion. Ibid. b.
Chorion y defcription de cette membrane. VII. 2. b. Glan-'
des qui la couvrent. IV. 317« b. Membrane moyenne qui
en en la bafe. Suppl. I. 296. b. Maniéré dont le chorion
s’attache à la matrice. Suppl. IV. 387. b.
CHOROBATE,(AiecA.) efpece de niveau dont fe fer-
voient les anciens. Defcription dé ce niveau. Les modernes
en ont inventé de meilleurs. III. 374. a. '
CHORODIDASCALE, (Mufiq. anc.) maître du choeur.
Les Latins l’appelloient pracentor. Suppl. H. 407. b.
CHOROGRAPHIE, étymologie du mot.En quoi elle différé
de la géographie & de la topographie. III. 374. a.
Chorographie, différence entre la chorographie & la topographie.
XVI. 420. a. Cartes chorographiques. II. 709. a. En
■quoi confifte le travail d’un chorographe. Vil. 613. a. Inftru-
mens dont on fe fert pour les cartes chorographiques : méthode
pour les lever. 626.4.
, CHQROIDE, {Anat.) fe dit de plufieurs parties qui ont
quelque reffemblance avec le chorion. Etymologie du mot.
Sens particulier de ce mot. Membrane qui revêt immédiatement
le cerveau ; fécondé tunique de 1 oeil : defcription de
cette derniere : fes variétés félon les âges & les efoeccs. M.
Mariotte & quelques autres foutiennent que la viuon fe fait
plutôt dans la choroïde, que dans la rétine. III. 374.a.
Chofoide, tunique de l’oeil. XI. 386. b. Suppl. IV. 109.b.
Ses ufages dans la vifion. XIV. 205. a. Réfutation du fenti-
ment de Mariotte fur fa nature & fes ufages. Suppl. IV. 625;
a. 631. a.
C horoïde , {plexus ) defcription de cette membrane, m .
374- . . . .
C horoïde. ( Anat. Phyfiol. ) Il eft tout-à-fàit hors d’ufage
d’appeller de ce nom la membrane intérieure qui couvre le
cerveau. Defcription d’une efpece de voile qui eft une pro-
duition de la pie-mere. Additions à l’article de la membrane
de l’oeil appellee choroïde. Suppl. II. 407. b.
CHORUS, ( Luth. | infiniment à vent & à bocal. Sa def-
cription. Ouvrage oii il en eft parlé. Suppl. II. 408. a.
CHORYPHÉE, fes fondions chez les anciens. III. 561. a.
CHOSE, (Gramm. ) fens de ce mot. III. 374. b.
C hoses , Us, ( Jurifp.) tout le droit fe rapporte à trois
objets ; les chofes, les personnes, les allions. Ce qu’on entend
Par les chofes. Diverfes qualités ou modes qui leur font attribuées.
Chofes hors du commerce, ou hors le patrimoine. III.
374- b. .
Chofes: les lobe romaines ont divifè lés chofes en faintes,
rchgieufes & facrées. XIV. 477, a.
Chofes communes; celles dont l’ufage eft commun à tous;
Chofes dont l’ufage eft commun, & dont la propriété en
France eft réfervée au roi. Chofes communes dont les puif-
fances peuvent empêcher l’ufage. III. 374. b. DiftinÔion qu’il
faut faire entre les chofes des communes & les chofes communes.
Ibid. 373. a.
Chofes corporelles, celles qui ont un corps matériel foit
animé ou inanimé , &c. III. 375. a.
Chofes douieufes, en droit. ÍH. 373. a.
Chofes de faculté, ou de pure faculté. III. 375. a.
Chofes fungibles. III. 375. 4.
Chofes impoffibles, en droit. Loix à confulter. III. yje.a:
Chofes jugées, en droit. Divers fens de ce mot. Autorité'
de la chofe jugée. Sentences & jugemens qui doivent paffer
en force de chofe jugée. DI. 373.4. Ceux dont l’appel n’eft
plus recevable. lbid. b. .
Chofes t appellées jnancipi, chez les Romains. Différence
entre lés chofes appellées resmancipi, & les chofes appellées
res nec mancipi. III. 373. b.
Chofes profanes, en droit. III. 373. b.
Chofes publiques, celles dont le public a l’ufage. Chez les
Romains le peuple en avoit la .propriété, au lieu que parmi
nous, „elles appartiennent au roi ou au feigneur. En quoi .les
chofes publiques & les chofes-communes conviennent & dit
ferent. III. 373. b.
Chofes religieufes : lieux qui fervent à là fépulture des fidèles.
Différence fur ce. point. .entre les anciens. Romains 8c
nous. B m £
Chofes facrées. III. 375.
Chofes faintes y en droit. III. 373. b.
CHOTTÉ, ( Agrie. ) fe dit du blé qui a été paffé à la
chaux, pour être femé enfuite. Dix boiffeaux en font communément
douze, étant chotté. Maniere de faire cette opér
ration. Avantage du blé chotté. Suppl. II. 408. a. \
Chotté y blé. De la maniere de paffer le blé à l’eau de chaux,'
& des avantages de cette pratique. Suppl. III. 217. a , b.
CHOU, cara&ere de ce. genre de plante. DI. 376. a.
- Chou r(. Jardin.) diyerfes efpeces. Choux rouges. Rejet-
tons appelles brocolis. Choux-fleurs: leqr culture. Çhpux d©
Milan : leur culture. Les choux ne fe - perpétuent que de
graine. III. 376. a.
Chou y fes différentes efpeces : chou karaïbe dés Américains..
III. 643. Ü Choux appelles,brocolis.fi. 433. a. Colfat,
chou fàuvage. III. 660. b. oemotte. XIV. 949. a. Chou de
Î’ifle de Madagafcar, nommhfonÿs. XV. 362. a. Chou marin,'
VOye{ SOLDANELLE.
C h o u , (Mat.rnéd. ) fyrop de'chóu-rouge¿ Les choux doivent
être rangés avec les plantes alkalines. Quelques anciens
ont regardé les choux comme un remede univerfel. III. 376. a«
Ce qu’en dit l’école de Salerne. Propriétés du chou, félon
plufieurs. anciens; félon ies modernes. Qualités malfaifantes
que quelques- uns lui ont attribuées. On ne, voit pas que
l’expérience réponde à cette opinion, vu le grand ufage que
certains peuples & les habitans. des campagnes eh font fans
en être incommodés. .C’eft avec moins de. fondement que
les mêmes auteurs ont aflùré que le chou nourriffoit peu,
& fe digéroit difficilement. Ce que c’eft que le fauer-kraut
des Allemands. Ibid. b. Voye[ l’article de ce mot.
CHOUCAS. Defcription de. cet oifeau. Il a beaucoup
d’inftinâ. Endroits qu’il hahite,,&. où il fait fon nid. Ponte
de la femelle. III. 377. a.
Choucas-rouge. Defcription de cet oifeau. Endroits où il
fe retire. III. 377. a. Il a la yoíx du choucas, mais plus en-,
rouée. Ibid. b.
CHOUETTE. Defcription de cet oifeau. Hl. 377-*•
Chouette y les anciens la nommoientjlrix. XV. 346. a. Petite
chouette ou cheveche. IR. 316.4.
C h o u e t t e , (Myth. ) elle étoit confacrée àMmerye. III.
377. b. Les Athéniens en firent un de leurs fignesmilitaires,
& la gravoient fur leurs monnoies. Bon mot d’iin efclave
lacédémonien, fur les richeffes de fon maître. Ibid. 378 4.
C houette. (Médec.) Propriété que lui attnbuoit Pline.
^ c l iO U N , ( Myth. ) divinité adorée dans le Pérou, avant le
regne des Incas. Merveilles que les Péruviens en racontoient.
SM^HOÙQUÊT , chuquet, bloc y tête demore. (Marine) Defcription
de cette piece du vaiffeau, & fon ufage. La grandeur
des chouquets fe regle fur celle des vaifleaux. Proportions
& mefures des chouquets des différens mâts. III. 37ÿ-a'
Chouquet, collier de chouquet. III. 640. b.
CHOURSES, ( Jean de ) comte de Malicorne, gouverneur
de Poitou. Suppl. m. 837. a.
CHOUSSET, boiflçn en ufage chez les Turcs. «
elle fe prépare. Son effet. Onfelave avec fa moufle. III. 37R.b.
CHOUWER (Ichthy. ) poiflon des Moluques. Sa defenp
tion & ftsmoeursf Maniéré de le clafler. Suppl. U .408,é.
CHR Imr“ initiales de q u e lle s mots grecs , dont VOUS
trouyerez Iesarticles, XVH.637. *•
CHR CHR 3 1 1
CHRAMNE, fils naturel de Clotaire : il cortfulte les forts
derHRASONÔvVSKI, anecdote fur ce juif devenu chré-
tien,& fur fa femme.XV. 384. b. _
CHRÊME, ( Théolog.) ufage quen font les-églifes grec-
aues & latines. D’où eft formé ce mot. Deux fortes de chrêmes
Comment les maronites le compofoient. Réformation
aue fit à ce chrême le P. Dandini, jéfuite. Ondion du faint
chrême dans la confirmation. III. 378. b. Ondions que l’évê-
_Ue feul a droit de faire. Rétribution qifexigeoient autrefois
les évêques, & qu’on retire encore aujourd’hui des fabriques
pour la diftribution du faint chrême. Ibid.yjy. a.
CHRÊS, ( Géogr. anc.) fleuve d’Afrique. XII. 373. a.
CHRESTOS, mot qui fe trouve dans quelques inferip-
tions. XVII. 657. 4. ml, .
CHRESTUS , ( Hift. anc.) chef d’une fadion«-)mfs,qm
caufadu tumulte dans Rome, fous l’empereur Claude. — C’eft
mal-à-propos que quelques auteurs ont appliqué çecià J.C. —•
Il eft vrai que notre fauveur fut fouyent appelle le Chrejl, oc
que ce nom même fut donné aux chrétiens. L’auteur en explique
la raifon dans le refte de cet article. Suppl. II. 408. b.
CHRÉTIEN. Ce fut à Antioche, l’an 4 1, que ce nom fut
donné aux fideles. Divers noms qu’on leur a donnés. Origine
du titre de roitris-chrétien donne au roi de Francc.-III.379'
Chrétien, principes philofophiques du chrétien. Suppl. IV.
b 333.b. Les vrais chrétiens appellés parfaits dans
j ’écritiire. a i . -940. a. Nature du bonheur du chrétien. H.
322. b. Sacrifices de? chrétiens. XIV. ,484. ¿. Matières fur
lefquelles les chrétiens devroient fe fupporter mutuellement
, lorfqu’ils font d’un fentiment différent. 1. 73.iva. Préjugé
des chrétiens en faveur des livres compofés par .les
Juifs. IX. 42. b. Çaufe des excès d’adoration où les chrétiens
font tombés envers les faints. IX 61. b. Des premiers chrétiens.
Leur vêtement. XVII. 221. 4 , b. Communauté de
biens entre les premiers,,chrétiens de Jérufalem. V . 422. b.
Leurs repas- publics. XII.* 301. b. Viyt{ A gapes. Leur fer-
vice divin. XV. 121. 4. Liturgie des premiers chrétiens IX.
597,4. Leur fréquente communion. III. 722. b. Leurs dan-
fes facrées. IV. 624. b. Abftinences qu’ils obfervoient. I. 44.
a. Des voeux parmi eux. XVII. 222. aÿ¿.Des vierges. 263.
b. Affemblées nollurnes des premiers chrétiens. XI. 483. a.
— Jamais les chrétiens ne dilputerent plus fortement contre
les Juifs,’qu’immédiatement après la ruine de Jérufalem.IX.
.41. b. Pourquoi les païens accufoient les chrétiens d’anthropophagie.
I. 498. b. Les premiers chrétiens traités de barbares
par les Romains. II. 68. b. Motif des injures dont fe cou-
vroient mutuellement les chrétiens & les païens. V. 281. b.
Perfécutions exercées I o. contre les chrétiens , '& enfuite
celles des chrétiens entr’eux. XII. 4a3- a" 42^.. a., Martyre des
premiers chrétiens. X. 168.4 ., b. 169. a. Apologies, écrites en
leur faveur. I. 33a. ayb. ‘ f • _
Chrétiens de S. Jean, aufli nommés Sabéens & Mandones.
Ce qu’on dit de leur première habitation. Ils ne font ni juifs
ni chrétiens, ni mufulmans. Ce que M. Chambers dit de leurs
baptêmes. Origine qu’ils s’attribuent. Leurs pratiques font un
mélange de judaïfme 8c de paganifme. Dogmes forgés par
les mathématiciens qui les gouvernoient. Il eft fait mention
d’eux dans l’alcoran. Ils fe difent les difciplcs de S. Jean.
&c. III. 379. b. Voye{ Sabiisme.
Chrétiens de S. Thomas, dans les Indes occidentales. Am-
baffade qu’ils députèrent aux Portugais à leur arrivée dans
les Indes. Hl. 379. b. Nom qu’ils fe donnent. Ils forment une
tribu confidérable, 'mais toujours divifée par des faôions.
Us fe regardent comme étrangers dans leur pays. Us attribuent
leur converfion à S. Thomas, &c. Ce qu’on penfe de ce
■faint. La fuite de l’hiftoire de cette églife n’eft pas moins
difficile à développer que fon origine. Evêques qu’elle reçoit.
Comment ces évêques la gouvernoient à l’arrivée des Portugais.
En quelle langue fe faifoit leur office. Chaos où fe
trouva leur religion. Maniere dont ils célébroient l’euchari-
ftie, quand les Portugais y arrivèrent. Ibid. 380. a. Soins inutiles
que prirent ceux-ci à les réformer. Hiftoire de leurs
erreurs écrite par Anteâne Govée. En quoi confiftent leur
do&rine & leur culte, lbid. b. Le p'ere Simon ne convient
pas de toutes les erreurs qu’on leur attribue. Ibid. 381. a,
Voye{ T homas.
Chrétiens orientaux ou arméniens. I. 693.4, b. Chrétiens de
la ceinture. II. 799. b. Chrétiens cophtes. IV. 173. a , b. Chrétiens
maronites. X. 134. b.
CHRÉTIENTÉ, fignifioit autrefois le clergé. Sens de ce
mot aujourd’hui. III. 381. 4.
CHRISIPPE, Médecin. X. 282. b.
CHRIST. Etymologie de ce mot. Ce mot fe dit par anto-
Çomafe d’une perfonne en particulier qui eft envoyée de
I^icu. Il fe dit par excellence du Sauveur du monde, &c.
Voye^ Messie.
C hrist, faute à corriger dans cet article de l’Encydo-
P% - StrpL m 408. b.
C h r is t ,lenom.de Chreflusdonné à J. C.Suppl. R. 408. b.
t C hrist , ( Ordre de ) ordre militaire en Portugal. Sort
inftitution , fa réglé, &c. La grande maîtrife réunie à la
couronne. Armes de l’ordre. Lieu de la réfidence des chevaliers.
Autre ordre de ce nom en Livonie. III. 381. 4.
CHRISTIANIj fon ouvrage italien fur les mefures. Suppl.
î .<66.b.
CHRISTIANISME, c’eft plutôt avec les légiflateurs qu’avec
les philofophes qu’on peut comparer l’auteur dü chri-
ftianifine. Le chriftianifme peut être confidéré dans fon rapport
avec les vérités révélées, ou avec les intérêts politiques.
Envifagé -fous le premier afpelt ; titres de fa divinité*
Les autres légiflateurs, pour inipirer aux peuplés le refpeft,
oiit aufli afpiré à l’honneur d’en être regardés comme les
organes de la Divinité. III. 381. b. Cette conduite prouvé
évidemment qu’on a toujours cru qué lé dogme d’iirie providence
eft le plus puiflant frein qu’on puifle donner aux
hommes. Mais les légiflateurs nous montrent dans . leurs per-
fonnés clés fourbes 8t des impofteurs. En facrifiant le vrai à
l’utile , ils ,auroient dû s’appércevolr qiie le coup qui frap-
poit fur le premier, frappoit aufli fur le fécond. Pourquoi les
légiflateurs ont tenu une telle conduite. Ils n’oferent hafarder
la vérité que dans les grands mÿfteres où ils n’admettoient
que .dés p.érfonnes choines. C’étoit fans doute une mauvaifé
politique , car tant qu’ils rie tarifloient pas la foürce empoi-
fonnée d’où les maujt fe répandoient fur ies états,il ne leur
étoit pas . poifibie d’en arrêier l’affreux débordement. Ibid. <
382. 4. Le.légÎflateur des chrétiens animé d’un éfprit bieri
différent, commença par détruire les erreurs qui tyranni-
foientle mondé , afin de'rendre fa religion plus utile. 11
rétablit dans fa Iplendeur primitive la loi naturelle qué les
paifions avoient u .fort ôblcurcie : il révéla aux hommes uno
morale jufqu’alors" inconnue dans les aiitrés religions. Ici
l’impiété fe confond, & ne voyant aiicune réflource à attaquer
la morale chrétienne du côté de fa perfellion, elle fe
retranché à, dire* que c’eft .cette perfeéüorirhême qùi la rend
nuifible aux états. Ibid. b. Défenfe de la morale .'du çhriftia-
riifme dans fes principaux points. I. Obje&ion. propôièe parles
adverfaires, fur le çélib.at que le ch.riftianitme fait confidé-
rer comme un degré de perfeltion en morale. Rêpohfe. Quelle
eft l’efpece de célibat vraiment condamnable. Effets du célibat
recommandé par le chriftianifme. II. ObjcSion par rapport
au luxe défendu par la loi des chrétiens. 'Ibid. 383. a.
Rêponfe. Effet du luxe-fur .les âmes. Influence fatale au luxé
fur les états. S’il leur eft'utile quelquefois j cê n’eft point pat*
fa nature; mais par certainesejrconftancës qui lui font étrangères.
.Du luxe dans les monarchies: M. de Montéfquicù
cité fur Ce fujet: en quel fens il faut entendre, fa penfée,
lorfqu’il admet l’utilité au luxe dans les monarchies. Ibid. b.
Le chriftianifme n’eft poiiit tel que lé figurent à nos yeux
■tous les rigoriftes, dont l’auftérité farouche nuit extrêmement
à la religion. ' Le carallere des hétéfies eft de porter
tout à l’excès en matière de morale. Exemples. 30. Comment
a répondu M. de Montefquieu à l’accùfatioh ■. que Bayle fait
au chriftianifme d’être peu proprè à former des héros & des
foldats. IV. Objeélion contre le chriftiàriifme. Son. intolérance,
fes fe&es, fes genres de religion. Ibid. 384. 4. Rêponfe.
En quel fens le chriftianiime' èft intolérant, caraâere qui
n’exclut pas la tolérance jufte .& raifonnabie. Les guerres
font l’effet du fanatifme, vice* des particuliers & non de la
religion de Jefus-Chrift. V.'Objeflion. Le meilleur remede
contre* le fanatifme & la fuperûition, fèroit de s’en tenir à
une religion qui preferivarit une morale pure, ne commande-
roit point à l’efprit de recevoir des dogmes qu’il ne comprend
pas. Ibid. b. Rêponfe. Néceflité d’un culte révélé pour
fixer dans l’efprit des hommes les grands principes de religion.
On ne réuflit à échauffer les efprits, qu’autant qu’on
démontre aux hommes l’intervention particulière de la Divinité
pour l’établiffement de fon Culte. VI. Objeflion. La religion
chrétienne ri’eft pas la meilleure de toutes pour tous les
pays. Une religion comme naturalifée par fon antiquité, eft
liée avec la conftitution de l’étàt. On qe peut S’aflurer que
les avantagés d’une meilleure religion compenfent les incon-
véniens quiréfultent d’un changement de religion, lbid. 383. 4*
Rêponfe. C’eft une maxime fàufle qu’une religion fondée fut1
l’erreur, foit jamais la meilleure pour lâ nation qui l’a
adoptée. Extrême avantage du chriftianifme Confidéré politiquement
, fur l’ancien paganifme , fur le mahomètilme
& les autres religions des Afiatiques. Non-;feulement le
chriftianifme établit le dogme de l’immortalité dé l’ame, mais
il fait admirablement bien le diriger. Ibid. b. Suite désavantages
du chriftianifme fur les religions dés orientaux. M. de
Montefquieu c.ité pour prouver les avantages qùe la religion
chrétienne procure aux états. Efpr. dès loix, livl XXIV. ch.
III. Ibid. 386. 4. Le chriftianifme fe lie très-bien avec les
intérêts politiques des états, il y conferve les moeurs qui
font elles-mêmes le bonheur des peuples. Maniéré dont on
doit l’établir pour éviter les inconvéniens qui réfultent d’un
changement de religion. Maniéré dont il s établit autrefois.
Ibid. b. Si l’ancienne religion nationale eft mauvaife, dès-.