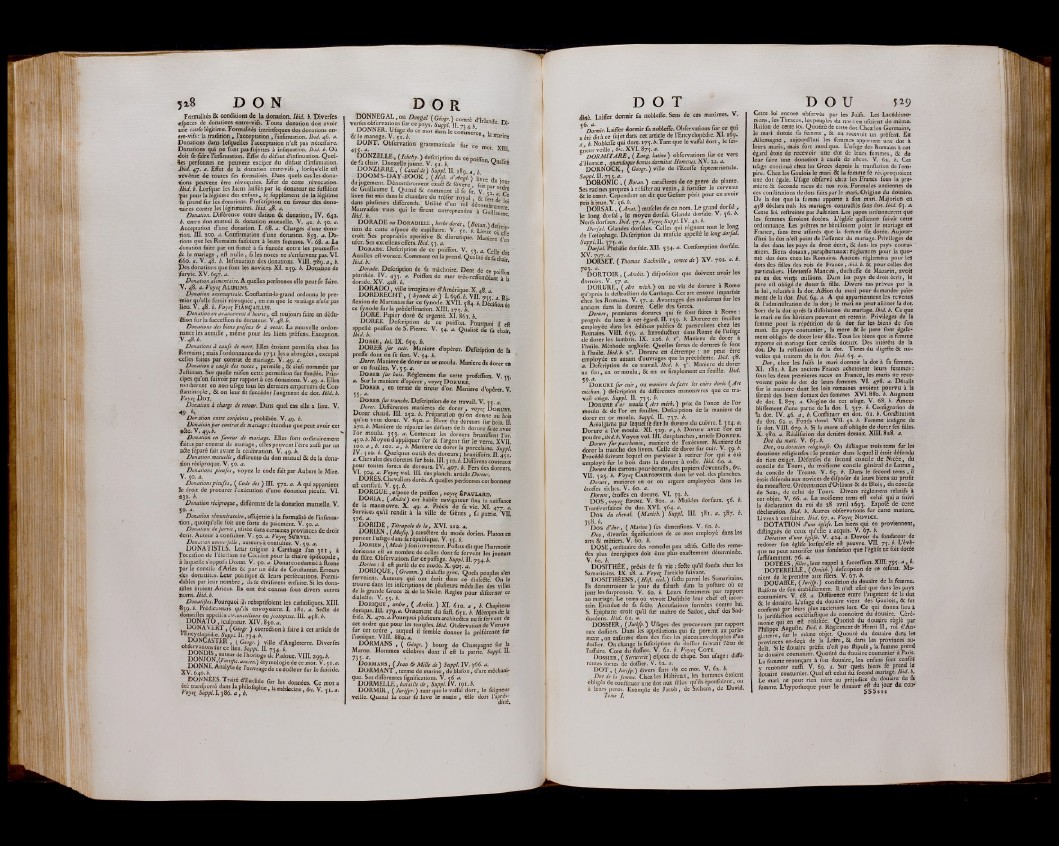
j i 8 D O N D O R
Formalités fie conditions de la donation. Ibid. b. Diverses
efpeces de donations entre-vifs. Toute donation doit avoir
une caufe légitime. Formalités tntrinfeques des donations entre
vifs : la tradition, l’acceptation, l’inftnuarion. Ibid. 46. a.
Donations dans 'lefquelles l’acceptation n’eft pas néceflaire.
Donations qui ne font pas fujettes à infinuation. Ibid. b. Où
doit fe;faire l’irifinuation. Effet du défaut d-infinuation. Quelles
perfonnes -ne peuvent excipcr du défaut dlnfinuation.
jbid. 47. a. Effet de la donarion entre-vifs , lorfqu’elle eft
■revêtue de toutes fes formalités. Dans quels cas les donations
peuvent être révoquées. Effet de cette révocation.
Ibid. b. Lorfciuc les biens Jaifféspar le donateur ne fuffifent
pas pour la légitime des enfans, le fupplémcnt de la légitime
fe prend fur les donations. Preicrfption en faveur des donataires
contre les légitimaires. Ibid. 48. a.
Donation. Différence entre dation de donation, IV. 642.
b. entre don mutuel & donation mutuelle. V. 4a. b. 30. a.
Acceptation d’une donation. I. 68. a. Charges d’une donation.
111. 20Q. a. Confirmation d’une donation. 853. a. Da- 1
-rions que les Romains faifoient à leurs femmes. V. 68. a. La I
donation faite par un fiancé à fa fiancée entre les promeftes
fie le mariage, cil nulle, fi les noces ne s’enfuivent pas. VI. :
660. a. V. 48. b. Infinuation des donations. V 1ÍI. 7,89. a , b.
pes donations que font les novice;. XI. 239. b. Donation de .
furyie. XV. 697. a.
Donation alimentaire. A quelles perfonnes elle peut fe faire.
V. 4?. a. V<tye{ Alimens.
Donation anténuptiale. Conftantin-lc-grand ordonna le premier
qu’elle feroit révoquée, en cas que le mariage n’eut pas
lieu. V . 48. b. Voyc^ F i a n ç a i l l e s .
Donation en avancement a'hoirie, cil toujours faite en déduction
fur la fucccfiion du donateur. V. 48. b.
Donations des bie/ts oréfens & à venir. La nouvelle ordonnance
les annuité, même pour les biens préfens. Exception.
V. 48. b.
Donations à caufe de mort. Elles étoient permifes chez les
Romains ; mais l’ordonnance de 1731 les a abrogées, excepté
celles faites p.ar contrat de mariage. V. 49. a.
Donaiiçn a caufe des noces, permife, & ainfi nommée par
Juftinien. Sur quelle raifon cette permifiion fut fondée. Principes
qu’on fuivoit par rapport à ces donations. V . 49. a. Elles
tombèrent en non-ufage fous les derniers empereurs de Con-
fiaminople, & on leur fit fuccéder l’augment de dot. Ibid. b.
Voyc{ D o t .
Donation à charge de retour. Dans quel cas elle a lieu. V.
* 40* **. . . . Donation entre conjoints, prohibée. V. 49. b.
Donation par contrat de mariage : étendue que peut avoir cet
«tte.V. 49. é.
Donation en faveur de mariage. Elles font ordinairement
faites par contrat de mariage, elles peuvent l’étre aulfi par uji
atte féparé fait avant la célébration. V. 49. b.
' Donation mutuelle, différente du don mutuel & de la donar
tion réciproque. V . 50. a.
Donations pieufes, voyez le code fait par Aubert le Mire.
V. 50. a.
Donations pieufes, ( Code des ) III. 37*- A qui appartient
le droit de procurer l’exécution d’une donation pieufe. VI.
332'. b.
Donation réciproque, différente'de la donation mutuelle. V.
50. a.
Donation rémunératoire, affujettie à la formalité de l’infinua-
tion | quoiqu’elle foit une forte de paiement. V . <0. a.
Donation de Jurvie, ufuée dans ceriainesj>rovinces de droit
écrit. Auteur à confulter. V. 50. a. Voye{ Si/nvit.
Donation unive'Jelle, auteurs à conlulter. V. 59. a.
DONATISTLS. Leur origine à Carrhaee l’an 311 , à
l’occafion de l’élettion de Cécnien pour la chaire épilcopale,
à laquelle s’oppofa Donar. V. 50. a. Donat condamné à Rome !
par le concile d’Arles U par un ¿dit de Conitantin. Erreurs !
des donatiltus. Leur politique Ht leurs perfécutions. Formidables
par leur nombre, ifs le diviferent enfuitc. Si les dona-
tifles étoient Ariens. Us ont été connus fous divers autres
noms. Ibid. b.
Donatifles. Pourquoi ils rebaprifoient les catholiques. XIII.
839. b. Prédicateurs qu’ils envoyoient. I. 181. a. Sefte de
donatifles appelles ctnoncellions ou Icotopues. III. 4<8. b.
DONATO, leulpteur. XIV. 830. a.
DONA VERT, ([Géogr ) correttionà faire à cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. II. 734. b.
pONCASTER , ^ Geo g/. ) ville d’Angleterre. Diverfes
n nM n îi1“ ' “ “ • 734-
l’horloge Je Padouc. VIII. 199. t .
n n w w f a ancitn) étymologie de ce mot. V.ei.a.
XV^4C ¿ 1 Ouvrage de ce doûeur fur le fuicide.
DONNÉES. Traité d’Euclide fur fis données. Ce mot a
été transporté dans la ph.lofophie, U méckcine, be. V. r i.a .
Voye^ Suppl. L 386. a , b.
DONNEGAL.ou Duagal (Gbagr.) comté dlrfande TV
verfes obfcrvarions for ce pays. Suppl. II y , . 1 " c- Ç r
DONNER. Ufage de ce"¿>t i Z le c o ^ e r c e . la mari
fie le manège. V . 31 .b. * “ raaruie
DONT. Obfervation grammaticale fur ce mot. XIII
DONZELLE, ( Ichthy. ) defeription de ce poiffon o v i
de fa chair. Donzellc jaune. V. < 1. b. Qualité
DONZERRE, ( Canal de) Suppl. II. 180. a U
| DOOM’S-DAV-BOOK , {Hifl. d'Angl. ) nVre d„ î
du jugement. Dénombrement exatt & févere, faitn,r J jUr
de Guillaume I. Quand & comment il fc fit. V ÏÏ r*
livre fut mis dans la chambre du tréfor royal fiiCrr', a i -
dans pluficurs différends Uf,liré d'un .cl dénombreme^
Mauvarfes vues qui le firent entreprendre à G u ill,"^
DORADE pu DoRéDILLE, htrbcdortt , (Bolau J ¿ ft*
«On de cette efpecc de capillaire. V. 51. i. Lieux oh elfe"
croit. Ses propriétés aperitive & diurétique. Manière d i.
ufer. Ses excéllcns effets. Ibid. 33. a.
D o r a d e . Defeription de ce poiffon. V. 53. a. Celle des
Antilles eft vorace. Comment onia prend. Qualité de fa chair
Dorade. Defeription de fa mâchoire. Dent de ce nniflV«
pétrifiée. IV. 435. «. Poiffon de mer trés-reffemblant à la
dorade. XV. 428. b.
DORADO, ville imaginaire d’Amérique. X. 48. a
DORDRECHT, {Synode de) \:6o6.b. VII. 7^ . a j>a
flexion de Martinius fur ce fynode. XVII. *84. L Dtciûnn ,u
ce fvnode fur la prédeftination. XIII. 273. b.
DORÉ. Panier doré & argenté. XI. 861. b.
DORÉE. Defeription de ce poiffon. Pourquoi il eft
appellé poiffon de S. Pierre. V. 34. a. Qualité de û chair
Ibid. b.
D o r é e , loi. IX. 639. b.
DORER fur cuir. Maniéré d’opérer. Defeription de la
prefle dont on fe fort. V . 34. b.
Dorer. Maniéré de dorer en or moulu. Maniéré de dorer en
or en feuilles. V. 33. a.
D o r e r fur bois. Réglemens fur celte profeflion. V. te.
a. Sur la maniéré d’opérer, voye[ D o r u r e .
D o r e r , en terme de tireur d’or. Maniéré d’opérer. V»
55-*-
Do re r fur tranche. Defeription de ce travail. V. te. a.
Dorer. Différentes maniérés de dorer , voyez D o ru r e .
Dorer chaud. III. 232. b. Préparation qu’on donne au bob
qu on veut dorer. V. 630. a. Blanc des doreurs fur bois. II.
270. b. Maniéré de réparer les défauts de la dorure faite avec
f ? ï lu‘ 3 P* a' CMrnnait les doreurs brumffent l’or.
430. A Moyen d’appliquer l’or fie l’argent fur le verre. XVII.
100. a , b. 101. a , b. Maniéré de dorer la porcelaine. Suppl.
. Quelques outils des doreurs; bruniffoirs. II.4(1.
a. Chevalet des doreurs fur bois. III. 310. A Différens couteaux
pour toutes fortes de doreurs. IV. 407. b. Fers des doreurs.
f J î ^ c ¡ S U I R M§ d#sPlanch- article Doreur.
a Clievaliers dorés. A quelles perfonnes cet honneur
eft conféré. V. 35. b.
DORGUE, efpece de poiffon, voye% É p a u l a r d .
DOR1A , {André) cet habile navigateur fixa la naiffance
de la manoeuvre. X. 49. a. Précis de fa vie. XL 477. a.
Services qu’il rendit à la ville de Gènes , fa patrie. VIL
DORIDE, Tètrapolc de la, XVI. 21a. a.
DORIEN, {Mujij. ) caraélere du mode dorien. Platon en
permet l’ufagc dans fa république. V.53. b.
D o r i e n , {Mode ) fon inventeur. Pollux dit que l’harmonie
donenne eft au nombre de celles dont fe fervent les joueurs
de flûte. Obfervations fur ce paffage. Suppl. II. 734. b.
Dorien : il eft parlé de ce mode. X. 903. a.
DORIQUE, {Gramm.) dialcâegrec. Quels peuples s’en
fervoienr. Auteurs qui ont écrit dans ce dialeôe. On le
trouve dans les inferiptions de plufieurs médailles des villes
de la grande Grece fie de la Sicile. Réglés pour difeerner ce
dialeéfe. V. 33. b.
D o r i q u e , ordre, ( Archit. ) XI. 610. a , b. Chapiteau
dorique. 111.179.4. Ornement du fuft. 631. b. Métopes de la
frife. X. 470. a. Pourquoi plufieurs architcâcs ne fe fervent de
cet ordre que pour les temples. Ibid. Obfervation de Virruvc
fur cet ordre , auquel il femble donner la préférence fur
1 ionique. VIII. 880. a.
DORMANS , ( Géogr. ) bourg de Champagne fur la
Marne. Hommes célébrés dont il eft la patrie. Suppl. IL
¿ 0 RM ANS, ( Jean fit Mille de ) Suppl. IV. 366. a.
DORMANT, terme de marine, de blafon, d’arc méchani-
que. Scs différentes fignifications. V. 36 a.
DORMELLE > bataille de , Suppl. IV. 191. b.
DORMIR, {Jurifpr.) tant que le vaffal dort, le feigneur
veille. Quand la cour fe lève le matin, elle dort l’apré<-
dmé.
75è ,
D O T
dîné. Laiffer dormir fa nobleffe. Sens de ces maximes. V.
* Dormir. Laiffer dormir fa nobleffe. Obfervations fur ce qui
a été dit à ce fujet dans cet article de l’Encyclopédie. XL 169.
a. b. Nobleffe qui dort. 173. b. Tant que ie vaffal dort, le feigneur
veille, &c. XVI. 873.a. .
DORMIT ARE, {Long, latine) obfervations fur ce vers
d'Horace, quandoque bonus dormitut Home rus. XV. 22. a.
DORNOCK, ( Géogr. ) ville de 4’Ecoffe feptentrionale.
S“g o R < $ î c , ( Sotan.) caraâeres de ce genre de plante. I
Ses racines propres à réfdter au venin, à fortifier le cerveau
fie le coeur. Cependant on dit que Gefner périt pour en avoir
pris à jeun. V. 36. b.
DORSAL , {Anat.) mufcles de ce nom. Le grand dorlal ,
le long dorfal, le moyen dorfal. Glande dortale. V. 36. b.
Nerfs dorfaux. Ibid. 57. a. Voye^ Suppl. IV. 42. b.
Dorfal. Glandes dorfales. Celles qui régnent tout le long
de l’oefophagc. Defeription du mufcle appellé le long dorfal.
Suppl. II. 373. a. ' . ,
Dorfal. Phtbifie dorfalc. XII. 334. <*• Confomption dorfale.
{ Thomas Sackville , comte de ) XV. 702. a. b.
7° è o ilTO IR I {Archit. ) difpofition que doivent avoir les
dortoirs. V. 3 7. a.
DORURE, {Art mêch.) on ne vit de dorure à Rome
qu’après la deftruétion de Cartilage-. Cet art encore imparfait
chez les Romains. V. 37. a. Avantages des modernes fur les
anciens dans la dorure. Celle des Grecs.
Dorure, premières dorures qui fe font faites à Rome :
progrès du luxe à cet égard. IL 139. b. Dorure en feuilles
employée dans les édifices publics & particuliers chez les
Romains. VIII. 639. a. Introduélion dans Rome dé Fufifge
de dorer les lambris. IX. 226. b. r°. Maniéré de dorer à
l’huile. Méthode angloife. Quelles fortes de dorures fe font
à l’huile. Ibid. b. 2°. Dorure en détrempe : ne peut être
employée en autant d’ouvrages que la précédente. Ibid. 38.
a. Defeription de ce travail. Ibid. b. 30. Maniéré de dorer
au feu, en or moulu, fie en or Amplement en feuille. Ibid.
39.4.
D O R U R E fur cuir , ou maniéré de faire les cuirs dorés ( Art
méchan. ) defeription de différentes manoeuvres que ce travail
exige. Suppl. II. 733. b.
D O R U R E d’or moulu {Art méch.) prix de lonce de lor
moulu fie de l’or en feuilles. Defeription de la maniéré de
dorer en or moulu. Suppl. II. 737. b.
Amalgame par lequelfe fait la dorure (du cuivre. I. ^14. a.
Dorure à l’or môulu. XI. 329. a, b. Dorure avec lor en
poudre, ¿é/</.è. Voyez vol. III. des planches, article D o r e u r .
Dorure fur parchemin, maniéré de l’exécuter. Maniéré de
dorer la tranche des livres. Celle de dorer fur cuir. V. 39. b.
Procédé fuivant lequel on parvient à retirer l’or qui a été
employé fur le bois dans la dorure à colle. Ibid. 00. a.
Dorure des cartons pour écrans, des papiers d’éventails, 6*c.
VIL 323. b. Voyei C a r t o n n i e r dans le* vol. des planches.
Dorure, matières en or ou argent employées dans les
étoffes riches. V. 60. a.
Dorure, étoffes en dorure. VI. 39. b.
DOS, voyei É p in e . V. 801. a. Mufcles dorfaux. 56. b.
Tranfverfaires du dos. XVI. 364. a.
Dos du cheval. {Maréch. ) Suppl. III. 381. a. 387. b.
398. b.
Dos Tânt, {Marine) fes dimenftons. V. 60. b.
Dos, diverfes fignifications de ce mot employé dans les
arts & métiers. V. 00. b.
DOSE, ordinaire des remedes peu attife. Celle des reme-
des plus énergiques doit être plus exaftement déterminée.
V. 60. b. , .
DOSITHÉE, précis de fa vie ; fette qu’il fonda chez les
Samaritains. IX. 28. a. Voyt\_ l’article fuivant.
DOSITHÉENS, ( Hift. eccl.) fette parmi les Samaritains.
Us demeuraient le jour du fabath dans la pofture où ce
jour les furprenoit. V. 60. b. Leurs fentimens par rapport
au mariage. Le tems où vivoit Dofithée leur chef eft, incertain.
Etendue de fa fette. Accufations formées contre lui.
S. Epiphane croit qu’il fut maître de Sadoc, chef des Sad-
ducéens. Ibid. 61. a.
DOSSIER, {Jurifp.) Ufages des procureurs par rapport
aux doffiers. Dans les appellations qui fe portent au parlement
, on enferme dans des facs les pièces enveloppées d’un
dofticr. On change la fufeription du doftier fuivant l’état de
l’affaire. Cote du doffter. V. 61. b. Voyc^ C o t e .
D o s s i p . r , {Serrurerie) efpece de chape. Son ufage: différentes
fortes de doftier. V. 62. a.
D O T , {Jurifp.) divers fens de ce mot. V. 62. b.
Dot de la femme. Chez les Hébreux, les hommes étoient
obligés de conllituer une dot aux filles qu’ils époufbicnt, ou
a leurs peres. Exemple de Jacob, de Sichem, de David.
Tome I,
D O U 529
Cette loi encore obfervêe par les Juife. Les Lacédémo*
niens, lesThraces, les peuples du nord en ufoient de mémo.
Raifon de cette loi. Quotité de cette dot. Chez les Germains,
le mari dotoit fa femme , 8c en recevoit un préfent. En
Allemagne , aujourd’hui les femmes apportent une dot à
leurs nuris, mais fort modique. L’ufage des Romains à cet
égard ¿toit de recevoir une dot de leurs femmes, 8c de
leur faire une donation à caufe de nôces. V. 62. b. Cet
ufage continué chez les Grecs depuis la tranftarion de l’empire.
Chez les Gaulois le mari fie la femme fe réciproquoient
une dot égale. Ufage obfervé chjz les Francs fous la première
8c féconde races de nos rois. Formules anciennes de
ces conftifutions de dots faits par le mari» Origine du douaire.
De la dot que la femme apporte à fon mari. Majo rien en
438 déclara nuls les mariages contrattés fans dot. Ibid. 63. a.
Cette loi reftreinte par Juftinien. Les papes ordonnèrent que
les femmes feraient dotées. L’églifé gallicane fuivit cette
ordonnance. Les prêtres ne bénilloient point le mariage en
France, fans être afturês que la femme fût dotée. Aujourd’hui
la dot n’eft point de l’effence du mariage. Privilèges de
la «lot dans les pays de droit écrit, fie dans les pays coutu»
miers. Biens dotaux, paraphernaux : réglemens pour la quotité
des dots cnez les Romains. Anciens réelemens pour le$
dots des filles des rois de France, ibid. b. fie pour celles des
particuliers. Hortenfé Mancini, ducheffe de Mazarin, avoit
eu en dot vingt millions. Dans les pays de droit écrir, le
pere eft obligé de doter fa fille. Divers cas prévus par la
la loi, relatifs à la dot. Attion du mari pour demander paiement
de la dot. Ibid. 64. a. A qui appartiennent les revenus
8c l’adminiftration de la dot ; le mari ne peut aliéner la dot.
Sort de la dot après la diffolution du mariage. Ibid. b. Ce que
le mari ou fes héritiers peuvent en retenir. Privilèges de la
femme pour la répétition de fa dot fur les biens de fon
mari. En pays coutumier, la mere 8c le pere font également
obligés de doter leur fille. Tous les biens que ta femme
apporte en mariage font cenfés dotaux. Des intérêts de la
dot. De la reftitution de la dot. Titres du digefte 8c no-
veiles qui traitent de la dot. Ibid. 63. a.
Dot, chez les Juifs le mari donnoit la dot à fa femme.
XI. 181. b. Les anciens Francs achetoient leurs femmes:
fous les deux premieres races en France, les maris ne rece-
voient point de dot de leurs femmes. VI. 478. a. Détails
fur la maniere dont les loix romaines avoient pourvu à la
fûreté des biens dotaux des femmes XVI. 880. b. Augment
de dot. I. 873. a. Origine de cet ufage. V. 68. b. Ameubli
fie ment d’une partie de la dot. I. 337. b. Confignation de
la dot. IV. 46. a, b. Conftituer en dot. 6t. b. ConftitutioA
de dot. 62. a. Fonds dotaL VII. 32. b. Femme indigne de
fa dot. VIII. 670. b. Si la mere eft obligée de doter fes filles.
X. 380. a. Réalifation des deniers dotaux. XIII. 828. a.
Dot du mari. V. 63. b.
Dot, ou dotation religieufe. On diftingue trois tems fur les
dotations religienfcs : le premier dans lequel il ¿toit défendu
de rien exiger. Défcnfes du fécond concile de Nicée, du
concile de Tours, du rroifieme concile général de Latran . '
du concile de Trente. V. 63. b. Dans le fécond tems, il
étoit défendu aux novices de difpofer de leurs biens au profit
du monafterc. Ordonnances d’Orléans 8c de Blois, du concile
I de Sens, de celui de Tours. Divers réglemens relatifs à
cet objet. V. 66. a. Le troifieme tems eft celui qui a fuivi
la déclaration du roi du 28 avril 1693. Expofé de cette
déclaration. Ibid. b. Autres obfervations fur cette matière.
Livres à confulter. Ibid. 67. a. Voye^ N o v i c e .
DOTATION d’une églife. Les biens qui en proviennent,
diftingués de ceux qu’elle a acquis. V. 6f. b.
Dotation d'une églife. V. 424. a. Devoir du fondateur de
redoter fon églife lorfqu’elle eft pauvre. VII. 73. A L’évê-
cjue ne peut autorifer une fondation que l’églife ue foit dotée
iuftifamment. 76. a. „ ,
DOTÉES, filles,leur rappel à fucceflion. X I I I .793. a , b.
DOTERELLE, ( Ornith. ) defeription de ce oifeau. Maniere
de le prendre aux filets. V. 67. b. \
DOUAIRE, {Jurifp.) condition du douaire de la femme.
Raifons de fon établiflement. Il n’eft ufité que dans les pays
coutumiers. V. 68. a. Différence entre l’augntent de la dot
8c le douaire. L’ufagc du douaire vient des Gaulois, 8c fut
confirmé par leurs plus anciennes loix. Ce qui donna lieu à
la jurifdittion eccléfiaftiquc de connoître du douaire. Cérémonie
qui en eft réfultée. Quotité du douaire réglé par
Philippe Augufte. Ibid. b. Règlement dé Henri I I , roi d Angleterre,
fur le môme objet. Quotité du douaire dans le*
provinces en-deçà de la Loire, 8c dans les provinces au-
delà. Si le douaire préfix n’eft pas ftipulé, la femme prend
le douaire coutumier. Quotité du douaire coutumier à Paris.
La femme renonçant à ion douaire, les enfàns font cenfés
y renoncer aurn. V. 69. a. Sur quels biens fe prend le
douaire coutumier. Quel eft celui du fécond mariage. Ibid. b.
Le mari ne peut rien taire au préjudice du douaire de fil
femme. L’hypothèque pour le douaire eft du jour du con-'