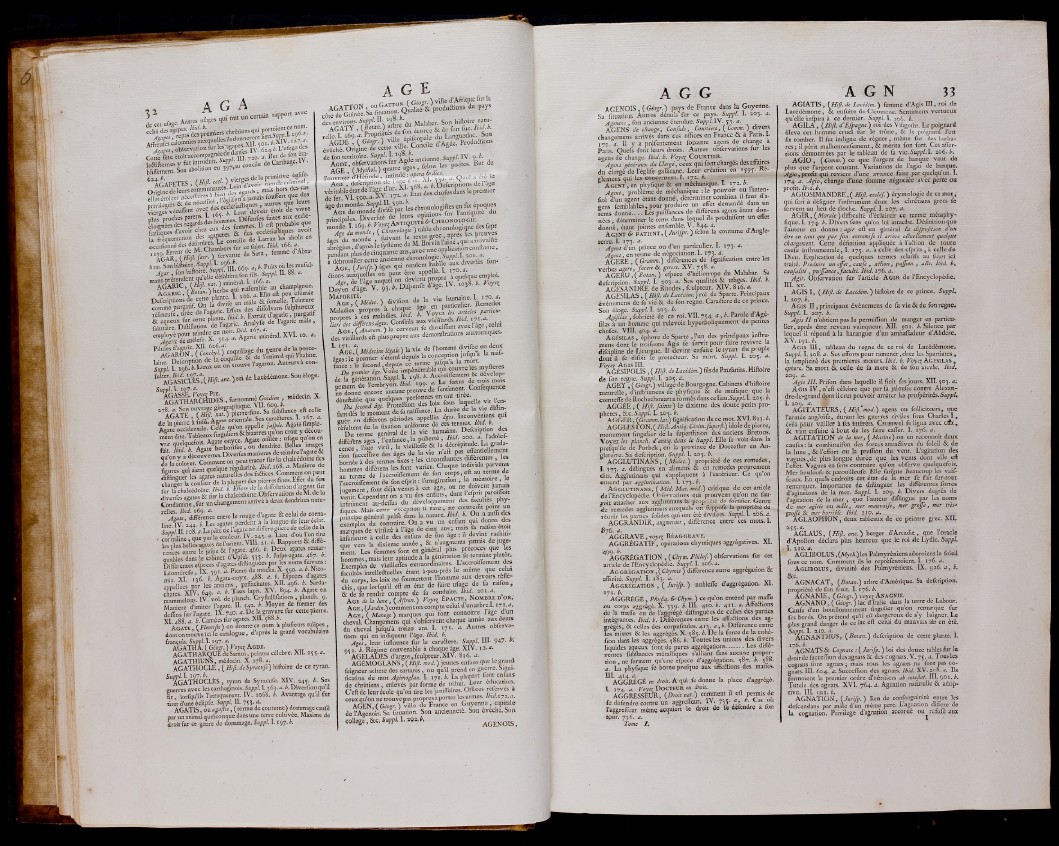
A G A
A-opu, oblenration fur les^gapes j y 56j4.à,L’uftgcd«
Cette â te ètoit accompagnée de:dan ■ ~ Bm d fo„ etaleaiftemes
| ■ D h 8 9 concile de Carthugc. IV.
bliffement. Son aboîinon eo 397*a"
^AGAPETES, (ffi/î- ccc\ ) J ^ H ’nvo/r ne” ecriminel,
Origine d e le u r s communautés. Loin . ^ hors des cas
ellesétoient „éceffiuresa lr.en ? jamais fouffert que des
privilégiés & de néceffite, ' ¿ « " J u e s , autres que leurs
vierges vécuffent avec des devoir êtott de vivre
plus proches parens. Défenfes « te s aux eedeeloignèes
des regards deshomm j j y obabie que
fiaftlques d'avoir ches e & dës eccléfiaihques avoir
la fréquentation des ag P -de de Latran les abolit en
occafionné des délor r • fpjei. ffid. *66. n. ■ g^MSWIhide 1 ■femme
léfmeufe, tirée de l’aganc. ets tfagaric, purgatif 1,aBaric M B g d n S S Agaric minéral. XVI. 10.
S , . P t é K - M f l P j g | cou-
A à t ë i c s Ç s X W - - r . ) r o i Lacèdémone. Son éloge,
Suppl. 1- ' 97*a'
AGATHARCHIDES, furnommé GnWire , médecin. X.
^ A G Â TE H H A Ï Sa^Wanceeft celle
ASTdheC1TabTwux finguliers 8cbizarres qu’on croit y décou-
Maladies p g g f g ankles particud
i t e A e a t e o n v c e . Agate oeiflée : ufage qu on en
FPSfÎS^ifÆ#*^SSB3* Condmn'ure^Eirun changement arrivé a deux dendrites nature'!
diaafdiffè?énce entre le rouge d’agate & celui de corna-,
r i v » aa h Les agates perdent à la longue de leur éclat.
W 8 r e L La pitfdc fagatene differegleredq celle de là
¿uppi.il. 10 F , Ty a Lieu dou Ion tire
| i -Rw ons I " •
rences entre le jafpe & l'agate. 466. b Deux agates remar-
S k s dans le cabinet d’tfpfal. 53 j . g Jafpe-agate. 467- b.
différentes efueces d'agates diflinguïes P” les non« fmvanst
t a .A-mC.» iY eni a Pierre de mocka. X. <90. a. b. mco-
^ a XI 136. ¿Agate-onyx. 488. a. i. Efpeces d'agates
appellées par les anciens, paffachates. Xïï. 496. g Sarda-
chates XIV. 649. fs t. Tads lapis. XV. 894. b. Agate en
Emmêlons IV vol. de planch. Cryftalhfauons , planch. 9.
OE A c ' l 5 4 * . / Moyen de former des
S u s fur l’agate. Æ 740 . n. D e lagravure fur cettepterte.
c- ( Giosr- ) ville d'Afrique furia
de AfoGuD teEr,roitbofierrev, aSnuopnpls. fLu r Agdeaanncciieennn ej. -S«ÆW>gLg IfVe- 9B-ub-t d.e
AGE , ( Mylhol.) quatre âges . félon
l'ouvrage d'Héfiode , intitue Q u e l a été le
AGE , defcnption d e A y n * ^ g Ôefcriptions del'age
véritable état de 1 asjetl on ■ | t e c h o f e s dans le premier
de fer. VI. 500. a. a v . 17^.
âge du monde. Suppl-1M 9°- ^ clironoiogiftes en fix époques
? E , de leurs opinions fur l'antiquité du
principales. ^D™er^ ANTIQ0 IT i& CHRON0L0GIE
monde. I. i6ç>.b. f f i g g g f g g s bl chronologique desfept
Agi du monde, (. Lbronologi' tes preuves
âges du monde , fuivtnt nJ^'m l’aîné, qui a travaillé
* p l ^ f l a ^ s ^ r t n d ^ g E“ d; w r fo f0" '
¿lions auxquelles on peut e r PP ^ quelque emploi. W««- Ses propres à chaque ag P ^ ^
deiiinsiuriagate. ------ -„«»-¿a ,
XI. 488.4. A Camées fur agates. Ail. 5»8.*.
A g a te , ( î&rr iic) on donne ce nom à plufieurs tiihpes ,
dont on trouve ici lie catalogue, d’apres le grand vocabulaire
francois. Suppl. 1. 197.4.
AGATHA. ( Gcogr.) Voycç A gde. m , v „
AGATHARQUËdeSamos, peintre cèlebre. A il. 255.4.
AGATHIUNS, médecin. X. 278. 4.
AGATHOCLE, ( Hiß. deSyracufe) hiftoire de ce tyran.
, tyran de Syracufe. XIV. 245. b. Ses
guerres avec les carthaginois. SupplX 363.0. ¿.Diverfion qu’il
fit , lorfqu’ils l’attaquerent. IV. 1068. b. Avantage qu’il fut
tirer d’une écüpfe. Suppl. H. 753. 4.
AGATIS, ou agafiis, ( terme de coutume ) dommage caufé
par un animal quelconque dans une terre cultivée. Maxime de
droit fur ce genre de dommage. Suppl. 1. 197. b.
e f v I em Ä eft pius propre aux démonftrarions atratouuques.
mÈBÊÊKÈm m S m m B r i DÏrermelageni;rdeUt ° v i= humrine" Defcription d « im Âvî^r Ws s p i
l’accroiffement de fon efprit : l’imagmatton, la mémoire , le
principe général puifé dans la. nature. Ilid. b. On aauffides
exemples du contraire. On a vu un enfant qiu ^
marauesde virilité a l’âge de cinq ans; mas fa rarfon êtott
Inférieure à ceUe des eSfans de ion âge : il devint raçhm.
que vers la dixième année, & n'augmenta jamais de jugement.
Les femmes font en général plus précoces que_ les
hommes, mais leur aptitude à la génération fe termine plutôt.
Exemples de vieilleffes extraordinaires. L accroiffement des
facultés inrelleâuelles étant à-peu-près le mente que celui
du corps, les loix ne foumettent lhomme aux devoirs réfléchis
, ÿ t e lorfqu’il eften état de faire ufage de fa rarfon,
& de le rendre compte de fa conduite, lbid. 201. 4.
A g e delà lune, {Jßron.) Voye^ ÉPACTE, N om br e DOR.
A g e (Jardiné) comment on compte celui d un arbre.1. 171.4.
A g e , ( Manege) marques qui font connoitre lage dun
cheval. Changemens qui s’obfervent chaque année aux dents
du cheval jufqu’à treize ans. I. 171. <*. Autres obferva-,
fions qui en indiquent l’âge, lbid. b.
Ages, leur influence fur le caraftere. Suppl. 1U- 947* b-
952. b. Régime convenable à chaque âee. XIV. 12- <*•
AGELADÈS d’argos,fculpteur.XIV. 8 i6. a.
AGÉMOGLANS, (Hiß. mod. ) jeunes enfans que le grand
feieneur acheté des tartares, ou qu’il prend en guerre, signification
du mot Agémoglan. I. 171. b. La plupart font entans
de chrétiens, enlevés par forme de tribut. Leur é ucation.
C’eftde leur école qu’on tire les janiflaires. Offices refervés à
ceux qu’on ne trouve pas propres à porter lesarmes. 1 .172.4.
AGEN, ( Géogr. ) ville de France en Guyenne , capitale
de l’Agenois. Sa fituation. Son ancienneté. Son évêché. Son
collège, & c . iW U .M î . é . AGENOIS,
A G G A G N 33
AGENOIS, (Ge'ogr.') pays de France dans la Guyenne.
Sa fituation. Autres détails fur ce pays. Suppl. I. 203. a.
Agenois, fon ancienne étendue. Suppl. IV. 53. 4.
AGENS de changey Confuls, Courtiers, (Comm. ) divers
changemens arrivés dans ces offices en France & à Paris. I.
172. a. Il y a préfentement foixante agens de change a
Paris. Quels font leurs droits. Autres obfervations fur les
agens de change. lbid. b. Voye| COURTIER.
Agens généraux du Clergé, ceux qui font, chargés des affaires
du clergé de l’égliiè gallicane. Leur création en *???• ”
glemens qui les concerueiit. I. 172. A '
A gen t , en phyfique & en méchanique. I. 172- b. ^
Agent, problème de méchanique : le pouvoir ou linten-
fité d’un agent étant donné’, déterminer combien il faut da-
gens femblables, pour produire un effet demandé dans un
rems donné.... Lespui(Tances de différens agens étant données,
déterminer le tems dans lequel ils prodmfent un efiet
donné, étant jointes enfemble. V . 844. a.
A g e n t & p a t i e n t , ( Jurifpr. ) félon la counune d Angleterre.
I. 173- a• „ . T
. Agent d’un prince ou dun particuüer. 1. 173. a.
Aient, en terme de négociation. 1. 173. n.
AGERE , ( Grnmm.) différences de ftgmficanon entre les
verbes nger’e, fncere & gerere. XV. 758. n.
AGERU (Bot an.) eipece d héliotrope du Malabar. 5a
defeription. * Suppl. I. 203. n. Ses qualités &ufages. lbid. b.
AGESANDRE de Rhodes, fculpteur. XIV. 816.4.
AGES1L A S , (Hifi. deLacédém.) roi de Sparte. Principaux
¿vénemens de fa vie & de-fon regne. Caraélere de ce prince.
Son éloge. Suppl. I. 203. b.
Agéjîlas, fobriété de ce roi. V II. 754. a , b. Parole d Agé-
filas à un homme qui rclevoit hyperboliquement de petites
chofes. VIII. 404. 4. . . . „
A gésilas , éphore de Sparte , l un des principaux ¿nltru-
mens dont le troifieme Agis fe fervit pour faire revivre la
difeipline de Licurgue. U devint enfuite le tyran du peuple
dont il fe difoit le protefteur. Sa mort. Suppl. I. 205. a.
^ a S é S IP O L I S , (Htfi. de Lacédém.) filsdePaufanias. Hiftoire
de fon regne. Suppl. I. 205. 4.
AGEY , ( Géogr.) village de Bourgogne. Cabinets d hiftoire
naturelle, d’inftrumens de phyfique & de mufique que la
comteffe de Rochechouart a formés dans ce Weu.Suppl.l. 20 5. b.
. AGGÉE , ( Hifi. fainte) le dixième des douze petits prophètes,
8cc.Suppl. I. 205. b. _____ o ,
AGGER , (Gramm.lat.) fignificafion de ce mot. XVI. 823. b.
AGGLESTON, ( Hifi. Antiq. Cérém.fuperft.) idole de pierre,
monument ftngulier de la fuperftition des anciens Bretons.
Voyez les planch. d’antiq. dans le Suppl. Elle fe voit dans la
prefqu’ile de Purbek, en la province de Dorcefter en Angleterre.
Sa defeription. Suppl. I. 205. b.
AGGLUTINANS, (Médeç.) propriété de ces remedes,
I. 173. 4. diftingués en alimens & en remedes proprement
dits. Aggludnans qui s’appliquent à l’extérieur. Ce quon
entend par agglutination. 1 . 173. b.
A g g l u t i n a n s , ( Méd. Mat. méd.) critique de^ cet article
de l’Encyclopédie. Obfervations qui prouvent qu’on ne fau-
joit attacher aux agglutinans la propriété de fortifier. Genre
de remedes agglutinans auxquels on fuppofe la propriété de
réunir les parties folides qui ont été divilées. SuppLl. ioô. a.
AGGRANDIR, augmenter, différence entre ces mots. I.
876. 4.
AGGRAVE,voyeç R é a g g r a v e .
AGGRÉGATIF, opérations chymiques aggréganves. XI.
49ÎGGR ÉGATION , ( Chym. Philof.) obfervations fur cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. I. 206. a.
. A g GRÉGATION, ( Chymie ) différence entre aggrégation &
affinité. Suppl. I . 183. 4. _ ■ • .
A g g r é g a t io n , ( Jurifp. ) nobleffe d aggrcgation. XI.
1171. b.
AGGRÉGÉ, Phyfiq. 6* Chym.) ce tfu’on entend par mafle
ou corps aggrégé. X. 339. b. III. 410. é. 411. 4. Affeclions
fie la malle ou de raggregé diftinguées de celles des parties
intégrantes, lbid. b. Différences entre les affrétions des ag-
srégés, & celles des corpufcules. 413* a,b. Différence entre
les mixtes & les aggrèges.X. 585.b. De la force de la cohé-
Jion dans les aggrégés. 586. b. Toutes les unions des divers
liquides aqueux font de pures aggrégations Les différentes
fubftances métalliques s’alliant fans aucune proportion
, ne forment qu’une efpece d’aggrégation. 587. b. 588.
■a. La phyfique fe borne prefque aux affrétions des maffes.
III. 414.4. • 1 , • «' ' i
AGGRÉGÉ en droit. A qui fe donne la place d aggrégé.
I. 174. 4. Voyez:D o c te u r en droit.
AGGRESSEUR, (Droit nat.) comment il eft pennis de
fe défendre contre un aggreffeur. IV. 735. | | Cm ou
l ’aggreffeur même acquiert le drpit de fe défendre à fon
A G IA T IS , (Hifi. de Lacédém. ) femme d’Agis III, roi de
Lacédémone, oc enfuite de Cléomene. Scntimens vertueux
qu’elle infpira à ce dernier. Suppl. 1. 2.06. b.
A G IL A , (Htfi. d’E/pagne) roi des Vifigoths. Le poignard
éleva cet homme cruel lur le trône, 8c le poignard l’en
fit tomber. Ilfiit indigne de régner, même fur des barbares
, il périt malheureufement, 8c mérita fon fort. Ces affer-
tions aemontrées par le tableau de fa vie. Suppl. I. 206. b.
A G IO , (Comm.) ce que l’argent de banque vaut de
plus que l’argent courant. Variations de l’agio de banque.
Agio, profit qui. revient d’une avance faite par quelqu’un. I.
174. 4. Agio, change d’une fomme négociée avec perte ou
profit, lbid. b..
AGIOSIMANDRE, ( Hifi. eccléf. ) étymologie de ce mot
qui fert à défigner l'inftrument dont les chrétiens grecs fe
fervent au lieu de cloche. Suppl. I. 207. a.
A G IR , (Morale ) difficulté d’éclaircir ce terme mètaphy-
fique. I. 174. b. Divers fens qu’on lui attache. Définition que
l’auteur en donne : agir eft -en général la difpofition d’un
être en tant que par fon entremife il arrive aEluellement quelque
changement. Cette définition appliquée à l’aélion de toute
caufe inftrumentale, I. 175- a. à celle .des efprits, à celle de
Dieu. Explication de quelques termes relatifs au fujet ici
traité. Produire un effet, caufe , aftion, paffton % a(le. lbid. bm
caufalité , puiffance, faculté. Ibid. 176. a.
Agir. Obfervation fur l’article A g i r de l’Encyclopédie,
n i. xv.
A G IS I , (Htfi.de Lacédém. ) hiftoire de ce prince. Suppl.
I. 207. b.
A g is H , principaux événemens de fa vie 8c de fon regne.'
Suppl. I. 207. b.
Agis I I n’obtient pas la permiflïon de manger en particulier,
après être revenu vainqueur. X ü . 501. ¿.Silence par
lequel il répond à la harangue d’un ambaftàdeur d’Abdere.
XV. 191. b.
■ A g i s II I , tableau du regne de ce roi de Lacédémone.
Suppl. 1. 208.4. Ses efforts pour ramener, chez les Spartiates ,
la iimplicitè des premières moeurs, lbid. b. Voÿc^ A g é s i la s „
éphore. Sa mort & celle de fa mere & de fon aïeule, lbid.
209. 4.
Agis III. Prifon dans laquelle il finit fes jours. Xü. 5O3. a:
À Gis IV , n’eft célébré que par fa jaloufie contre Alexan-
dre-lt'-grand dont il crut pouvoir arrêter les profpérités. Suppl..
L 209. 4. mg: ,
AGITATEURS, ( Hifi. mod.) agens ou folliciteurs, que
l’armée angloife, durant les guerres civiles fous Charles I ,
créa pour veiller à fes intérêts. Cromwel fe ligua avec etfcc,
& vint enfuite à bout de les faire caffer. L 176. a. gj
AG ITATION de la mer y (Marine) on en reconnoît deux
caufcs : la combinaifon des forces attraélives du foleil 8c de
la lune , 8c l’effort ou la preflion du vent. L’agitation des
values,de plus longue durée que les Vents dont elle eft
l’effet. Vagues en fens contraire qu’on obferve quelquefois.
Mer houleufe & patouilieufe. Elle fàrihue beaucoup les vaif-
feaux. En quels endroits cet état de la mer fe fait fur-tout
remarquer. Importance de diftinguer les différentes fortes
d’agitations de la mer. Suppl. I. 209. b. Divers degrés de
l’agitation de la mer , que l’auteur diftingue par les noms
de mer agitée ou mâle, mer mauvaife, mer große, mer très*
große & mer horrible. Ibid. 210» a.
AGLAOPHÖN, deux tableaux de ce peintre grec. X ü .
255-tf-
AGLAUS, (Hifi. anc.) berger d’Arcadie, que l’oracle
d’Apollon déclara plus heureux que le roi de Lydie. Suppl.
1 I. 210.4. ■ m
AGLIBOLUS, (Myth!) les Palmyrèniensadoroient le foleil
fous ce nom. Comment ils le repréferitoient. I. 176. a.
A g l ib o l u s , divinité des Palmyréniens. IX. 926. a , b.
8cc.Â
G N A CA T , (Botan.) arbre d’Amérique. Sa defeription.
propriété de fon fruit. 1 . 176. b.
AGNANIE, (Géogr.) voyer A n agnie.
AGNANO, (Géogr.) lac d’Italie dans la terre de Labour.
Caufe d’un bouillonnement fingulier quon remarque fur
fes bords. On prétend qu’il eft dangereux de s y baigner. Le
.plus grand danger de ce lac eft celui du mauvais air en été.
^ ¿N A N T H U S , (Botan.) defeription de cette plante. L
176. b.
AGNATS 8c Comats : ( Jurifp. ) loi des douze tables fur le
droit de fucceflion desagnats8c des cognats. V .75. a. Tous les
cognats font agnats; mais tous les agnats ne font pas co-
enats. III. 604. a. Succeiïïon des agnats. Ibid. XV. 208. a. Ils
formoient le premier ordre d’héritiers ab intefiat. IIL 901. b.
Tutele des agnats. XVI. 764. a. Agnation naturelle 8c adoptive.
III. 001. b. . . .
AGNATION, (Jurifp. ) lien de confangutmtè entre les
defeendans par maie d’un même pere. L’agnation différé de
la cognation. Privilège d’agnation accordé ou^refiifé aux