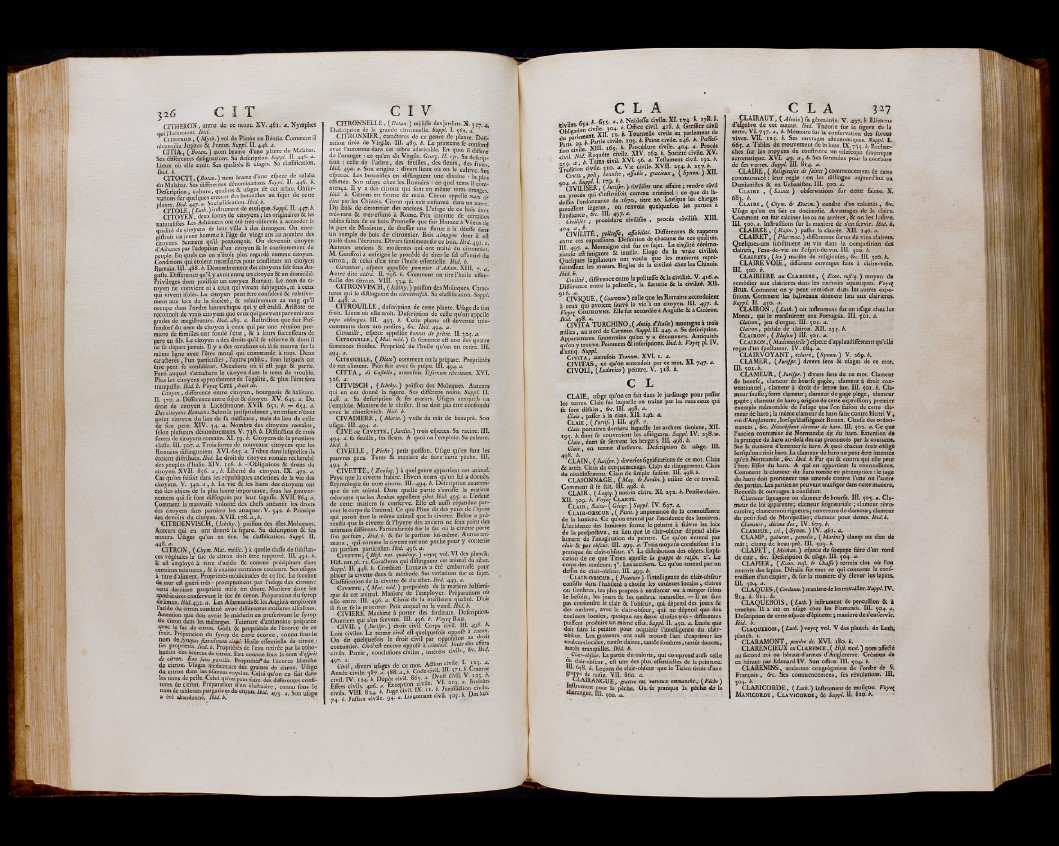
x i G C I T
CITHERQN, antre de ce raopç. XV. 461. a. Nymphes
qui l’habitoient. Ibid. _
Çi^heron , (Myth.) roi de Platée en Béotie. Comment u
réconcilia Jupiter 8f. Junon. Suppl. II. 446. a.
CITIA, ( Botaru ) pom brame d’une plante du Malabar.
S,es différentes défignations. Sa defcription. SuppL IL 446. a.
Lieux où elle croît. Ses qualités 8c ufages. Sa claflification.
^C1TOCTI, (Sotan.) nom brame d’une efpece de calaba
du Malabar. Ses différentes dénominations. Suppl. II. 446. b.
Deferiprion, culture, qualités & -figes de cet arbre. Obfervjrions
fur quelques erreurs des botamftes au fi,jet de cette
plante, Ibid. 447. a. Sa claflification. Ibid.b.
CITQLE, {Luth.) infiniment de mufique.Sayjw. U. 447-b-
CITOYEN, deux fortes de citoyens ; les originaires & les
naturalises- Les Athéniens ont été très-réfervés à accorder la
qualité de citoyens de leur ville à des étrangers. On enre-
giftroj t un jeune homme à l’âge de Yingt ans au nombre des
citoyens. Serment qu’il pronônçoit. On devenait citoyen
d’Athenes par l'adoption a un citoyen & le canfentement du
peuple. Eu quels cas on n’étoit plus regardé comme citoyen.
Conditions quiétoient néceffaires pour conftituer un citoyen
Romain. UI. 488. b. Dénombrement des citoyens fait fous Au-
guffç. Différence qu’il y aYOit entre un citoyen & un domicilié.
Privilèges dont jouifloit un citoyen Romain. Le nom de citoyen
ne convient ni à ceux qui vivent fubjueués,ni à ceux
qui vivent ifolés. Le citoyen peut être confidéré 8c relativement
aux lpix de la fociété, & relativement au rang qu’il
occupe dans l’ordrç hiérarchique qui y eft établi. Ariftote ne
rçconnoît de vrais citoyens que ceux qui peuvent parvenir aux
grades de magiftrature. Ibid. 489. a. Reftriélion que fait Puf-
fendotf du nom de citoyen à ceux qui par une réunion première
de familles ont fondé l’état, & a leurs fucceffeurs de
pçre en fils. Le citoyen a des droits qu’il fe réferve & dont il
ne fe départ jamais. Il y a des occafions où il fe trouve fur la
même ligne avec l’être moral qui commande à tous. Deux
caraûeres, l’un particulier , l’autre public, fous lefquels cet
être peut fe confidèrer. Occafions où il eft juge & partie.
Parti auquel s’attachera le citoyen dans le tems de trouble.
Plus les citoyens approcheront de l’égalité, & plus l’état fera
tranquille. Ibid. b. Voyez C ité , droit de.
Citoyen, différence entre citoyen, bourgeois & habitant.
IL 370. a. Différence entre fujet 8c citoyen. XV. 643. a. Du
diroit de citoyen à Lacédémone. XVlI. 651. b. — 654. a.
Des citoyens Romains. Selon la jurifprudence, un enfant n’étoit
point citoyen du lieu de fa naiffance, mais du lieu de celle
de fon pere. XIV. 34. a. Nombre des citoyens romains,
félon plufieurs dénombremens. V. 738. b. Diinn&ion de trois
fortes de citoyens romains. XI. 59. b. Citoyens de la première
daffe. III. 507. a. Trois fortes de nouveaux citoyens que les
Romains diftinguoient. XVI. 625. a. Tribus dans lefquelles ils
étoient diftribués. Ibid. Le droit de citoyen romain recherché
des peuples d’Italie. XIV. 156. b .- Obligations 8c droits du
citoyen. XVII. 8c6. a , b. Liberté du citoyen. IX. 472. a.
Cas qu’on faifoit dans les républiques anciennes de la vie des
citoyens. V. 342. a , b.L a vie & les biens des citoyens ont
été des objets de la plus haute importance, fous les eouver-
nemens qui fe font diftingués par leur fageffe. XVIL 864. a.
Comment laxnauvaife volonté des chefs anéantit les droits
des citoyens fans paraître les attaquer. V. 342. b. Principe
dç& devoirs du citoyen. XVIL 178. a,b.
CITROEN VISCH, ( Ichtky.) poiffon des iftes Moluques.
'Auteurs qui en ont donné la figure. Sa defcription & fes.
moeurs. Ufages qu’on en tire, Sa claflification. Suppl. II.
448. a.
CITRON, \ Chym. Mat. médic. ) à quelle claffe de fubftan-
ces végétales le fuc de citron doit être rapporté. III. 491. b.
Il eft employé à titre d’acide & comme précipitant dans
certaines teintures, 8c à exalter certaines couleurs. Ses ufages
à titre d’aliment. Propriétés médicinales de ce fuc. Le feorbut
de mer eft guéri très - promptement par l’ufage des citrons:
cette demicre propriété mife en doute. Maniéré dont les
apothicaires confervent le fuc de citron. Préparation du fyrap:
de limon. Ibid. 492. a. Les Allemands & les Anglois emploient
l’acide du citron combiné avec différentes matières alkalines.
Attention que doit avoir le médecin en preferivant le fyrop
de citron dans les mélanges. Teinture d’antimoine préparée
avec 1® fqç de citron. Goût & propriétés de l’écorce de ce-
fruit. Préparation du fyrop de. cette écorce, connu fous le
nom à&Jyrupus fluvedinum citjû. Huile efieptielle de citron :
les . propriétés. Ibid. b. Propriétés de l’eau retirée par la coho-
bation des écorces de citron. Eau connue fous le nom d'efprit
de cjfron. Eau fans pareille. Propriété^ de l’écorce blanche
de citron. Ufages médicinaux des graines de citron. Ufage,
du citron dans lesnfcnnes royales. Celui qu’on en fait dans
les tems de pefte. Celui qu’on peut faire- des différentes confitures
de citron- Préparation d’un éleftuaire, connu fous le
TOm de tablciLispiirgaiivçs cUi citfp“ . m d. m , So„ u&ge
a été abandonne. Ibid. b, -
C I V
CITRONNELLE, ( Boian. ) méliffe des jardins. X. 317,
Defcription de la grande citronnelle. Suppl. I. 361. a.
CITRONNIER, cara&ercs de ce genre de plante. Définition
tirée de Virgile. III. 489. b. Le printems fe confond
avec l’automne dans cet -arbre admirable. En quoi il différé
de l’oranger : ce qu’en dit Virgile. Gcorg. II. 131. Sa defcription
: celle de l’arbre, des feuilles, des fleurs, des fruits.
Ibid. 490. a. Son origine : divers lieux où on le cultive. Ses
efpeces. Les botaniftes en diftinguent une dixaine : la plus
eftimée. Son ufage chez les Romains : en quel tems il commença.
Il y a des citrons qui font en même rems oranges.
Ibid. b. Citrons en forme de main. Citron appellé main de
dieu par les Chinois. Citron qui naît enfermé dans un autre.
Dji bois de citronnier des anciens. L’ufage de ce bois étoit
très-rare & três-eftimé à Rome. Prix énorme de certaines
tables frites de ce bois. Promeffe que frit Horace à Vénus de
la part de Maximus, de dreffer une ftatue à la déeffe dans
un temple de bois de citronnier. Bois almugim dont il eft
parlé dans l’écriture. Divers fentimens fur ce bois. Ibid. 491.
Auteurs anciens 8c modernes qui ont traité du citronnier!
M. Geoffroi a enfeigné le procédé de tirer le fel cffenticl du
citron, 8c celui d’en tirer l’huile effentielle. Ibid. b.
Citronnier, efpece appellée pommier d'Adam. XIII. 7. a.
Autre dite cédra. II. 796. b. Comment on tire l’huile effentielle
des citrons. VIIL 334. b.
CITRON VISCH, ( lchthy. ) poiffon des Moluques. Caractères
oui le diftinguent du citroinvifch. Sa claflification. SuppL
II. 448. ' a.
CITROUILLE, defcription de cette plante. Ufage de fon
fruit. Lieux où elle croit. Defcription de celle qu’on appelle
pepo oblongus. III. 493. b. Cette plante eft devenue très-
commune dans nos jardins, &c. Ibid. 494. a.
Citrouille, efpece appellée bonnet de prêtre. II. 323.4*.
C itrouille , ( Mat. mid. ) fr femence eft une des quatre
fcmences froides. Propriété de l’huile qu'on en retire. III.
494. a.
C itrou ille, ( Dieu) comment on la prépare. Propriétés
de cet aliment. Pain frit avec fapulpe. III. 494. a.
CITTA , di Cafiello, autrefois Tifernum tiberinum. XVI.
326. a.
CITVISCH , ( lchthy. ) poiffon des Moluques. Auteurs
qui en ont donné la figure. Ses différent noms. Suppl: II.
448. a. Sa defcription 8c les moeurs. Ufages auxquels on
l’emploie. Maniéré de le claffer. Il ne doit pas être confondu
avec le chietfevich. Ibid. b.
CIVAD1ERE , ( Marin. ) voile du mât de beaupré. Son
ufree. III. 494. a.
O V E ou C ive tt e, (Jardin.) trois efpeces. Sa racine. ITT.
494. a. fa feuille, fes fleurs. A quoi on l’emploie. Sa culture.
Ibid. b.
CIVELLE, (Pèche) petit poiffon. Ufage qu’en font les
pauvres gens. i. Tems 8c : ï
maniere de frire cette pèche. III.
CIVETTE, ( Zoolog. ) à quel genre appartient cet animal:
Pays que la civette habite. Divers noms qu’on lui a donnés.
Étymologie du nom civette; III. 1494. b. Defcription anatomique
494. b.
de cet animal. Dans quelle partie s’amaffe la matière
odorante que les Arabes appellent \ibet. Ibid. 49«. a. L’odeur
de cette matière fe conferve. Elle eft auffi répandue partout
le corps de l'animal; Ce quç Pline dit des yeux de l'hyene
qui paraît être le même animal que la civette. Belon a prétendu
que II civette 8c l’hyene des anciens ne font point des
animaux différens. Particularités fur le fac où la civette porte
fon parfum , Ibid. b. 8c fur le parfum lui-même. Autres animaux
, qui comme la civette ont une poche pour y contenir
un parfum particulier. Ibid. 496. a. '
C iv e t t e ; ( Hifl. nat. quadrup. ) voyez vol. V I des planch.
Hift.nat.pl. 12.Caraéteres qui diftinguent cet animal cfuzifcer.
Suppl. II. 448. b. Combien Linnæus a été embarraffé pour
placer la civette dans fa méthode. Ses variations fur ce fujet.
Claflification de la civette 8c du zibet. Ibid. 449. a.
C ivette , ( Mat. mid,. ) propriétés de la matière balfami-
que de cet animal. Maniéré de l'employer. Préparations où
elle entre. III. 496. a. Choix de la meilleure qualité. D’ou
il fout fe laprocurer. Prix auquel on la vend. Ibid. b.
CIVIERE» Machine à porter des fordcaux. Defcription.
Ouvriers qui s’en fervent. III. 496. b. Voyeç Bar .
CIVIL , (Jurifpr.) droit civil. Corps civil. III. 49"- b’
Loix civiles. Le terme civil eft quelquefois oppofé à canon.
On dit quelquefois le droit civil par oppoiition ?u droit
coutumier. Ovi/ eft encore oppofé à criminel: Joute des e
'civils. Partie, condufions civiles , intérêts civils»
Année c ivde. 387.4*.388.4*,¿. ^oaeci^i. j/
civil. IV. ,24. .. Dépôt civil.. 865.. a D,o,t
m Si"IS1/- l üil si., i™” • «*■ Jurlfdiaion civile.
C L A
V ^liment. XII. tt. 6. Tdurnelle civUe au parlement de
î C iv ile* • X•>IaIrIt.i e Ciy8Sb*. 1P0r5o‘ c*é' dPu“ren ec i“vVil,*e1“. 4 ®0‘t46.’ a*.' Procès
vil Ibid Requête civile. XIV. 162. b. Société civile. XV.
‘ b Tems civil. XVL 96. a. Teftament civil 192. b.
Tradition civitc. sto. 4. Vie civUe. XVU. »«+. 1 *17-1
C i v i l , poli. honnête , ttfnltle , gracieux , ( Syrien. ) XII.
r & t ô f i f t (Junfpt. ) civilifer une affaire ; rendre civil
vn procès qui s’inftruifoit comme criminel : ce que dit là-
deflus l’ordonnance de-1670, titre 20. Lorfque les charges
paroiffent légères, on renvoie quelquefois les parues à
l ’audience, &c. IIL 497* a\ v m
Civilifer ; procédure civxlifée , procès civuifê. Xill.
4° C I v ia T É , poUtlfe, ajfabilitê. Différences & rapports
entre ces expreffioni. Définition de chacune de ces quittés.
III. 407. 4. Montaigne cité fur ce fu)et. La civjlité cérémo-
tiieule eit fatigante & inurile. Eloge de la vrate ctvthté.
Ouelques ligïfia.eurs ont voulu que les maniérés repré.
fentaffent les moeurs. Règles de la ctvdtté chez les Chinois.
■ H i , différence entre la pofiteffe & la civilité. V. 416. 4.
Différence entre la politeffe, la flatterte & la civilité. XII.
5 ’ CIVIQUE, ( Couronne) celle que les Romains accordoient
à ceux qui avoient fauvé la vie à un citoyen. III. 497. h.
Voyez C ouronne. Elle fut accordée à Augufte 8c à Cicéron.
Ibid. 498. a. ,
CIVlTA TURCHINO, ( Antiq. ef Italie) montagne à trois
milles, au nord de Carneto. SuppL H. 449*a- S» defcription.
Appartemens fouterreins qu’on y a découverts. Antiauités
qu’on y trouves Peintures 8c infcnptions. Ibid. b. Voyez pl. IV.
o’antiq. Suppl.
C i v it A , autrefois Teanum. XVL 1. a.
CIVITAS, ce qu’on entendoit par ce mot. XL 747. a.
CIVOLI, (Ludovicô) pe'mtre. V. 318. b.
C L
CLAIE, ufage qu’on en frit dans le jardinage pour paffer
les terres. Claie fur laquelle on traîne par les rues «eux qui
ie font défaits, Grc. III. 4198. a.
Claie , paffer à la claie. XII. >4& a-
C laie , {Fortif. ) III. 498. a.
Claie portative derrière laquelle les archers tiraient, XII.
193. b. dont fe couvraient les afliègeans. Suppl. IV. 238.«.
Claie, dont fe fervent les bergers. UL 498- b-
Claie, en terme d’orfevre. Defcription 8c ufage. III.
49 CL AIN, ( Jurifpr. ) diverfesfigniiications de ce mot. Clain
& arrêt. Clain de cerquemenage, Clain de dégagement. Clain
de rétabhffement. Clain de firople foifine. III. 49^* h.
CLAIONNAGE , (Maç. Jardin.) utilité de ce travail,
Comment il fe fait. IIL 498. h, _ t
CLAIR, ( Lagiq.\notion clajre. XL 232. b. Penféeclaire.
XII. 399. b. Voyez CLARTÉ.
C l a ir , Saint- ( Géogr.) Suppl. IV. 697. a.
C lair-obscur , ( Peint. ) impoitance de b cmmoiftance
de b lumière. Ce qu’on entend par L’iacidence des lumières.
L’incidence des lumières forme: la peintre à fuivre les loix
de b perfpeétive, au lieu que le clair-ohfcur dépend abfo-
lument de l’imagination du peintre. Ce qu’on entend par
clair 8c par obfcur. III. 499. a> Trois moyens conduifent à la
pratique du clair-obfcur. is. La diftribution des objets. Expli*
cation de ce que Titien appelle U grappe de raifin. a°. Le
corps des couleurs. 30. Les accidens. Ce qu’on entend par un
deffm de clair-obfcur. III. 499. A
C lair-o bscu r, ( Peinture) ^intelligence du clair-obfcur
confifte dans l’hahUeté à choinc les couleurs locales , claires
ou fombres, les plus propres à renforcer ou à mitiger félon
le befoin, les jours oc les; ombres naturelles. — Il ne. frut
pas confondre le clair 8c l’obfcur, qui dépend des joues 8c
des ombres, avec le clair-obfcur, qui no dépend que des
couleurs locales , quoique, ces deux cho&s très - différentes
puiffent produire un même effet. Suppl. II. 43a a. Etude quo
doit faire le peintre pour acquérir l’intelligence du. clair-
obfcur. Les graveurs ont aulti trouvé l’art d’exprimer les
couleurs locales, tantôt claires »tantôt fombres, tan tôt douces,
tantôt tranquilles. Ibid. b,
Clair-obfcur. La partie du coloris, qui comprend auffi celle
ou clair-obfcur, eft une des plus, eilentielles de la peinture;
“ *» 638. b. Leçons de clair-ohfcur que le Titien tiroic d’une
grappe de raifin. VU. 860. a.
ULAIRANGUE, grattes ou varveux emmanchéy ( Riche )
«Urumcnt pour la pêche. Qùi fo pratique 1a pAme de b
«majgue. ¿1. soo_^_
C L A 327
„ ÇLAIRAUT, ( Alexis) fa géométrie. V. 497. b. Elémens
daTgebre de cet auteur. Ibid. Théorie fur b figure de b
terre. VL 737« <*, b. Mémoire fur la confervation des forces
Vives. VII. 113. b. Ses ouvrages aftronomiqucs. Suppl. L
66f. a. Tables du mouvement de la lune. IX. 733. b. Recher*
ches fur les moyens de conftruire un télefcopc tûoptrique
acromatique. XVI. 49. a , b. Ses formules pour b courbure
de fes verres. Suppl. lü . 8x4. a.
CLAIRE, ( Religieufes de fainte ) commencemens de cette
communauté : leur réglé : on les diftingue aujourd’hui en
Damianiftes 8c en Urbaniftes. III. 300. a.
C laire , ( Sainte ) obfervations fur cette fainte. X.
683* A
C laire , ( Chym. & Docim. ) cendre d’os calcinés, &c.
Ufage qu’on en fait en docimaiie. Avantages de la claire.
Comment on frit calciner les os ou arrêtes, 8c on les leffive.
HL 300.4*. Inftru&ions fur la maniéré de s’en fervir. Ibid. b.
CLAIRÉE , ( Rajin. ) paffer la clairée. XII. 140. a.
CLAIRET, ( Pharmac. ) différentes fortes de vins clairets.'
Quelques-uns iubftituent au vin dans la composition des
clairets, l’eau-de-vie ou refprit-de-vin. III. 300. A
C la ire t s , (les ) maifon de religieufes, &c. III. 300. A
CLAIRE-VOIE, différens ouvrages faits à claire-voie»
UI. 300. A
CLAIRIERE ou C la r ie rb , ( Econ. ntfliq. ) moyen de
remédier aux clairières dans les endroits aquatiques. Voyez
Bois. Comment on y peut remédier dans les autres expo*
fitions. Comment les bidiveaux donnent lieu aux clairières.
SuppL II. 430. 4*.
CLAIRON, (Luth. ) cet infiniment fut en ufage chez les-
Mores, qui le tranfmirent aux Portugais. III. 301. a.
Clairon y jeu d’orgue. III. 501. a.
Clairon , pédale de clairon. XII. 23 3. A
C lairon , ( Blafon ) IIL 301. a.
C lairon , (Mademoijelle) efpece d’appbudiffement qu’elle
reçut d’un fpeoateur. IV. 684. a.
CLAIRVOYANT, éclairé, (Synon. ) V. 269. A
CLAMER, (Jurifpr.) divers fens & ufages de ce mot»
IQ. 301. A
CLAMEUR, (Jurifpr.) divers fens de ce mot. Ciameut
de bourfe, clameur de bourfe gagée, clameur à droit conventionnel
, clameur à droit de lettre lue. IIL 301. A Clameur
fauffe ; forte clameur ; clameur de gage plege, clameur
gagée ; clameur de haro ; origine de cette eXpreifion ; premier
exemple mémorable de l’ufage que l’on foifoit de cette clameur
de haro ; b même clameur ae haro faite contre Henri V »
rai d’Angleterre ,lorfqu’ilaffiêgeoit Rouen. Ciaufe des ordonnances
, &c. Nonobfiant clameur de haro. IIL 302. a. Ce que
l’ancien coutumier de Normandie dit du haro. Extenfion de
1a pratique du haro au-delà des cas prononcés par 1a coutume»
Sur b maniéré d’intentej- le haro. A quoi chacun étoit obligé
lorfqu’on criojt haro. La clameur de haro ne peut être intentée
qu’en Normandie, Grc. Ibid. A Par qui 8c contre qui elle peut
l’être. Effet du haro. A qui en appartient 1a connoiflànce.
Comment b clameur du haro tombe en péremption : le juge
du haro doit prononcer une amende contre l’une ou l’autre
des parties. Les parties ne peuvent tranfiger dans cette matière»
Recueils 8c ouvrages, à confultcr.
Clameur lignagere ou clameur de bourfe. III. 303.0. Clameur
de loi apparente;- cbmçur ieigneuriale ; clameur révo»
catoire; clameurs ou rigueurs; ouverture de clameur; clameur
du petit feel de Montpellier; clameur pour dettes. Ibid.b.
Clameurs , décime des , IV. 679. A
C lameur, cri, ( Synon. ) IV. 461. a.
CLAMP, gaburon, gemeue , ( Marine ) clamp ou cbn de
mât ; clamp de beau-pré- III. 303. A
CLAPET, (Mèchan. ) efpece de foupape frite d’un rond
de cuir, Grc. Defcription 8c ufage. III. 304. a.
CLAPIER, {Econ. rufl. & Chaffe) terrein clos où l’on
nourrit des bpins. Détails fur tout ce qui concerne la conf*
tru&on d’un cbpier, 8c fur b maniéré d’y élever les bpins;
III. 3O4. 4*.
CLAQUES, ( Cordonn. ) maniéré de les travailler. Suppl. IV*
814- A 8.»f. A
CLAQUEBOIS, ( Luth. ) infiniment de percuiüon & à
touches; IL a été en ufage chez les Flamands. III. 304. a.
Defcription de cette efpece d’épinette ; manière de s’en fervir.
Ibid. A ■
C laqueboxs, (Luth. ) voyez vol. V des planch. de Luth»
planch. x.
CLARAMONT, poudre de. XVI. 180. A
CLARENCIEUX ou C larence , ( Hifl. mod. ) nom affefté
au fécond rai ou héraut-tfarmes d’Angleterre. Création' de
ce héraut; par Edouard IV. Son office. UI. 304. A -
CLARENINS, ancienne congrégation de l’ordre de S»
François , G/c. Ses commencemens, fes révolutions. III.
304. A
CLARICORDE, (Luth.) infiniment de mufique^ Voyt{
Man lcord è , C la v ic o rd e , 8c Suppl. H. 829. A