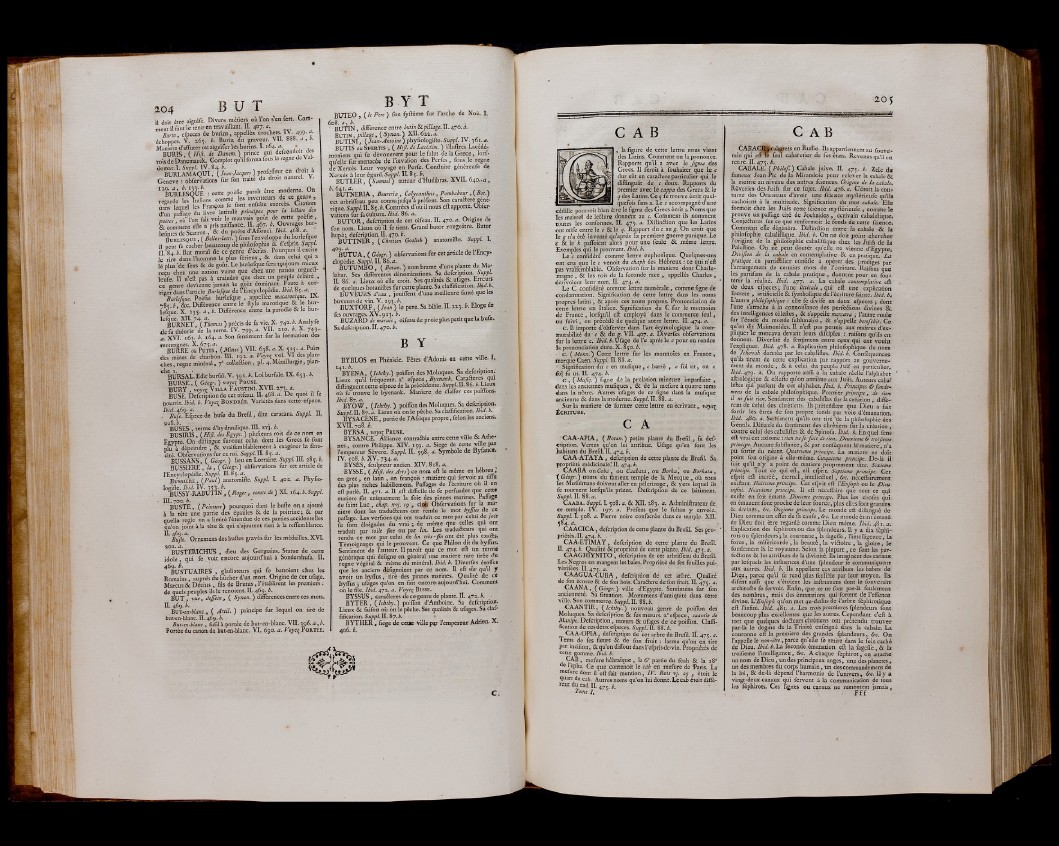
a o 4 B U T B Y T
a doit être aiguifé- Divers métiers où l’on s en fert. Coffl-
ment il faut le tenir en travaillant. H. 407. a.
Burin, efpeces de burins, appelles crochets. IV. 499- “■
échoppes. V. i- Burin du graveur. Vil. 888. « ,
Maniéré d'affuter ou aiguifer tes.hunns. 1. 164. u. •
BUR1S , ( Hill. i t Dmtm. ) prince qui defcendoit des
tois de Danemarck. G om p lo t q u ’i l fo rm a fo u s le regne de Val-
^BUIUAMAQUÎ g Jcan-Jacquts ) H m rT ’v
Gcneve : Obfervations fur fon traité du droit naturel. Y.
1 2^URLES(3 u£ I cette poéfie paroît être moderne. On
r e fa r fe l« Italiens comme les inventeurs de ce genre ,
d i s lequel les François fe font enfiute exercés. Citaüon
d’un paffaee du livre indtule yrmcipts jo u r lu l,Sure des
poitJ, ou l’on fait voir le mauvais gout de cette poêiie,
l e comment elle a pris naiffance. II. 467- b- ÿ W f c f f '% I
lefques de Scarron, & du poste d Affouci. Ihd. 468. a.
B u r l e s q u e , ( BclUs-latr. ) fous l’enveloppe du burlefque 1
il peut Te cacher beaucoup de philofophie 8c d’efprit. Çuppl.
II. 84. b. But moral de ce genre d’ècrits. Pourquoi il excite
le rire dans l’homme le plus férieux, & dans celui quia
lé plus ‘de fens & de goût. Le burlefque fera toujours mieux
reçu chez une nation vaine que chez une nation orgued-
leufe. Il n’eft pas à craindre que chez un peuple éclairé ,
ce genre devienne jamais le août dominant. Faute à corriger
dans l’article Burlefque de 1 Encyclopédie. Ibid. 83. <z.
Burlefque. Poéfie burlefque , appellee macaromque. IX.
r t ' .b , 8cc. Différence entre le ftyle marorique & le burlefque.
X. 135. a , b. Différence entre la parodie & le burle
BURNET^( Thomas ) précis de fa vie. X. 742. b. Analyfe
de fa théorie de la terre. IV. 799- a- § . 743**
xVT. 163. b. 164. a. Son fentiment fur la formation des
^ B u ÎÎrE ou P u i t s , (Mines)VU. 638. a.X. 525» a. Puits
des mines de charbon. III. 102. a. Voyc{ vol. VI des planches,
regne minéral, 7e collection , pi» 4. Métallurgie, plan-
ChBURSAL.Edif burfal. V . » 1 . *. Loiburfale.IX. 653. b.
BURSE, ( Gèogr. ) v qw P r ÜSE.
BURY , voyrç V i l l a F a u s t i n i . XVII. 173. a.
BUSE. Defcription de cet oifeau. IL 468. a. De quoi il fe
pourrit. Ibid. b. Voyc{ Bon d rée. Variétés dans cette'efpece.
Ibid.46Q.ai o » TT
. Bujè. Efpece de bufe du Brefil, dite caracara. Suppl. 11.
228.6. . .. . .
BUSES , terme d’hydraulique. 111. xvj. b.
BUSIRIS, (Hift. desÉgypt. ) plufieurs rois de ce noni en
Egypte. On diftingue fur*tout celui dont les Grecs fe font
plu à dépeindre , & vraifemblablement à exagérer la férocité.
Obfervations fur ce roi. Suppl. H. 85. a.
BUSSÀNS, ( Gèogr. ) lieu en Lorraine. Suppl. III. 285. b.
BUSSIERE, la , (Gèogr.) obfervations fur cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. II. 8q.a.
B u s s i e r e , (Paul) anatomiite. Suppl. 1 . 402. a. rhyiio-
loeifle. Ibid. IV. 353* b.
BUSSY-RABUTIN , (Roger, comte de ) XL 164. b.Suppl.
• n i. 700. é. $ I • j 1 l a ■. »
BUSTE, ( Peinture) pourquoi dans le bulte on a ajouté
à la tête une partie des épaules & de la poitrine ; & par
quello réglé on a limité l’étendue de ces parties accidentelles
qu’on joint à la tète 8c qui n’ajoutent rien à la reffemblance.
II. 469. a. t .
Bulle. Ornemens des buftes gravés fur les médailles. XVL
202. a .’ . 0 ,
BUSTERICHUS , dieu des Germains. Statue de cette
idole, qui fe voit encore aujourd’hui à Sondershufa. II.
462 USTUAIRES , gladiateurs qui fe battoient chez les
Romains, auprès du bûcher d’un mort. Qrigine de cet ufage.
Marcus & Déchis , fils de Brutus, l’établirent les premiers :
de quels peuples ils le tenoient. II. 469. b.
BU T , vue, dejfein, ( Synon.) différences entre ces mots,
n . 469. b. . . .
But-en-blanc, ( Artil. ) principe fur lequel on tire de
but-en-blanc. H. 469. b. t ,
But-en-blanc , fufil à portée de but-en-blanc. VII. 306. a , b.
Portée du canon de but-en-blanc. VI. 630. a. Vtye^ P o r té e .
BÜTEO , ( le Pcre ) fon fyftême fur l’arche de Noé. I>
^BUTIN, différence entre butin &.pillage. II. 470. À
BUTIN, pillage, ( Synon. ) XII. 622.0.
BUTINl, (Jean-Antoine) phyfiologifte. Suppl. IV. 361.«;
BUTIS ou S p e r tis -, ( Hift. de Lacèdèm. ) illuftres Lacédé-
moniens qui fe dévouèrent pour le falut de la Grece, lorf*
qu’elle fut menacée de l’invafion des Perfcs, fous le regne
de Xerxès. Leur voyage en Perfe. Conduite généreufe de
Xerxès à leur égard. Suppl. II. 85. b<. „_ rTT .
BUTLER, (Samuel) auteur d’Hudibras. XVU. 640..a ,
b'. 641. a. ■.
BUTNERIA , Beureria , Calycanthus , Pombabour, (Bot.)
cet arbriffeau peu connujufqu’àpréfent.¡Son cara&eregéne-
rique. Suppl. U. 8 5. b. Contrées d’où il nous eil apporté. Obfervations
fur fa culture. Ibidi 86. a, . . ’ .
BUTOR, defcription de cet oifeau. II. 470.0. Origine de
fon nom. Lieux où il fe tient. Grand butor roügeâtre. Butor
hupé : defcription. 11.470. b. -
BUTTNER, ( Chrétien Gotlieb ) anatomïfte. Suppl. L
4° ll? T U A , ( Gèogr. ) obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 86. a.
BUTUMBO, ( Botan. ) nom brame d’une plante du Malabar.
Ses différentes dénominations. Sa defcription. Suppl.
II. 86. a. Lieux où elle croît. Ses qualités 8c ulages. Erreurs
de quelques botaniiles fur cette plante. Sa claflification. Ibid. b..
BUVEURS d’eau , jouiffent d’une meilleure fanté que les
buveurs de vin. V. 193. b.
BUXTORF, (Jean ) le pere. Sa bible. II. 223. b. Eloge de
les ouvrages. XV. 913. b. '
BUZARD de marais, oifeau de proie plus peut que la Duie*
Sa defcription. II. 470. b.
B Y
BYBLOS en Phémcie. Fêles d’Adonis en cette ville, t
I4BYÉNA. Uchthy.) poiffon des Moluques. Sa defcription:
Lieux qu’il fréquente. ac efpece, Byenank. Carafteres qui
diftinguent cette efpece de la précédente. Suppl.H. 86. é. Lieux
où fe trouve le byenaiik. Maniéré de claffer ces pomonSi
Ibid. 8 y. a. „ , . . .
B YOW , (Ichthy. ) poiffon des Moluques. Sa defcription.
Suppl. II. 87. a. Lieux où on le pêche. Sa claffification. Ibid. b.
BYSACENE, partie de l’Afrique propre, félon les anciens*
XVII. 708. b.
BYRSA, voye{ Pruse. .
BYSANCE. Alliance contraôée entre cette ville 8c Athènes,
contre Philippe. XTV. 159. a. Siege de cette ville pat
-i l’empereur Sévere. Suppl. IL 598. d. Symbole de Byfance»
TV. 508. b. XV. 734. a.
BYSÈS, fculpteur ancien. XIV. 818. a.
BYSSE, ( Hift. des Arts) ce nom eft le même en hébreu;
en grec, en latin, en françois t matière qui fervoit au tiffu
des plus riches habillemens. Paffages de l’écriture où il en
eft parlé. H. 471. a. Il .eil difficile de fe perfuader que cette
matière fut uniquement la. foie des pinnes marines. Paffagc
de faint Luc , chap. xvj. ip , cité. Obfervations fur la maniéré
dont les traducteurs ont rendu le mot byffus de ce
paffage. Les verfions qui ont traduit ce mot par celui de joie
fe font éloignées du vrai ; de même que celles qui ont
traduit par toile fine ou par lin. Les tradufteurs qui ont
rendu ce mot par celui.de lin tris -fin. ont été plus exafts.
Témoignages qui le prouvent. Ce que Philon dit du byffus.
Sentiment de l’auteur. Il paroît que ce mot eft un terme
générique qui défigne en général une matière rare tirée du
regne végétal & même du minéral. Ibid. b. Diverfes étoffes
que les anciens défignoient par ce nom. Il eft sûr qu’il y
avoit un byffus, tiré des pinnes marines. Qualité de ce
byffus ; ufages qu’on en fait encore-aujourd’hui. Comment
on le file. Ibid. 472. a. Voyeç Bisse.
BYSSUS, caraôeres de ce genre de plante. IL 472. b. % •
BYTER, (Ichthy.) poiffon d’Amboine. Sa defcription.'
Lieux & faifon où on le pêche. Ses qualités & ufages. Sa claffification.
Suppl. ü. 87. b. * ,.
BYTHER , fiege de cerne ville pqr l’empereur Adrien. X.
406. b.
si«?
20 J
C A B
, la figure de cette lettre nous vient
des Latins. Comment on la prononce.
Rapports qu’il a avec le figma des
Grecs. Il feroit à fouhaiter que le c
dur eût un caraélere particulier qui le
diilinguât du c doux. Rapports, du
premier avec lé caopa des Grecs & le
q des Latins. Ce q le trouve écrit quelquefois
fans u. Le c accompagné d’une
cédille pourroit bien être le ligma des Grecs écrit s. Noms que
les maîtreS de leélure donnant au c. Cofnment ils nomment
toutes les confonnes. II. 473. a. Diftinflion que les Latins
ont mife entre le c & le q. Rapport du c au g. On croit que
le g n’a été inventé qu’après la première guerre punique.le
c & le A paffoient alors pour une feule 8c même lettre.
Exemples qui le prouvent. Ibid. b. %
Le c confidéré comme lettre euphonique. Quelques-uns
ont cru que le c venoit du chaph des Hébreux : ce qui n’eft
pas vraïfemblable. Observation fur la maniéré -dont Charle-
magne, & les rois de la fécondé race , appelles Charles ,
écrivoient leur nom. II. 474. a.
Le C confidéré comme lettre numérale, comme ligne de
condamnation. Signification de cette lettre dans les noms
propres latins, 8c après ces noms propres. Prononciation de
cette lettre en Italien. Signification du C fur le monnoies
de France, lorfqu’il eft employé dans le commerce feul,
ou fuivi’, ou précédé de quelque autre lettre. II. 474. a.
C. Il importe d’obferver dans l’art étymologique la com-
mutabilité du c 8c du g. VII. 407. a. Diverfes obfervations
fur la lettre 'c; Ibid. b. Ufage de l’a après le c pour en rendre
la prononciation dui'e.X. 850. b.
■ e. ( Monn. ) Cette lettre fur les monnoies en France,
marque Caen. Suppl. II. 88. a.
• Signification du c en mufique , c barré , c fol ut, ou c
fol fa ut. II. 474. b.
C , ( Mufiq. ) figue de la prolation mineure imparfitite ,
dans les anciennes mufiques, & de la raefure à quatre tems
dans la nôtre. Autres ufages de ce figne dans la mufique
ancienne & dans la moderne. Suppl. II. 88. a.
Sur la maniéré de former cette lettre en écrivant, voye^
ÉCRITURE.
C A
CAA-APIA, ( Botan.) petite planté du Brefil, fâ defcription.
Vertus qu’oit lui attribue. Ufage qu’en font lés.
habitans du Brefil. IL 474. b.
CAA-ATAYA, defcription de cette plante du Brefil. Sa
propriété médicinale? II. 474. b.
CAABÀ où Coba, ou Caabata, ou Borka \ ou Borkata,
"( Gèogr. ) noms du fameux temple de la Mecque, où tous
les Mufulmans doivent aller en pèlerinage, & yers lequel ils
fe tournent lorfqu’ils prient. Defcription de ce bâtiment.
Suppl. II. 88. a.
C a a b a . Suppl. I. 308. a. 8c XII. 283. a. Adminiftrateur de
ce temple. Iv . 197. a. Préfens que le fultân y envoie.
Suppl. 1. 508. a. Pierre noire confacrée dans cè temple. XII.!
584 .a.
CAACICA, defcription de cette plante du Brefil. Ses propriétés.
II. 474. b. .
CAA-ETIMAY, defcription de cette plante du Brefil.
II. 474. b. Qualité & propriété de cette plante. Ibid. 473. a.
CAAGHÏYNITO , defcription de cet arbriffeau du Brefil.
Les Negres en mangent les baies. Propriété de fes feuilles pul-
vérifèes. II. 473. a.
CAAGUA-CUBA, deferip tion de cet arbre. Qualité
de fon écorce & de fon bois.' Càraétere de fpn fruit. II. 473. a.
CAANA, ( Gèogr. ) ville d’Egypte. Sentimens fur fon
ancieimeté. Sa fmiation. Monumens d’antiquité dans cette
ville. Son commerce. Suppl. H. 88. b.
CAANTIE* (Ichthy.) nouveau genre de poiffon des
Moluques. Sa defcription & fes moeurs. 2e efpece, caantie de
Manipe. Defcription, moeurs & ufages de ce poiffon. Clafii-
ncation de ces deux efpeces. Suppl.U. 88. b.
CAA-OPIA, deferiptipn de cet arbre du Brefil. IÎ. 475. a.
Tems de fes fleurs 8c de fon fruit : larme qu’on en tire
par incifion, & qu’on diffout dans l’efprit-de-vin. Propriétés de
cette gommé. Ibid. b.
, GAB , mefure hébraïque , la 6e partie du féah & la 18e
de l’épha. Ce que contenoit le ecb en mefure de Paris. La
uiefure dont il eft fait mention, IV. Rois vj. ny , étoit le
quart du cab. Autres noms qu’on lui donne. Ce cab étoit différent
du cad. II. 475. b%
Tome /, •
CAB
GARACfifcakrets en Ruffie. Ils appartîenheht au fouVé-
rain qui eitTe feul cabaletier de fes états. Revenus qu’il en
retiré. II. 473. b..
CABALE. (Philof. ) Cabale juive, il. 473. b. Zele .du
fameux Jean rie de la Mirandole pour relever la cabale &
la mettrë au niveau des autres fciences. Origine de la cabalea
Rêveries des Juifs fur ce fujet. Ibid. 476. a. G’étoit la coutume
dos Orientaux d’avoir une fcience myflérieufe qu’ils
cachoieni à la multitude. Signification du mot cabale, Elle
formoit chez les Juifs cette lcience myftérieufe t comme le
prouve un paffage cité de Jochaides , écrivain cabaliftique*
Conjectures fur ce que renfermou le fonds de cette fcience*
Gomment elle dégénéra. DiftinCiiori entre la cabale & la
philofophie cabaliftique. Ibid. b. On ne doit poinr chercher
l’origine de la philofophie cabaliftique chez les Juifs de la
Paleiline. On iie peut doutèr qu’elle ne vienne d’Egypte*
Div\fion de la cabale en contemplative & en pratique. Ta
pratique en partUmlier confifte à opérer des prodiges par
l’arrangement de certains mots de l’écriture. Raifôns que
les partifans de la cabale pratique, donnent pour en fou-»
tenir la réalité. Ibid. 477. a. La cabale contemplative eft
de deux efpeces; l’une littérale , qui eft une explication
fecrete , artificielle 8c iymboliqtie de l’écriturè fainte. Ibid. bt
L’autre phïlofophique : elle fe divife en deux eipeces ; dont
l’üne s’attache à la connoiffance des perfections divines 8c
des intelligences céleftes, & s'appelle mercava j l’autre roule
fur l’étude du monde fublunaire, & s’appelle berefehit. Ce
qu’en dit Maïmonides. Il n’eft pas permis aux maîtres d’expliquer
le mercava devant leurs difciples ; raifons qu’ils en
donnent. Diverfité de fen^mens entre ceux qui onr voulu
l’expliquer. Ibid. 478. a. Explication philofophique du nom
de Jehovah donnée par les cabaliftes. Ibid. b. Conféquences
qu’ils tirent de cette explication par rapport au gouvernement
du monde , & à celui du peuple Juif en particulier.
Ibid. 479. a. On rapporte aüffi à la cabale réelle l’alphabet
aftrologique & célefte qu’on attribue aux Juifs. Auteurs caba*.
liftes qui parlent de cet alphabet. Ibid. b. Principes b fonde-,
mens de la cabale philofophique. Premier principe , de rien,
il ne fuit rien. Sentiment des cabaliftes fur la création différent
de Celui dès chrétiens. Ils prétendent que Dieu a fait
forrir les êtres de fon propre fonds par voie d’émanation.-
Ibid. 480. a. Serftiment qu’ils ont tiré *de la philofophie des
Gentils. Défenfe du fentiment des chrétiens fur la création,
contre celui des cabaliftes 8c de Spinofa. Ibid. b. En quel fen9
eft vrai cet axiome : rien nefe fait de rien. Deuxième b troifiemè
principe. Aucune fubftance, 8c par confirment la'matière, n’a
pu fortir du néant. Quatrième principe. La matière ne doit
point fon origine à elle-même. Cinquième principe. De-là il
fuit qu’il n’y a point de matière proprement dite. Sixième
principe. Tout ce qui eft, eft efprit. Septième principe. Cet
efprit eft incréé, éternel, intelleéluel, bc. nécefTairertient
exiftant. Huitième principe. Cet efprit eft ŸEnfop/i ou le Dieu ■
infini. Neuvième principe. 11 eft néceffaire que tout ce qui
exifte en foit émané. Dixième principe. Plus les chofes qui-
en émanerit font proche de leur fource, plus elles font grandes
8c divinîs, bc. Ônfieme principe. Le monde eft distingué de
Dieu comme un effet de fa çaufe, bc. Le monde étant émané
de Dieu doit être regardé comme Dieu même. Ibid. 481. a.
Explication des féphirots ou des fplendeurs. Il y a dix féphi-
rotsou fplendeurs; la couronne, la fageffe, l’intelligence, la
force, la miféricorde, la beauté, la viôoire , la gloire, le
fondement & le royaume. Selon la plupart, ce font les per-
fcélions & les attributs de la divinité. Ils imaginent des canaux:
par lefquels les influences d’une fplendeur ie communiquent-
aux autres. Ibid. b. Ils appellent ces attributs les habits de
Dieu, parce qu’il fe rend plus fenfible par leur moyen. Ils
difent aufli que c’étoient les inftrumens dont le fouverain'
architeéte fe fervoit. Enfin, que ce ne font pas-là feulement
des nombres, mais des émanations qui -forcent de l’effence
divine. L'Enfoph qu’on met au-deffus de l ’arbre féphirotique
eft l’infini. Ibid. 48.1. a. Les trois premières fplendeurs font
beaucoup plus excellentes que les autres. Cependant c’eft à.
tort que quelques doéleurs chrétiens ont prétendu trouver
par-là le dogme de la Trinité enfeigné dans la cabale. La
couronne eft la première des grandes fplendeurs, bc. On
l’appelle le non-étre, parce qu’elle fe retire dans le fein caché
de Dieu. Ibid. A La fécondé, émanation eft la fageû'e, & la
troifieme l’intelligence, bc. À chaque féphirot, on attache
un nom de Dieu, un des principaux anges, ui\e des planetes
un des membres du corps humain, un descommandemens de
la loi, & de-là dépend l’harmonie de l’univers, bc. Il y a
vingt-deux canaux qui fervent à h communication de tous
les féphirots. Ces lignes ou canaux ne remontent jamais,