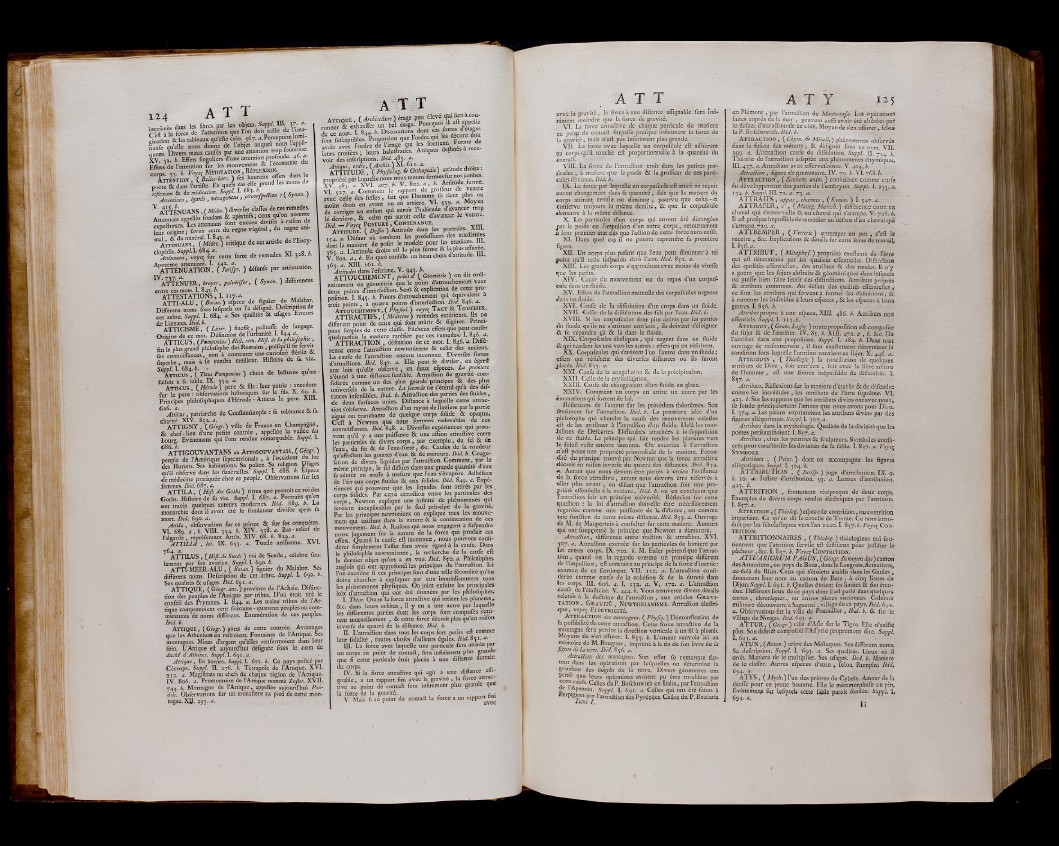
P ATT
i
Snarion & l i tableaux qu’elle «ée. ,67. ..Percepuonlurni-
neufe qu’elle nous donne de l’objet auquel n0l*? PP I
quons. Divers maux caufés par une attenuon trop. fouteniu . 1
5cv. -ta. b. Effets fineuliers d’une attention P^onde. 46. g
Effets3 de l’attention fur les mouvemem; & 1 économie du
coros 'Us b. Voyez Meditation , Réflexion. I
A t t e n t io n , (Sdlts-ltm. ) fes heurcùx effets dans e
P . Ä 1Ä . En ,ue¿ ca s elle prend les noms de
V A-TÎÉNUANS , m m ) dlTerfes nlaffes de nesremedes
leur origine ; favoir ceux du regne végétal, du regne atu- I
“ imN UAN sTTAi«« 3) critique de cet article de l'Ency-
Cl0C ^ Pr, % t ^ cene forte de remedes. XI. 528. i.
APA T r t i r o A n ( » / | }*Jurifpr. ) défenfe par atténuation.
^ATTÉNUER, broytr, pnlvcrijsr, ( Synon. ) différences
entre ces mots. I. 843. b.
ATTESTATIONS, I. 117.a. r . §
ATTI-ALU, (Botan.') efpece de figuier du Malabar.
Différens noms fous lefquels on l’a défigné. Defcription de
cet arbre. Suppl. I. 684. a. Ses qualités & ufages. Erreurs
île Linnsus. Ibid. b. , ,
ATTICISME, ( Unir. ) fiueffe, politeffe de langage.
Oriaine de ce mot. Définition de l’urbamté. I. 84+/>•
ATTICÜS, (Ptmponius) Hiß. rom. Hiß. d th pkilofophic,
fut le plus grand philofophe des Romains, puifqu d fit fervir
fes connoiffances, non à contenter une cunofité fténle &
fuperbe, mais à fe rendre meilleur. Hiftoire de fa vie.
^¡Erncus , ( Titus Pomponius ) choix de leéhires qu on jj
faifoit à fa table. IX. 334. a. . ,
A tticus , ( Hirode ) pere & fils : leur patne : anecdote
fur le pere: obfervations hiftoriques fur le fils. X. 69. b.
Principes philofophiques d’Hérode - Atticus le pere. Xlll.
^^Atticus » patriarche de Conftantinople : fe tolérance & fe I
charité. XIV. 85a. a. I
ATTIGNY, ( Géogr.) ville de France en Champagne, I
& chef-lieu d’une petite contrée , appellée la vallée du I
bourg. Evénemens qui l’ont rendue remarquable. Suppl. 1. I
¿ 8 6 .b. m m X
ATTIGOUVANTANS ou A t t ig o u v an ta is , ( Geogr. )
peuple de l’Amérique feptentrionale , à l’occident du lac
des Hurons. Ses habitations. Sa police. Sa religion, ylages
qu’il obferve dans les funérailles. Suppl. I. 686. b. Efpece
de médecine pratiquée chez ce peuple. Obfervations fur les
• femmes. Ibid. 687. a. . H
ATTILA, ( Hiß. des Goths ) titres que prenoit ce roi des
Goths. Hiftoire de fa vie. Suppl. J 687. a. Portraits qu en
ont tracés quelques auteurs modernes. Ibid. 689. b. La
monarchie dont il avoit été le fondateur divifée. après fa
mort. Ibid. 69O. a.. . „ e r a_
Attila, obfervations fur ce pnnce & fur fes conquêtes. 1
VI. 689. a , b. Vffl. 3$4-> XIV. 338. *. Bas - relief de
l’algarde , reprèfentant Attila. XIV. 68. b. 829. a.
ATTILIA , loi. IX. 633. a. Tutele attilienne. XVI.
^ATTILUS , {Hiß. de Suède) roi de Suede, célebre feulement
par fon avarice. Suppl. I. 600. b.
ATTt-MEER-ALU, ( Botan.) figuier du Malabar. Ses
différens noms. Defcription de cet arbre. Suppl. I. 690. b.
Ses qualités & ufages. Ibid. 601. a.
ATTIQUE, ( Gcogr. anc.) province de 1’Achate. Diftmc-
tion des peuples de l’Attique par tribus. D’où étoit tiré le
confeil des Prytanes. I. 844. a. Les treize: tribus de l’At-
tique comprenoient cent foixante - quatorze peuples ou communautés
de noms différens. Enumération de ces peuples.
Ibid. b.
A t t iq ue, {Geogr.) ports de cette contrée. Avantages
que les Athéniens en retiroient. Fontaines de l’Attique. Ses
montagnes. Mines d’argent qu’elles renfermoient dans leur
fein. L’Attique eft aujourd’hui défignée • fous le -nom de
duché d.'Athènes. Suppl. 1. 691. <z.
Attique, fes bornes. Suppl. I. 671. b. Ce pays policé par
Cécrops. Suppl. ü. 276. b. Tétrapole de 1 Attique. XVI.
312. a. Magiftrats ou chefs de chaque région de l’Attique.
IV. 806. a. Promontoire de l’Attique nommé Zofler. XVII.
744. b. Montagne de l’Attique, appellée aujourd’hui Peù-
deli. Obfervations fur un mOnaftere au pied de cette montagne.
XU. 293. a.
B B H fc ta ë ’
voir des inferiptions. féh/. 485-
A tÎ tTU D E ^(Phy/iolog. & Orthopédie) attitude ,dr01t® :
propriété p * laquelle nous nous tenons fermes fur nos jamhes.
B H i i XVI. 407. i v . 80s. u , 4. Attitude ferme.
VI «7? u. Comment le rapport de groffeur de ventre
avec celle des feffes, fait que l’homme fe uent plus ou
m o t o droit en avant ou en arriéré VI u. Moyen
de corriger un enfant qui auroit l'habitude d avancer trop
i l S , & celui qui auroit ceUe d'avancer le ventre.
Ibid. — Voyez Posture , Contenance. . _
Attitude . ( DtJTm ) Attimde dans les portraits. XIII.
| i<4 a. Défaut ou tombent les profeffeurs des académies
dans la maniéré de pofer le modèle pour les étudnma m .
,6 t. a. L’attitude droite eft la plus ferme & la plus allurée.
I V. 802. u, 4. En quoi confifte un beau choix d attitude. IIL ,6 t. a. XIII. 161. 4.
I Altitudes dans l’ I efcrime. V . 945. 4. q ATTOUCHEMENT, point ( Gtomltnt ) on dit ordinairement
en géométrie que le point d’attouchement vaut
deux points d’interfeffion. Sens & explication de cette propofition.
ï 845. 4. Points d’attouchement qui équivalent a I trois points , à quatre points d’interlethon. Ibtd.V46. a. I Attouchement, ( Phyfiol. J voyr? T a c t & Tou ch er.
ATTRACTIFS, ( Médecine ) remedes exteneurs. Ils ne I différent point de ceux qui font mûrir & digérer. Principaux
Amples de cette claffe. Fâcheux effets que peut cauier 1 quelquefois la matière raréfiée par ces remedes.« I. 846 .a .
ATTRACTION , définition de ce mot. I. 846. a. Ditte- I rence entre l’attraétion newtonienne & celle des anciens. I La caufe de l’attra&ion encore inconnue. Diverfes fortes I d’attraftions. Ibid. 847« ® g Peut & «livifer, eu égard
. I aux loix qu’elle obferve , en deux efpeces. La première
I s’étend à une diftance fenfible. Attraction de gravité con-
' fidérée comme un des plus grands* principes & des plus
uiiiverfels de la nature. La fécondé ne. s’étend qu à des dil-
tances infenfibles. Ibid. b. Attraétion des parties des fluides,
de deux furfaces unies. Diftance à laquelle cette attraction
s’obferve. AttraCtion d’un rayon de lümiere par la partie
aiguë ou tranchante de quelque corps folidé & opaque.
Ceft à Newton que nous fommes redevables de ces
connoiffances. Ibid. 848. a. Diverfes expériences qui prouvent
qu’il y a une puiffance & une aCtion atirattive entre
les particules de divers corps, par exemple, du fel & de
l’eau, du fer & de l’eau-forte, bc. Caufes de la rondeur
qu’affeftent les gouttes d’eau & de mercure. Ibid. b. Coagulation
de divers liquides par l’attraétion. Comment, par le
même principe, le lel diffous-dans une grande quantité d’eau
fe réunit en maffe à mefure que l’eau s’évapore. Adhéfion
de l’air aux corps, fluides & aux'folides. Ibid. 849. a. Expériences
qui prouvent que les liquides font attirés par les ,
corps foüdes. Par cette atrraCtion entre les particules des
corps, Newton explique une infinité de phénomènes qui
feroient inexplicables par le feul principe de la gravité.'
Par les principes newtoniens on explique tous les mouve-
mens qui exiuent dans la nature & la continuation de ces
mouvemens. Ibid. b. Raifons qui nous engagent à fufpendre
notre jugement fur la nature de la force qui produit ces
effets. Quand la caufe eft inconnue , nous pouvons confi-
j dér'er Amplement l’effet fans avoir égard à la caufe. Dans
la philofophie newtonienne, la recherche de -la caufe eft
le dernier objet qu’on a en vue. Ibid. 850. a. Philofophes I anglois qui ont approfondi les principes de l’attraftion. Ici I l’on examine fi ces principes font d’une telle fécondité qu’bn I doive chercher à expliquer par eux immédiatement tpus I les phénomènes phyfiques. ôn joint enfuite les principales I loix d’attraftion qui ont été données par les philofophes.
I. Théor. Outre la force attra&ive qui retient les planetes, I &c. dans leurs orbites, il y en a une autre par laquelle
I les différentes parties dont les corps font compofés s’atti-
I rent mutuellement , & cette force décroît plus qu’en raifon
1 inverfe du quarré de la diftance. Ibid. b.
I II. L’attraftion dans tous les corps fort petits eft comme
I leur folidité , toutes chofes d’ailleurs égales. Ibid. 851. a.
ni. La force avec laquelle une particule fera attirée par
I un corps au point de contaft, fera infiniment plus grande.
I que fi cette particule étoit placée à une diftance donnée
I du corps. _
I IV. Si la force attraétive qui agit à une diftance a -
I gnable, a un rapport fini avec la gravité , la force attrac
tive au point de contaft fera infiniment plus grande que
1 la force de la gravité. ..fini
V. Mais fi au point de contail la force a un rapportai«
ATT A T Y 12,5
avec la gravité, la force â une diftance alfigrtable fera infiniment
moindre que la force de gravité.
VI. La force attraélive de chaque particule de matière
au poiqt de contait furpaffe prefque infiniment la force de
la gravité, mais n’eft pas infiniment plus grande.
VII. La force avec laquelle un corpuîcule eft adhérent
au corps qu’il touche eft proportionnelle à la quantité du
contait.
VIII. La force de l’attraitiort croît dans les petites par*-
.licules, à mefure que le poids & la grôffeür de ces particules
diminue. Ibid. b.
IX. La force par laquelle un corpuîcule eft attiré rie reçoit
aucun changement dans fa quantité, foit que la matière du
corps attirant croifle ou diminue , pourvu que celui - ci
confefve toujours la même denfité, & que 1e corpufcule
demeure à la même diftance.
X. Les particules d’un corps qui auront été dérangées
par le poids ou l’impulfion d’un autre corps, retourneront
z leur premier état dès que l’aition de cette force aura ccffé.
XI. Dans quel ca§ il ne pourra reprendre fa première
figure.
XH. Un corps plus pefant que l’eau petit diminuer à tel
point qu’il refte fufpendu dans l’eaü. Ibid. 852. a.
Xm. Les grands corps s’approchent avec moins de vîteffe
que les petits.
XIV. Caufe du mouvement ou du repos d’un corpuf-
cnle dans un fluide.
XV. Effets de l’attraétion mutuelle des corpufcules nageant
dans im fluide.
XVI. Caufe de la diflblunon d’un corps dans un fliîide.
XVII. Celle de la diffolution des fels par l’eau. Ibid, b.
XVIII. Si les corpufcules font plus attirés par les parties
du fluide qu’ils ne s’attirent entr’eux, ils doivent s’éloigner
& fe répandre çà & là dans le fluide.
XIX. Corpufcules élaftiques, qui nagent dans un fluide
& qui tendent les uns vers les autres : effets qui en réfultent.
XX. Corpufcules qui s’attirent l’un l’autre dans un fluide ;
effets qui réfultent des diverfes diftances où ils feront
placés. Ibid. 853. a.
XXI. Caufe de la coagulation 8c de la précipitation,-
XXn. Celle de la cryualli£ition.
XXIII. Caufe du changement d’un fluide en glace. •
XXIV. Comment un corps en attire un. autre par les
•émanations qui fortent de lui. '
Réflexions de l’auteur fur les précédens théorèmes. Son
fentiment fur l’attraétion. Ibid. b. La première idée d’un
philofophe qui cherche la caufe des mouvemens céleftes
eft de les attribuer à l’impulfion d’un fluide. Delà les tourbillons
de Defcartes. Difficultés attachées à la fuppofition
de ce fluide. Le principe qui fait tendre les planetes vers
le foleil refte encore inconnu. On examine fi l’attraftion
ai’eft point une propriété primordiale de la matière. Fécondité
du principe trouvé par Newton que la force attraétive
décroît en raifon inverfe du quarré des diftances. Ibid. 854.
*. Autant que nous devons être portés à croire l’exiftence
de la force attraétive, autant nous devons être réfervés à
•aller plus avant, en difant que l’attraétion foit une profriété
effentielle à la matière, Ibid. b. ou en concluant que
attraélion foit un principe univerfel. Réflexion fur cette
queftion : la loi d’attraétiQn doit-elle être nécefl'airement
regardée comme une puiffance de la diftance, ou comme
une fonction de cette même diftance. Ibid. 855. a. Ouvrage
de M. de Maupertuis à confulter fur cette matière. Auteurs
«jui ont foupçonné le principe que Newton a démontré;
Attradion, différence entre traâion & attraétion. XVI.
Ç07. a. Attraétion exercée fur les particules de lumière par
les autres corps. IX. 720. b.. M. Euler prétend que l’attraction
, quand on la regarde comme un principe différent
de l’impulfion, eft contraire au principe de la force d’inertie :
examen de ce fentiment. VII. 112. a. L’attraétion confédérée
comme caufe de la cohéfion & de la dureté dans
les corps. III. 606. a. I. 132. <r. V N 172. a. L’attraétion
caufe de l’élafticité. V. 444. b. Vous trouverez divers détails
relatifs à la doéirine de l’attraétion, aux articles G r a v i ta
t io n , G r a v it é , Newtonianisme. Attraétion éle&ri-
que, voye^ Electricité.
A t tra ct ion des montagnes. (Phy/iq. ) Démonflration de
la poifibilité de cette attraétion. Cette rorce attraétive de la
montagne fera perdre la direétion verticale à un fil à plomb.
Moyens de s’en affurer. I. 8çç; b. L’auteur renvoie ici au
mémoire de M. Bouguer, imprimé à la fin de fon livre de la
figure de la terre. Ibid. 8 56. a.
Attraflion des montagnes. Son effet fe remarque fur-
tout dans les opérations par lefquelles on détermine la
• grandeur des degrés de la terre. Divers géomètres ont
penfé que leurs opérations avoient pu être troublées par
*jett® caufe. Celles au P. Bofchowieh en Italie, par l’attraétion
de 1 Apennin. Suppl. L 691. a. Celles qui ont été faites à
rerpignan par l’attraétion des Pyréoées. CeUes du P, Beccaria
Tome I, ' ‘ '
en Piémont, par l’attraétion de Monte-rofa. LeS opérations
faites auprès de la mer , peuvent auflravoir été altérées pat*
le défaut d attraction de ce côté. Moyen de s’en affurer < félon
le P. Bofchowieh. Ibid. b.
A t t r a c t io n , {Xhym. b Métall») phénomènes obf*erv¿s
dans la fufion des métaux £ & défignés fous ce nom. VIL
399. a. L’attraétion caufe de diffolution. Suppl. II. b.
Théorie de l’attraétion adaptée aux phénomènes êhymiques.
III. 437. a. Attraétion avec efferveicence. W. 404^b.
Attradion, figure de grammaire. IV. 79. b. VI. 768. b,
A t t r a c t io n , ( Économ. anim.) cônfîdérée comme caufe
du développement des parties de l ’embryon. Suppl, I. 133.41»
134. b. Suppl. III. 72. a. 73. a, ’
ATTRAITS , appas ¿ charmes ¡ { Synon, ) ï. 347. a.
ATTRAPER,, s‘ , {Maneg. Maréch.) différence entre Un
cheval qui s’entre-taille & un cheval qui s’attrape. V . 728. b.
Il eft prefque impoffible de remédier au défaut d’un cheval qui
s’attrape. 729. a.
ATiREMPER , | Verrerie) attremperun pot * c’eft le
recuire , &c. Explications & détails fur cette forte de travail,
I. 8<¡6. a.
ATTRIBUT, ( Mètaphyf.) propriété confiàntè dè l’être
qui eft déterminée par les qualités effentielles. Diítinétioñ
des qualités effentielles, des attributs & des modes. Il n’y
a guere que les fujets abftraits & géométriques dans lefquels
on puiffe bien faire fentir ces diftinétions. Attributs propres
& attributs communs. Au défaut des qualités effentielles |i
ce font les attributs qui fervent à former les définitions, &
à ramener les individus à leurs efpeces les efpeces à leurs
genres. I. 856. b.
Attribut propre à une efpece. XIII. 486. b. Attributs non
effentiels. Suppl. I. 113. b.
A t t r ib u t , f Gram.Logia.) toutepropofition eft compofée
du fujet & de l’attribut. IV. 81. b. XIII. 472. a , b. &c. De
l’attribut dans une propofition. Suppl. I. 184. b. Dans tout
ouvrage de rationnement, il feut exaélement déterminer la
condition fous laquelle l’attribut convient au fujet. X. 446. a.
A ttribut s , | Théologie ) la conciliation de quelques
attributs de Dieu , foit entr’eux , foit avec le libre arbitro
de l’homme , eft une fource inépuifeble de difficultés. L
837. a.
Attributs. Réflexions fur la maniere d’établir & de défendre
contre les incrédules, les attributs de l’être fuprême, VI.
423. b. Sur les rapports que les attributs divins ont avec nous,
fe fonde principalement l’amour que nous avons pour Dieu,
I. 374. a. Les païens exprimoient les attributs divins par des
figures allégoriques. Suppl. I. 307. a.
Attributs dans la mythologie. Qualités de la divinité que les
poetes perfonnifioient. 1 .857. a.
Attributs, chez les peintres & fculpteurs. Symboles confe-
crés pour caraôérifer les divinités de la feble> L 837..!*. Voyeç
Symbole.
Attributs , ( Peint. ) dont on accompagne les figures
allégoriques. Suppl. I. 304. b.
ATTRIBUTION , ^ ( Jurifp. ) juge d’attribution. IX. 9»
b. 10. a. Juftice d’attribution, 93. a. Lettres d’attribution.
413. b.
ÀTTRITION , frottement réciproque de deux corps.
Exemples de divers corps rendus éleâriques par l’attritiom
I. 837. a,
A t tr it io n , ( Théolog. ) efpece de contrition, ou contrition
imparfaite. Ce qu’en dit le concile de Trente. Ce nom introduit
par les fcholaftiqucs vers l’an X220.1. 837.b. Voye^C ontr
it io n .
ATTRHTONNAIRES , ( Théolog.)«théologiens qui foiï-
tiennent que l’attrition fervile eft fuffifente pour juftifier le
pêcheur, ote. 1. 837. b. Voye[ C ontr itio n .
ATTUARIORUM PAGUS t {Géogr. du moyen âge ) canton
des Attuariens, ou pays de Beze, dans le Langrois. Attuariens,
au-delà du Rhin. Ceux qui s’étoieht établis dans les Gaules,
donnèrent leur nom au canton de Beze, à cinq lieues de
TyC)on.Suppl. 1. 691. b. Quelles étoient fes limites 8c fon étendue.
Différens lieux de ce pays dont il eft parlé dans quelques
cartes , chroniques, ou autres pièces anciennes. Colonné
militaire découverte à Saguenai » village de ce pays» Ibid. 693.
a. Obfervations fur la ville de PontaUlier, Ibid. b. & fur le
village de Norges. Ibid. 693. q.
ATTUR, (Géogr.) ville d’Afié furie Tigre. Elle n’exifté
' plus. Son diftriéf compofoit l’Aifyrie proprement dite. Suppl.
I. 693. a.
ATUN, {Botan.) arbre des Moluques. Ses différens noms.
Sa defcription. Suppl. I. 693. a. Ses qualités. Lieux où il
croît. Maniere de le multiplier. Ses ufages. Ibid. b. Maniere
de le claffer. Autres efpeces d’atun , felón Rumphe. Ibid,
694. a.
ÀTYS , ( Myth. ) l’un des prêtres de Cybele. Amour de la
déeffe pour ce jeune homme. Elle le métamorphofe en pin*
Événemens fur lefquels cette feble paroi t fondée. Suppl, I,
694. a,