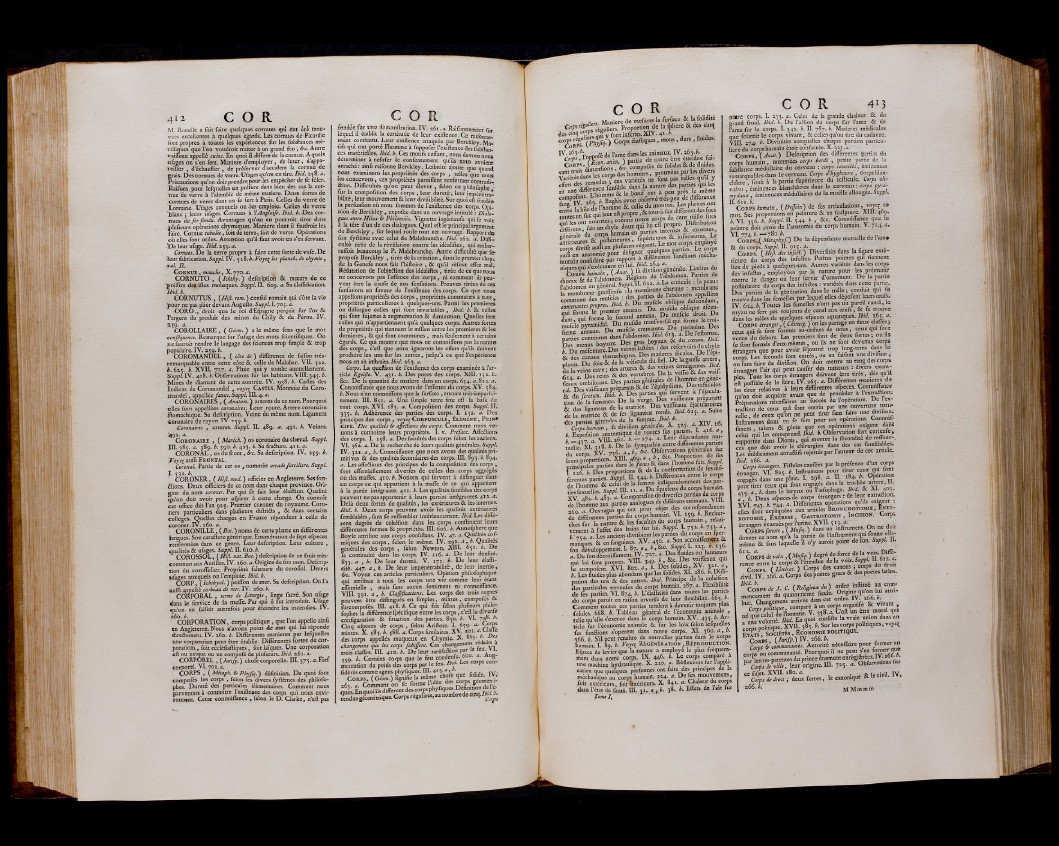
M. Rouelle a fait faire quelques cornues qui Ont été trouvées
excellentes à quelques égards. Les cornues de'Picardie
(ont propres à toutes les expériences fur les fobftances métalliques
que l’on voudroit traiter à un grand feu ', &c. Autre
vaifleau appellé cu'me. En quoi il-différé de la cornue. A-quels
ufages on s’en fert.-Maniéré d’employer, de luter, dép areiller
, d’échauffer , de préferver d'accident la cornue de
grais. Des cornues de verre.'Ufages qu’on en tire. Ibid.xq8. a.
Précautions -qu’on-doit.prendre pour les empêcher de fe feler.
Rations .pour lefquelles on préféré dans bien des cas la cornue
de verre à l’alembic de même matière. Deux fortes de
cornues de verre-dont on fe fert à Paris. Celles du verre de
Lorraine. Uiàges auxquels on des emploie. Celles -de verre
'blanc ; leurs ufages. Cornues à l'Angloife. lbid. b. Des cornues
de fer fondu. Avantages qu’on en pourroit tirer dans
•jduiieurs opérations chymiques. Maniéré dont-il faudrait les
¿ire. Cornue tubuléc, ion de terre, foitde verre. Opérations
où elles font utiles. Attention qu’il-faut avoir en s’en fervant.
-De leur ufgge. lbid. 259. a.
Cornues. De la terre propre à faire cette forte de-vafe. De
: leur fabrication. Suppl. IV. 518. b. Voyc{ Us planch. de chymie 4 ;
■yol. n .
CO R N U E y mouche, X77O. a.
CORNUTO -, 1 Ichthy. ) deferiptibn & moeurs de ce
.“poiffon des ifles moluques. Suppl. U. 609. a. Sa daffification.
lbid. b.
CORNUTUS ., \Hiff rom.) conful romain qui s’ôte la vie
.pour ne pas. plier devant Auguue. Suppl. 1. 705. a.
•CORO,, droit que le roi d’Eipaene perçoit fur l’or &
l ’argent du produit des mines du Chily & du Pérou. IV.
259. a.
COROLLAIRE , ( Ge'om.) a le même fens que le mot
xonfèquence. Remarque fur l’ufage des mots feientinques. On
ne fauroit rendre le langage des fdences trop ftmple & trop
populaire. IV. 259. b.
COROMANDEL , ( côte de ) différence de faifon très-
remarquable entre cette côte & celle de Malabar. VII. 522.
b. 625, b. XVII. 727. a. Pluie qui y tombe annuellement.
'Suppl. IV. 418. b. Obfervations for les habitans.VIII. 345. b.
Mines de ¿amant de cette contrée. IV. 938. b. Caftes des
Indiens de Coromandel , voyez C astes. Monnoie du Coro-
jnandel, appellée fanos. Suppl. III. 4. a.
CORONAIRES , ( Anatom. ) arteres de ce nom. Pourquoi
elles font appellées coronaires. Leur rçute. Artere coronaire
Itomachique. Sa defeription. Veine du même nom. Ligament
-coronaire du rayon. IV. 239. b.
Coronaires , arteres. Suppl. IL 489. a. 491. b. Veines.
^92. a.
C oronaire , ( Maréch. ) os coronaire du cheval. Suppl.
HI.j8ç. a. 389. b. 300. b. 423. b. Sa fraâure. 411. a.
CORONAL , os du front, &c. Sa defeription. IV. 259. b.
Voye{ aufli F rontal. # f
CoronaL Partie de cet os , nommée arcade furciliere. Suppl.
■' H o r o n e r , ( Hift. mod. ) officier en Angleterre. Ses fondons.
Deux officiers de ce nom dans chaque province. Origine
du nom coroner. Par qui fe fait leur éleôion. Qualité
qu’on doit avoir pour aipirer à cette charge. On connoît
cet office dès l’an 025. Premier coroner du royaume. Coroners
particuliers dans plufieurs diftriâs , & dans certains
collèges. Quelles charges en France répondent à celle de
coroner. IV. 260. a. ’
CORONILLE, ( Sot.) noms de cette plante en différentes
tangues. Son caraâere générique. Enumération de fept efpeces
renfermées dans ce genre. Leur defeription. Leur culture ,
qualités & ufages. Suppl. H. 610. b.
COROSSOL, ( Hift. nat. Bot. ) defeription de ce fruit très-
commun aux Antilles. TV. 260. a. Origine de fon nom. Defcrip-
tion du coroffolier. Propriété falutaire du coroflol. Divers
ufages auxquels on l’emploie. lbid. b.
CORP, ( Ichthyol. ) poiffon de mer. Sa defeription. On 1 a
aufli appellé corbeau de mer. IV. 260. b.
COKPORAL , terme de Liturgie, linge facré. Son ufage
dans le fertrice de la meffe. Par qui il fut introduit. Ufage
qu’on en fkifoit autrefois pour éteindre les incendies. IV.
CORPORATION, corps politique, que l’on appelle ainG
en Angleterre. Nous n’avons point de mot qui lui réponde
direôement. TV. 260. b. Différentes maniérés par lefquelles
une corporation peut être établie. Différentes fortes de corporations
, foit eccléfiaftiques , foir laïques. Une corporation
eft ou unique ou un compofé de plufieurs. lbid. 261. a.
CORPOREL , ( Jurijp. ) choie corporelle. IIL 373. a. Fief
co rporel. VL toi. a.
CORPS , ( Mitaph. 6« Phyjiq. ) définition. De quoi font
compofés les corps , félon les divers fyftêmes des pbilofo-
phes. Dureté des particules élémentaires. Comment nous
parvenons à connoitre l’exiftence des corps qui nous environnent.
Cette connoiffance , félon le D. Clarke, n’eft pas
fondée for une démonftratiôn. IV. 26*. a, Raifonriement for
lequel il établit la certitude de leur exiftence. Ce raifonnement
combattu. Leur exiftence attaquée par Berckley Motifs
qui ont porté l’homme à foppofer l’exiftence des fobftan-
ces matérielles, lbid. b. Ces motifs ceffant,nous devons nous
déterminer à refufer le confentement qu’ils nous avoient
arraché: atnft raifonne Berckley. Leïbnitz ajoute que quand
nous examinons les propriétés des corps , telles que nous
les concevons, ces propriétés paroiffent renfermer contradiction.
Difficultés qu’on peut élever , félon ce philofophe ■
fur la compofition des corps , leur dureté, leur impénétrabilité,
leur mouvement &leur divifibilité. Sur quoi eft fondée
la perfuafion où nous fommes de l’exiftence des corps. Opinion
de Berckley, expofée dans un ouvrage intitulé : Dialogues
entre Hilas & Philonoüs. Vignette ingenieufe qui fe voit
à la tête d’un de ces dialogues. Quel eft le-principal argument
de Berckley, fur lequel roule tout cet ouvrage. Rapport de
fon fyftême avec celui de Malebranche. lbid. 262. a. Difficulté
tirée de la révélation contre les idéaliftes, qui embar-
raffoit beaucoup le P. Malebranche. Autre difficulté que fe-
propofe Berckley , tirée de la création, dont le premier chap;
de la Genefe nous fait l’hiftoire , & qu’il réfout affez mal.'
Réfutation de l’objeétion des idéaliftes, tirée de ce que nous
ne concevons pas l’effence des corps, ni comment ils peuvent
être la caufe de nos fenfations. Preuves tirées de ces
fenfations en faveur de l’exiftence des corps. Ce que nous
appelions propriétés des corps, propriétés communes à tous ^
propriétés particulières à quelques-uns. Parmi les premières
on diftingue celles qui font invariables , lbid. b. 8c celles
qui font fujettes à augmentation & diminution. Quelles font
celles qui n’appartiennent qu’à quelques corps. Autres fortes
de propriétés qui tiennent le milieu entre les premières 8c les
dernieres, & qui font communes, mais feulement à certains
égards. Ce qui montre que nous ne connoiffons pas la nature
des corps, c’eft que nous ignorons les effets qu’ils doivent
produire les uns lur les autres, jufqu’à ce que l’expérience
nous en ait inftruits. lbid. 263. a.
Corps. La queftion de l’exiftence des corps examinée à l’article
Egoïfte. V . 431. b. Des pores des corps. XIII. 132. b.
8cc. De la quantité de matière dans un corps. 634. <1.812. a.
Connoiffance que nous avons de l’effence du corps. XV. 384.
b. Nous n’en connoiffons que la furface, encore très-imparfaitement.
UI. 831. a. Une fimple terre fixe eft la bafe de
tout corps. XVI. 183. a. Compofition des corps. Suppl. II.
333. b. Adhérence des parties des corps. I. 132; a: Des
principes des corps, voye[C orpuscule, Élément, Prin*
CIPE. Des qualités & affrétions des corps. Comment nous venons
à connoître leurs propriétés. I. v. Préface. Affrétions
des corps. I. 138. a. Des facultés des corps félon les anciens.-
VI, 362. a. De la recherche de leurs qualités générales. Suppl.
IV. 321. a, b. Connoiffance que nous avons des qualités primitives
8c des qualités fecondaires des corps. III. 803.1
a. Les affrétions des principes de la compofition des corps -,
font effentiellement diverfes de celles des corps aggrégés
ou des maffes. 410. b. Notions qui fervent à difunguer dans
un corps ce qui appartient à la maffe de ce qui appartient
à la partie intégrante. 411. b. Les qualités fenfibles des corps
euvent ne pas appartenir à leurs parties intégrantes. 412. a.
D<
_)elà deux fortes de qualités, les extérieures & les internes.
lbid. b. Deux corps peuvent avoir les qualités extérieures
femblables , fans fe reffembler intérieurement, lbid. Les diffé-
rens degrés de cohéfion dans les corps conftiruent leurs
différentes formes & propriétés. III. 606. b. Atmofphere que
Boyle attribue aux corps confiftans. IV. 47. a. Qualités cof-
iniques des corps, félon le même. IV. 292.. a , b. Qualités
générales des corps , félon Newton. XIII. 631. b. De
la continuité dans les corps. TV. 116. a. De leur denfité.
833. a , b. De leur dureté. V. 171. b. De leur élasticité.
447. a , b. De leur impénétrabilité , de leur inertie,
(fc. Voyez ces articles particuliers. Opinion philofophique
qui attribue à tous les corps une vie comme leur étant
effentielle , mais fans aucun fentiment ni connoiffance.-
VIII. 391. a t b. ClaJJifications. Les coips des trois régnés
peuvent être diftingués en Amples, mixtes, compofés &
furcompofés. III. 418. b. Ce qui fait félon plufieurs philo-
fophes la différencefpécifique entre les corps, c’eft la diverfe
configuration & fituation des parties. 830. b. VL 74°- b-
Cinq efpeces de corps , félon Ariftote. I. 639. a‘ vfTï?
mixtes. X. 383. b. 588. a. Corps fimilaires. XV. 201. *• 'Clafle
des corps appellés muqueux en Chymie. X. : r f f
changement que Us corps fubiffent. Ces changemens r 1
trois claies. III. 410. 4. Do leur raréfaffion par le feu VI.
399. b. Certains corps que le feu conde
mentation du poids des corps par le feu. lbid. Le rp
Adirés comme agens phyfiquet. III. 41 S-“ ’ ■ . . . .
ques En quoi ils différent des corps phyfiqnes. Déïnmon de j e-
tendaegéométrique. Corpt réguliers, au nombre de cinq.
des cinq « g ' X y f„„t infirta. X K - . . . , t
Corps élaWques, mous, durs, fluides. I
lVr%6'‘ ' ‘ i-oooofé de l'ame dans Corps, 10PP°" . :. 1«d ae nniomtrea uêtrrIeV éateénjd.iu.e fui- I
CO R P S . ( Pcompoiëe de folides&de fluides.
-^"■s^lMsles corps* des "hommes, prouvées par les divers
remedes ; ces variétés ne font pas telles qu ii y I
eafifte tusn e différence ¿tennf ible dan_s Ja ^nat ure <fes parties qui les ^ près le même
compofrnt. L h°mB his avoif obfervé très-peu de différence
fang. IV. îfij- S“ , o, relie du mouton. Les plantes ont I
entre
toutes un foc qui leur e«Pr9P : corpS de cent. mi)le focs I
qui les oit nourries; comnewye p ... ()iftrib ion
différens, faitunchyle ^ ^ ¿ n ^ é r L & externes,
gènétale du corps (îpérieures & iufétteures.. Le
d s u x & t& m oe “ méchi- niques qui s’exécutent^ec1 lut. f e f f i g f a g à y ¿imites du
A ottoaixu -&sd be ln'a»b»d>o m Ce Amn\ R Jé “^ u ^dd el4^ dompn. P; arties .de
fabdomen en g4".4?*-, ^ ’membrane charnue : membrane
la membrane graiffeufe . a u t e pm ^ llabdôme„ appeflées
commune des mllfcle oblique defcèndant,
ionunanus propres. Du mufcle oblique afeen-
Du mufcle droit. Du
flant, qm forme le te Kanfverfal qui forme le trot- 1
mufcle pyramidal. Du mulcle mm h Des I
fieme anneau. D“ ” ^ “ E 6T j. a.De l'eilomac.
de la matrice & de fes ligamens M k M «M- Suitc
■
m
du corps. X ..731 | x ¿ c. Propornon de fes I
le u r s propomons.XnL 4* * » » l’homme fait. Suppl.
de^onformanondc fe s if-
rl le Suool II. «544- h. Différences entre le corps
deThommT& c S de la femme indépendamment des par-
riL f e S e s . Suppi.ni. I I . Du fquefette du corps humam. |
X V S a “ 483 U. Comparaifon de diverfes parues du corps
a . Æ , Î J Darties analogues.de différens animaux. V I .
odo a OulSgesSuilmt pour objet des correfpondances
d?éffè«n.es parS“ <lu «¡rps humU VI. i S9- *• R « 1}“ -
cheffur la namre & les facultés du cotps humain , relan-
vement à l’effet des bains fur lui. Suppl. 1. 75a. é. 7S3-11 >
é 7S4 u Les anciens divifoient les parties du corps en fper-
matiqiies & en fanguines. XV. 45?. u. Son accro.ffem*t &
- 'i " V le compofent ¿VI. 80a. u, i. Des fobd«, XV. aai. u 1
b. Les fluides plus abondans que les fohdes. XL 286. b. Vüh- I
padon des u ii & des autres, m . Principe de B H n 1
des particules terreufes du corps humam. a8p. a. tlexibiUte
de fes parties. VI. 874. 4. L'élaflicité dans mutes.te parues
du corps paroît en ration inverfe de leur flexibilité. 663- b.
Comment toutes ces parties tendent à devenir toujours plus
folides. 668. b. Tableau général de l’économie animale , ,
telle qu’elle s’exerce dans le corps humain. XV. 4^ $ • " r"
ticle fur l’économie animale & fur les lpix félon lefquelles
fes fondions s’opèrent dans notre corps. XI. 360. a 9 b.
266 b S’il peut renaître de nouvelles parties dans le corps
humain. I. 89. b. Voyc^ Régénération , Réproduction.
Efpece de levier que la nature a employé le plus fréquemment
dans notre corps. IX 44^- b- corPs comparê à
une machine hydraulique. X 220. a. Réflexions fur 1 application
que quelques perfonnes ont faite des principes de la
méchanique au corps humain. 224. a. De fes mouvemens,
foit extérieurs, foit4ntérieurs. X 841. «.Chaleiir du corps
dans l’état de fantè. UL 31. ^ » b. 38. b. Effets de lair fur
Tome /,
nctre corps. I. 233. a. Celui de la grande chaleur & du
grand froid. Ibid. b. De l’a&ion du corps fur l’ame & de
famé fur le corps. I. 342. b. IL 787. b. Matières médicales
que fournit le corps vivant, & celles qu’on tire du cadavre.
VIII. 274. b. Divinités auxquelles chaque portion particu-
lieredu corps humain étoitconfacrée.X. 315.1.
CORPS (Mat.) Defeription des différentes pamis du
coips humain, nommées corps 4»rii , petite partie de la
fubuance médullaire du cerveau : corps cannclts, éminences
remarquables dans le cerveau. Corps ihyfhnorc , corps blan-
châtre , fitué h la partie fupérieure du teflicule. Corps oli-
vaircs , éminences blanchâtres dans le cerveau: corps pyramidaux
, éminences médullaires de la moelle allongée. Suppl.
I 1 C o r p s humain, (Dttftm) de fes articulations ,voyrr ce
mot. Ses proportions en peinture 8c en fculprure. Xlll. 4Ö9*
b. VI. 336. b. Suppl. 11. 344. b y 8cc.; Connoiffance que le
peintre doit avoir de L’anatomie du* corps humain. V. 714-a- II Vl. 774. b. —*'78o.'é.' , - - j 1» ■ C o rp s .^ C Métaphyf.) De la dépendance mutuelle de 1 am» II & Cdu corps. Suppl. II. 913. o. ^ . . . . . . o r p s . (Hifl. des infini) Divérfités dans la figure exté-
I rieure du corps des infeftes. Petites pointes qui nennent
I lièu de pieds à quelques-uns. Autres variétés dans les corps
I des infeïtes, employées par la nature pour les prémunir
I contre le danger ou leur fervlr d’ornement. De la parue
I poftérieure du corps des infeftes : variétés dans cette partie.
I Des parties de la génération dans le maie; condmt qui fe
I trouve dans les femelles par lequel eUes dépofent leurs teufst
I IV. 614.4. Toutes les femelles n’ont pas un pared canal, le
tuyau ne fert pas touiouis de canal aux oeufs, & fe trouve
dans les mâles de quelques efpeces aquatiques. Ibtd. 265.1.
CORPS ¿1ranger, ( cïintrg.) on les partage en deux claffes,
ceux qui fe font formés au^dedans de nous, ceux qui font
venus du dehors. Les premiers font de deux fortes, ou ils
fe font formés d-eux-mêmes, ou ils ne font devenus corpsj
étrangers que pour avoir féjoumé trop long-tems dans le
corps. Les féconds font entrés, ou en faifanr une divifion,
ou fans faire de divifion. On doit mettre au rang des corps
étrangers l’air qui peut caufer des tumeurs t.d'Vers cxem-
ples. Toiis les corps étrangers doivent être tués, des qui!
eft poffible de le faire. IV. 265. a. Différentes maniérés de
les nrer reladves à leurs différentes efpeces. Connoiffance
qu’on doit acquérir ayant que de procéder à lextraflion.
Préparations néceflaires au fuccés de 1 opération. De l ex
uartion de ceux qui font entrés par une ouverture naturelle,
de ceux qu’on ne peut tirer fans fiure ime ivifion.
Inftrumens dont on fe fert pour ces opéranons. Connoif-
fances talens & génie que ces opéranons exigent dans
S qui les entreprend. Aid. 4. Obferva,ion fort e,uieufe
rapportée dans Dionis, qui montre la fécondité de reliour-,
ces que doit avoir le chirurgien dans des cas femblables.
Les médicamens attraétifs rejettés par 1 auteur de cet arncle.
I UiColfs6t:,rangers. Eftules caufées par la préfence ¿’“ " .« n “
étraneer V if 825. 4. Inftrumens pour tirer ceux qui font
engagés dans une plaie. I. 298. a. II. 184. 4. Opération
pour tirer ceux qui font engagés dans la trachée ^artere, II.
ait a, 4. dans le larynx ou Toefophage. Ihd. St XI. 4=3-
1 , 4. Deux efpeces de corps étrangers : de
1 vrvi. v it 4. 744. a. Différentes opéranons quils exigent . I elles font expliquées aux articles Bronchotomie, Ente- I rotomie, I r Îrese, G astro tom ie , Incision. Corps I étrangers évacués par l’urine. XVII. 313. <«•
C o r p s finorc, (Mufiq.) dans un infiniment. On ne doit
donner ee nom qu’à la partie de
même & fans laquefle il n’y auroit pomt de Ton .Suppl. 11.
6 C o r ’p s de voix .(Mafia.) degré de force
civü’i v i C o ^ des poëtes grecs & des poe.es launs.
^ C o r p s d, J. C. (Rcltgicnx du) ordre infliniè au commencement
du quatorzième (tocic. O n ^ o n i o r attribue
c !ung5!ne,ls flmnafé àun coros organilé & vivant;
Corpspolt‘W“ > Pe y n J fc ’eft un être moral qui
aune'volonté. HU. En moi eonfdle la vraie union dans un
roros politique. XVII. 385- 4. Sur les corps polmques, v»yr{
Etats , Sociétés , Économie politique.
c Z Î% \ om ^ ia l^ A om r à néccflidre pour former un
coros ou communauté. Pourvoi il ne P=ut s en fonner que
par lettres-patentes du prince auementenrègifoéexl . g I Corps de ville, leur ongme.III. 725. a. Obfervau
ce fujet. XVII. 280. a. . . . . * le civil. IV.
Corps de droit ; deux fortes, le canonique S le civu.
1 M Mmmm