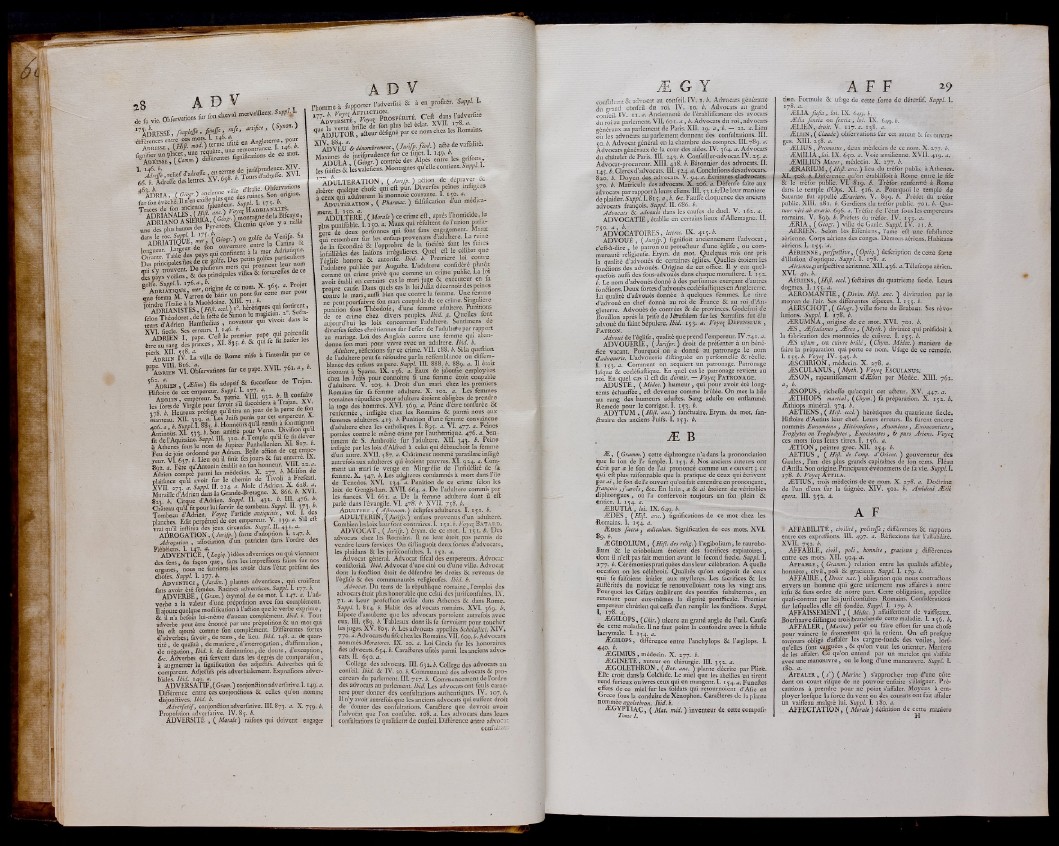
0 ADV èe fa vie. Obfervations fur fon
m b.
cheval merveilleux. Suppig
ttgMMR^artifice , (ty'«”»*) ADRESSE, i ü M m mf ‘
■, mots. 1. VSwp4*
».de *mo
./c, h ^’Italie. Obfervations FWjgwpii
dans le m B É II É ^ I r e t a l ou golfe de Venife. Sa
M ^ i É K entre la Canina &
lo n g u e u r . Largem^ conHnent à la mer Adrauque.
§ r Æ U ? e | o , f e . Des
X W < t e de ce
que forma M. Varron de batir un pont fur cette me p
être au rang des princes , XI. °3 5* “
piÎ D ™ ' R j Û ville de Rome mife à Vinterdit par ce
¡ h JK> VDObfervaûons fur ce pape. XVTI. |
^ A dm j» , (Æ it e ) fiU adoptif & fucceffeur de Trajan.
Hiftoire de cet empereur. Supp/. L 177. “■ confulte
A d r ien , empereur. Sa patrie. V fu . 93 ■ - î
les forts de Virgile pour favoir s il fuçcédera a Tra|an. XV.
,78 4 Heureux préfage qu’il tira un jour de la perte de fon
manteau XII. 319. e. Les Juifs punis par cet empereur. X.
406 a , 4. Stipph. 885. 4. Honneurs qu’il rendit à (on mignon
Antinous X t <33. 4. Son aminé pour Verus. Divifion qull
fit de l’Aquitaine. Suppl. lîl.3 10 . i.Jemp e quü
à Athènes fous le nom de Jupiter Panhellemen. XI. 7.
Feu de joie ordonné par Adrien.. Bçlle aétion de cet empereur.
VI. 637. b. Lieu où il finit fes jours & fut enterre. IX.
802. a. Fête qu’Antonin établit én fon honneur. VIIl.22._f.
Adrien compró parmi les médecins. X. 277- \h Mzjfon de
A D
l'homme à fcpportér l’adverfité & à en profiter. Suppl. I-
177. 4. Koyt^AFFUCTON. « | l’adverfite
^ A D V E v'biinombrm<nt,Vurifp,fioJ.) afte de vaffalité.
Ilpès emre les grifons ,
les fififo & t e valefiens. Montagnes qu eUe contient. Suppl.
'^ADULTÉRATION , ( Jurifp. ) aûion de depraver & . .
altérer quelque chofe qui eft pur. Diverfes peines infiigees
à ceux qui adultèrent la monnoie courante. I. t U a. .
A d u l t é r a t io n , ( Pharmac.) fàlfificauon dun médica-
'" " 'aD U lÎeR Ê , ( Morale ) ce crime eft, après l’homicide, le
plus puniffable. 1. 150. a. Maux qui rèfultent de l’union palla-
eere de deux perfonnes qui font fans engagement. Maux
qui retombent fur t e enfiujs provenais d’adultere. La ruine
de .la fécondité & l’opprobre de la focteté font les fuites
infaillibles des liaifons irrégulières. Quel eft le célibat que
l’èelife honore & autorife. Ibid. 4. Première loi contre
l’adultere publiée par Augufte. L’adultere confidéré plutôt
comme un crime privé que comme un crime public, La loi
avoit établi en certains cas le mari juge 8c exécuteur en la
propre caufe. Dans quels cas la loi Julia décernoit des peines
contre le mari, auiïi bien que contre la femme. Une femme
ne peut pourfuivre fon mari coupable de ce crime. Smguhere
punition fous Théodofe, d’une femme adultéré. Punitions
de ce crime chez divers peuples. Ibid. a. Quelles font
aujourd’hui les loix concernant l’adultere. Sentimens de
diverfes feâes chrétiennes fur l’effet de l’adulteie par rapport
au mariage. Loi des Anglois contre une femme qui abandonne
fon mari pour vivre avec un adultéré. Ibid. b.
Adultéré y réflexions fur ce crime. VII. 188. b. Si la queftion
de l’adultere peut fe réfoudre par la reffemblance ou diffem-
blançe des enfons au pere. Suppl. III. 888. b. 889. a. Il étoif
inconnu à Sparte. IX. 156. a. Eaux de jaloufie employées
chez les Juits pour connoître fi ime femme étoit coupable
d’adultere. V . 203. b. Droit d’un mari chez les premiers
Romains fur fa femme adultéré. X. 102. a. Les femmes
romaines répudiées pour adultéré étoient obligées de prendre
la toge des hommes. XVI. 369. a. Peine d’être tonfurée Sc
renfermée , infligée chez les Romains 8c parmi nous aux
femmes adultérés. 413. ¿.Punition d’une femme convaincue
d’adultere chez les catholiques. I. 895. a. VI. 477. a. Peines
portées contre le même crime par l’authentique. 476. a. Sen •.
timent de S. Ambroife fur l’adultere. XII. 343. b. Peine
infligée par les loix d’Alfred à celui qui débàuchoit la femme
d’un autre. XVII. 587. a. Châtiment nommé paratilme infligé
autrefois aux adultérés qui étoient pauvres. XI. 924. a. Comment
tin mari fe venge en Mingrélie de l’infidélité de fa
plaifance qu’a avoit fur le chemin de Tivoli à Fré ta i.
aV I I 273. a. Suppl. IL 214. a. Mole d Adrien. X. 620. a.
MuraÙle d’Adrien dans la Grande-Bretagne. X. 866. b. XVI.
$23. b. Çirque d’Adrien. Suppl. II. 431. b. UI. 476. b.
Château qu’a fit pour luifervir de tombeau. Suppl. 11. 373- b-
Tombeau d’Adrien. Voye[ l’article antiquités, vol. I. des
planches. Edit perpétuel de cet empereur. V. 139. a. bû eit
vrai qu’il inftitua des jeux circenfes. Suppl. II. 431. a.
ABROGATION, {Jurifp. ) forte d’adoption. L 147, b.
Adrogaiiori, affociation d’un patricien dans 1 ordre des
Plébéiens. L 147. a. . . .
ADVENTICE, (Logiq.) idées advennces ou qui viennent
des fens, de façon que, fans les impreflions faites fur nos
organes, nous ne (aurions.les avoir dans l’état préfent des
chofes. Suppl. I. 177- , , . -
A d v en t ice , ( Jardin. ) plantes adventices, qui croil.ent
fans avoir été femées. Racines adventices. Suppl. 1. 177. b.
ADVERBE, (Gram.) étymol. de ce mot. I. 147. a. L’adverbe
a la valeur d’une prépofition avec fon complément.
11 ajoute quelque modification à l’aftion que le verbe exprime,
& il n’a befoin lui-même d’aucun complément. Ibid. b. Tout
adverbe peut être énoncé par une prépofition & un mot qui
lui eft ajouté comme fon complément. Différentes fortes
d’adverbesj favoir, de tems, de lieu. Ibid. 148. a. de quantité
, de qualité , de maniéré, d’interrogation, d’affirmation ,
de négation, Ibid. b. de diminution, de doute, d’exception,
¿>c. Adverbes qui fervent dans les degrés de comparaifon,
4 augmenter la fignification des adjemfs. Adverbes qui fe
comparent. Adjeétifs pris adverbialement. Expreffions adverbiales.
Ibid. 149. a.
ADVERSATIF, {Gram.) conjonftionadverfative.1. 149. a.
Différence entre ces conjonctions & celles qu’on nomme
disjonétives. Ibid. b.
Adverfatif, conjonction adverfative. III. 873. a. X. 739. b.
Propofition adverfative. IV. 85. b.
ADVERSITÉ , ( Morale ) raifons qui doivent engager
femme. X. 547. b. Les~adujteres condamnés à mort dans l’ile
de Tenedos. XVI. 134. a. Punition de ce crime félon les
loix de Gcngis-kan. XVII. 664. a. De l’adultere commis par
les fiancés. VI. 661. a. De la femme adultéré dont il eft
parlé dans l’évangile. VI. 478. b. XVII. 758. b.
A d u lté r é , ( AJlronom. ) éclipfes adultérés. I. 151. b.
ADULTERIN, {Jurifp.) enfans provenus d’un adultéré.
Combien les loix leur font contraires. I. 151 .b. Voye| B a ta rd ,
A D V Ô C A T , (Jurifp.). étvm. de ce mot. I. 151. b. Des
advocats chez les Romains. Il ne leur étoit. pas permis de
vendre leurs fervices. On diftinguoit deux fortes a’advocats,
les plaidans & les jurifconfultes. I. 152. a.
Advocat général. Advocat fifcal des empereurs. Advocar
confiftoriaL Ibid. Advocat d’une cité ou d’une ville. Advocat
dont la fonCtion étoit de défendre les droits & revenus de
l’èglife & des communautés religieufes. Ibid. b.
Advocat. Du tems de la république romaine, l’emploi des
advocats étoit plus honorable que celui des jurifconfultes. IX.
71. a. Leur profeffion avilie dans Athènes & dans Rome.
Suppl. I. 814. b. Habit des advocats romains. XVI. 369. ¿.
Eipece d’amulette que les advocats portoient autrefois avec
eux. III. 589. b. Tableaux dont ils fe fervoient pour toucher
les juges. XV. 8oj. b. Les advocats appellés Scholaflici. XIV,
770. a. Advocats au fifc chez les Romains.VII. 600. ¿.-Advocats
nommèsoMoratores. IX. 20. a. Loi Cincia fur lès honoraires
des advocats. 654. b. CaraCleres ufités parmi les anciens advo?
cats. II. 630. a.
Collège des advocats. III. 632. b. Collège des advocats au
confeil. Ibid. 8c IV. 20. b. Communauté des advocats & pro->
cureurs du parlement. III. 717. b. Commencement de l’ordre
des advocats au parlement. Ibid. Les advocats ont feuls caractère
pour donner des confultations authentiques. IV. 107. b.
Il n’y avoit autrefois que les anciens advocats qui euffent droit
de donner des confultations. Caraftere que devroit avoir
l’advocat que l’on confulte. 108. a. Les advocats dans leurs
confultations fe qualifient de confeil.Différence entre advocat
confultau:
Æ G Y A F F
confultant & advocat au confeil. IV. 1. b. Advocats généraux'
du grand c&nfeil du roi. IV. 10. b. Advocats au grand
confeil. IV. xi. a. Ancienneté de l’établiffement des avocats
du roi au parlement. VIL 601. a , b. Advocats du roi, advocats
généraux au parlement de Paris. XII. 19. a3 b. — 22. a. Lieu
où les advocats au parlement donnent des confultations. III.
50. b. Advocat général en la chambre des comptes. III. 789. a:
Advocats généraux de la cour des aides. IV. 364. a. Advocats
du châtelet de Paris. III. 243. b. Confeiller-advocat.IV. 23. a.
Advocat-procureur. XIII. 418. b. Bâtonnier des advocats. H.
143. b. Clercs d’advocats. U3. 324. a. Conclufions desadvocars.
820. b. Doyen des advocats. V. 04. a. Ecritures d’adyocats.
370. b. Matricule des advocats. X. 206. a. Défenfe faite aux
advocats par rapport à leurs diens. III. 33 i.érDe leur maniéré
de plaider. Suppl. 1. 813. a3 b. &c. Faillie éloquence des anciens
advocats françois. Suppl. H. 686. b.
Advocats & advoués dans les caufes de duel. V . 162. a.
ADVOCATIE , établie en certains lieux d’Allemagne. II.
' 'aD VOCATOIRES , lettres. IX. 413. b.
AD VOUÉ , (Jurifp.) fignifioit anciennement l’advocat,
c’eft-à-dire , le patron ou prote&eur d’une églife, ou communauté
religieufe. Etym. du mot. Quelques rois ont pris
la qualité d’advoués de certaines églifes. Quelles étoient les
fonctions des advoués. Origine de cet office. Il y eut quelquefois
auffi des fous-advoués dans chaque monaitere. I. 132.
I. Le nom d’advoués donné à des perfonnes exerçant d’autres
fondions. Deux fortes d’advoués eedéfiaftiques en Angleterre.
La qualité d’advoués donnée à quelques femmes. Le titre
d’advoué en chef donné au roi de France & au roi d’Angleterre.
Advoués de contrées 6c de provinces. Godcfroi de
Bouillon après la prife de Jêrufalem furies Sarrafins fut élu
advoué du faint Sépulcre. Ibid. 133. a. Voye^ D éfenseur ,
Pa t r o n . r*r
Advoué de l’églife, qualité que prend 1 empereur. IV.741. a.
ADVOUER1E , ( Jurifpr. ) droit de préfenter à un bénéfice
vacant. Pourquoi on a donné au patronage le nom
eSfadvouerie. L’advouerie diftinguée en perfonnelle 8c réelle.
I. 133. a. Comment on acquiert un patronage. Patronage
laïque 8c eedéfiaftique. En quel cas le patronage revient au
roi. En quel cas il eft dit dormir. — Voyeç Pa t r o n a g e .
ADU STE , ( Médec. ) humeur, qui pour avoir été long-
tems échauffée, eft devenue comme brûlée. On met la bile
au rang des humeurs aduftes. Sang adufte ou enflammé.
Remede pour le corriger. I. 133. b.
ADYTUM , (Hifi- une.) fan&uaire. Etym. du mot, fan-
jftuaire des anciens Juifs. I. 133. ¿.
Æ B
Æ , ( Gramm. ) cette diphtongue n’a dans la prononciation
ique le Ion de IV fimple. I. 133. b. Nos anciens auteurs ont
écrit par a le fon de Yai prononcé comme un e ouvert ; ce
qui eft plus raifonnable que la pratique de ceux qui écrivent
par ai, le fon de IV ouvert qu’on fait entendre en prononçant,
françois , j ’avois y 8cc. En latin, ce 8c ai étoient de véritables
diphtongues , où Va confervoit toujours un fon plein 8c
¡entier. 1. 134. a.
Æ BU T IA , loi. IX. 649. b.
ÆDES, (Hifi. anc.) lignifications de ce mot chez les
Romains. L 134. a.
JE d e s facra, adiculum. Signification de ces mots. XVI,
89* b.
ÆGIBOLIUM, (Hifi 1 des relig.) l’ægibolium, le taurobo-
Jium 8c le criobolium étoient des facrifices expiatoires,
dont il n’eft pas fait mention avant le" fécond fiecle, Suppl. L
.277. b. Cérémonies pratiquées dans leur célébration. A quelle
occafion on les célébroit. Qualités qu’on exigeoit de ceux
qui fe faifoient initier aux myfteres. Les facrifices 8c les
nuftérités du noviciat fe renouvelloient tous les vingt ans.
Pourquoi les Céfars établirent des pontifes fubalternes, en
retenant pour eux-mêmes la dignité pontificale. Premier
empereur chrétien qui cefla d’en remplir les fondions. Suppl.
I, 178. a.
ÆGILOPS, (Chir.) ulcere au grand angle de l’oeil. Caufe
de cette maladie. Il ne faut point la confondre avec la fiftule
lacrymale. I. .154. a.
Æ g il o p s , différence entre l’anchylops 8c l’ægilops. L
440. b.
ÆGIMIUS, médecin. X. 277. b.
ÆGINETE, auteur en chirurgie. III. 332. a.
ÆGOLETHRQN, (Bot. anc.j plante décrite par Plin'e.
Elle croît dans la Colchide. Le miel que les abeilles en tirent
rend furieux ou ivres ceux qui en mangent. I. 134. a. Funeftes
effets de ce miel fur les foldats qui retournoient d’Afie en
Grece fous la conduite de Xénophon. Cara&eres de la plante
nommée agolethron. Ibid. b.
ÆGYPTIAC , ( Mat, méd. ) inventeur de cette compofi-
Tome I,
tien. Formule 8c ufage de cette forte dé déterfif. Suppl. I.
178. *.
ÆLIA fufia y loi. IX. 649. b.
Ælia fentia ou fextia ÿ loi. IX. 649.6. ' ‘
ÆLIEN,^droit. V. 117. a. 138. a.
Æ l ie n , ( Claude) obfervations fur cet auteur 8c fes ouvrages.
XIII. 258. a.
ÆLIUS, Promotus, deux médecins de ce nom. X. 277. b.
ÆMILIA*A?/. IX. 630. a. Voie æmilienne. XVII. 419. a.
ÆMILIUS Macer, médecin. X. 277. b.
ÆRARIUM, ( Hifi. anc. ) lieu du tréfor public à Athènes.
XI. 5q8. A Différence qu’on établiftoità Rome entre le fifc
8c le tréfor public. VI. 819. b. Tréfor renfermé à Rome
dans le temple d’Ops. XI. 316. a. Pourquoi le temple de
Saturne fut-appcllé Ærarium. V. 899. b. Préfet du tréfor
public. XIII. 281. b. Gardiens du tréfor public. 701. b. Quatuor
viri ab otrario. 696. a. Tréfor de l ’état fous les empereurs
romains. V . 899. b. Préfets du tréfor. IV. 133. a.
ÆRIA, (Géogr. ) ville de Gaule. Suppl. IV. 11. b.
AÉRIEN. Selon les. Efféniëns, l’ame eft une fubftance
aérienne. Corps aériens des congés. Démons aériens. Habitans
aériens. I. 133. a.
A é r ie n n e , perfpeftive, ( Optiq. ) defeription de cette forte
d’illufion d’optique. Suppl. I. 178. a.
Aérienncy'Qerfpeôxve aérienne. XII. 436. tf.Télefcobe aérien.
XVI. 40. b.
A é r ie n s , (Hifi. eccl. ) feèlaires du quatrième fiede. Leurs
dogmes. I. 133. a.
AEROMANTIE, ( Divin. Hifi. anc. | divination par le
moyen de l’air. Ses différentes efpeces. I. 133. b.
A ERSCHOT, ( Géogr. ) ville forte du Brabant. Ses révolutions.
Suppl. I. 178. b.
ÆRUMNA, origine de ce mot. XVI. 701. b.
Æ S , Æfcul anus | Æres , ( Myth. ) divinité qui préfidoit à
la fabrication des monnoies de cuivre. I. 133. b.
ÆS uflumy ou cuivre brûléa (Chym. Médec.) maniéré de
faire la préparation qui porte ce nom. Ufage de ce remede.
I. 133. b. Voye{ IV. 343. b.
ÆSCHRION, médecin. X. 278. a.
ÆSCULANUS, (Myth.) Voyeç E s c u l à n u s .
ÆSON, rajeuniffement d’Ælon par Médée. XIII. 762.
à , b.
. ÆSOPUS, richeffe qu’acquit cet a&eur. XV. 447. a.
ÆTHIOPS martial, (Chym.) fa préparation. X. 132. b.
Æthiops minéral. 374. b.
AETTENS, ( Hifi. eccl.) hérétiques du quatrième fiecle.
Hiftoire d’Aetius leur chef Leurs erreurs. Us furent encore
nommés Eunoméens 3 Hètèroufiens, Anoméens , Exoucontiens 3
Troglytes ou Troglodytes , Exocionites , & purs Ariens. Voye£
ces mots fous leurs titres. I. 136. a.
Æ TIO N, peintre grec. XII. 234. b.
AETIUS , ( Hifi. de l'emp. d’OricnU ) gouverneur des
Gaules, l’un des plus grands capitaines de fon tems. Fléau
d’Attila.. Son origine. Principaux événemens de fa vie. Suppl. I.
178. b. Voyez A ttila. -
ÆTIUS, trois médecins de ce nom. X. 278. a. Doéirine
de l’un d’eux fur la faignée, XIV. 302. b. Amideni Ætii
opéra. HI. 352. 4.
A F
• AFFABILITÉ, civilité 3 politeffe ; différences 8c rapports
entre ces expreffions. III. 497. a. Réflexions fur l’affabilité.
XVII. 732. ¿L
AFFABLE, civil y poli, honnête , gracieux; différences
entre ces mots. XII. 904. a.
A f f a b l e , ( Gramm. ) relation entre les qualités affable -,
honnête ÿ civil, poli 8c gracieux. Suppl. I. 179. b.
AFFAIRE , (Droit nat.) obligation que nous contrarions
envers un homme qui gere utilement nos affaires à notre
infu.8c fans ordre de notre part. Cette obligation, appellée
quafi-contrat par les jurifconfultes Romains. ConfidérationS
fur lefquelles elle eft fondée. Suppl. I. 179. b.
AFFAISSEMENT ,‘ ( Médec. ) affaUTement de vaiffeaux.
Boerhaave diftingue trois branches de cette maladie. I. 136. b.
AFFALER, (Marine) pefer ou faire effort fur une chofe
pour vaincre le frottement qui la retient. On eft prefque
toujours obligé d’affaler les cargue-fonds des voiles, lorf-
qu’ellcs font cajguées , 8c qu’on veut les orienter; Manière
de les affaler. Ce qu’on entend par un matelot qui s’affale
avec une manoeuvre, ou le long d’une manoeuvre; Suppl. L
180. a.
A f f a l e r , ( j ’ ) (Marine) s’approcher trop d’une côte
dont on court rifque de ne pouvoir enfuite s’éloigner. Précautions
à prendre pour ne point s’affaler. Moyens à employer
lorfque la force du vent ou des courans ont fait affaler
un vaiffeau malgré lui. Suppl. I. 180. a.
A FFECTATION, ( Morale) définition de cette .maniéré