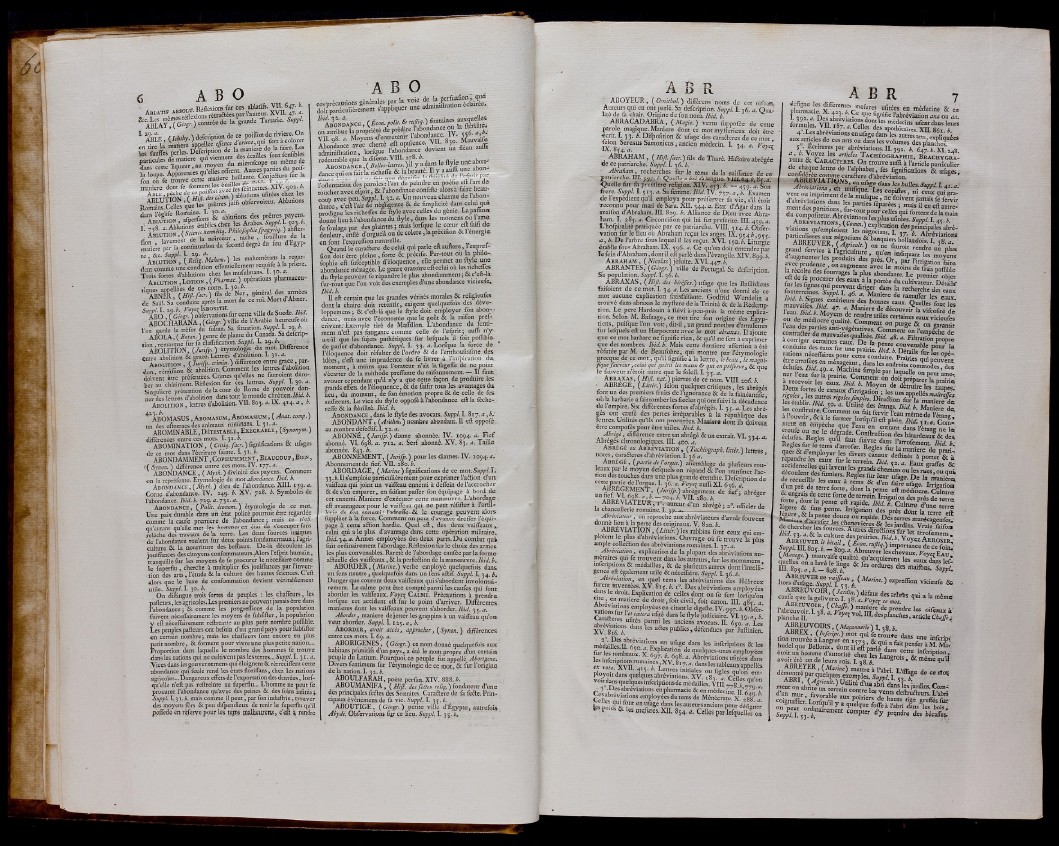
A B O
i) ¿flexions fur ces ablatifs. V U . 647*
A b l a t i f AB^ U; ? enf rS è e s par l’auteur. XVII. 47• B
&CÀ B U T ™ G * f t ) contrée de la grande Tartarie. Suppl.
1 Ï b lE { Ichthy.) defcription de ce poiflbnde riviere- On
| S | £ « H ¡ ¡ g « S I S Î S
les fautes perles.
particules de manere qui vi microfeope ou même de
ÿJSSsissS'Æï Æ S ^ ^ M b f e r v o l e n r . »
dans l'églife h R m B B S 'tb lu f io n s des prêtres payens.
S les A r a b e , V l , c s . i .
PMf°rWpisyr\i- ) a b f e
A blutio a noirceur , tache , fouillure de la
f e r e f e a » n £ f e n L fécond degré du feu d’Egyp-
^ Æ j S S s \ R ? li ( aMahm.) les mahométans la regardent
comme une condition effendellement reqmfe a la pnere.
Trris fortes d’abludons cher les mufulmans. I. 30.4.
A blut ion , L o tion , ( Phanmc. ) opérations pharmaceu-
,ïqM eU W / “ r.’¡ ¡ I de^Ner | général des armées
de SaüLSa condiue après la mort de ce ron Mort d Abner.
SUfABO obfetvanons fur cette ville de Suede. Ibid.
■ ABOCHARANA, (Gwgr.) ville de 1 Arabie heureufe ou
l'on garde le trèfor du fultan. Sa fimaoon. S u f f i . 20. b
ABOLA, (Botan. ) genre de plante du Canada. Sa defenp-
tion remarque fur fa claffification.-Supp/. L -
ABOLITION, {Jurifp. ) étymologie du mot. Différence
entre abolition & grâce. Lettres ¿abolition. L 31.4.
A ^ o u t io n , ( jurifp. crimm.) différence entre grâce pardon,
rémiffion & abolition. Comment les lettres dabohnon
doivent être prcfentêes. Crimes qu'elles ne faurotent dérober
au châtiment. Réflexion fur ces lettres. Suppl. I. 30. a.
Singulière prétendon de la cour dc Rome de pouvoir don-
ner des lettres d’abolidon dans tout le monde chréuen./Éid. b.
A b o l i t io n , lettres d’abolition. VU. 803. a. IX. 4.14. a , b.
4 î^BOMASUS, Abomasum, ÀBOMASIUM , ( Anat. comp. )
un des eftomacs des animaux ruminans. 1 . 31. a.
ABOMINABLE, D é t e s t a b l e , E x é c r a b l e , (Synonym.
différences entre ces mots. 1. 31. A . . _ .
ABOMINATION, ( Critiq. facr. ) fignifications & ufages
de ce mot dans l'écriture fainte. L 31. A _
ABONDAMMENT, C opieusement , B eaucou p , Bien
» ( Synon. ) différence entre ces mots. IV. 177. a.
ABONDANCE, ( Myth. ) divinité des payens. Comment
on la repréfente. Etymologie du mot abondance. Ibid. b.
A bo nd anc e , (Myth. ) dieu de l’abondance. XIII. 159. a.
Corne d’abondance. IV. 249. A XV. 728. b. Symboles de
l ’abondance. Ibid. b. 729. a. 731. a.
Abo n d a n c e , (Polit, économ.) étymologie de ce mot.
Une paix durable dans un état policé pourroit être regardée
comme la caufe première de l’abondance ; mais ce n'eü
qu’autant qu’elle mer les hommes en ¿ïat de s occuper fans
relâche des travaux de la terre. Les deux fources uniques
de l’abondance roulent fur deux points fondamentaux ^agriculture
8c la nourriture des befuaux. De-la^ découlent les
iouiffances des citoyens confommateurs. Alors l’efprit humain,
tranquille fur les moyens de fe procurer le néceflaire comme
le fuperflu, cherche à multiplier fes jouiffances par l’invention
des arts, l'étude & la culture des hautes fciences. C’eft
alors que le luxe de confommation devient véritablement
On di^ngue^ trois fortes de peuples : les chaffeurs, les
pafteurs, les agricoles. Les premiers ne peuvent jamais être dans
fabondance ; & comme les progreflions de la population
fuivent néceffairement les moyens de fubfifter, la population
Ïeft néceffairement reftreinte au plus petit nombre poflîble.
lêSKÎSSè?" flllS
VIL 98. a. Moyens d entretenir 1 abondance.$ ¿p BRRS Si i» mnf
Loftentarion des paroles d ’art de peindre en poéfie eftl’art de
toucher avec efprit, & l’abondance confifte alors à faire beau-
coup avec beu. Suppl. L 3 a. 4. Un nouveau charme de 1 abondance,
es peuples pafteurs ont befoin d’un grand pays pour fubfifter
en certain nombre; mais les chaffeurs font encore en plus
petit nombre, 8c forment pour vivre une plus petite nation....
Proportion dans laquelle le nombre des hommes fe trouve
dans les nations qui ne cultivent pas les terres... Suppl. I. 31 .a.
Vices dans lesgouvernemens qui éloignent 8c rétréci ffent cette
abondance qui feule rend les états floriffans, chez les nations
agricoles... Dangereux effets de l’exportation des denrées, lorf-
qu'elle n’eft pas reftreinte au fuperflu... L’homme ne peut fe
procurer l’abondance qu’avec des peines & des foins infinis;
Suppl. 1. 31 .b. mais comme il peut, par foninduftrie, trouver
•des moyens fiirs 8c peu difpendieux de tenir le fuperflu qu’il
ppffede en réferye pour les tems waljlfiuxetuc, c’eft 4 rendre
c’eft l’air de négligence & de fimplicité dansi celuiiqua
prodigue les richeffes de ftyle avec ceües du génie. La paihoi*
donne lieu h l’abondance du ftyle, dans les momens ou lame
fe foulage par des plantes ; mais lorfque le coeur eft; faifi de
douleur enflé d’orgueil ou de colere, la précifion & 1 énergie
en font l'Cxpreflion naturelle. . . . »
Quand le caraftere de celui qui parle eft auftere, 1 expref-
fion doit être pleine, forte & précife. Par-tout ou h philo-,
fophie eft fufceptible d’éloquence, elle permet au ftyle une
abondance ménagée. Le genre oratoire eft celui ou les richeffes
du ftyle peuvent fe répandre le plus abondamment; occ eit-la
fur-tout que l’on voit des exemples d’une abondance vicieufe*
Ibid. b. ÿ , « v • r
Il eft certain que les grandes vérités morales 8c religieules
dont la chaire doit retentir, exigent quelquefois des déve-
loppemens; & c’eft-là que le ftyle doit employer Ion abondance
, mais avec l’économie que le goût oc la raifon pref-
crivent.'Exemple tiré de Maiullon. L’abondànce du fenti-
ment n’eft pas. fatigante comme celle de l’efprit ; | aufli n’y
a-t-il que les fujets pathétiques fur leiquels il foit poflible.
de parler d’abondance. Suppl. I. 33. a. Lorfque la force de
l’éloquence doit réfulter de l’ordre & de l’enthoufiaiine des
idées, c’eft une imprudence de fe livrer à nnljpirarion du
moment, à moins que l’orateur n’ait lafageffe de ne point
s’écarter de la méthode preffante du raifonnement. — Il faut.
avouer cependant qu’il n’y a que cette façon de produire les
grands effets de l’éloquence, 8c de faifir tous les avantages du
lieu, du moment, de fon émotion propre & de celle de fes
auditeurs. Le vice du ftyle oppofè à l’abondance eft la féche-
reffe 8c la ftérilitè. Ibid. b.
A bo n d an c e , dans le ftyle des avocats. Suppl. I. 817. a , b:
ABONDANT, (Arithm.) nombre abondant.Il eft oppofè.
au nombre défeétif. L 3 2. a.
ABONNÉ, (Jurifp. ) dixme abonnée. IV. 1094. a. Fief
abonné. VI. 698. a. 712. a. Serf abonné. XV. 83. a. Taille
abonnée. 843. b.
ABONNEMENT, (Jurifp.) pour les dixmes. IV. 1094.fr.'
Abonnement de fief. VU. 280. b.
ABORDAGE, (Marine ) fignifications de ce mot. Suppl.I,'
33. A II s’emploie particulièrement pour exprimer l’aétion d’un
vaiffeau qui joint un vaiffeau ennemi à deffein de l’accrocher
8c de s’en emparer, en faifant paffer fon équipage à bord de
cet ennemi. Maniéré d’exécuter cette manoeuvre. L’abordage .
eft avantageux pour le vaiffeau qui ne peut réfifter à l’artti-
îfrî© de Conr ennemi-l’adreffe.8c_le courage peuvent alors
fuppléer à la force. Comment on peut d’avance dreffer l’équipage
à cette aétion hardie. Quel eft, des deux vaifleaux
celui qui a le plus d’avantage dans cette opération militaire.
Ibid. 34. a. Armes employées des deux parts. Du combat qu»
fuit ordinairement l’abordage. Réflexion fur le choix des armes
les plus convenables. Rareté de l’abordage caufée par la forme
a&uelle des vaiffeaux, 8c la perfeâion de la manoeuvre. Ibid» b.
ABORDER, (Marine.) verbe employé quelquefois dans
un fens neutre, quelquefois dans un lens aétif. Suppl. I. 34. b:
Danger que courent deux vaiffeaux qui s’abordent involontairement.
Le calme peut être compté parmi les caufes qui font
aborder les vaiffeaux. Voye[ C alme. Précautions à prendre
lorfque cet accident eft fur le point d’arriver. Différentes
maniérés dont les vaiffeaux peuvent s’aborder. Ibid. y$.a.
Aborder, maniéré dejetter les grappins à un vaiffeau qu’on-
veut aborder. Suppl. 1. 125. A
A b o r d e r , avoir accès, approcher, (Synon*) différences
entre ces mots. I. 6q. a.
ABORIGENES, ( Gcogr.) ce nom donné quelquefois aux '
habitons primitifs d’un pays, a été le nom propre a’un certain
peuple du Latium. Pourquoi ce peuple fiit appelle Aborigène.
Divers fentimens fur l’étymologie ae ce mot, 8c fur l'origine
de la nation. I.32. A
ABOULFARAH, poète perfan. X IV. 888. A
ABOUMANJFA, ( Hijl. des feSes relig.) fondateur d’une
des principales feâes des Sonnites. Cara&ere de fa fe&e. Principaux
événemens de fa vie. Suppl. I. 3 5. A
ABOUTIGE, ( Gcogr. ) petite ville d’Égypte, autrefois
Abyde, ObfcrYations fur ce Ueu. Suppl. I. 35. A
A B R
ABOYEUR, ( Omithol. ) différens noms de cet oifean.
Auteurs qui en ont parlé. Sa defeription. Suppl. I. 36, a. Qualité
de fa chair. Origine de fon nom. Ibid. A
ABRACADABRA, (Magie.) vertu fuppofée de cette
parole, magique. Maniéré dont ce mot myfterienx doit être
écrit. I. 33. A Difpofition 8c ufage des caraéteres de ce mot,
•ielon Sereuus Samomcus 3 ancien médecin. I, 34. a. Voyez
IX. 8 y . à. J v
, ABRAHAM, (Hijl./acr.) fils de Tharé. Hiftoire abrégée
de ce patriarche. Suppl. I. 36. A
I -d*™*™’ recherches fur le tems de la naiffance de ce
patnarchc. lu . Qucllo a ¿ ti /i/angue. XHLü^b, üe.a.
Quelle fut fa preifiiere religion. XIV. 473! m 439; * Son
frere. Suppl. I. 513. a. Sa femme. Ibid. IV. 737. a, A Examen
de l’expédient qu’il employa pour préferver fa vie, s’il étoit
Teconnu pour mari de Sara. XII. 344. a. État d’Agar dans la
inaifon d’Abraham. III. 829. A Alliance de Dieu avec Abraham.
I. 285. a. Circoncifion qui lui fut preferite. UI. 459. a.
L ’hofpitalité pratiquée par ce patriarche. VIII. 314. b. Observation
fur le lieu où Abraham reçut les anges. IX. 934 b^aee.
«z, A De l’arbre fous lequel il les reçut. XVL 150. A Liturgie
établie fous Abraham. IX. co6. a. Ce qu’on doit entendre par
le fein d’Abraham, dont il eft parlé dans l’évangile. XIV. 899. A
A b r a h a m , (Nicolas)jéiùite.XVI.447.b.
, ABRANTES, ( Géogr. ) ville de Portugal. Sa defeription.
Sa population. Suppl. L 36. A
ABRAXAS, (Hijl. des hcréjies.) ufage que les Bafilidiens
iaifoient de ce mot. I. 34. a. Les anciens n’ont donné de ce
mot aucune explication fatisfaifante. Godfrid Wendelin a
trouvé dans abraxas le myftere de la Trinité Sc de la Rédemption.
Le pere Hardouin a fuivi à-peu-près la même explication.
Selon M. Bafnage, ce mot tire ion origine des Egyptiens,
puifque l’on voit , dit-il, un grand nombre d’amulettes
fur lefquels eft un Harpocrate avec Te mot abraxas. Il ajoute
que ce mot barbare ne fignifie rien, 8c qu’il ne fert à exprimer
que des nombres. Ibid. A Mais cette derniere aflertion a été
Téfutée par M. de Beaufobre, qui montre par l’étymologie
grecque de ce mot, qu’il fignifie à la lettre, le beau , le magnifique
fauveur , celui qui guérit Us maux & qui enprcfcrve, 8c que
le fauveur n’étoit autre que le foleil. I. 3 ç. a.
A b r a x a s , ( Hijl. nat. ) pierres de ce nom. VIII. 206. A
• ABREGE, (Littér.) félon quelques critiques, les abrégés
font un des premiers fruits de l’ignorance 8c de la fainéantife -
où la barbarie a fait tomber les fiedes qui ont fuivi la décadence
de l’empire. Six différentes fortes d’abrégés. I. 3 e. a. Les abrégés
ont caufé des pertes irréparables à la république des
lettres. Utilités qu’ils ont procurées. Maniéré dont ils doivent
etre compofés pour être utiles. Ibid. A
Abrégé, différence entre un abrégé 8c un extrait. VI. 334. a.
Abrégés chronologiques. UI. 400. a.
A bré g é 0« A br é v ia t io n , (TacUcpaph. Iktir.') lettres
notes, caractères d’abréviation.I. 36 a.
| A br é g é , (partie de l'orgue.) affemblage de plufieurs rouleaux
par le moyen defquels on répand & l’on minfmet l’action
des touches dans une plus grande étendue. Defeription de
ce“ e1Pa«ie de l’orgue. I. 3 6. a. Voyez aufli XL. 616 a iSSil la d’m «■»¥> »• <*«
Abréviattur, on reproche aux abréviateurs d’avoir fouveut
donné lieu àlaperte des originaux. V . 8ao. i.
ABRÉVIATION, {Littér.) les rabbins font ceux qui emploient
le plus d abréviations. Ouvrage où fc trouve la plus
ample colleélion des abréviations romaines. I. 37. a.
■ Abréviation . explication de la plupart des abréviations numéraires
qui fe trouvent dans les auteurs, fur les monumens.
infcnptions & médailles , & de plufieurs autres dont rimeili-
gence eft également utile &néceffaire. Suppl. I. 36. b.
2 Abréviation, en quel tems les abréviations des Hébreux
f e “/ “ ' r 5’ S S S ’ b- 1°- Des abréviations employées
dans le droit. Expbcatron de eeUes dont on fe fert lorfqu’on
c ite, en matière de droit , foit civil, foit canon. HI. 48e. a
E S r a employées en citant le digefte. IV. 097. i.Obfer-
c f e e i « “r T " “ Ité, dans le Itylajudiciaire. V I .39.», b.
Caractères ufités parmi les anciens avocats. IL i t o a Les
X V ¿“ T 15 les publics, défendues par juftimen.
médtilks’ n f e f e 3 ?” u^age dans les inferiptions & les
* f e f V l î f e mr f X V -8l-7:■?’ ,dans kstab'eauxappellés
p l f e r d X e l f e a b LS o u nf e v . “ g f e d ë M
v °itdanS quelques mfcriptiûns de médallies. 'JlII 778 b
H •L>f s.aûréviations en pharmacie 8c en médecine. M h
Cell^ V-1/'tl0nS emPl°y^es Au tems de Ménécrate. X.
les b n â W i ” * en li Se dans auteurs anciens pour défiener
^ p ° « k & mcfures.XII, 854.4. Celles par le fq u e t fe n
ilMs “lïrcS'n.A B R
ïi’Æ-*“” « i . toa a Des a h r L ; „ r i „ L !l ^ labréviatton ana ou aa.
fotmute. VII..«87. - C e l t e d e s ' ^ e f e “ ^ ^ f e
‘•■*fecriturf s Par abréviations, n . 391. b. 647. ¿.XI lÜ &TAfer" r?'ACHÎOGRAPH'E' Buachygra- phie & CARACTERES. On trouve aufli à l’article particulier
r r j t qï e e 'alphabet, fes fignifications & ufages,'
¿ABRXVIA li“ re ’' ’abréviation. V
' I ’bm u v e r f
grand fervice à V Î g n k X i r é ^ f e L f e q f e l e T PlUS
d'augmenter les produits des p r k
fur l =f e 0CUr.er des eaux à la portée du c u l t i v a t f e b S
f e r k S S i - d ¿ i î f e e t i S f e ?
coCS e rdeCs f e f u r p r l ïX \ T i b d S ? 5 P0urJ a
rations néeeffaires pour cette conduite ’P r f e
etre arrofées en ménageant dans les peuvent,
éclufes. Ibid. an a Midi in« en“ ro‘“ Çommodes, des
ner l’eau l u r Î î Æ f e S S '
à recevoir les eaux Ibid h M« i j préparer la prairie;
wçaiKâ rmiÆrmæ IB§WÊ Bà lt accidentelles qui lavent les grands chr • ^r es ^
SÊ ¿fepeme eii sis m WMbhbb fe » B ^ , fans Penj e* Irngatu)n des prés dofft la terre eft
de chercher les foureeO - u t t e f e r a f e - f e 115' Vrai»
« p reffio,Vicieufe &
caufe que l a ^ H v m a l ^ 8 B. l f e f e ®„ f e s 9" ^ a i#lantèrne ^ planche II. roye^ voL IU. des planches, article ChaJJe,
A B R E x f e ^ ’■( 1 3*- f i
hudel que BeUorix, dont il S p » l ? d f e P f®
i s - jn z i s t
jSpk
tuent on d i r i i f e « ¿ E f e f e ïbri da” sf e ¡ardins. Com4
d’un mur, ftvOTabic aür ^ 2 loe Jve,;‘s deftruiteurs.L’abri
Sappi. 1. 53. b, compter d y prendre des bécafléç.