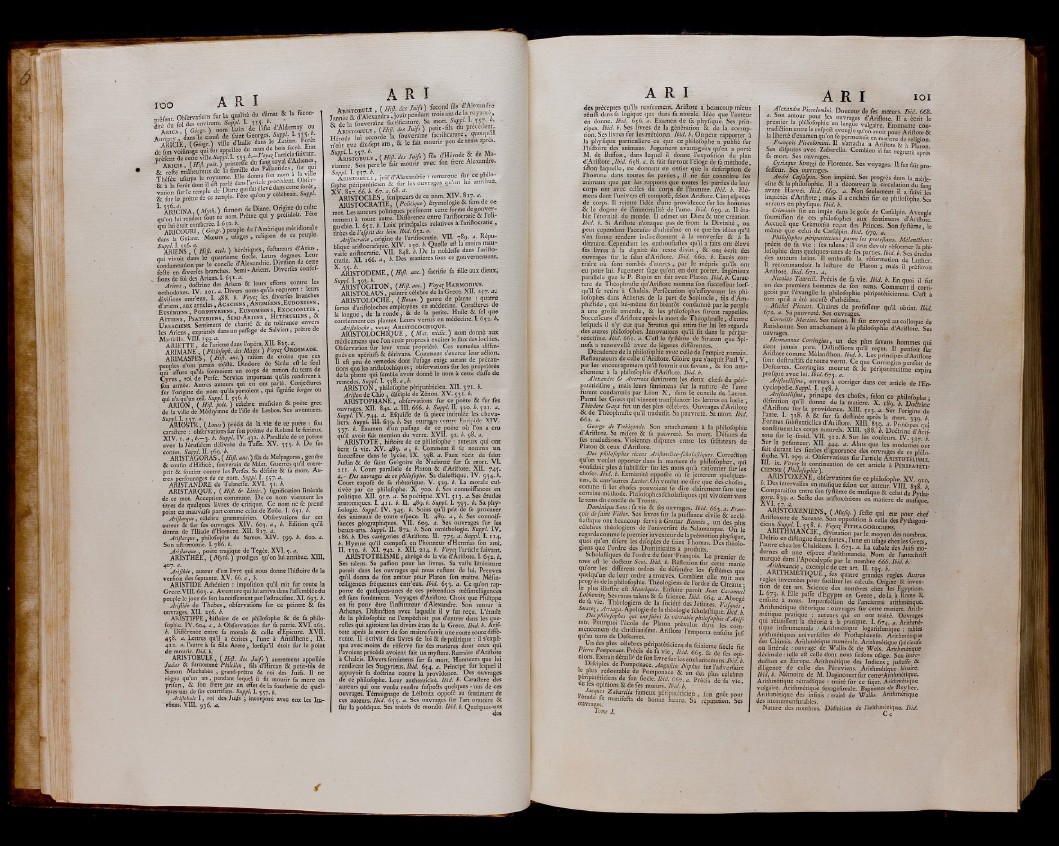
ioo A R I
préfent. Obfervations fur la qualité du Æraat & 1a
aisroPB M I i nÉÉd|&g|
& refte malheureux de la famille des Prilmudes|
Théfée ufurpa le royaume EUe ^ / ^ ¿ cédent. obfer-
& à la foret dont ll e^ P . fut ¿ievé dans cette foret,
^ l = UF é Â dr ^ l e . M A qu’on y célébrolr. Suppl.
L !iRTCINA, ( Myth. ) furnom de Diane. Origine du culte
quA“ d i . ¿US cenom. Frêne qui y prSfidou. Fête
^ARTCOURI.-O Ge'agr.) peuple de l’Amérique méridionale
dans la Guiane. Moeurs , ufeges , religion de ce peuple.
*îTr 1EN S6,' ( Hiß- ceci. ) hérétiques, feSatcurs d’A riu s ,
qui vivoit dans le quatrième fiecie. Leurs dogmes. Leur
condamnation par le concile ’d’Alexandrie. Divilîon de cette
fefte en diverfes branches. Semi - AnenS. Diverfes contef-
i fions de foi des Ariens. 1. 651. a' 1
Ariens „ doôrine des Ariens & leurs efforts contre les
orthodoxes. IV . 101. a. Divers noms cfu ils reçurent : leurs
jdivifions entr’eux. I. 488. 1 toym l « * v e r f o branches
d’ariens, aux articles, A c a c ien s , A n om é en s ,E u d o x ien s ,
Eu sébiens, P o rp h y r ie n s , Eunomeens , E x o c io n i te s ,
AÉTIENS, PSATYRIENS , SEMI-ARIENS , HÉTERUSIENS , &
ÜRSACIENS. Sentimens de charité & de tolérance envers
les Ariens, exprimés dans un paifage de Salvien, pretre de
Marfeille. VIIL i 39. a.
A R IE T T E d e l’ariette dans 1 opéra. A l l . 023. a.
ARIMANE, {Philofoph. des Mages ) Voyei OROSMADE.
AR1MASPES , {Hifl.ancA raifon de croire que ces
peuples n’ont jamais exifté. Diodore de Sicile eft le feul
o u i affure qu’ils formoient un corps de nation du tems de
fcyrus roi de Perfe. Service important qu’ils rendirent a
fon armée. Autres auteurs qui en ont parlé. Conjectures
fur l’origine du nom qu’ils portoient, qui fignifie borgne ou
quin’aqu’un oeil.$app£l. Ç56.A
ARION, ( Hifl.poét. ) célébré muficien & poete grec
de la ville de Méthymne de rifle de Lesbos. Ses aventures.
ST m o W e ' , {Louis) précis de la vie de ce poëte : fon
caraétere : obfervations fur fon poëme de Roland le furieux.
XIV. 1. a , ¿.—3. b. Suppl. IV. 432. ¿.Parallele de ce poëme
avec laJérufalem délivrée du Tafle. XV. 555. b. De fes
contes. Suppl. II. 569.'A , „ . . . ,
ARISTAGORAS, ( Hiß. anc.) fils de Melpagoras, gendre
& coufin d’Hifticé, fouverain de Milet. Guerres qu’il entre-
■ prit & foutint contre les Perfes. Sa défaite & fa mort. Autres
perfonnages de ce nom. Suppl. I. 5 ¿7. a.
ARISTANDRE de Telmefle. XVI. <1. b.
ARISTARQUE, ( Hiß. & Littér. ) lignification littérale
de ce mot. Accepdon commune. De ce nom viennent les
titres de quelques livres de critique. Ce nom ne fe prend
point en mauvaife part comme celui de Zoïle. T. 651. b.
Arißarque, célébré grammairien. Obferyatipns fur cet
auteur & fur fes ouvrages. XIV. 603. a , b. Edition qu’il
donna de l’Iliade d’Homere. XIL 817. a.
Arißarque, philofophe de Samos. XIV. 599. b. 600. a.
Son aftronomie. 1. 706. b.
Arißarque , poëte tragique de Tegée. XVL 5. a.
ARISTHÉE, ( Myth. ) prodiges qu’on lui attribue. XIII.
'407. a.
Ariflhée, auteur d’un livre qui nous donne l’hiftoire de la
verfion des feptante. XV. 66. a , b.
ARISTIDE Athénien : impofition qu’il mit fur toute la
Grece.VIII. 603. a. Aventure qui lui arriva dans l’aifembléedu
peuple le jour de fon banniflement par l’ofiracifme. XI. 693. b.
Ariflide de Thebesobfervations fur ce peintre & fes
ouvrages. XII. 256. b.
ARiSTÏPPE, 4iiftoire de ce philofophe & de fa philo-
fophie. IV. 604. a , b. Obfervations fur fa patrie. XVI. 263.
b. Différence entre fa morale & celle d’Epicure. XVII.
458. a. Lettres qu’il a écrites , l’une à Antiflhene, IX.
412. a. l’autre à la fille Arete, lorfqu’il étoit fur le point
de mourir. Ibid. b.
ARISTOBULE, ( Hiß. des Juifs ) autrement appellée
Judas & furnommè Philellen, fils dnircan & petit-nls de
Simon Machabée , grand-prêtre & roi des Juifs. Il ne
régna qu’un an, pendant lequel il fit mourir fa mere en
pnfoji, & fon frere par un effet de la fourberie de quelques
uns de fes courtifans. Suppl. 1. 3 3 7 . b.
Arißobulc I , roi des Juifs 3 incorporé avec cujc les Itu-
réens. VIII. 936. a.
A R I
ÄHISTOBDU , (Hifl. i ‘C Juifs) fils A H
Jannée & d’Alexandra , jomt pendant trois ans de la royaut.,
& de la fouveraine facrificature. Sa mon. Suppl M J 7- -
des Juifs) petit-fils du g ÿ èd L h t.
Hérode lui accorde la fouveraine faenficature, quoiqu il
ifeiit q u c dix-fept ans, & le fait mourir peu de tems après.
, (W d e s Juifs) fils d’Hérodc & de Ma
riamne. Son pere le feit mourir avec fon frere Alexandre.
Ä“Ä s T O B u i u , juif d’Alexandrie : remarque fur ce philofophe
péripatéticien & fur les ouvrages qu on lui attribue.
XV. 817. 66. i. 67. a. 68. a.
ARISTOCLÈS , fculpteurs de ce nom. A l y . 017-a-
ARISTOCRATIE, ( Politique) étymologie & fens de ce
mot. Les auteurs politiques préfèrent cette forme de gouvernement
à toute autre. DiKrence entre 1 anftocratie & 1 oh-
garchie. 1. 651. t. Loix principales relatives à 1 anftocratie ,
tirées d el’cfprit des lo'tx.Ibid. 651. a.
AMocralie, origine de l’anftocrane. VII. 789. a. République
ariftocratique. XIV. 150. *. Q u e lle eft la moinsmau-
vafle ariftocratie. VII. 848. i. De la noblefle dans lanfto-
cratie. XL 166. a , b. Des maniérés fous ce gouvernement,
X A&STODEME, (Hiß. une.) facrifie fa fille aux dieux,’
& 2 r IsÎ? )GITON , (Hiß. une.) Voye^ H a r m ODIUS.
ARISTOLAUS, peintre célébré de la Grece. Xlt. 157. ai
ARISTOLOCHE , (Boten. ) genre de plante S quatre
fortes d’ariftoloches employées en médecine Çarafteres de
la longue, de la ronde, & de la petite. Huile & fel que
contiennent ces plantes. Leurs vertus en médecine. I. 65a. b.
Arißoloche, voye^ ARISTOLOCHIQUE.
ARÜSTQLOCHIQUE, {Mat. médic.) nom donné aux
médicamens que l’on croit propres à exciter le flux des lochies.
Obfervation fur leur vraie propriété. Ces remedes dittin-
gués en apéritifs & dérivans. Comment s exerce leur aétion,
11 eft peu de remedes dont l’ufage exige autant de précautions
que les ariftolochiques ; obfervations fur les propriétés
de la plante qui femble avoir donné le nom à cette claffe de
remedes. Suppl. I. 338. a,b.
ARISTON, philofophe péripatéticien. X u . 371. b.
Ariflon de Chio, difciple de Zénon. XV. 331. b.
ARISTOPHANE, obfervations fur ce poëte & fur lès
ouvrages. XU. 842. a. III. 666. b. Suppl. II. 320. b. 321. a.
Suppl. IV. 744. a. Efquiffe de fa piece intitulée les chevaliers.
Suppl. III. 639. b. Ses outrages contre Euripide. X IV.
337. b. Examen d’un paffage de ce poëte où l’on a cru
' qu’il avoit fait mention du verre. XVII. 92. b. 98. a.
ARISTOTE, hiftoire de ce philofophe : auteurs qui ont
écrit fa vie. XV. 489. a , b. Comment il fe nomma un
fucceffeur dans le lycée. IX. 398. a. Faux récit de faint
Juftin & de faint Grégoire de Nazianze fur fa mort. VI.
211. b. Court parallele de Platon & d’Ariftote. XII. 743.
a. — Des ouvrages de ce philofophe. Sa dialeftique. IV. 034. b.
Court expofé de fa rhétorique. V. 529. b. La morale cultivée
par cè philofophe. X. 700. b. Ses connoiflances en
politique. XII. 917. a. Sa poétique. XVI. 313. a. Ses études
anatomiques. I. 411. b. II. 489.b. Suppl. I. 393. b. Sa phy-
fiologie. Suppl. IV. 343. b. Soins qu’il prit de fe procurer
des animaux de toute efpece. II. 489. a , b. Ses connoif-
fances géographiques. VII. 609. a. Ses ouvrages fur les
beaux-arts. Suppl. J3. 872. b. Son ornithologie. Suppl. IV .
186.b. Des catégories d’Ariftote. II. 773. a. Suppl. 1. 114.
b. Hymne qu’il compofa en l’honneur d’Hermias fon ami,
II. 139. b. XI. 742. b. XIL 214. b. Voyez l’article fuivant.
ARISTOTÉLISME, abrégé de la vie d’Ariftote. I. 632. b.
Ses talens. Sa pafiion pour les livres. Sa vafte littérature
paraît dans les ouvrages qui nous reftent de lui. Preuves
qu’il donna de fon ambur pour Platon fon maître. Méfin-
telligences fréquentes entr’eux. Ibid. 633. a. Ce qu’on rapporte
de quelques-unes de ces prétenaues méfintelligences
eft fans fondement. Voyages d'Àriftote. Choix que Philippe
en fit pour être l’inftituteur1 d’Alexandre. Son retour à
Athènes, Diftinftion avec laquelle il y fut reçu. L’étude
de la philofophie ne l’empêchoit pas d entrer dans les querelles
qui agiraient les divers états de la Grece. Ib'id. b. Arif-
tote après la mort de fon maître fuivit une route toute différente.
Il écrivit des livres de loi & de politique : il s’expliqua
avec moins de réferve fur des matières dont ceux qui
l’avoient précédé avoient fait un myftere. Retraite d’Ariftote
à Chalcis. Divers fentimens fur fa mort. Honneurs que lui
rendirent les Stagyriens. Ibid. 634. a. Principe fur lequel il
appuyoit fa doftrme contre la providence. Des ouvrages
de ce philofophe. Leur authenticité. Ibid. b. Caraftere des
’ auteurs qui ont voulu rendre fufpeôs quelques - uns de ces
ouvrages. Témoignage de Léibnitz oppofé au fentiment de
ces auteurs. Ibid. 633. a. Ses ouvrages fur l’art oratoire &
fut la poétique. Ses traités de morale. Ibid. b. Quelques-uns
4e*
A R I A R I 101
¿es préceptes qu’ils renferment. Ariftote a beaucoup mieux
réufti dans fa logique que dans fa morale. Idée que l’auteur
en donne. Ibid. 056. a. Examen de fa phyfique. Ses principes.
lbid. b. Ses livres de la génération & de la corruption.
Ses livres fur les météores. Ibid. b. On peut rapporter à
la phyfique particulière ce que ce philofophe a publié fur
Thiftoire des animaux. Jugement avantageux qu’en a porté
M. de fiuffon, dans lequel il donne l’expofition du plan
d’Ariftote, Ibid. 638. a. 6c fait fur-tout l’éloge de fa méthode,
félon laquelle, ne donnant en entier que la defeription de
l’hômme dans toutes fes parties, il ne fait çonnoitre les
animaux que . par les rapports que toutes les parties de leur
corps ont avec celles au coras de l’homme. Ibid. b. Elé-
mens dont l’univers eft compofé, félon Ariftote. Cinqefpeces
de corps. I l rejette l’idée a’une providence fur les nommes
6c lé dogme de l’immortalité de l’ame. Ibid. 639. a. Il établit
l’éternité du monde. Il admet un Dieu & une1 création'.
Ibid. b. Si Ariftote n’attaque pas de front la Divinité, on
peut cependant l’accufer d’atliéifme en ce que les idées qu’il
s’en forme tendent indirectement à la renverfer & à la
détruire. Cependant les enthoufiaftes qu’il a faits ont élevé
fes livres à la dignité du texte divin , & ont écrit des
ouvrages fur le falut d’Ariftote. Ibid. 660. b. Excès contraire
où font tombés d’autres, par le mépris qu’ils ont
eu pour lui. Jugement iàge qu’on en doit porter. Ingénieux
parallèle que le P. Rapin en fait avec Platon. Ibid. b. Caractère
de Théophrafte qu’Ariftote nomma fon fucceffeur lorfqu’il
fe retira à Chalcis. Perfécution qu’effuyerent les phi-
lofophes dans Athènes de la part de Sophocle, fils d’Am-
phiétide, qui lui-même fut bientôt condamné par le peuple
à une grofle amende, & les philofophes frirent rappellés.
Succefieurs d’Ariftote après la mort de Théophrafte,. d’entre
lefquels il n’y eut que Straton qui attira fur lui les regards
des autres philofophes. Innovations qu’il fit dans le péripa-
‘ téticifme. îbid. 661. a. C’eft le fyftême de Straton que opi-
nofa a renouvelle avec de légères différences.
Décadence de la philofophie avec celle de l’empire romain.
Reftaurateurs de celle d’Ariftote. Gloire que s’acquitPaul V ,
par les encouragemens qu’il fournit aux iavans, & fon atta->
chement à la philofophie d’Ariftote. Ibid. b.
Alexandre & Averroës devinrent les deux chefs du péri-
patéticifme , mais leurs fentimens fur la nature de l’ame
frirent condamnés par Léon X , dans le concile de-Latran.
Parmi les Grecs qui vinrent tranfplanter les lettrés en Italie,
Théodore Ga^a fut un des plus célébrés. Ouvrages d’Àriftote
& de Théophrafte qu’il traduifit. Sa pauvreté. Sa mort. Ibid.
662. a.
George de Trebiçonde. Son attachement à la philofophie
d’Ariftote. Sa mifere & fa pauvreté. Sa mort. Défauts de
fes traduirions. Violentes difputes entre les feôateurs de
Platon & ceux d’Ariftote.
Des philofophes récens Ariflotelico-fcholafliques. Correfrion j
qu’on voulut apporter dans la maniéré de philofopher, qui
confiftoit plus à fubtilifer fur les mots qu’à raifonner fur les
chofes. Ibid. b. Extrémité oppofée où fe jetterent quelqlies-
uns, & entr’autres Luther. On voulut ne dire que des chofes,
comme fi les chofes pouvoient fe dire clairement fans une
certaine mediode. Philofophes fcholaftiques qui vivoient vers
le tems du concile de Trente.
Dominique Soto : ia vie & fes ouvrages. Ibid. 663. a. François
de faint ViSor. Ses livres fur la puiftance civile & ecclé-
fiaftique ont beaucoup fervi à Grotius Bannis , un des plus
célébrés théologiens de l’univerfité de Salamanque. On le
regarde comme le premier inventeur de laprémotionphyfique
quoi qu’en difent les difciples de faint Thomas. Des théologiens
que l’ordre des Dominicains a produits.
Scholaftiques de l’ordre de faint'François. Le premier de
tous eft le dofteur Scot. Ibid. b. Réflexion fur cette manie
qu’ont les différens ordres de défendre les fyftêmes que
quelqu’un de leur ordre a trouvés. Combien elle nuit aux
progrès de la philofophie. Théologiens de l’ordre de Cîteâux *
le plus illuftre eft Manriqués. Enfuite paraît Jean Caramucl
Lobkomtç. Ses rares talens & fa fcierice. Ibid. 66a. a. Abreeé
ne fa vie. Théologiens de la fociété des Jéfuites. Vàfqués
Suare^ Aniaga Apologie de la théologie fcholàftiquê. & b
Des philosophes qui ontfuivi la véritable philofophie d'AriC->
me. Pourquoi l'école de Platon prévalut dais les com-
nicncemens du chriihanifme. Ariftote l'emporta enfuite iuf-
qu au tems de Defcartes. Jux
Un des plus célébrés péripatéticien? du feizieme fiecie fut
Pierre Pomponasc. Précis de fa vie , Ibid. 66t. & de fes ooi-
" 'n - r Mtr!U,t| n!1 d? fcnEvrefurlessnchantcmehs./Kd.b.
le K dC u?mS0nÛCe' W M Ê Nirhus Pudverfaire
néri^ ^ r d% P0,” P?,n.ace & un des P>“ s célébrés
I T S W P a !$ ion/ ,ecle- a s ««7- O. Précis dè fa vie,
<ie les opimons & de fes moeurs. Ibid. b. '
l'émdTS f?me,ux péripatéticien , fon goût pour
ouvrages mamfefla dc bonne >,eure- Sa réputation. Ses
Tome L ' ' -V -I
Alexandre Piecolomim. Douceur de fes moeurs. Ibid. 668.
a. Son amour pour les ouvrâgoe d’Ariftote. li a écrit le
J 1 P^ enen m k Etonnante con-
. 1 W i P p.e a ?Ve" la lftiené d examen qu on fe pesrmle ewttoitm en m*at pièoruer d Aer rieftloigtieo &n.
Français Piecolomim. D s’attacha à Ariftote & à Plïton
Ses difputes avec Zabarella. Combien il fut regretté aorès
fa mort. Ses ouvrages. F
Cyriaque Stroqfi de Florence. Ses voyages. Il fut feit pr0-
fefleur. Ses ouvrages.
André Cæfalpin. Son impiété. Ses progrès dans la médecine
& la phÜofophie. II a découvert la circulation du fane
avant Harvei. Ibid. 669. a. Non feulement il a fuivi les
impiétés d’Ariftote ; mais il a enchéri fur ce philofophe. Ses
erreurs en phyfique. Ibid. b.
Crémortin fut un impie dans le goût de Cæfalpin. Aveugle
foumiifion de ces philofophes aux fentimens d’Ariftote.
Accueil que Crémonin reçut des Princes. Son iyftême, le
même que celui de Cæfalpin. Ibid. 670. a.
Philofophes péripatéticiens parmi Us proteftans. Mélantlhon :
précis de fa vie : fes talens : il crut devoir réformer la philofophie
dans quelques-unes de fes parties. Ibid. b. Ses études
des auteurs latins. Il embrafle la réformation de Luther
Il recommandoit. la le&ure de Platon j mais il préférait
Ariftote. Ibid. 671. a.
Nicolas Taureill. Précis de fa vie. Ibid. b. En quoi il fut
un des premiers hommes de fon tems. Comment il corri-
geoit par l’évangile la- philofophie péripatéticienne. C ’eft à
tort qu il a été accufé d’athéifine.
Michel Piccart. Chaires de profeiïeur qu’il obtint Ibid.
• 072. a. Sa pauvreté. Ses ouvrages.
Corneille Martini. Ses talens. Il frit envoyé au colloque de
Katisbonne. Son attachement à la philofophie d’Ariftote. Ses
ouvrages.
Hermannus Coningius, un des plus favans hommes qui
aient jamais paru. Diftinélions qu’il reçut. Il penfoit lur
Ariftote comme Mélanfthon. Ibid. b. Les principes d’Ariftote
lont deftrumfs de toute vertu. Ce que Corringius penfoit de
encartes. Corringius mourut & le péripatéticiime expira
prefque avec lui. Ibid. 673. a.
Ariflotélifme, erreurs à corriger dans cet article de l ’Encyclopédie.
Suppl. I. 338. b.
AriflotéUfme principe des chofes, félon ce philofophe ;
j. a 3 donne de la matière. X. 189. b. Doftrine
d Ariftote fur la providence. Xffl. 313. Sur l’origine de
lame. I. 328. b. & fur fa deftinée après la mort. 330. b
Formes fubftantielles d’Ariftote. XUI. 839. a. Principe?qui
conftituent les corps naturels. XIII. 388. b. Doftrine d’Ariftote
fur le froid. VII. 312. b. Sur les couleurs. IV. 327. b.
Sur la pefanteur. XII. 444. a. Abus que les modernes ont
tait^durant les fiecles d’ignorance des ouvrages de ce philo-
lophe.VL 299. à. Obfervations fur l’article A ristotélisme
m . îx. Voyerla continuation de cet article à Péripatéticienne
{Phuofophie ).
ARISTOXENE, obfervatíonsfiurcephilofopiie. XV. 010
b. Des intervalles en mufique félon cet auteur. VIII 818. b
Comparai ion entre fon fyftême de mufique & celui de Pvrha'
g « . 839. a. Seile des ariftoxéniens en matière de mufique.
Armî^S'P<jXÉc Î I E N S fefte qui eut pour chef '
Arftloxene de Sarente. Son oppofitxon à ceUe des Pythagori-
ARÍTHM 4 a ^ .PlTHAGOMC'pNS.
, ’ dlYmanon parle moyen des nombres.
Delno en diftinmie deux fortes, l’une en ufage.chez les Grecs,
1 autre chez les Chaldéens. I. 673. u. La cabale des Juifs mo-
dernes eft une efpece d’arithmancle. Nom de l’antechrift
marqué dans 1 Apocalypfe par le nombre 666. Ibid. b.
« M l exemple de cet art. II. toc. b.
, ARITHMÉTIQUE, fes quatre granáés regles. Autres
reglçs inventées pour faciliter les calculs. Origine & invention
de cet art. Science des nombres chez les Egyptiens.
¿ 73’ , k Pa^® d’Egypte en Grece, de-là à Rome &
enfuite a nous. Imperfection de l ’ancienne arithmétique.
Arithmétique^ théorique : ouvrages fur cette matière.. Arithmétique
pratique : auteurs qui en ont traité. Ouvrages
qui réunifient la théorie à la pratique. L 674. a. Arithmétique
inftrumentale : Arithmétique logarithmique : tables
arithmétiques univerfelles dc Proftapharefe. Arithmétique
des Cliinois. Aridimétique numérale. Arithmétique ipécieufe
ou littérale : ouvrage de Wallis & de Wels. Arithmétique
décimale : telle eft celle dont nous fàifbns ufàge. Son intre-
dufrion en Europe. Arithmétique des Indiens ; juñeífe &
diligence de celle des Péruviens. Arithmétique binaire.
Ibid, b. Mémoire de M. Dagincourt fur cette-Arithmérique.
Aridiniétique tétraélique : traité fur ce fujet. Arithmétique
vulgaire. Arithmétique fexagéfimale. Baguettes de Reyher.
Arithmétique des infinis : traité de Wallis. Arithmétique
des incommenfurables.
Nature des nombres. Définition de l ’arithmétique. Ibid.
C e