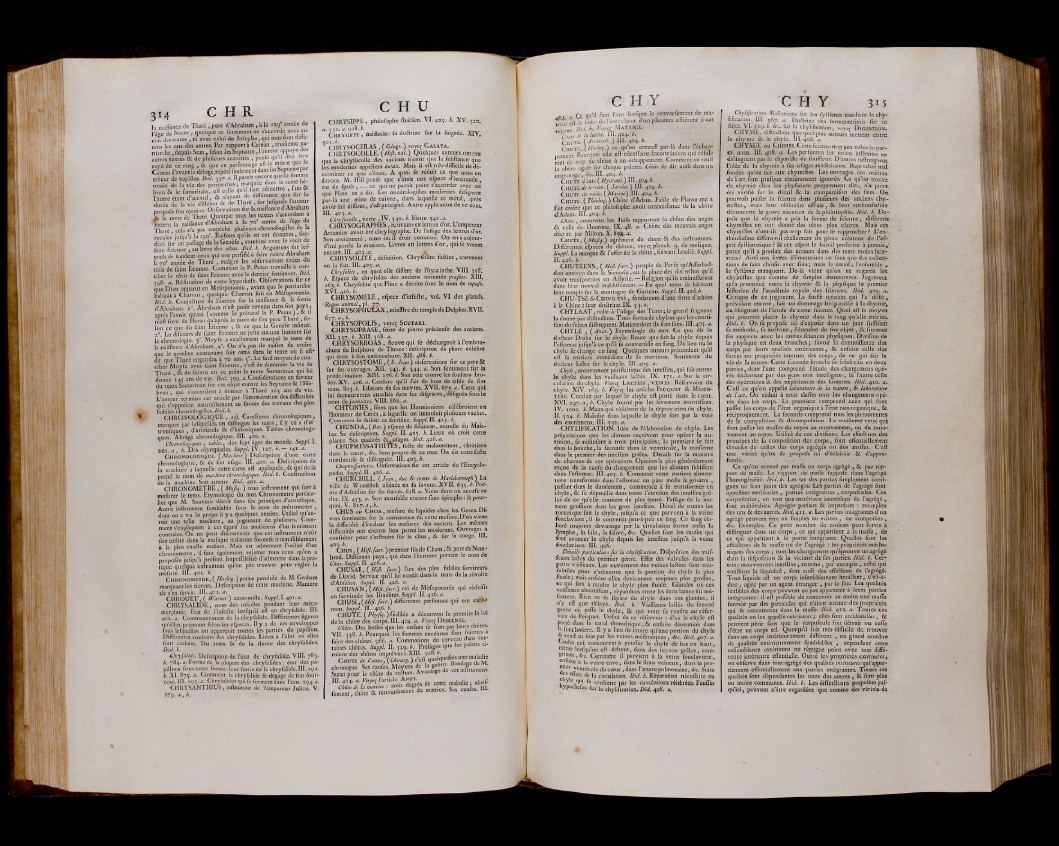
314 C H R
la naiflincc de Tharé , pore d'Abraham , à la 119* année de
l’âee de Nacor, quoique ce fentiment ne s’accorde avec aucun
des textes, ni avec celui «le Jofephc,qui tous font diffé-
rens les uns des autres. Par rapport à Caïnan , troifieme patriarche*
depuis Sem, félon IcsScptantc\ l'auteur appuyé des
autres textes & de pluficurs autorités , penfe q« «] doit ctre
rayé de ce rang , fcc que ce perfonnage cft le m g g jg *
Caïnan d’avant le déluge,répété feulement dans les ^ePta P
erreur de copiftcs. lbtd. ¡ f e Il paro.t
totale de la vie des patriarches, marmiée dans le texte ht
breu | le famaritain, eft celle q»’. I
l ’autre étant d’accord , & n’ayam de différence
durée de la vie d’Hébcr & de- Tharé , fur lcfqueU 1 auteur
propofe fon opinion. OJ.fem.dons fur la naiffancç d Abraham
L fa mon de Thari. Quoique tous les textes s accordent à
mettre la naiflancc d’Abraham à la 70 année de lâgc de
Tlnré cela n’a pas empêché pluficurs chronologies de la
reculer iufqu’à la 130'. Raifons-qu’ils en ont données , fondées
fur un pairage de laGcnèfc , combiné avec le récit de
faiht Etienne , au livre des a&cs. lbid. b. Argumens fur let-
«ucls fe fondent ceux qui ont perfiftéà faire naître Abraham
la 70e année de Tharé , malgré les obfervations tirées du
récit de faint Etienne. Comment le P. Petau travaille à concilier
le récit de faint Etienne avec le dernier fentiment./*/</.
308. ». Réfutation de cette hypothefe. Obfervations fur ce
que Dieu apparut en Méfopotamic , avant que le patriarche
Habitât à Charran , quoique Charran foit en Méfopotamie.
lbid. b. Conjc&urc de l’auteur fur la naiffancc 6c la lortie
d’Abraham. i°. Abraham n’eft point revenu dans fon pays,
après l’avoir quitté (comme le prétend le P. PetauKfccil
n’eft forti de Haran qu’après la mort de fon pere Tharé, ie-
lon ce que dit faint Etienne , 6c ce que la Gcnèfe mfinue.
a°. Le difeours de faint Etienne ne jette aucune lumière fur
la chronologie. 30. Moyfca exa&cment marqué le tems de
la naiffance d’Abraham. 4°- On n’a pas de raifon de croire
que le nombre centenaire foit omis dans le texte ou il eft*
dit que Tharé engendra à 70 ans. 30. Le foui moyen de concilier
Moyfe avec faint Etienne, c’cft de diminuer la vie de
Tharé , & de fuivre en ce point le texte Samaritain qui lui
donne 145 ans de vie. lbid. 199. ».Confidérations en faveur
du texte Samaritain fur cet objet contre les Septante & 1 Hébreu,
qui s’accordent à donner à Tharé 205 ans de vie.
L’auteur termine cet article par l’énumération des difficultés
qui s’oppofent naturellement au fuccès des travaux des plus
habiles cnronologiftcs./éid. b. I
CHRONOLOGIQUE , adj. Cara&crcs chronologiques,
marques par lefqucllcs on diftingue les tems ; il y en a d’af-
tromiques , d’artificiels 8c d’hiftoriques. Tables chronologiques.
Abrégé chronologique. III. 400. «i
Chronologiques , tables, des fept âges du monde. Suppl. L
201. a , b. Des olympiades. Suppl. IV. 127. b. — 141. a.
C h r o n o l o g iq u e . ( Machine ) Defcription d’une carte
chronologique, 8c de fon ufage. III. 400. a, Defcription de
la machine à laquelle cette carte cft appliquée, 6c qui dc-là
prend le nom de machine chronologique, lbid. b. Conftru&ion
de la machine. Son auteur. lbid. 401. a.
CHRONOMETRE, ( Mujîq. ) tout inftrument qui fort à
mefurer le tems. Etymologie du mot. Chronométré particulier
que M. Sauveur décrit dans fos principes d’acouflique.
Autre inftrument fomblable fous le nom de métrometre,
dont on a vu le projet il y a quelques années. Utilité qu’au-
roit une telle machine, au jugement de plufieurs. Comment
s’expliquent à cet égard les muficicns d’iin fentiment
contraire. On ne peut dijeonvenir que cet inftrument n’eût
fon utilité dans la mufique italienne loumifo irrémiffiblemcnt
à la plus exa&c mefurc. Mais en admettant l’utilité d’un
chronomètre, il faut également rejetter tous ceux qu’on a
propofés jufqu’à préfent. Impoffibilité d’admettre dans la pratique
quelque inftrument qu’on pût trouver pour régler la
mefurc. III. |ɧ| h.
C h r o n o m é t r é , (Uorloe.)petite pendule de M.Granam
marquant les tierces. Defcription de cette machine. Maniéré
de s en fervir. III. 40** a- . ,
CHROUET, (JVarner ) anatomifte. Suppl. 1.401.«*.
CHRYSALIDE, nom des infe&es pendant leur méta-
morphofo. Etat de l’infe&c lorfqu’il eft en chryfalidc. III.
402. a. Commencement de la chryfalidc. Différentes figures
qu’elles prennent félon les cfpeccs. Il y a de ces enveloppes
fous lefqucllcs on apperçoit toutes les parties du papillon.
Différentes couleurs des chryfalides. Lieux à l’abri où elles
font cachées. Du tems 8c de la durée des chryfalides.
lbid. b.
Chryfalidc. Defcription de l’état de chryfalidc. VIII. 783.
b. 784. a. Forme de la plupart des chryfalides : état des papillons
fous cette forme-.leur fortic de la chryfalidc. III. 292.
b. XI. 873. »• Comment la chryfalide fc dégage de fon fourreau.
III. 293. a. Chry falides qui fc forment dans l’eau. 294.0.
CHRYSANTHIUS, inftitutcur de l’empereur Julien. V.
»79. a , |
CHU CHRYSIPPE, philofophe ftoïcicn. VI. 425. b. XV. 320.
•a «32. a. 918. b.
Chrvsippe , médecin : fa doârine fur la faignée. XIV.
5°CHRYSOCERAS , ( Gtogr. ) voyn G a la t *.
CHRYSOCOLLE, (/fi/L nat.) Quelques auteurs ont cm
que la cbryfocolle des anciens n’étoit que la fubAance que
les modernes appellent borax. Mais il eft .très-difficile de déterminer
ce que c’étoit. A quoi fe réduit ce que nous en
•favons. M. Hill penfc que c étoit une efoece d’émeraude,
ou de fpath , . . . ce qui ne paroit point s accorder avec ce
que Pline en a dit. Les minéralogiftes modernes défignent
par-là une mine de cuivre, dans laquelle ce métal, après •
avoir été diffous, s’eft précipité. Autre application de ce nom.
111. 403. a.
Chryfocolle, verte , IV. 340. b. bleue. 341.0.
CIÎRYSOGRAPHES, écrivains en lettres d’or. L’empereur
Artémius avoit été chryfographe. De l’ufage des lettres d’or.
Son ancienneté, tems où il étoit commun. On en a aujourd’hui
perdu la manière. Livres en lettres d’or, qui fc voient
encore. III. 403.0. J r
CHRYS0 L1T E , définition. Chryfolite factice, comment
on la fait. III. 403. o.
Chryfolite , en quoi elle diffère de l’hyacintlie. VIII. 338.
b. Efpece de chryfolite des anciens nommée prafius. XIII.
263. b. Chryfolite que Pline a décrite fous le nom de topafe.
XVI. 4*6. b. g |
CHRYSOMELE, efpece d’infeâe, v o l VI des planch.
Regne animal, ph 77*
CHRYSOPHUlAX , miniftre du temple de Delphcs.XVII.
637. o, b.
CHRYSOPOLIS, voyei Scu ta ri.
CHRYSOPRASE, forte de pierre précieufo des anciens.
XII. 337. b. XIII. 368. a.
CHRYSORROAS , fleuve qui fe déchargeoit à l’embouchure
du Bofphore de Thrace : defcription du phare célébré
qui étoit à fon embouchure. XII. 488. b.
CHRYSOSTOME, ( S. Jean ) obfervations fur ce pere 8c
fur fos ouvrages. XII. 342. b. 344. o. Son fentiment fur la
prédeflination. XIII. 276. b. Son zele contre les fouliers brodés.
XV. 406. o. Ccnfure qu’il fait du luxe de table de fon
tems. 803. b. Editions de fos oeuvres. XVII. 673. o. Ceux qui
lui demeurèrent attachés dans fos difgraces, défignés fous le
nom dejoannites. VIII. 866. a.
* CHTONlES, fêtes que les Hcrmioniens célébroient en
l’honneur de Cérès, à laquelle on immoloit pluficurs vaches.
Comment fe faifoit ce facrifice. Suppl. II. 423. b.
CHUNDA, (Bot.) efpece de folanum, morelle du Malabar.
Sa defcription. Suppl. II. 423. b. Lieux où croît cette
plante. Ses qualités Sç^ufages. laid. 426. a.
CHUPMESSATHITES, feâe de mahométans, chrétiens
dans le coeur, &c. Sens propre de ce mot. On dit cette feâe
nombreufe 8c diftinguée. III. 403. b.
Chupmcjfathitcs. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 426. a.
CHURCHILL. ( Jean, duc M comte de Marleborough) La
ville de Woodftok aliénée en fa faveur. XVII. 633. b. Poème
d’Addiflbn fur fos fuccès. 618. a. Vices dont on accufe ce
duc. IX. 433. a. Son maufolée encore fans épitaphe : 6c pourquoi.
V. 817. », é. r»»
CHUS ou C hoà , mefure de liquides chez les Grecs. Divers
fentimens fur la contenance de cette mefure. D’où vient
la difficulté d’évaluer les mefures des anciens. Les mêmes
difficultés ont encore lieu parmi les modernes. Ouvrages à
confultcr pour s’inftruire fur le chus , 6c fur la congé, lu .
4 b m s , [Hifl. facr. ) premier fils.de Chain, & pere deNem-
brod. Différens pays, qui dans l’écriture portent le nom de
Chus. Suppl. II. 416. a. .
CHüSAI, ( Hifl. facr.) l’un des plus fidcles fervitcurs
de David. Service qu’il lui rendit dans le tems de la révolte
d’Abfalon. Suppl. II. 426. a. . '
CHUSAN, (Hifl. facr.) roi de Méfopotamie qui réduilit
en fervitude les Ifraélites. Suppl. II. 426. ».
CHUSI, ( Hifl. facr. ) différentes perfonnes qui ont cu?cc
nom. Suppl. II. 4^6. b. . • .
CHUTE. ( Phyftq. ) Galilée a découvert le premier la loi
delà chûte des corps. III. 404. ». JWrrDescente.
Chiite. Des boffes que les enfans fo font par leurs chûtes.
VII. 338. b. Pourquoi les femmes enceintes font fujettes à
faire des chûtes. 966. ». Commotions du cerveau dans certaines
chûtes. Suppl. II. 329. b. Préfagcs que les païens tiromm
des «bûtes imprévues. maladie
C hute de l’anus, ( Chtrurg. ) c eft quelques
chronioue. Ses caufes. Moyens de la guér ■ 1 . 15
Suret pour la chûte du reélum. Avantage de cet inftrument.
! ar.t*^roi^dce'rés Chfite de la matrice : trois aegrcs de ce. tte m_ aladie; .a btafiif-
renient, chûte 8c renverfement de matrice. Scs caufes. ffl.
C H Y
r c qu’il faut foire lorfqueje renverferticnt de ma- f
• la foits de l’extraftion d’un placenta adhérent à cet j
organe, lbid. b. Voyer Matrice.
l/uitede la luttte. \U 404. b.
C h u t e . (ArchitcEl. ) III. 404. b.
C h u t e , (Jlorlog.) ce qu on entend par-la dans léchap*
pement. Pourquoi elle eft néceffaire.Inconvéniens qui réful-
tent dc'trdp (le chûte à un échappement. Comment on rend
la chûte égale fur chaque palette. Chiite fe dit auffi dans un
engrenage, bc. III. 404.
C hute d'eau. (Hydraul.) III. 404s b.
C hute de terrein. ( Jardin. ) III. 404. b.
C hute de voile. ( Marine) III. 404. b.
C hute. ( Théolog. ) Chûte d’Adam. Fable de Platon oui a
fait croire que ce philofophe avoitconnoiffance delà chûte
d’Adam. III. 4° 4- b.
Chiite, comment les Juifs rapportent la chute des anges
& celle de l’homme. IX. 48. ». Chûte des mauvais anges
décrite, par Milton. X. 83*. ».
C hute , (Mufiq.) agrément du chant 8c des mftrumens.
Différentes efpeces de chûtes, voyeç planch. 9. de mufique.
Suppl. La marque 8c l’effet de la chûte, fuivant Loulié. Suppl.
II. 426. b. in. , ,
CHUTÉENS, ( Hifl.facr.) peuple de Perfe qu’Affarhad-
don envoya dans la Samarie,cn la place des dix tribus quil
avoit traniportées en Affyrie. — Religion qu’ils embrafferent
dans leur nouvel établiffement. — En quel tems ils bâtirent
leur temple fur la montagne de Garizim. Suppl. II. 426.b.
CHU-TSE 6* C hing-tsé , fondateurs d’une forte d’athées
à la Chine : leur doétrine. IX. 33. ».
CHYLAAT, robe à l’ufage des Turcs ; le grand feigneur
la donne par diftinélion. Trois fortes de chylaat que les courti-
fans du fultan distinguent. Maticre dont ils font faits. III. 403. ».
CHYLE , (Anat.) Etymologie du mot. Ce que dit le
dofteur Drake fur le chyle. Route que fuit le chyle depuis
l’eftomac jufqu’à ce qu’il fe convertille en fang. Du lieu ou le
chyle fe change en lang. Quelques auteurs prétendent qu’il
cft la maticre immédiate de la nutrition. Sentiment du
do&eur Lifter fur le chyle. III. 403. a.
Chyle, mouvement périftaltique des inteftins, qui fait entrer
le chyle dans les vaiffeaux la&és. IX. 171. ».Sur la circulation
du chyle. Voyc^ L actées , veines. Réfervoirs du
chyle. XIV. 169. b. Voye{ les articles Pecquet 8c Mésentère.
Conduit par lequel le chyle eft porté dans le coeur.
XVI. 297. », b. Chyle fourni par les lavemens nourriffans.
IV. 1001. ¿.Maux qui réfultentde la dépravation du chyle.
II. 304. b. Maladie dans laquelle le chyle fort par la voie
des excrémens. III. 391. ».
CHYLIFICATION. Idée de l’élaboration du chyle. Les
préparations que les alimens reçoivent pour opérer la nutrition
, fe réduifent à trois principales ; la première fe fait
dans la bouche, la féconde dans le ventricule, la troifieme
dans le premier des inteftins grêles. Détails fur la maniéré
de chacune de ces opérations. Opinion la plus généralement
reçue de la caufe du changement que les alimens fubiffent
dans l’eftomac. III. 403. b. Comment cette matière alimentaire
transformée dans l’eftomac en pâte molle 8c grisâtre ,
paffant dans le duodénum, commence à fe transformer en
chyle, 8c fe dépouille dans toute l’étendue des inteftins grêles
de ce qu’elle contient de plus épuré. Paffage de la matière
groffiere dans les gros inteftins. Détail de toutes les
routes que fuit le chyle, jufqu’à ce que parvenu à la veine
fouclavicrc, il fe convertit peu-à-peu en fang. Ce fane élaboré
toujours davantage par la circulation forme enfin la
lymphe, la bile, la fauve, 6*c. Quelles font les caufes qui
font avancer le chyle depuis les inteftins jufqu’à la veine
fouclavierc. III. 406.
DitaiLt particuliers fur la cliylification. Difpofition des vaif-
'féaux la&és du premier genre. Effet des valvules dans les
petits vaiffeaux. Les ouvertures des veines la&ées font très-
fubtiles pour n’admettre que la portion du chyle la plus
fluidemais enfuite elles deviennent toujours plus groiles,
<*.qu> fort à rendre le chyle plus fluide. Glandes où ces
vaiffeaux aboutiffent, répandues entre les deux lames du mé-
fentcrc. Rien ne fo fépare du chyle dans ces glandes, il
ny cft que délayé, lbid. b. Vaiffeaux la&és du fécond
genre où paffe le chyle, 8c qui vont fe rendre au réfer-
voir de Pecquet. Utilité de ce réfervoir : d’où le chyle eft
porté dans le canal thorachiquc, 8c enfuite déterminé dans
la fouclaviere. Il y a lieu de croire qu’une portion du chyle
fo rend au foie par les veines mcférafques, &c. lbid. 407. ».
Laufcs qui concourent à pouffer le chyle de bas en haut,
roème lorfqu’on eft debout, dans des tuyaux grêles, com-
pnmés, fi ‘c. Comment il parvient à la veine fouclaviere,
fe I à la veine-cave, dans le finus veineux, dans le pre-
™lCr ventricule du coeur, dans l’artere pulmonaire, &c. Suite
■es P p p de la circulation, lbid. b. Réparàtion néccffaire au
fe confume par les circulations réitérées. Fauffcs
ypothcfos fur la chylincation. lbid, 498, »,
C H Y 3 1 s
Chyltficaiiùn. Réflexions fur les fyftêmes toiiehant la chy-
lification. III. <67. tu Do&rine des fermentations fur ce
Îi. cliylification j voyer DIGESTION.
CHYMe., d’ftin&ion que quelques auteurs mettent entrô
le chyme oc le chyle, lu. 408. ».
CHYMIE ou Chimie. Cette fciencc trop peu cultivée parmi
nous. III. 408. •». Les perfonnes les moins inftruites ne
diftinguent pas le chymifte du fouffleur. D’autres reftreignenc
l ’idée de la chymie à fos ufages médicinaux. Reproches mal
fondés qu’on fait aux chymiiles. Les ouvrages des maîtres
de l’art font prefque entièrement ignorés. Ce qu’on trouve
de chymie chez les phyficiens proprement dits, n’a point
été vérifié fur le détail 6c la comparaifon des faits. On
pourroit puifer la fcience dans plufieurs des anciens chy-
miftes, mais leur obfcurité effraie, 6c leur cnthoufiafme
déconcerte le grave maintien de la philofophie. lbid. b. Depuis
que la chymie a pris la forme de fcience, différens
chymiftcs en ont donné des idées plus claires. Mais ces
chymiftes n’ont-ils pas trop fait pour fo rapprocher ? L’en-
thoufiafmc differc-t-il réellement du génie créateur de l’ef-
prit fyftématique ? & cet cfprit le faut-il proferire à jamais
parce qu’il a produit des erreurs dans des tems moins heur,
reux? Ainfi nos livfes élémentaires ne font que des collections
défaits choifis avec foin; mais le.noeud, l’enfemble ,
le fyftême manquent. De-là vient qu’on ne regarde les
chymiftes que comme de fimples manoeuvres. Jugement
qu’a jirononcè entre la chymie 8c la phyfique le premier,
niftorien .de l’académie royale des fcicnces. lbid. 409. ».
Critique de ce jugement. La fauffe opinion qui l’a ' di&é.,
prévalant encore, fait un dommage irréparable à la chymie,
en éloignant de l’étude de cette fcience. Quel eft le moyen
qui pourroit placer la chymie dans le rang qu’elle mérite*
lbid. b. Oh fe propofe ici d’expofer dans un jour fuffifant
fa méthode, fa doârine, l’étendue de fon objet, 6c fur-tout
fos rapports avec les autres fciences phyfiques. Divifion de
la phylique en deux branches; favoir la connoiffance des
corps par leurs qualités extérieures, 6c enfuite celle des
forces ou propriétés internes des corps, de ce qui fait la
vie de la nature. Cette fccondc branche fe fubdiyifo en deux
parties, dont l’une comprend l’étude des changcmens opérés
feulement par des gens non intclligens, 6c l’autre celle
des opérations 6c des expériences des hommes, lbid. 410. ».
C’eft ce qu’on appelle laboratoire de la nature, fi* laboratoire
de l’art. On réduit à trois claffes tous les changemens opérés
dans les corps. La première comprend ceux qui font
paffer les corps de l’état organique à l’état non organique, 8c
réciproquement. La fécondé comprend tous les phénomènes
de la compofition 6c décompofition. La troifieme 'ceux qui
font paffer les maffes du repos au mouvement, ou du mouvement
au repos. Utilité de ces divifions. Les affeâions des
O es de la compofition des corps, font effentiellemcnt
:s de celles des corps agrégés ou des maffes. C’cft:
une vérité qu’on fo propofe ici d’éclaircir 8c d’approfondir.
Ce qu’on entend par maffe ou corps agrégé , 8c par rapport
de maffe. Le rapport de- maffe fuppoie dans l’agrégé
l’homogénéité. lbid. b. Les tas des parties Amplement conti-
guës ne font point des agrégéSf'Les parties de l’agrégé font
appcllées molécules , parties intégrantes , corpùfcules. Ces
corpufculcs, en tant que-matériaux immédiats de l’agrégé ,
font inaltérables. Agrégés parfaits 8c imparfaits : exemples
des uns 8c des autres. lbid. 411. ». Les parties intégrantes d’un
agrégé peuvent être ou fimples ou mixtes , ou compofées ,
&c. Exemples. Ce petit nombre de notions peut fervir à
diftinguer dans Un corps , ce qui appartient à la maffe , de
ce qui appartient à la partie intégrante. Quelles font les
affections de la maffe ou de l’agrégé : les propriétés média-
niques des corps ; tous les:changcmens qu’éprouve un agrégé
dans la difpofition 8c la vicinité de fos parties. lbid. b. Certains
mouvemens inteftins, comme, par exemple, celui qui
conftituc la liquidité, font auffi des affe&iorts de l’agrégé.
Tout liquide eft un corps infenfiblement bouillant, ceft-à-
dire , agité par un agent étranger , par le feu. Les qualités
fonfibles des corps'peu vent ne pas appartenir à leurs parties
intégrantes : il eft poffible de concevoir au moins une' maffe
formée par des particules qui n’aient aucune des propriétés
qui fe rencontrent dans la maffe. lbid. 412. ». Tontes ces
qualités on les appelle extérieures ; elles font accidentelles, 8c
peuvent périr fans que le corpufcule foit détruit ou ceffe
d’être un corps tel. Quoiqu’il foit très-difficile de trouver
dans un corps intérieurement différent , un grand nombre
de qualités extérieurement femblablcs , cependant cette
reffcmblance extérieure ne répugne point , avec une différence
intérieure effentielle. Outre les propriétés extérieures.,
on obferve dans tout agrégé des qualités intérieures qui appar-
ticnnent effentiellcment aux. .parties intégrantes. Toutes ces
qualités font dépendantes les unes des autres, 8c font plus
ou moins communes. lbid. b. Les diftin&ions propofées juf-
qu’ici, peuvent n’être regardées que comme des vérités de