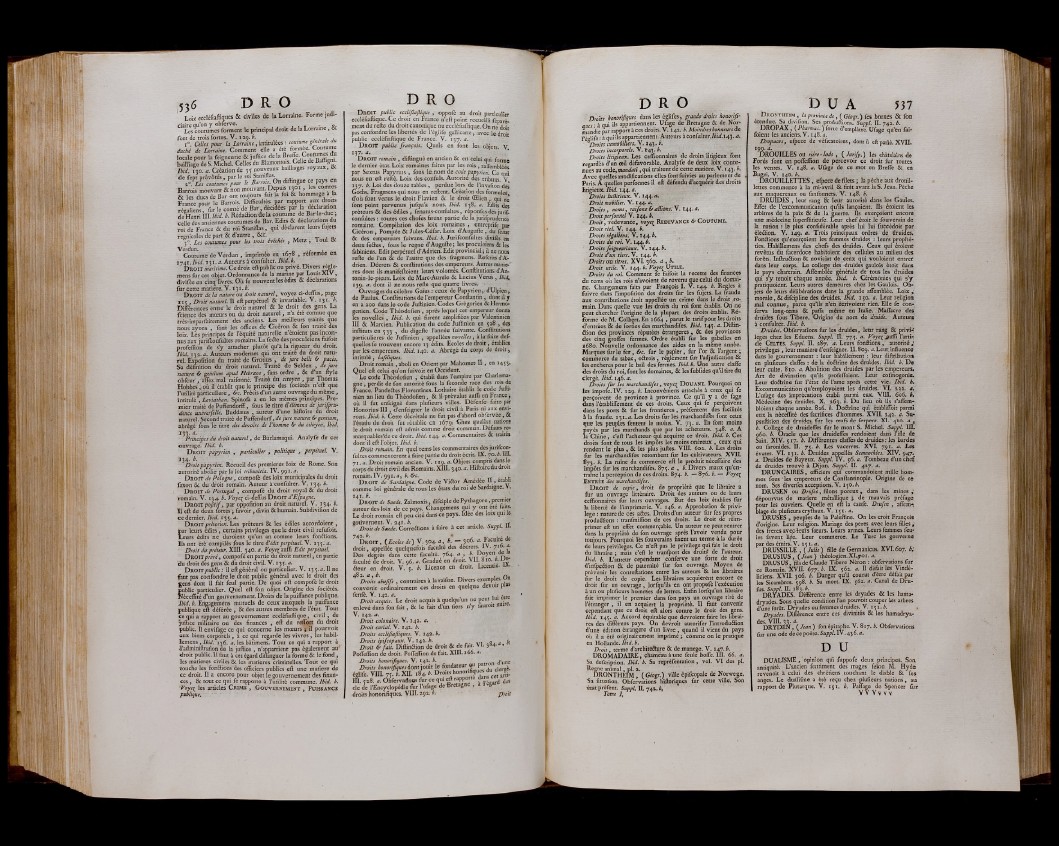
jj6 D R O
Loi* ccclilïaitiquet k civiles de 1a Lorraine. Forme ¡udì-
cisifc au’on y oblcrvc» t *
Les coutumes forment le principal droit de la Lorraine, oc.
font de trois fortes. V . 129. b. ,
1°. Celles pour la Lorraine ; intitulées : coutume générale du
duché de Lorraine. Comment elle a été formée. Coutume
locale pour la feigneurie & jùiliçe de la Brcffe. Coutumcs ihi
bailliage deS.Michel. Cellesdu Blamonro's Geile deBaffigm.
lbid. 130. a. Création de 35 nouveaux bailliages royaux, Ce
de fept prévôtés, par le roi Staniflas.
M M coutumes pour le Jurro./. On ddbngue Çep^sen
Barrois mouvant & non mouron!. Depuis 1301 les comtes
& les ducs de Bar ont toujours fait la foi oc hommage à la
France pour le Barrois. Difficultés par rapport aux droits
régaliens, furie comté de Bar, décidées par la déc arauon
de Henri III. ltid. b. Rédaâion dcla coutume de Bar-le-duc ;
celle des anciennes coutumes de Bar. Edits & déclarations du
roi de France & du roi Staniflas, qui déclarent leurs fujets
regnicoles de part 8c d’autre, '8c'c'. a.
Les coutumes pour les trou ¿Ucchés , Metz , Toul Oc
Verdun. ‘ , , a ,c x -
Coutume de Verdun , imprimée en 1678 , réformée en
1742.lbid. 131 .a. Auteurs à consulter, lbid. b. _
D ro it maritime. Ce droit eftpublic ou privé. Divers régle-
mens fur cet objet. Ordonnance de la marine par Louis X IV ,
divifée en rinqbVrcs. Où fe trouvent les ¿dits 8c déclarations
fur cette matière. V . 232. é. , „
D r o it de la nature ou droit naturila voyez ci-deiius, page
1 1 5 , Droit naturel. Il eftperpétuel & invariable. V. 131. b.
Différences entre le droit naturel & le droit des gens. La
fcience des moeurs ou du droit naturel, n t été connue que
très-imparfaitement des anciens. Les meilleurs traités que
nous ayons , font les offices de Cicéron 8c fon traité des
loi*. Les principes de l’équité naturelle n’étoient pas inconnus
aux jüriftonfuifes romains. La fede des proculeïens feifoit
profeffion de s’y attacher plutôt qu’à la rigueur du droit.
lbid. 13 a. a. Auteurs modernes qui ont traité du droit naturel.
Expofition du. traité de Grotius * de jure belli 6* pacis.
Sa définition du droit naturel. Traité de Selden , deiure
naturai & gehtïunt apud Hebrceos, fans ordre , 8c d’un ftyle
obfcur'/ âfTèz'mal raifonné. Traité du citoyen , par Thomas
Hobbes, où il établit que le principe des iociétés n’eft que
l’utilité particulière , &c. Précis d’un autre ouvrage du même,
intitulé , Leviathan. Spùiofa a eu les mêmes principes. Premier
traité dePuffendorff, fous le titre Silimens de jurijpru-
dence universelle. Buddæus , auteur d’une hiftoire du droit
naturel. Second traité de Puffendorf, de jure natura 8* gentium.
abrégé fous lé titre des devoirs de l’homme & du citoyen, lbid.
Principes du droit naturel, de Burlamaqui. Analyfe de cet
ouvrage. lbid. bj
D r o it papy rien , particulier , politique , perpétuel. V.
134. b.
Droitpàpyrien. Recueil des premierés loix de Rome. Son
autorité abolie par la loi tribunitia. IV. 991. a. 5
D ro it de Pologne, compofé des loix municipales du droit
faxon 8c du droit romain. Auteur à confulter. V . 134. b.
D ro it de Portugal , compofé du droit royal 8c du droit
romain. V. 134. b. Voye[ ci-aeffus D ro it d’EJpagne.
D r o i t pofitif, par oppofition au droit naturel. V .13 4 . b.
Il eft de deux fortes ; favoir, divin 8c humain. Subdivifion de
ce dernier. lbid. 13 5. a.
D ro it prétorien. Les préteurs 8c les édiles accordoient,
Îar leurs edits , certains privilèges que le droit civil refufoit.
Æurs ¿dits ne durOient qu’un an comme leurs fondions.
Ils ont été compilés fous le titre A’¿dit perpétuel. V . 135. a.
Droit du préteur. XIII. 340. a. Voye[ aulii Ed.it perpétuel.
D r o it privé, compofé en partie du droit naturel, en partie
du droit des gens 8c du droit civil. V. 1 3 ç. a.
D r o it public : il eft général ou particulier. V. 135. a. Il ne
faut pas confondre le droit public général avec le droit des
gens dont il fait feul partie. De quoi eft compofé le droit
public particulier. Quel eft fon objet. Origine des fociétés.
Néceflité d’un gouvernement Droits de la puiflance publique.
lbid. b. Ertgagemens mutuels de ceux auxquels la puiflance
publique eft déférée, 8c des autres membres de l’état Tout
ce qui a rapport au gouvernement eccléfiaftique, civil, de
juftice militaire ou des finances , eft du reflort du droit I
public. Il envifage ce qui concerne les moeurs il pourvoit
aux biens corporels, à ce qui regarde les vivres, les habil-
lemens, lbid. 13 6. a. les bâtimens. Tout ce qui a rapport à
Tadminiflration de la juftice, n’appartient pas également au
droit public. 11 faut à cet égard dimnguer la forme 8c le fond,
les matières civiles 8c les matières criminelles. Tout ce qui
touche les fonftions des officiers publics eft une matière de
ce droit. Il a encore pour objet le gouvernement des finances
, 8c tout ce qui fe rapporte à l’utilité commune, lbid. b.
'Voye[ les articles C rime , G ouvernement , Puissance
publique.
D R O
D r o i t public eccléfiaftique, oppofé au droit particulier
eccléfiaftique. Ce droit en France n’eft point recueilli féparè-
ment du refte du droit canonique ou eccléfiaftique; On ne doit
pas confondre les libertés de i’églife gallicane, avec le droit
public eccléfiaftique de France. V. 137. a.
D r o i t public françois. Quels en font les objets. V.
237. a.
D r o i t romain , diftingué en ancien 8c en celui qui forme
le dernier état. Loix romaines faites par les rois, raflembléés
par Sextus Papyrius , fous le. nom de code paoyricn. Ce qui
nous en eft refté. Loix des confuls. Autorité dès tribuns. V.
137. b. Loi des douze tables, perdue lors de l’invafion des
Goths. Fragmens qui nous en reftent. Création des formules
d’où font venus le droit Flavicn 8c le droit GElieti, qui ne
font point parvenus jufqu’à nous. lbid. 138. a. Edits des
préteurs 8c des édiles, fenatus-confultes, réponfes dés jurif.
1 confukes : toutes ces chofes firent partie de la jurifprudencé
romaine. Compilation des loix romaines , entreprife par
Cicéron, Pompée 8c Jules-Céfar. Loix d’Auguftc, du fénat
8c des empereurs fuivans. lbid. b. Jurifconfultes divifés en
deux fefles, fous le regne d’Augufte; les proculeïens 8c les
fabiniens. Editperpétuel d’Adrien. Edit provincial ; il ne nous
refte de l’un 8c de l’autre que des fragmens. Refcrits d’Adrien.
Décrets 8c conftitutions des empereurs. Autres manie*'
res dont ils manifeftoient leurs volontés. Conftitutions d'An?
tonin-le-pieux. Loix de Marc-Aurele 8c Lucius Verus, lbid,
139. a. dont il ne nous refte que quatre livres.
Ouvrages du célébré Gaïus: ceux de Pàpyrien, dUlpien,
de Paulus. Conftitutions de l’empereur Conftanrin, dont il y
en a 200 dans le code Juftinien. Codes Grégorien 8c Herrao-
genien. Code Théodofien, après lequel cet empereur donna
les novelles , lbid. b. qui furent amplifiées par Valentinien
III 8c Marcien. Publication du code Juftinien en p 8 , des
inftituts en 533 , du digefte l’année fuivante. Conftitutions
particulières de Juftinien , appellées novelles, à lu fuite def*
quelles fe trouvent encore 13 edits. Ecoles de droit, établies
par les empereurs. lbid. 140. a. Abrégé du corps de droit *
intitulé, bafiliques.
Droit romain, aboli en Orient par Mahomet I I , en 2453.
Quel eft celui qu’on fuivoit en Occident.
Le code Théodofien ,' établi dans l’empire par Charlema*
gne, perdit de fon autorité fous la fécondé race des rois de
France. Pandefles Florentines. Lothaire établit le code Juili-
nien an lieu du Théodofien, 8c il prévalut aufli en France j
où il fut enfeigné dans plufieurs villes. Défenfe- fait© par
Honorius I I I , d’enfeigner le droit civil à Paris ni aux entrons.
lbid. b. Cette décrétale ne fut pas d’abord obfcrvée, &
l’étude du droit fut rétablie en 1679. Chez quelles nations
le droit romain eft admis comme droit commun. Défauts re-
marquables’dc ce droit. lbid. 144. a. Commentaires 8c traités
dont il eft l’objet. lbid. b. _ .
Droit romain. En quel tems les commentaires des junfeon-
fultes commencèrent à faire partie du droit écrit. IX. 7°. é- ML
71. a. Droit romain ancien. V. 119. a. Objets compris dans le
corps de droit civil des Romains. XIII. 340. a. Hiftoire du droit
romain. IV. 991. a, b. &c. ..
D r o i t de Sardaigne. Code de Viftor Amédée 11, établi
comme loi générale de tous les états du roi de Sardaigne. V»
I4DROrrde Suide. Zalmoxis, difciple dePythagore.premier
auteur des loix de ce pays. Changemens qui y ont été faits.
Le droit romain eft peu cité dans ce pays. Idée des loix qui le
eoüvernent. V . 241. b. -r
Droit de Suede. Correâions à faire à cet arude. Suppl. il.
74DRC>1T, (Ecolesde) V. 304.a, 1 - 306- ->•Facnlt* I
droit, appellée quelquefois faculté des décrets. IV. 71 • •
Des degrés dans cette faculté. 764. a , b. Doyen de
faculté de droit. V. 96. a. Gradué en droit. VU. 810. .
fleur en droit. V. 5. b. Licence en droit. Licenné. ia.
48Dmisulufifs, contraires à la raifon. Divers exemples. On
convertit ordinairement ces droits en quelque devoir pm>
fenfé. V . 142. a. . .
Droit acquis. Le droit acquis à quelqu’un ne peut lui eu
enlevé dans fon fait, 8c le fait d’un tiers n’y iauroit nuir .
V. 142. a.
Droit colonaire. V. 142. a.
Droit curial. V. 142. b.
Droits eccléfiaftiques. V. 144. b.
Droits épifeopaux. V . 142. b. no. , fc
Droit & fait. Diftinflion de droit 8c de fait. VI. 3 4* » ,
Pofleflion de droit. Pofleflion de fait. XUI. 106. a.
Droits honorifiques. V. 142. b. »l’une
Droits honorifiques dont jouit le fondateur ou p -,
égliic. VIII. y y l XII. m *■ Droits 1honorffiques^du clerge
IEL eu», a. Obfervadons fur ce qui ril rappofit dm» ^
cle ae l’Encyclopédie fur l’ufàge de Bretag , ; H
droits honorifiques. VMI. 292;^ 1 pyoit
D R O D U A 537
Droits honorifiques dans les éelifes, grands droits honorifiques:
à qui ils appartiennent. Ulage de Bretagne 8c de Nor*
mandie par rapport à ces droits. V. 142. b. Moindres honneurs de
m m : à qui ils appartiennent. Auteurs à confulter.lbid. 143. a.
Droits immobiliers. V. 143. b.
Droits incorporels. V . Ï43. b. . , ^
Droits litigieux. Les ceuionnaires de droits litigieux font
regardés d’un mil défavorable. Analyfe de deux loix contenues
au code,mandati ,qui traitent de cette matière. V. 143. b.
Avec quelles modifications elles font fuivies au parlement de ,
Paris. A quelles perfonnes il eft défendu d’acquérir des droits
litigieux, lbid. 144. a.
Droits htflitieux. V. 144. a.
Droit mobilier. V. 144. a.
Droits , noms , rai fions & allions. V. 144. a.
Droit perfionnel V. X44. b.
Droit, red e van c e, voyet^ R e d e v a n c e 8» C o u tum e ,
Droit réel. V. 144. b.
Droits régaliens. V. 144. b.
Droits du roi. V. 144. b.
Droits fieigneuriaux. V. 244. b.
Droit d’un tiers. V. 144. b.
Droits ou titres. XVL 360. a , b.
Droit utile. V. 144. b. U t i l e .
Droits du roi. Comment fe faifoit la recette des finances
du tems où les rois n’avoient de revenu que celui du domaine.
Changemens faits par François I. V. 244. b. Réglés à
fuivre dans l’impofition des droits fur les fujets. La fraude
aux contributions étoit appellée un crime dans le droit Romain.
Dans quelle vue les droits du roi font établis. C)n né
peut chercher l’origine de la plupart des droits établis. Réforme
de M. Colbert. En 2664 , parut le tarif pour les droits
d’entrées 8c de forties des marchandifes. lbid. 143. a. Diftin-
flion des provinces réputées étrangères, 8c des provinces
des cinq grofles fermes. Ordre établi fur les gabelles en
1680. Nouvelle ordonnance des aides en la même année.
Marques furie fer, &c. fur le papier, fur l’or 8c l’argent ;
commerce du tabac, oftrois, règlement fut l’adjudication 8C
les enchères pour le bail des fermes. Ibid.b. Une autre dafle
des droits du roi, font les domaines, 8c les fubfides qu’il tire du
clergé, lbid. 14 6. a.
Droits fur les marchandifes, voye[ D o u a n e . Pourquoi^ on
les impofe.1V. 229. b. lnconvéniens attachés à ceux qui fe
perçoivent de province à province. Ce qu’il y a de fage
dans rétabliflement! de ces droits. Ceux qui fe perçoivent
dans les ports 8c fur les frontières, préfentent des facilités
à la fraude. 131 .a. Les droits fur les marchandifts font ceux
que les peuples fentent le moins. V. 73. a. Ils font moins
payés par les marchands que par les acheteurs. 348. a. A
la Chine, c’eft l’acheteur qui acquitte ce 'droit, lbid. b. Ces
droits font de tous les impôts les moins onéreux , ceux qui
rendent le plus , 8c les plus juftes. VIII. 602. b. Les droits
fur les marchandifes retombent fur les cultivateurs. XVH.
873. b. La ruine du commerce eft le produit néceflaire des
impôts fur les marchandifes. 875. a , b. Divers maux qu’entraine
la perception de ces droits. 874. b. — 876. b. — Voye[
E n t r é e des marchandifes.
D r o i t de copie, droit de propriété que le libraire a
fur un ouvrage littéraire. Droit des auteurs ou de leurs
ceffionnaires fur leurs ouvrages. But des loix établies fur
h liberté de l’imprimerie. V. 146. a. Approbation 8c privilège:
nature de ces afles. Droits d’un auteur fur fes propres
produâions : tranfmiflion de ces droits. Le droit de réimprimer
eft un effet commerçable. Un auteur ne peut rentrer
dans la propriété de fon ouvrage après l’avoir vendu pour
toujours. Pourquoi lès fouverains fixent un terme à la durée
de leurs privilèges. Ce n’eft pas le privilège qui fait le droit
du libraire ; mais c’eft le tranfport des droiti de l’auteur.
lbid. b. L’auteur cependant conferve une forte de droit
d’infpeftion 8c de paternité fur fon ouvrage. Moyen ^ de
prévenir les conteftations entre les auteurs 8t les libraires
fur le droit de copie. Les > libraires acquièrent encore ce
droit, fur un ouvrage, lûrfqu’ils en ont propofè l’exécution
à un ou plufieurs hommes de lettres. Enfin lorfqu’un libraire
fait imprimer le premier dans fon pays un ouvrage tiré de
l’étranger , il en acquiert la propriété. Il faut convenir
eepenaant que ce droit eft alors contre le droit des gens.
lbid. 145. a. Accord équitable'que devraient faire les libraires
des aifférens pays. On devrait autorifer l’introduftion
d’une édition étrangère d’un livre, quand il vient du pays
où il a été originairement imprimé ; cômme on le pratique
en Hollande, lbid. b.
Droit, terme d’archite&ure 8c de manege. V. 147. b.
DROMADAIRE, chameau à une feule boffe. lu . 66. a.
Sa defeription. lbid. b. Sa repréfentation, vol. VI des pl.
Regne animal, pl. 2.
DRONTHEIM, ( Géogr.) ville épifcopale de Norwege.
Sa fituation. Obfervations hiftoriques fur cette ville. Son
¿ut préfent. Suppl, U. 74a, é,
Tome I,
DRONTHEIM , la province de, (Géogr.) feS bôWéS 8c fon
étendue. Sa divifion. Ses produflions. Suppl. ïï. 742. b.
DROPAX, (Pharmac. ) forte d’emplâtre. Ufage qu’en fai-
foient les anciens. V. 148. a.
Dropaces, efpcce de véficatoires, dont il eft parlé. XVII.
^ROUILLES ou riére-lods , ( Jurifp.) les châtelains de
Forés font en pofleflion de percevoir ce droit fur toutes
les ventes. V. 148. a. Uûge de ce mot en Breffe 8c en
Bugei. V. 140. b.,
DROUILLETTES , eipece de filets ; la pêche àux drouil-
lettes commence à la mi-avril 8c finit avant la S. Jean. Pêche
aux maquereaux ou fanfonnets.' V. 148. b.
DRUIDES , leur rang 8c leur autorité dans les Gàules.
Effet de l’excommunication qu’ils lançoient. Ils étoient les
arbitres de la paix 8c de la guerre. Ils exerçoient encore
une médecine fuperftitieufe. Leur chef étoit,le fouverain de
la nation : le plus confidérable après lui lui füccédoit par
éleflion. V. 149. a. Trois principaux ordres de druides.
Ronflions qu’exerçoient les femmes druides : leurs prophéties.
Habillemens des chefs des druides. Ceux qui étoient
revêtus du facerdoce habitaient des cellules au milieu des
forêts. Inftruôion 8c noviciat de ceux qui vouloient entre*
dans leur corps. Le collège des druides gaulois étoit dans
le pays chartrain. Aflemblée générale de tous les druides
qui s’y tenoit chaque année, lbid. b. Cérémonies qui s’y
pratiquoient. Leurs autres démeures chez les Gaulois. Oo-
jets de leurs délibérations dahs la grande aflemblée. Loix
morale, 8c difdpline des druides. lbid. 150. a. Leur religion
mal connue, parce qix’ils n’en écrivoient rien. Elle fe con-
ferva long-tems 8c pafla même en Italie. Maflacre des
druides fous Tibere. Origine du nom de druide. Auteurs
à confulter. lbid. b.
Druides. Obfervations fiir les druides, lehr rang 8c privir
leges chez les Eduens. Suppl. II. 773. a. Voye^ juflî l’article
C e l t e s . Suppl. II. 287. a. Leurs fondions, autorité i
privilèges, leur maniéré d’enfeigner. II. 809. o. Leur, influence
dans le gouvernement : leur habillement : leur diftributioa
en plufieurs daffes : de la doflrine des druides, lbid. b. De
leur culte. 810. a. Abolition des druides par les empereurs.
Art de divination qu’ils profeflbient. Leur cofinogonie.
Leur doflrine fur l’état de l’ame après cette vie» lbid. b.
Excommunication qu’employoient les druides. VI. 222. a.
L’ufage des imprécations établi parmi eux. V11L 606. b.
Médecine des druides. X. 263. b. Du lieu où ils s’aflem-
bloient chaque année. 826. b. Doflrine qui établiffoit parmi
eux la nécelfité des facrifices d’hommes. XVU. 242. a. Su-
perftition des druides, fur les oeufs de feraent. XI. 410. a ,
b. Collège de druideffes fur le mont S. Michel. Suppl. III.
960. b. Oracle que les druidefles rendoient dans lifte de
Sain. XIV. 727. b. Différentes claffes de druides : les bardes
ou faronides. M. 75. b. Les vacerres. XVL 791. a. Les
évates. VI. 231. b. Druides appellés Semnothées. XIV. 947.
a. Druides de Bayeux. Suppl. TV. ç6. a. Tombeau d’un chef
de druides trouvé à Dijon. Suppl. II. 427. a.
DRUNCAIRES, officiers qui commandoient mille hommes
fous ' les empereurs de Conftantinople. Origine de ce
nom. Ses diverfes acceptions. V. 2 50. b.
DRUSEN ou Drufes, filons poreux, dans les mines
dépourvus de matière métallique ; de mauvais préfage
pour les ouvriers. Quelle en eft la caufe. Drufen , affem-
blage de plufieurs cryftaux. V. 231. a.
DRUSES , peuples de la Paleftine. On les croit François
d’origine. Leur religion. Mariage des peres avec leurs filles
des rreres avec4etirs foeurs. Leurs armes. Leurs femmes feules
favent li^e. Leur commerce. Le Turc les gouverne;
par des émirs. V. 252. a.
DRUSSILLE , (Julie ) fille de Germanicus. XVI. 607. bi
DRUSIUS, (Jean) théologien.XI..701. a.
DRUSUS, fils de Claude Tibere Néron : obfervations fur
ce Romain. XVII. 677. b. IX. 562. a. U défait les Vindé-
liciens. XVII. 306. b. Danger qu’il courut d’être défait par
les Sicambres. b. Sa mort. IX. $62. a. Canal de Dru-
fus. Suppl. M. 183. b.
DRYADES. Différence entre les dryades & les hama-
dryades. Sous quelle condition l’on pouvoit couper les arbres
d’une forêt. Dryades ou femmes druides. V . 131. b.
Dryades. Différence entre ces, divinités 8c les hamadrya-,
des. VnL 33. a.
DRYDEN, ( Jean ) fon épitaphe. V. 817. b. Obfervations
, fur une ode de ce poète. Suppl. 1V. 436. a.
D U
DUALISME, opinion qui fuppofe deux principes. Son
antiquité. L’ancien fentiment des mages félon M. Hyde
revenoit à celui des chrétiens touchant le diable 8c fes
anges. Le dualifme a été reçu chez -plufieurs nations, au
rapport de Plutarque. V. 252. b. Paffage de Spencer fur
y V V v v v