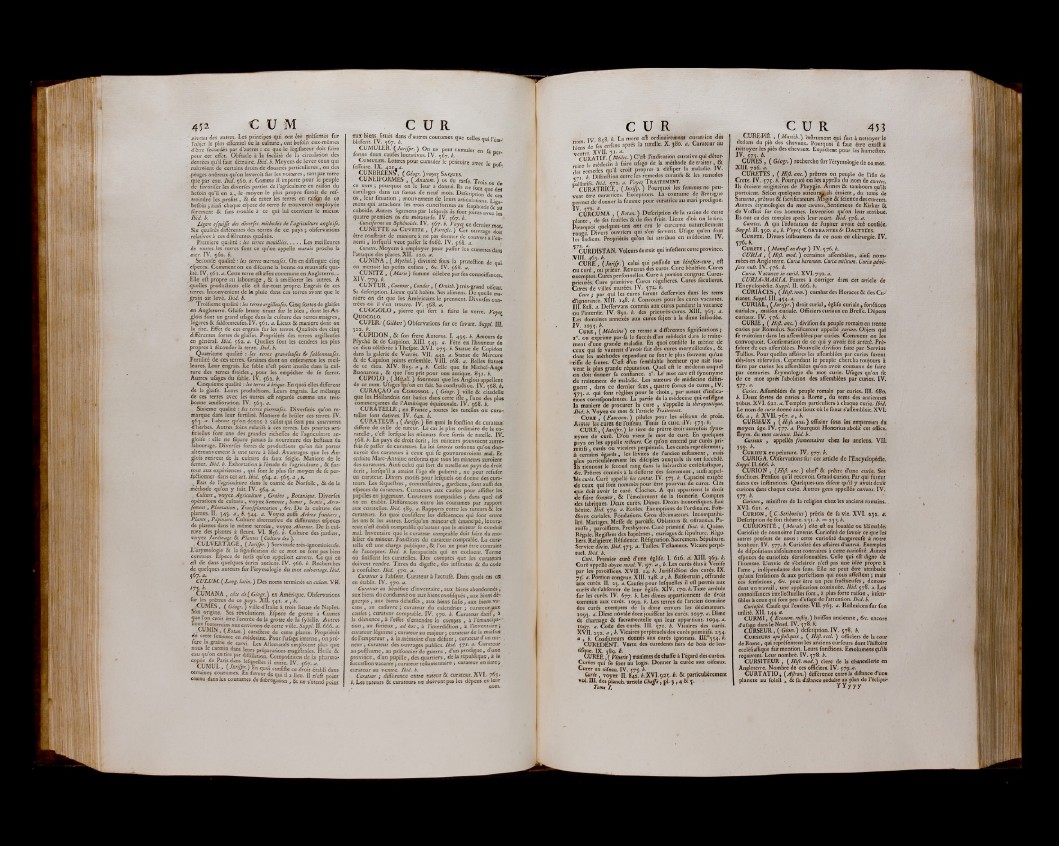
CÜM C U R
pivcau des autres. Les principes qui ont été préfentés fur
j’objet le plus effemiel de la culture, ont befoin eux-mémes
■d'être fécondes par d’autres : ce que le lceiflatcur doit faire
pour cet effet. Obitacle à la facilité de la circulation des
denrées qu’il faut détruire, lbid. b. Moyens de lever ceux qui
naiiroient de certains droits de-douanes particulières , ou des
péages onéreux qu’on leveroit fur les voitures , tant par terre
que par eau. lbid. 560. 4. Gomme il importe pour le peuple
de favorifer les diverfes parties de l’agriculture en raiion du
befoin qu’il en a,, le moyen le plus propre feroit de ref-
treindre les. profits, 8c de taxer les terres en raifçn de ce
befoin ; ainfi chaque efpece de terre fc trouveroit employée
furemenr 8c ûuis trouble à ce qui lui convient le mieux.
lbid. b.
Légère efquiffc des diverfes mithodes de l’agriculture angloife.
Six qualités différentes des terres de ce pays ; obfervations
relatives à ces différentes qualités.
Première qualité : les terres mouillées. . . . . Les meilleures
de toutes les terres font ce qu’on appelle marais proche la
mer. IV. 560. b.
Seconde qualité : les terres mameufes. On en diflingue cinq
efpeces. Comment on en difeerne la bonne ou mauvaife qualité.
IV. 561.4. Cette terre cft affez commune en Angleterre....
Elle cft propre au labourage , 8t à améliorer les autres. A
quelles produirons elle cil fur-tout propre. Engrais de ces
terres. Inconvénient de la pluie dans ces terres avant que le
j ’rain ait levé. lbid. b.
Troifieme qualité : Us terres argilleufes. Cinq fortes de glaifes
en Angleterre. Glaifc brune tirant fur le bleu, dont les An-
.glois font un grand ufâec dans la culture des terres maigres,
légères & fâblonncufês. IV. 561. a. Lieux & manière dont on
la tire. Effet de ces engrais fur les terres. Qualités des cinq
différentes fortes de glaifes. Propriétés des terres argilleufes
en général, lbid. 562. a. Quelles font les cendres les plus
propres â féconder la terre, lbid. b.
Quatrième qualité : les terres graveleufes O fablonneufes.
Fertilité de ces terres. Graines dont on ememence les meilleures.
Leur engrais. Le fable n’efl point inutile dans la culture
des terres froides, pour les empêcher -de fe ferrer.
Autres ufàges 'du fable. IV. 562. b.
, Cinquième qualité : Us terres à brique. En quoi elles différent
de la glaife. Leurs productions. Leurs engrais. Le mélange
de ces terres avec les autres eft regardé comme une très-
bon ne amélioration. IV. 563. a.
Sixième qualité : Us terres pierreufes. DiveWités qu’on remarque
dans leur fertilité. Maniéré de brûler ces terres. IV.
563. a. Labour qu’on donne à celles qui font peu couvertes
tfherbes. Autres foins relatifs à ces terres. Les prairies artificielles
font une des grandes richeffcs de l’agriculnire angloife
: elle ne iêparc jamais la nourriture des befliaux du
-labourage. Diverfes fortes de productions qu’on fait porter
alternativement i une terre à bled. Avantages que les Anal
ois retirent de la culture du faux feigle. Maniéré de le
temer. lbid. b. Exhortation à l’étude de 1 agriculture, 8c fur-
tout aux expériences, qui font le plus fur moyen de fc perfectionner
dans cet art. lbid. 564. a. 565. a , t>.
, Etat de l’agriculture dans le comté de Norfolk, & de la
-méthode qu’on y fuit. IV. 564. a.
, Culture, voyez Agriculture , Grains , Botanique. Diverfes
opérationsde culture-, voyez Semence t Semer , Semis, Arro-
fement, Plantation, Transplantation , ère. De la culture des
plantes. II. 343. a. b. 344, a. "Soyez aufli Arbres fruitiers ,
Plante, Pépinière. Culture alternative de différentes efpeces
de plantes dans le même terrein, voyez Alterner. De la culture
des plantes à fleurs. VL 856. b. Culture des jardins,
voyez Jardinage 8c Plantes ( CuUure des ).
. CULVERTAGE, ( Jurifpr. ) Servitude très-ienominieufe.
L’étymologie 8c la lignification de ce mot ne lont pas bien
connues. Efpece de ferfs qu’on appelloit cuve rts. Ce qui en
eft dit dans quelques écrits anciens. IV. 566. b. Recherches
de quelques auteurs fur ¡’étymologie du mot culvertage. lbid.
qfrj.a.
CULUM. (Lartg. latin.) Des noms terminés en culum. VH.
CUMANA , cote de (Géogr.) en Amérique. Obfervations
fur les prêtres de ce pays. XIL <41. a , b.
•CUMES | ( Géogr.) ville-d’Italie à trois lieues de Naples.
Son origine. Scs révolutions. Efpece de grotte à Cumes
que Ton croit être l’entrée delà grotte de la fybille. Autres
<mMrwrC/n* 3UXCnv‘rons de cette ville. Suppl. IL 6(6. a.
V.UM1N, ( Eotan. ) caradere de cette plante. Propriétés
de cette fenence en médecine. Pour l’ufâge interne, on préféré
-la graine de carvi. Les Allemands emploient plus que
nous le carmin dans Ici:,* préparations maullralcs. Huile &
ean qn on en rtre pa, dffllarfoi CnmpofniS. de la pharma-
, « cn.teïlV. ,67. a
CUMUL, ( Jun/pr.) En quoi tortille ce droit établi dans
«naine* courûmes, tn farenr de qui il a lieu. Il n'ert point
«mou dans les coutumes de ûtbregariou, & ne s’étend Liât
aux biens flttiés dans d’autres coutumes que celle« mi! iv. .
bliffenr. IV. 567. b. 4 C*
CUMULER. ( Jurifpr. ) On ne peut cumuler en fa ner.
fonne deux caufcs lucratives. IV. 567. é. 1
Cumuler. Lettres pour cumuler le pétiroirc avec le n,.r
lefloirc. IX. 421.4. “ *
CUNBRÉENy, {Géogr.)voyez Saques.
CUNEIFORMES , ( Anatom. ) os du tarfe. Trois o* d»
ce nom ; pourquoi on le leur a donné. Ils ne font aul,\f*
cartilages dans un foetus de neuf mois. Defeription de ce«
os, leur fituation ; mouvement de leurs articulations. Liea-
mens qoi attachent les trois cunéiformes au feaphoidc & au
cuboidc. Autres ligamens par lefqucls ils font joints avec les
quatre premiers os du métatarfe. IV. 567. b.
r u ï f u ™ SM noUt- IV* É É b: / m % dernier mot.
CUNETTE ou C u v e t t e , {Fortifie. ) Cet ouvrage doit
être confirait de manière à ne pas donner de converti l’ennemi
, lbrtqu’il veut paffcr le roffé. IV. 568. a.
Cunette. Moyens i employer pour paffcr les cuncttcsdans
l’attaque des places. XII. 120. a.
CÜNINA, ( Mythol.) divinité fous la protcâion de qui
on mettoit les petits cnfàns , Oc. IV. 568. a.
CUNITZ, (Marie) femme célébré par fes connoiffances.
XIV. 779. b.
CUNiUR , Contour, Condor, ( Ornith.) très-grand oifeau.
Sa defeription. Lieux qu’il habite. Scs alimem. De quelle ma-
nierc on dit que les Américains le prennent. Diverfes contrées
pli il s’en trouve. IV. 568. 4,
CUOGOLO , pierre qui fert i faire le verre. Voyez
Q u o c o lo . '
CUPER. (Gilbert ) Obfervations fur ce favant. Suppl. IIL
322. b.
CUPIDON, & (on frerc Anteros. I. 495. b. Amours de
Pfyché & de Cupidon. XIII. <43. 4. Féte en l'honneur de
ce dieu célébrée à Thcfpic. XVI. 275. b. Statue de Cupidon
dans la galerie de Serrés. VII. 442. a. Statue de Mercure
8c de Cupidon joints enfcmblc. VIIL 168. a. Belles flatues
de ce dieu. XIV. 825. a , b. Celle que fit Michcl-Ange
Buonarota , 8c que l’on prit pour une antique. 831. b.
CUPOLO , ( Métal!. ) fourneau que les Anglois appellent
de ce nom. Ufagcs qu’on en fait. Sa conflruâion. IV. 568. b.
CURAÇAO ou C o r o s s o l , ( Géogr. ) ville 8c citadelle
que les Hollandois ont bâties dans cette ifle , l’une des plus
commerçantes de l’Amérique équinoxalc. IV. <68. b.
CURATELLE ; en France, toutes les tutelles ou curatelles
font datives. IV. 642. b.
CURATEUR, ( Jurijp. ) En quoi la fonQion de curateur
différé de celle de tuteur. Le cas le plus ordinaire de la curatelle
, c’cfl lorfquc les mineurs font forns de tutelle. IV.
568. b. En pays de droit écrit, les mineurs pouvaient autrefois
fc palier de curateurs. La loi Uetoria ordonna qu’on donneront
des curateurs à ceux qui fc gouverneroient mal. Et
en fuite Marc-Antoinc ordonna que tous les mineurs auroient
des curateurs. Ainfi celui qui fort de tutelle en pays de droit
écrit, lorfqu’ii a atteint 1 âge de puberté, ne peut refufer
un curateur. Divers motifs pour Icfqueis on donne des curateurs.
Les féqucflres, commiffaires, gardiens, font auffi des
efpeces de curateurs. Curateurs aux caufcs pour afliflcr les
pupilles en jugement. Curateurs comptables ; dans quel ca*
on en établir. Différences entre les coutumes par rapport
aux curatelles, lbid. 589. 4, Rapports entre les tuteurs oc les
curateurs. En que« confiflent les différences qui font entre
les uns & les autres. Lorfqu’un mineur cil émancipé, ^curateur
n’cfl établi comptable qu’autant que le mineur fe conduit
mal. Inventaire que le curateur comptable doit faire du mobilier
du mineur. Fondions du curateur comptable. La curatelle
eft une charge publique, & l’on ne peut être contraint
de l’accepter, lbid. b. Incapacités qui en excluent. Terme
ou flniffem les curatelles. Des comptes que les curateurs
doivent rendre. Titres du digefte, des infiitutes 8c du code
â confulter. lbid. <70. 4.
Curateur i l’abfenr. Curateur i l’accufé. Dans quels cas 00-
en, é¿t.a..bc lii:t.. iIV\ ,r .
Curateur au bénéfice d’inventaire, aux biens abandonnés,
aux biens du condamné ou aux biens conflfqués, aux biens dé-,
guerpis, aux biens délaiflés, aux biens iâifis, aux biens va-
cans , au cadavre} curateur du calendrier ; curateur aux
caufcs curateur comptable. IV. 570. b. Curateur datif, i
la démence, k l’effet d’entendre le compte , â 1’émancipa-'
don , au furieux, ad hoc , â llnterdidion , à l’inventaire }
curateur légitime ; curateur au majeur ; curateur de la maifon
de l’empereur, k la mémoire d’un défunt ; curateur d’un mi- ,
neur ; curateur des ouvrages publics, lbid. 571. *• Curateur
au pofîhume, au prifonnier de guerre, d’un prodigue, d’une
province, d’un pupille, des quartiers, de la république, i la
fucceffion vacante ; curateur teflamentaire ; curateur en titre j
curateur au ventre, lbid. b.
Curateur i différence entre tuteur 8c curateur, XVL W '
b. Les tuteurs 8c curateurs ne doivent pas les dépens en leur
nom.
C U R
TV 8<8 é La mere eft ordinairement curatrice des
Mens de Vcs cnfàns après la tutelle. X. 380. ». Curateur au
yC'cVRATlE IMldec. ) Ccft l ’indication curative qui détermine
le médecin h faire ufage de la méthode de traiter g
des remèdes qu’il croit propres à difliper la maladie. IV.
b Diflinclion entre les remèdes curatifs & les remèdes
palliatifs, lbid. ¡m u. VoycFT r a i t e m e n t .
CURATRICE, ( ) Pourquoi les femmes ne peuvent
être curatrices. Exceptions. La coutume de Bretagne
permet de donner la femme pour curatrice au mari prodigue.
IV. 57®* et.
CURCUMA , ( Botan. ) Defeription de la racine de cette
plante, de fes feuilles & de fon fruit. Lieux d’où on le tire.
Pourquoi quelques-uns ont cru le curcuma naturellement
rouge. Divers ouvriers qui s’en fervent. Ufage qu en font
les Indiens. Propriétés qu’on lui attribue en médecine, IV.
*7CURDISTAN. Voleurs de nuit qui infeftent cette province.
.VICIIU. R46E3,. 1( J urifp.) celui qui pof~fe d1 e un bléjn éjafte e-cure , ctat
ou curé, ou prieur. Revenus des cures. Cure bénéfice. Cures
exemptes. Cures perfonncllcs. Cure ?i portion congrue. Cures-
prieurés. Cure primitive. Cures régulières. Cures fécuhercs.
Cures de villes murées. IV. 572. b. _
Cure : par qui les cures furent dcffcrvics dans les tems
¿’ignorance. XIII. 148. b. Concours pour les cures vacantes.
IIL 828. 4. Dcffcrvans commis aux cures pendant la vacance
ou l’interdit. IV. 892. b. des pricurés-curcs. XIII. 363.. a.
Les domaines annexés aux cures fujets à la dime inféodée.
C u r e * , {Médecine) ce terme a différentes figtiifications;
i°. on exprime par-là le fuccés d’un médecin dans le traitement
d’une grande maladie. En quoi confiflc le mérite de
ceux qui fe vantent d'avoir fait des cures merYCtllcufcs, &
dont les méthodes cependant ne font le plus fouvent qu’un
•tiffu de fautes. C’cft d’un fcmblable bonheur que naît fou-
vent la plus grande réputation. Quel cft le médecin auquel
on doit donner (à confiance, a". Le mot cure eft fynonyme
de traitement de maladie. Les auteurs de médecine diitin-
guent , dans ce dernier fens , quatre forte» de cures, IV.
<73. 4. qui font réglées pour le choix, par autant d’indications
corrcfpondantes. La partie de la médecine qui enfélgne
la maniéré de procurer la cure , s’appelle la thérapeutique,
lbid. b. Soyez ce mot & l’article Traitement.
C u r i , ( Pauconn. ) pilules pour les oifeaux de proie.
Armer les cures de l’oifcau. Tenir fa cure. .IV. 573. b.
CURÉ, (Jurifpr.) le titre de prêtre étoitautrefois fvno-
nyme de curé. D’où vient le mot de curé. En quelques
pays on les appelle refleuri. Ce qu’on entend par curés primitifs
, curés ou vicaires perpétuels. Les curés repréfentent,
à certains égards » les lévites de l’ancien teftament, mais
plus particulièrement les difciples auxquels ils ont fuccédé.
Ils tiennent le fécond rang dans la hiérarchie ccdéfiaftique,
€ec. Prêtres commis à la defferte des facrcmens, aufli appcl-
lés curés. Curé appellé bis cantat. IV. 573. b. Capacité exigée
¿c ceux qui font nommés pour être pourvus de cures. Clés 3ue doit avoir le curé. Cloches. A qui appartient le droit
e faire fonnèr, 8c l’émolument de la fonncric. Comptes
des fabriques. Deux curés. Dîmes. Droits honorifiques. Eau
bénite, lbid. 574. 4. Ecoles. Exemptions de l’ordinaire. Foh-
ftions curiales. Fondations. Gros décimatcurs. Incompatibilité.
Mariages. Mcffe de paroiffe. Oblations 8c offrandes. Pa-
roiffe, paroifliens. Presbytère. Curé primitif, lbid. b. Quétc.
Régale. Rcgiftrcs des baptêmes, mariages 8cfépulturc. Kegu-
lÎCrS ers. Religieux.Rc’’ Réfidcncc. Réfiénation.DI/ïahuhah C-Sacremens.irr/.m/-n-. Sépulture,SAnnlriu-p
Service
crvicc divin. lbid. 573* Tailles. Tcftamcns. Vicaire perpédc
tuel. lbid. b.
Curé. Premier curé d’une églife. I. 616. a. XIII. 369. b.
Curé appellé doyen rural. V. 97. a t b. Les curés élus à Vcnifc
par les paroifliens. XVII. 14. b. Jurifdiélion des curés. IX.
7.5; 4. Portion congrue. XIII. 148. a, b. Baife-main, offrande
aux curés. II. 23.4. Caufcs pour Icfauelles il cft permis aux
curés de s’abfcntcr de leur egliic. XÎV. 170. ¿.Taxe arrêtée
fur les curés. IV. 677. b. Les dîmes appartiennent de droit
commun aux curés. 1092. b. Les terres de l’ancien domaine
des curés exemptes de la dime envers les décimatcurs.
1093. 4. Dime nôvaledont jouiffent les curés. 1097. a. Dime
charnage 8c facramcntcllc qui leur appartient. 1094. a.
1097. 4. Code des curés. III. 571. b. Vicaires des curés.
XvII. 232. 4, b. Vicaires perpétuels des curés primitifs. 234.
4 , b. Coadjutcurs donnés aux curés ignorans. 111*554. b.
CUREDENT. Vertu des curedcnts faits de bois de lcn-
tifmic. IX. 389. b.
CURÉE ¿(Vénerie) maximes de chaffe à l’égard des curées.
Curées qui te font au logis. Donner la curée aux oifeaux.
Curer un oifeau. IV. 575. b.
Curée , voyez II. 84a. é. XVI. 925. b. 8c particulièrement
Vol. IIL des planch.'article Chaffe, pl. 3 ,4 & î •
Tome i.
C U R 453
CURE-PIÉ , (Maréch.) infiniment qui fert à nettoyer le
dedans du pié des chevaux. Pourquoi il faut être cxnél à
nettoyer les piés des chevaux. Expédient pour les humcélcr.
IV. 573. b.
CURES, ( Géogr.) recherche fur l’étymologic de eo mot.
Xlil. 726. 4.
CURETES , ( fftfl. anc. ) prêtres ou peuple de Me de
Crctc. IV. 575. b. Pourquoi on les appclla du nom de curetés.
Ils croient originaires de Phrygie. Armes 8c tambours qu’ils
portoicnt. Selon quelques autcurqAils étoient, du tems de
Saturne, prêtres 8c facrificateurs. Magie 8c fcience des curetés.
Autres étymologies du mot cureter.. Scntimcns dcKirkcr 8c
de Voflius fur ces hommes. Invention qu’on leur attribue.
Ils ont eu des temples après leur mort. Ivid. 576. a.
Curetés. A qui l’éducation de Jupiter avoit été confiée.
Suppl. II. 390.4, b. Voye{ CORYBANTES & DACTYLES.
C u r e t e . Divers inftrumens de ce nom en chirurgie. IV.
576. b.
C u r e t e , ( Manuf. en drap ) IV. 576. b.
CURIA, ( Hifl. mod. ) certaines affcmblécs, ainfi nommées
en Angleterre. Curia baronum. Curia militum. Curia advi-
fare vult. IV. 576. b.
Curia. Vacance in curid. XVI. 790. a.
CURIA-MARIA. Fautes à corriger dans cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. II. 666. b.
CURI ACES, ( Hifl. rom. ) combat des Horaccs 8c des Cu-
riaces. Suppl. 111.454. a.
CURIAL, (Jurifpr.) droit curial, églife curiale, fondions
curiales, maifon curiale. OfHcicrs curiaux en Brcifc. Dépens
curiaux. IV. 576. b.
CURIE, ( Hifl. anc. ) divifion du peuple romain en trente
curies par Romiilus. Sacrificateur appelle curion. Objets qui
fe traitoient dans les affcmblécs par curies.'Comment on les
convoquoir. Confirmation de ce qui y avoit été arrêté. Pré-
fuient de ces affcmblécs. Nouvelle divifion faite par Scrvius
Tullius. Pour quelles affaires les affcmblées par curies furent
dès-lors réfervècs. Cependant le peuple chercha toujours à
faire par curies les aflcmblécs qu on avoit coutume de faire
par centuries. Étymologie du mot curie. Ufagcs qu’on fit
de ce mot après l’abolition des affemblées par curies. IV.
Curies. Affemblées du peuple romain par curies. III. 680.
b. Deux fortes de curies à- Rome, du tems des anciennes
tribus. XVI. 621.4. Temples particuliers à chaque curie, lbid.
Le nom de curie donné aux lieux où le fénat s’aucmbloit. XVI.
66.4, b. XVII. 767.4, b.
CURIEUX , ( Hifl. anc. ) officier fous les empereurs du
moyen âge. IV. 577.4. Pourquoi Honorius abolit cet office.
Étym. du mot curieux, lbid. b.
Curieux , appellés frumentaires chez les anciens. VIL
352: <*•
C u r i e u x en peinture. IV. 577. b.
CURIGA. Obfervations fur cet article de ^Encyclopédie.
Suppl. II. 666. b.
CURION , {Hifl. anc.) chef 8c prêtre d’une curie. Ses
fondions. Pchfion qu’il recevoir. Grand curion. Par qui furent
faites ces inftiturions. Quelques-uns difent qu’il y avoit deuk
curions ¿ans chaque curie. Autres gens appellés curions. IV.
377. b. . . . . . . .
Curions, miniftres de la religion chez les anciens romains.
XVI. 621. 4.
C u r i o n , ( C.Scribonius) précis de fa vie. XVI. 232. 4.
Defeription de fon théâtre. 231. b. —- 233. é.
CURIOSITÉ, {Morale) elle eft ou louable ou blâmable;
Curioflté de connoitre l’avenir. Curioflté de favoir ce que les
autres penfent de nous : cette curioflté dangereufe à notre
bonheur. IV. 577. b. Curioflté des affaires d’autrui. Exemples
de difpofltions abfolumcnt contraires à cette curioflté. Autres
efpeces de curiofltés déraifonnablcs. Celle qui eft digne de
l’homme. L’envie de s'éclaircir n’eft pas une idée propre k
l’amc , indépendante des fens. Elle ne peut être attribuée
qu’aux fenfations 8c aux perfcélions qui nous affeftent ; mais
ces fenfations, Oc. pour être un peu fruélueufes, demandent
un travail, une1 application continuée, lbid. <78. a. Les
connoiffances intellectuelles font, à plus forte raiion , iufen-
flblcs à ceux qui fout peu d’ufaec de l’attention, lbid. b.
Curioflté. Caufc qui l’excite. VII. 763. a. Réflexions fur fon
utilité. XII. 144. a. „
CURMI, ( Econom. rufltq.) boiffon ancienne, Oc. encore
tf ufage dans le Nord. IV. 578. A.
CURSEUR, {Géom.) defeription.IV. 578. b.
C u r s e u r s apofloüques( Hifl. ccd. ) officiers de la cour
de Rome, qui repréfentent les anciens curfcurs dont l’hiftoire
eccléflaftique fait mention. Leurs fondions. Emolumens qu’ils
reçoivent. Leur nombrè. IV. 578. b.
CURSITEUR , ( Hifl. mod. ) clerc de la chancellerie en
Angleterre. Nombre de ces officiers. IV. 579.4.
CURTATIO, ( AJlron.) différence entre la diftance d’une
1 planète au foleil , 8c fa diftance réduite au plan do l’éclipti*
1 r Y y y y