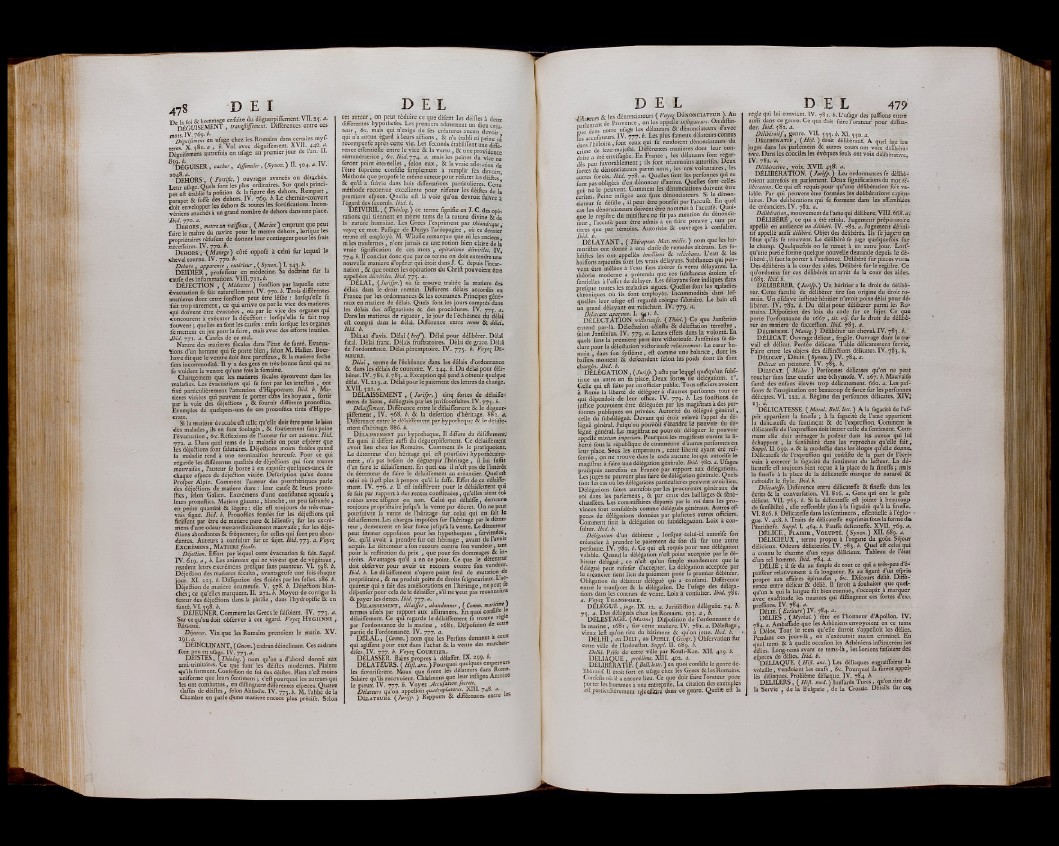
4 7 § D E I
L i9 fo\ & hommage enfuite du déguerpiffement. VIÏ. 2Ç. a.
DÉGU ISEMENT , travejliffement. Différences entre ces
m°nè'tnüfemens en triage chez les Romains dans certains myf-
teres. X. 581. a , A Vol avec déguifement. XVII. 440. a
Déguifemens autrefois en ufage au premier jour de 1 an. 11.
S3B é g u i s e r , cacher y dijjîmuler, (Synon.) II. 504- a- IV.
3°DÊHORS , (Fortifie. ) ouvrages avancés ou détachés.
Leur ufage. Quels font les plus ordinaires. Sur quels principes
eft établie la pofition & la figure des dehors. Rempart,
parapet & foffé des dehors. IV. 769. b. Le chemin-couvert
doit envelopper les dehors & toutes les fortifications. Incon-
véniens attachés à un grand nombre de dehors dans ime place.
Ibid. 770. a. .
DEHORS, mettre un vaiffeau, ( Marine ) emprunt que peut
faire le maître du navire pour le mettre dehors, lorfque les
propriétaires réfùfent de donner leur contingent pour les frais
néceffaires. IV. 770. b. (
D e h o r s , (Manège) côté oppofé à celui fur lequel le
¡cheval tourne. IV. 770. b.
Dehors , apparence, extérieur, (Synon.) 1.24t. b.
DEIDIER, profeffeur en médecine. Sa doârine fur la
caufe des inflammations. V l ll .7 1 1. b.
DÉJECTION , ( Médecine ) fonâion par laquelle cette
évacuation fe fait naturellement. IV. 770. b. Trois différentes
maniérés dont cette fonâion peut être léfée : lorfqu’elle fe
fait trop rarement, ce qui arrive ou par le vice des matières
qui doivent être évacuées , ou par le vice des organes qui
concourent à exécuter la déjeâion : lorfqu’elle fe fait trop
fouvent ; quelles en font les caufes: enfin lorfque les organes
fe mettent en jeu pour la faire, mais avec des efforts inutiles.
Ibid. 771. Ü Caules de ce mai
Nature des matières fécales dans l’état de fanté. Evacuations
d’un homme qui fe porte bien, félon M. Haller. Boer-
have dit que le ventre doit être pareffeux, & la matière feche
fans incommodité. Il y a des gens en très-bonne fanté qui ne
fe vuident le ventre qu’une fois la femàine.
Changemens que les matières fécales éprouvent dans les
maladies. Les évacuations qui fe font par les inteftins , ont
fixé particulièrement l’attention d’Hippocrate. Ibid. b. Matières
viciées qui peuvent fe porter dsis les boyaux, forrir
E: la voie des déjeâions , & fournir différens pronoftics.
emples de quelques-uns de ces pronoftics tirés d’Hippo-
crate.
Si la matière évacuée eft telle qu’elle doit être pour le bien
des malades, ils en font foulagés, & fotitiennent fans peine
l ’évacuation, &c. Réflexions de l’auteur fur cet axiome. Ibid.
772. *. Dans quel tems de la maladie on peut efpérer que
les déjeâions font falutaires. Déjeâions moins fluides quand
la maladie tend à une terminaifon heureufe. Pour ce qui
regarde les différentes qualités de déjeâions qui font toutes
mauvaifes, l’auteur fe borne à en expofer quelques-unes de
chaque efpece de déjeétion viciée. Defcription qu’en donne
Proiper Alpin. Comment l’auteur des prorrhétiques parle
des déjeâions de matière dure : leur caufe & leurs prono-
ftics, félon Galien. Excrémens d’une confiftance aqueufe ;
leurs pronoftics. Matière gluante, blanche, un peu fafranée,
en petite quantité & légère : elle eft toujours de très-mauvais
ligne. Ibid. b. Pronoftics fondés fur les déjeâions qui
finiffent par être de matière pure & bilieufe ; fur les excrémens
d’une odeur extraordinairement mauvaife ; fur les déjeâions
abondantes & fréquentes ; fur celles qui font peu abondantes.
Auteurs à confulter fur ce fujet. Ibid. 773. a. Voye^
E x c r ém e n s , M a t iè r e fécale.
Déjeélion. Effort par lequel cette évacuation fe fait. Suppl.
IV. 619. a , b. Les animaux qui ne vivent que de végétaux,
rendent leurs excrémens prefquê fans puanteur. VI. 598. b.
Déjeétion des matières fécales, avantageufe une fois chaque
jour. XI. 223. b. Diffipation des fluides parles felles. 280. b.
Déjeétion de matière ccumeufe. V. 378. b. Déjeétions blanches;
ce qu’elles marquent. II. 272. b. Moyen de corriger la
feteur des déjeâions dans la phtifie, dans l’hydropifie & en
fanté; VI. 598. b.
DÉJEUNER. Comment les Grecs le foifoient. IV. 773. a.
Sur ce qu’on doit obferver à cet égard. Voye[ H y g ie n n e ,
Rég im e .
Déjeuner. Vin que les Romains prenoient le matin. XV.
191. a.
DÉINCLÏNANT, ( Gnom.) cadran déinclinant. Ces cadrans
font peu en ufage. IV. 773. a.
DÉISTES, (Théolof.) nom qu’on a d’abord donné aux
anti-trinitaires. Ce que font' les déifies modernes. Plainte
qu’ils forment. Confefiion de foi des déifies. Rien n’eft moins
uniforme que leurs fentimens ; c’eft pourquoi les auteurs qui
les ont combattus, en diftinguent différentes efpeces. Quatre
daffes de déifies, félon Abbadie. IV. 773. b. M. l’abbé de la
Chambre en parle dHme maniéré encore plus précife. Selon
D E L
cet auteur, on peut réduire ce que difent les déifies à deux
différentes hypothefes. Les premiers admettent un dieu créa-
teur, &c. mais qui n’exige de fes créatures aucun devoir
qui n’a aucun égard à leurs aâions , & n’a établi ni peine ni
récompenfe après cette vie. Les féconds établiffent une différence
effentielle entre le vice & la vertu, & une providence
rémunératrice , &c. Ibid. 774. a. mais les peines du vice ne
feront point éternelles , félon eux, & la vraie adoration de
l’être fuprème confifte Amplement à remplir fes devoirs
Méthode que propofe le même auteur pour réfuter les déifies *
& qu’il a fuivie dans huit differtations particulières. Cette
méthode reconnue excellente pour réfuter les déifies de la
première efpece. Quelle eft la voie qu’on devroit fuivre à
l’égard des féconds. Ibid. b.
DÉIVIRIL, ( Théolog.) ce terme fignifie en J. C. des opérations
qui tiennent en même tems de Ta nature divine & de
la nature humaine. Les Grecs l'expriment par théandrique,
voyei ce mot. Paffage de Denys l’aréopagite , où ce dernier
terme eft employé. M. Witaffe remarque que ni les anciens,
ni les modernes, n’ont jamais eu une notion bien claire de la
vraie lignification de ces mots , opérations déiviriles. IV.
774. b. Il conclut donc que par ce terme on doit entendre une
nouvelle maniéré d’opérer qui étoit dans J. C. depuis l’incarnation
, & que toutes les opérations du Chrift pouvoient être
appellées déiviriles. Ibid. 775. a.
DÉLAI, ( Jurifpr.) où le trouve, traitée la matière des
délais dans le droit romain. Différens délais accordés en
France par les ordonnances & les coutumes. Principes généraux
en matière de délais. Quels font les jours comptés dans
les délais des affignations 6c des procédures. IV. 775. a.
Dans les matières de rigueur, le jour de l'échéance du délai
eft compté dans le délai. Différence entre terme 8ç délai.
Ibid. b.
DÉLAI d’avis. Délai ( bref). Délai pour délibérer. Délai
fatal. Délai franc. Délais fruitratoires. Délai de grâce. Délai
de l’ordonnance. Délai pèremptoire. IV. 775. b. Voyeç D em
eur e .
Délai, terme de l’échéance dans les délais d’ordonnance
& dans les délais de coutume. V. 244. b. Du délai pour délibérer.
IV. 782. b. 783. a. Exception qui ¿end à obtenir quelque
délai. VI. 219. a. Délai pour le paiement des lettres de change.
XVII. 521. *.
DÉLAISSEMENT , ( Jurifpr. ) cinq fortes de délaiffe-!
mens de biens, diftingués par les jurifconfultes. IV. 775. b.
Déljijfcment. Différence entre le délaiffement & le déguetf
Îiffement, IV. 768. b. 8c la défertion d’héritage. 882. a.
)ifférence entre le délaiffement par hypothéqué oc le défifte-,
nient d’héritage. 886. b.
D é la is semen t par hypothéqué, Il différé du défiftementi
En quoi il différé aufli du déguerpiffement. Ce délaiffement
avoit lieu chez les Romains. Comment ils le pratiquoient.
Le détenteur d’un héritage qui eft pourfitivi hypothécairement
, n’a pas befoin de déguerpir l’héritage , il lui fuffit
d’en faire le délaiffement. En quel cas il n’eft pas de l’intérêt
du détenteur de faire le délaiffement au créancier. Quel eft;
celui où iLeft plus à propos qu’il le faffe. Effet de ce délaiffement.
IV. 776. a. Il eft indifférent pour le délaiffement qui
fe fait par rapport à des rentes conftituées, qu’elles aient été
créées avec aflignat ou non. Celui qui delaiffe, demeure
toujours propriétaire jufqu’à la vente par décret. On ne peut
pourfuivre la vente de l’héritage fur celui qui en fait le
délaiffement. Les charges impofées fur l’héritage par le détenteur
, demeurent en leur force jufqu’à là vente. Le détenteur
peut former oppofition pour les hypothéqués , férvitudes ,
&c. qu’il avoit a prendre fur cet héritage , avant de l’avoir
acquis. Le détenteur a fon recours contre fon vendeur, tant
pour la reftitution du prix , que pour fes dommages & intérêts.
Avantages qu’il a en ce point. Ce que le détenteur
doit obferver pour avoir ce recours contre fon vendeur.
Ibid. b. Le délaiffement n’opere point feul de mutation de
propriétaire, & ne produit point de droits feigneuriaux. L’acquéreur
qui a fait des améliorations en l’héritage, ne peut fe
difpenfer pour cela de le délaiffer, s’il ne yeut pas reconnoitre
8c payer les dettes. Ibid. 777; a. . • \
DELAISSEMENT, délaijjer , abandonner, (Comm. maritime)
termes ufités par rapport aux affurances. En quoi confifte le
délaiffement. Ce qui regarde le délaiffement fe trouve régie
par l’ordonnance de la marine , 1681. Difpofition de cette
partie de l’ordonnance. IV. 777. a.
DÉLAL, (Comm. ) nom que les Perfans donnent à ceux
qui agiffent pour eux dans 1 achat 8c la vente des marchan-
difes. IV. 777. b. Foyer C o u r t ie r ..
DÉLASSER. Bains propres à délaffer. IX. 299. b.
DÉLATÉURS. ( Hifi. anc. ) Pourquoi quelques empereurs
les favoriferent. Maux que firent les délateurs dans Rome.
Salaire qu’ils recevoient. Châtimens que leur infligea Antoi
le pieux. IV. 777. b. Voyez Accufation fecrete.
Délateurs qu’on appelloit quadruplâmes.^III. 748. a.
D é l a t e u r s . (J u r ifp .) Rapports & différences entre les
D E L
•dèhfeurs & les dénonciateurs ( Voyez DÉNONCIATEUR ). Au
mrlementde Provence, on les appelle mfttgateurs. Ondiftin-
.ians notre ufage les délateurs & dénonciateurs davec L accufateurs. IV. 777. b. Les plus fameux, délateurs connus
dans l’hiftoire, font ceux qui fe rendoient dénonciateurs- du
crime de leze-majefté. Différentes maniérés dont leur ton-
dnite a été envifagée. En France , les délateurs font regardés
peu favorablement ; ils font néanmoins autorifés. Deux
fortes de dénonciateurs parmi nous, les uns volontaires, les
autres forcés. Ibid. 778. a. Quelles font les perfonnes qui ne
font pas obligées d’en dénoncer d’autres. Quelles font celles
qui ne le peuvent. Comment les dénonciations doivent être
écrites. Peine infligée aux fgux dénonciateurs. Si le dénonciateur
fe défifte, il peut être pourfui par l’accufé. En quel
cas les dénonciateurs doivent êtrè nommés à l’accufé. Quoique
le regiftre du miniftere ne fît pas mention du dénonciateur
l’accufé peut être admis à en faire preuve , tant par
titres que par témoins. Autorités & ouvrages à confulter.
Ibid. b,... - ' v • • J*. ...
DÉLAYANT, ( Thèrapeut. Mat. medic. ) nom que les hu-
moriftes ont donné à une clatfe de remedes altérans. Les fo-
lidiftes les ont appcllés émolliens 8c relâchons. L’eau & les
boiffons aqueufes font les vrais délayans. Subftances qui peuvent
être mêlées à l’eau fans altérer fa vertu délayante. La
théorie moderne a prétendu que ces fubftances étoient ef-
fenrielles à l’effet de délayer. Les délayans font indiqués dans
prefque toutes les maladies aiguës. Quelles font les maladies
chroniques où ils font employés'. Incommodités dans lesquelles
leur ufage eft regardé comme falutaire. Le bain eft
un grand délayant ou relâchant. IV. 779.
Délayant aporeme. I. «41. b. - i- ' ' ' .
DÉLECTATION viâorieufe. ( Théol.) Ce que Janfémus
entend par-là. Déleâation célefte & déleâation terreftre ,
félon Janfénius» IV. 779. a. Leurs effets dans la volonté. En
quels fens la première peut être viâorieufe. Janfénius fe déclare
pour la déleâation viâorieufe relativement. Le coeur humain
, dans fon fyftême, eft comme une balance, dont les
baffins montent 8c defeendent félon les poids dont ils font
chargés. Ibid. b.
DÉLÉGATION, ( Jurifp.) aâe par lequel quelqu un fubf-
titue un autre en fa place. Deux fqrte6 de délégations. i°.
Celle qui eft faite par un officier public. Tous officiers avoient
à Rome la liberté de déléguer à d’autres perfonnes tout ce -
qui dépendoit de leur office. IV. 779. b. Les fonâions de
juftice pouvoient être déléguées par les magiftrats à des perfonnes
publiques ou privées. Autorité du délégué général, .
celle du fubdélégué. Devant qui étoit relevé l’appel du délégué
général. Jufqu’où pou voit s’étendre le pouvoir du délégué
général. Le magiftrat ne pouvoit déléguer le pouvoir
appèllè mixtum imperium. Pourquoi les magiftrats eurent la liberté
fous la république de commettre d’autres perfonnes en
leur place. Sous les empereurs, cette liberté ayant été ref-
ferrée, on ne trouve dans le code aucune loi qui autorife le
magiftrat à faire une délégation générale. Ibid. 780. a. Ufages
pratiqués autrefois en France par rapport aux délégations.
Les juges ne peuvent plus faire de délégation générale. Quels
font les cas ou les délégations particulières peuvent avoir lieu.
Délégations faites autrefois par les'Jirocureurs généraux dH
roi dans les parlemens, & par ceux des bailliages & féné-
chauffées. Les commiffaircs départis par le roi dans les provinces
font confidérés comme délégués généraux. Autres efpeces
de délégations données par plufieurs autres officiers.
Comment finit la délégation ou fubdélégation. Loix à confulter.
Ibid. b. ,. .r e
Délégation d’un débiteur , lorfque celui-ci autonfe fon
créancier à prendre le paiement de fon du fur une autre
perfonne. IV. 780. b. Ce qui eft requis pour une délégation
valable. Quand la délégation n’eft point acceptée par le débiteur
délégué , ce n’eft qu’un fuüple mandement que le
délégué peut refufer d’accepter. La délégation acceptée par
le créancier tient lieu du paiement pour le premier débiteur.
Obligation du débiteur délégué qui a confenti. Différence
entre le tranfport 8c la délégation. De l’ufage des délégations
dans les contrats de vente. Loix à confulter. Ibid. 781.'
a. Voye{ T r a n s p o r t .
DÉLÉGUÉ, juge. IX. 12. a. Jurifdiâion déléguée. 74. b.
7c. a. Des délégués chez les Romains. 503. a , b.
DÉLESTAGE (Marine) Difpofition de l’ordonnance de
la marine, 1681 , fur cette matière. IV. 781. a. Déleftage,
vieux left qu’on tire du bâtiment & qu’on jette. Ibid. b.
DELHI, ou D eli , ou D eh lr ( Géogr.) Obfervation fur
cette ville de l’Indouftan. Suppl. II. 689. b.
Delhi. Prife de cette ville par Kouli-Kan. XII. 419. b.
DELIAQUE t problème. XlII. 402. a.
DÉLIBERATIF. (Bell, lettr. ) en quoi confifte le genre dé-
libératif. Il étoit fort en ufage chez les Grecs 8c les Romains.
Confeils où il a encore lieu. Ce que doit faire l’orateur pour
porter les hommes à une entreprife. La citation des exemples
cihparticulièrement i\éceffaire dans ce genre, Quelle eft la
D E L 479
regle qui lui convient. IV. 781. b. L’ufage des paffions entré
auffi dans ce genre. Ce que doit faire l’orateur pour diffua-
der. Ibid. 582. a. v
Délibératify genre. VII. $95.$. XI. <550.0.
DÉLIBÉRATIF , ( Hift. ) droit délibératif. A quel âge les
juges dans les parlemens & autres cours ont voix dèfibéra-
tive. Dans les conciles les évêques feuls ont voix délibêrative,
IV. 782. «.
Délibérative, voix. XVIL 438. a.
DÉLIBÉRATION. ( Jurifp.) Lex ordonnances fe délibé-
roient autrefois en parlement. Deux lignifications du mot dé--,
libération. Ce qui eft requis pour qu’une délibération foit valable.
Par qui peuvent être formées les délibérations capitu-
laires. Des délibérations qui fe forment dans les affemblées
de créanciers. IV. 782. a.
Délibération, mouvement de l’aitiequi délibéré. VIII. 668. al
DÉLIBÉRÉ, ce qui a été réfolu. Jugement'préparatoire
appellé en audience un délibéré. IV. 782. a. Jugement définitif
appelle auffi délibéré. Objet des délibérés. Ils fe jugent en
l’état qu’ils fe trouvent. Le délibéré fe juge quelquefois fur
le champ. Quelquefois on lé remet à ùn autre jour. Lorf-
qu’une partie forme quelque nouvelle demande depuis le délibéré
, il faut la porter à l’audience. Délibéré fur pièces vues»
Des délibérés à la cour des aides. Délibéré fur le regiftre. Ce
qu’ordonna fur ces délibérés un arrêt de la cour des aides.
1683. Ibi'd.b.
DÉLIBÉRER. (Jurifp Un héritier a le droit de délibérer.
Cette faculté de déliBérer tire fon origine du droit romain.
Un éfclave inftitué héritier n’avoit point délai pour dé*
libérer. IV. 782. b. Du délai poiir délibérer parmi les Romains.
Difoofition des loix du code fur ce fujet. Ce que
porte l’ordonnance de 1667, tit. vij. fur le droit de délibérer
en matière de fucceffion. Ibid. 783. a.
D é l ib é r e r . (Maneg. ) Délibérer un cheval. IV. 783. A
DÉLICAT. Ouvrage délicat, fragile. Ouvrage dont le travail
eft délicat. Penfée délicate, lable délicatement fervie.
Faire entre les objets des diftinâions délicates. IV. 783. b.
D é l i c a t , D é lié. (Synon.) IV. 784.a.
Délicat en peinture. IV. 783. b.
D é l ic a t . ( Médec. ) Perfonnes délicates qu’on ne peut
toucher fans leur caufer une échymofe. V. 267. b. Mauvâife
fanté des enfans élevés trop délicatement. 660. a. Les paffions
& l’imagination ont beaucoup de force fur les perfonnes
délicates. VI. 122. a. Régime des perfonnes délicates. XIV,’
13. à.
DÉLICATESSE. (Moral. Bell. Utt. ) A la fagacité de l’ef-
prit appartient.la fineffe ; à la fagacité de l’ame appartient
la délicateffe de fentiment & de l’expreflion. Comment la
délicateffé de l’expreffion doit imiter celle du fentiment. Comment
elle doit ménager la pudeur dans les aveux qui lui
échappent , la fenfibilité dans les reproches qu’elle foit,
Suppl. II. 690. a. 8c la modeftie dans les éloges qu’elle donne.
Délicateffe de l’exprelfion qui confifte de la part de l’écrivain
à exercer la fagacité du fentiment du leâeur. La délicateffe
eft toujours bien reçue à la place de la fineffe ; mais
la fineffe à la place de la délicateffe manque de naturel &
refroidit le ftyle. Ibid. b.
Délicateffe. Différence entre délicateffe 8c fineffe dans les
écrits & la converfation. VI. 816. a. Gens qui ont le goût
délicat. VII. 765. b. Si la délicateffe eft jointe à beaucoup
de fenfibilité, elle reffemble plus à la fagacité qu’à la fineffe.
VI. 816. A Délicateffe dans les fentimens, effentielle à l’églo-
gue. V . 428. A Traits de délicateffe exprimés fous la forme da
l’äntithefe. Suppl. I. 464. b. Fauffe delicateffe. XVII. 769. a.
DÉLICE, Pl a i s i r , V o l u p t é . (Synon.) XII. 689. a.
DÉLICIEUX , terme propre à l’organe du goût. Séjour
délicieux. Odeurs délicieufes. IV. 783. A Quel eft celui qui
a connu le charme d’un repas délicieux. Tableau de l’état
d’un tel homme. Ibid. 784. a.
DÉLIÉ ; il fe dit au fimple de tout ce qui a très-peu d é-
paiffeur relativement à fa longueur. Et au figuré d’un efprit^
propre aux affaires épineufes , &c. Difcours délié. Différence
entre délicat & délié. Il feroit à fouhaker que quelqu’un
à qui la langue fut bien connue, s’occupât à marquer
avec exaâitude les nuances qui diftinguent ces fortes a’ex-.
preifions. IV. 784. a.
D élié. (Ecriture) IV. 784. a.
DÉLIES , (Mythol. ) fête en l’honneur d’Apollon. IV;
784. a. Ambaffade que les Athéniens envoyoient en ce tems
à Délos. Tout le tems qu’elle duroit s’appelloit les délies.
Pendant ces jours-là , on n’exécutoit aucun criminel. En
quel tems 8c à quelle occafion les Athéniens inftituerent les
délies. Long-tems avant' ce tems-là, les Ioniens faifoient des
efpeces de délies. Ibid. b. ' .
DÉLIAQUE. ( Hift. anc. ) Les déliaques engraiffoient I»
volaille, vendoient les oeufs , &c. Pourquoi ils furent appeli
lés déliaques. Problème délkique. IV. 784. A
DELILERS, ( Hiß. mod.) huffards Turcs, qu’on tire de
la Servie , de la Bulgarie, de la Croatie. Détails fur ce^