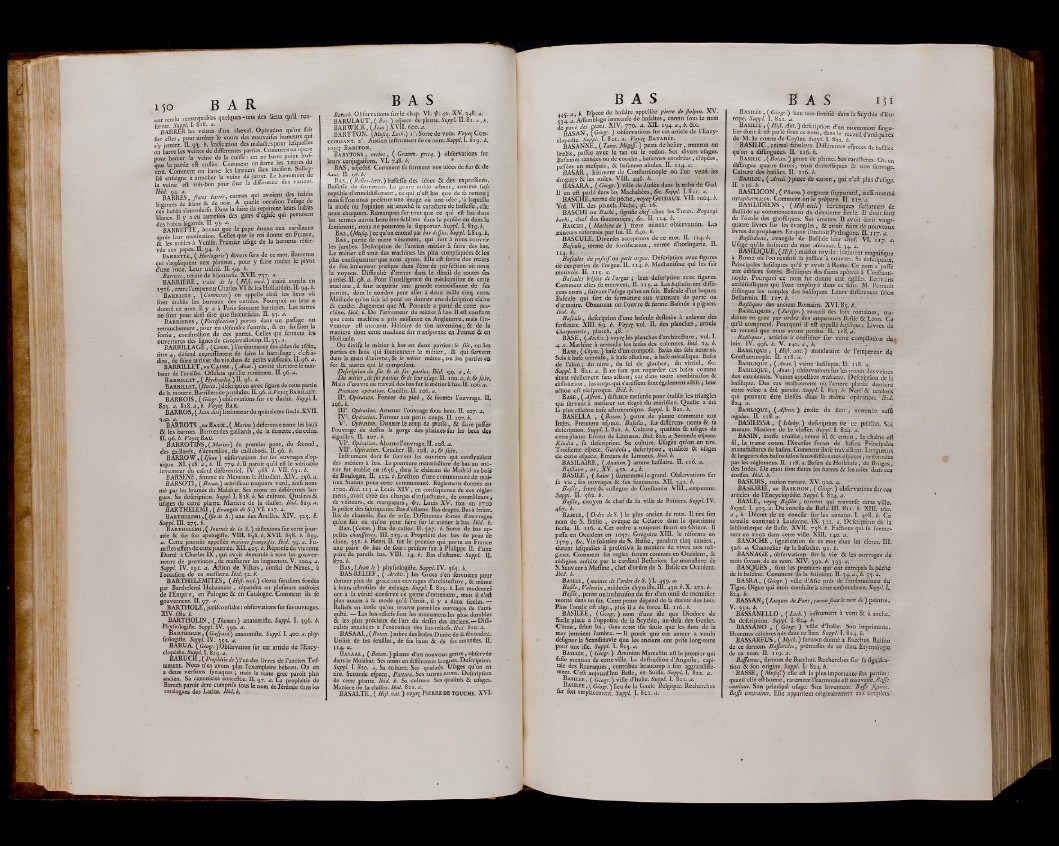
150 B A R
ont rendu remarquables quelques-uns des lieux qu’il renferme.
Suppl. I- 818. a. -- , r*
BARRER les veines d’un cheval, Opération quon tait
fur elles, pour arrêter le cours des mauvaifes humeurs oui
s’y jettent. 11. 93. ¿. Indication des maladies pour lefquelles
on barre les veines de différentes parties. Comment on opere
pour barrer la veiné de la cuiffe : on ne barre point lori-
mie la partie eft enflée. Comment on barre les veines du
cou. Comment on barre les larmiers fans incifion. Solley-
fel enfeiene à arracher la veine du jarret. Le barrement de
la veine eft très-bon pour ôter la difformité des varices.
ADIRÉS freres barrés, carmes qui avoient des habits
? . n 1 ' A LJS de bic'l dfep p p SHa) 1 a ®ÜS§® S1 llfBït4fîf iclt*
ces habits s’introduifit. Dam la fuite ils reprirent leurs hâtas
blancs. Il y a eu autrefois des gens déglife qui portoient
des habits bigarrés. II. 93. a. . .
BARRETTE, bonnet que le pape donne aux cardinaux
après leur nomination. Celles que le roi 'donne en France,
& les nobles à Venife. Premier ufage de la barrette réfer-
vée aux papes. IL 94.b .
Barrette, ( Horlogerie) divers fens de ce mot. Barrettes
qui s’appliquent aux platines, pour y faire rouler le pivot
d’une roue. Leur utilité. II. 94. b.
Barrette, terme de bijouterie. XVII. 757. a.
BARRIERE, traité de la { Hijl. mod.) traité conclu en
1716, entre l’empereur Charles VI 8c les Hollandois. II. 94. b?
Barrière , ( Commerce) on appelle ainfi les lieux où
font établis lés bureaux des entrées. Pourquoi on leur a
donné ce nom. Il y a à Paris foixante barrières. Les autres
ne font pour ainfi dire que fuccurfales. II. 95. a.
BARRIERES, ( Fortification) portes dans un paffage ou
retranchement, pour en défendre l’entrée, 6c en faciliter la
fortie, conftruttion de ces portes. Celles qui ferment les
ouvertures des lignes de circpnvallatiop.il. 95. a.
BARRILLAGE, ( Comm. ) l’ordonnance des aides de 1680,
titre 4, défend expreffément de faire le barrillage ; c’eft-à-
dire, de faire arriver du vin.dans de petits vaiffeaux. H. 96. a.
BARRILLET, ou C aisse , ( Anat.) cavité derrière le tambour
de l’oreille. Offelets qu’elle renferme. II. 96. a.
B ARRILLET,' ( Hydrauliq.) II. 96. a.
B arrillet, {Horlo. ) defeription avec figure de cette partie
de la montre. Barrillets de pendules. IL 96. a.Voye^ Barillet.
BARROIS, ( Géogr.) obfervations fur ce duché. Suppl. I.
803. a. 818.a,b. yoyeç Bar.
BARROS, {Jean dos) littérateur du quinzième fiecle. XVII.
340. a.
BARROTS , ou Baux , ( Marine) différence entre les baux
& les barrots. Barrots des gaillards, de la dunette, du celtis.
II. 9 6.B. Voyez Ba u.
BARROllNS,( Marine) du premier pont, du fécond,
des gaillards, d’écoutilles, de caillebotis. II. 96. b.
B ARROW, ( Ifaac ) obfervations furfes ouvrages d’optique.
XI. 3 18. a , b. II. 779. b. U paroît qu’il eft le véritable
•inventeur du calcul différentiel. IV. 988. b. VII. 631. b.
BARSENE, femme de Memnon le Rhodien. XIV. 156. a.
BARSOTI, { Botan.) arbriffeau toujours verd, ainfi nommé
par les brames du Malabar. Ses noms en différentes langues.
Sa defeription. Suppl. I. 818. ¿. Sa culture. Qualités 6c
ufages de cette plante. Maniéré de la claffer. lbid. 819. a.
BARTHELEMI, {Evangile de S.) VI. 117. a.
Barthelemi, {Iflede S.) une des Antilles. XIV. 515. b.
Suppl. III. 273. b.
B arthelemi , ( Journée de la S.) réflexions fur cette jour-
- née 8c fur fon apologifte. V 11L 898. ¿.XVII. 838. b. 839.
a. Cette journée appellée matines françoifes. lbid. 39. a. Fu-
neftes effets de cette journée. XQ. 423. b. Réponfe du vicomte
Dorté à Charles IX , qui avoit demandé à tous les gouverneurs
de provinces, de maffacrer les huguenots. V. 1004. a.
Suppl. IV. 191. a. Aétion de Villars, conful de Nîmes, à
l’occafion de ce maflàcre. lbid. 5 a. b\
BARTHELEMITES, ( Hijl. eccl. ) clercs féculiers fondés
par Barthelemi Hobzauzer, répandus en plufieurs endroits
de l’Empire, en Pologne 6c en Catalogne. Comment ils fe
gouvernent. II. 97. a.
B ARTHOLE, jurifconfulte : obfervations fur fes ouvrages.
XIV. 682. b.
BARTHOLIN, ( Thomas ) anatomifte. Suppl. I. 396. b.
Phy fiologifte. Suppl. IV. 330! a.
B artholin , {Gafpard) anatomifte. Suppl. 1. 400. a. phy*
fiologifte. Suppl. IV. 352. a.
BARUA. {Géogr. ) Ubfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. 1. 819. a.
BARUCH, ( Prophétie de ) l’iui des livres de l’ancien Tef-
tament. Nous n’en ayons plus l’exemplaire hébreu. On en
a deux venions fyriaques ; mais le texte grec paroît plus
ancien. Sa canonicité conteftée. IL 97. a. La prophétie de
Baruch paroît être comprife fous le nom de Jérémie dans les
catalogues des Latins, lbid, b.
BAS Baruch. Obfervations fur le chap. VI. -ÿ. 42. XV. 348. a.
BARULAUT, ( Bot.) eipece de plante. Suppl. II. 81. a ,b.
BARWICK, {Jean) XVlI. 600. a.
BARYTON. {Mufiq. Luth.) 1 °. Sorte de voix. Voyer C oncordant.
20. Ancien inftrument de ce nom. Suppl. I. 819. b.
yoyeg- Bariton.
Barytons , verbes, ( Gramm. grecq. ) obfervations fur
leurs conjugaifons. VI. 748. b.
BAS, adjeétif. Comment fe forment nos idées de bas 6c de
haut. II. 07. b.
Bas , {Belles-lettr. ) baffeffe des idées 8c des expreflions.
Baffcffe de fentimens. Le genre noble admet, comme fuf-
ceptible d’ennobliffement, ce qui n’eft bas que de fa nature ;
mais fi l’on nous préfente une image où une idée,'à laquelle
la mode ou l’opinion ait .attaché le caraétere de baffeffe, elle
nous choquera. Remarquez fur-tout que ce qui eft bas dans
les termes auroit beau être fublime dans la penfée ou dans le
fentimenr, nous ne pourrons le fupporter. Suppl. 1. 819. b.
B as , {Mufiq.) ce qu’on entend par bas dejfus. Suppl. 1.8 19. b.
Bas , partie de notre vêtement, qui fert à nous couvrir
les jambes. Defeription de l’ancien métier à faire des bas.
Le métier eft une des machines les plus compliquées 6c les
plus conféquentes' que nous ayons. Elle eft fortie des mains
de fon inventeur prefque dans l’état de perfe&ion où nous
la voyons. Difficulté • d’entrer dans le détail de toutes fes
parties. II. 98. a. Pour l’intelligence du méchanifine de cette
machine, il faut acquérir une grande connoiffance de fes
parties, dont le nombre peut aller à deux mille cinq cens.
Méthode qu’on fuit ici pour en donner une defeription claire
6c exafte. Jugement que M. Perrault a porté de cette machine.
lbid. ¿.De l’inventeur du métier à bas. U eft confiant
que cette machine a pris naiffance en Angleterre, mais l’inventeur
eft inconnu. Hiftoirë de ion invention, 6c de la
maniéré dont cette machine fut rranfportée en France 6c en
Hollande.
. On divife le métier à bas en deux parties : le fut, ou les
parties en bois qui foutiennent le métier, 6c qui fervent
dans la main d’oeuvre; 6c le niétier même, ou les parties en
fer 6c autres qui le compofent.
Defeription du fût & de fes parties. lbid. *99. a , b.
Du métier , defesparties 6* de leurufage.il. 100.a9.b. & fuiv.
Main d’oeuvre ou travail des bas fur le métier à bas. IL xo6. a.
Première opération. Cueillir. II. 106. a. '
IIe. Opération. Foncer du pied, 6c former l’ouvrage. II,
106. b.
IIIe. Opération. Amener l’ouvrage fous becs.1 H, 107. a.
IVe. Opération. Former aux petits coups. II. xoy.b.
V e. Opération. Donner le coup de pteffe, 6c faire pafler
l’ouvrage de deffus la gorge des platines* fur les becs des
aiguilles. U. 107. b.
VIe. Opération. Abattre l’ouvrage. II. 108. a.
VIIe. Opération. Crocher. II. 108. a, 6* fuiv.
ïhftrumens dont fe fervent les ouvriers .qui conftruifent
des métiers à bas. La première manufacture de bas au métier
fut établie en 1636, dans le château de Madrid au bois
de Boulogne. II. 112. b. Ereétion d’une communauté de maîtres.
Statuts pour cette communauté. Réglemens donnés en
1700. lbid. 113.4. Louis X IV , en conféquence de ces régie-
mens, avoit créé des charges d’inibeéteurs, de contrôleurs *
de vifiteurs, de marqueurs, &c. Louis XV. fixa en 1720
la police des fabriquants. Bas d’eftame. Bas drapés. Bas à étrier.
Bas de chamois. Bas de toile. Différentes fortes d’ouvrages
qu’on fait ou qu’on peut faire fur le métier à bas. lbid. b.
Bas . {Çomm.) Bas de caftor. II. 327. ¿. Sorte de bas ap-
pellés chaujfettes. III. 239. a. Propriété des bas de peau dè
chien. 331. b. Henri II. fut le premier qui porta, en France
une paire de bas de foie : prefent fait à Philippe H. d’une
paire de pareils bas. VIII, 14. b. Bas d’eftame. Suppl. IL
872. b.
Ba s , {Jean le ) phy fiologifte. Suppl. IV. 363.. ¿. .
BAS-RELIEF, ( Arch.it7) les Grecs s’en fervoient pour
donner plus de grâce aux ouvrages d’architefture, 8c même
à leurs uftenfiles de ipénage. Suppl. I. 819. b. Les modernes
ont à la vérité confervé ce eenre d’ornement, mais il n’eft
plus autant à la mode qu’il l’étoit, il y a deux fiecles. —
Reliefs en boffe qu’on trouve parmi les ouvrages de l'antiquité.
— Les bas-reliefs font les monumensles plus durables
oc les plus précieux de l’art du defiïn des anciens. — Difficultés
attachées à l’exécution des bas-reliefs, lbid. 820. a.
BASAAL, {Botan. ) arbre des Indes. Durée de fa fécondité.
Utilité -de fes feuilles, de fes baies & de fes amandes. II.
114. a.
Ba s a a l , ( Botan. ) plante d’un nouveau genre, obfervéë
dans le Malabar. Ses noms en différentes langues. Defeription.
Suppl. I. 820. a. Sa culture. Ses qualités. Ufages qu’on en
tire. Seconde eipece, Pattara. Ses autres noms. Defeription
de cette plante. lbid. b. Sa culture. Ses qualités 6c ufages.
Maniéré de la claffer. lbid. 821. a.
BASALTE, ( Hijl. nat. ) voye^ Pierre de touche. XVI.
BAS 443. a b. Efpece de bafalte appellée pierre dejlolpen. XV.
c il ! a ’Affemblaee immenfe de bafaltes, connu fous le nom
de pavé des géans. XIV. 77O. a. XII. 194. a , b. &c.
BAS AN, {Géogr. ) obfervations fur cet arude de 1 Encyclopédie.
Suppl. I. 821. a. Voyei Batanée.
BASANNE, { Tarn. Mégijfi ) peau de belier, mouton ou
brebis, paffée avec le tan ou le redon. Ses divers ufages»
Bafannes tannées ou de couche, bafannes coudrées, chipées,
paffées en mefquis, 6c bafannes aludes. II. 114. a.
BASAR, bâtiment de Conftantinople où l’on vend les
drogues 8c les toiles. VIII. 446. ¿.
BASARA, ( Géogr. ) ville de Judée dans la tribu dè Gad.
Il en eft parlé dans les Machabées, &c. Suppl. I. 821. a.
BASCHE, terme de pêche , voye{ Gu id au x . VIL 1004, ¿.
Vol. VIII. des planch. Pêche, pl. 16.
BASCHI oujjBachï, figmEe chef chez les Turcs. Bogangi
bachiy chef des fauconniers, 6*c. H. 114. b.
BASCHI, {Mathieu'de ) frété mineur obfervantin. Les
mineurs réformés par lui. II. 640. b.
BASCULE.. Diverfes acceptions de ce mot. U. 114. b.
Bafcule, terme de fortification, terme d’horlogerie. II.
114. bi - - ■ I
Bafcules du pojîtif Ou petit orgue; Defcnpuon avec figures
de ces parties dè l’orgue. II. i 14. b. Méchanifine qui les fait
mouvoir» H. 113. a. ■ -r ' \ :
Bafcules brifées de l’orgue ; leur defeription avec figures.
Comment elles ,fe meuvent. II. 113. a. Les bafcules ont diffé-
r.ens noms, fuivant l’ufage qu’on en fait. Bafcule d’un loquet.
Bafcule qui fert de fermeture aux vanteaux de porte ou
d’armoire. Ofemment on l’ouvre 8c ferme. Bafcule à pignon»
lbid. b.
Bafcule, defeription d’une bafcule deftinée à enlever des
fardeaux. XIII. 69. b. Voyeç voL H. des planches, article
Charpenterie i planch. 48. •
BASE, {Archit.) voyeg\ès planches.d’architeéhire, vol. I.
4. a. Machine à arrondir les bafes des colonnes, lbid. 14. b.
B ase, ( Chym.) bafe d’un compofé. Bafes des fels neutres.
Sels à bafe terreufe, à bafe alkaline, à bafe métallique» Bafes
de l’alun,* du nitre, du fel de glauber, du vitriol, &c.
Suppl. I. 821. a. U ne faut pas regarder ces bafes comme
étant réellement fans aétion; car dans toute combinaifon 6c
diffolution, les corps qui s’uniffent font également aâifs; leur
aétion eft réciproque. lbid. b.
Base , {Ajlron.j diftance mefurée pour établir les triangles
qui fervent à mefurer un degré du méridien. Quelle a été
la plus célébré bafe aftronomique» Suppl. I. 821. b.
BASELLA , {Botan. )■ genre de plante commune aux
Indes. Première eipece. Bafella, fes différeus noms 6c fa
defeription. Suppl. I. 821. b. Culture, qualités 8c ufages de
cette plante. Erreur de Linnæus. lbid. 822» a. Seconde eipece.
Kindra, fa defeription. Sa culture. Ufages qu’on en tire.
Troifieme efpece. Gandola, defeription, qualités 6c ufages
de cette efpece. Erreurs de linnæus. lbid. b.
BASILAIRE, {Anatom.) artere bafilaire. H. 116. a.
Bajilaire, os,.XV. 452. a,b.
BASILE , ( Saint ) furnommé le grand. Obfervations fur
fa vie , fes ouvrages 6c fes fentimens. XII. 342. b.
B a file, frere 6c collègue de Conftantin V I I I , empereur.
Suppl. II. 362. b.
Bafile, citoyen 6c chef de la ville de Poitiers. Suppl. IV.
467. b. -
Basile, ( Ordre de S.) le plus ancien de tous. Il tire fon
nom de S. Bafile , évêque de Céfarée dans le quatrième
fiecle. II. 116. a. Cet ordre a toujours fleuri en Orient. Il
paffa en Occident en 1057. Grégoire XIII. le réforma en
1379 , &c. Vie folitaire de S. Bafile, pendant cmq années,
durant lefquelles il preferivit la maniéré de vivre aux religieux.
Comment fes réglés furent connues en Occident, 8c
rédigées enfuite par le cardinal Beffarion. Le monaftere de
5. Sauveur à Mefune, chef d’ordre de S. Bafile en Occident.
lbid. b.
B asile , {moines de Tordre de S. ) I. 439. a.
Bafile, Valentin, médecin chymifte.IU. 430. b. X. 272. b.
Bafile, pente ou indinaifon du fer d’un outil de menuifier
monté dans un fut. Cette pente dépend de la dureté des bois.
Plus l’angle eft aigu, plus il a de force. II. 116. b.
BASILÉE, ( Géogr. ) nom d’une ifle que Diodore de
Sicile place à l’oppofite de la Scythie, au-delà des Gaules.
C’étoit, félon lui, dans cette ifle feule que les flots de la
mer jettoient l’ambre. — II. paroît que cet auteur a voulu
défigner la Scandinavie que les anciens ont prife long-tems
pour une ifle. Suppl. I. 823. a.
Ba silée , ( Géogr.) Ammien Marcellin eft le premier qui
fcffe mention de cette ville. La deftruélion d’Augufte, capitale
des Rauraques , contribua beaucoup à fon aggrandiffe-
ment. C’eft aujourd’hui Baile, en Suiffe. Suppl. 1. 822. a.
B asilée, { Géogr.) ville d’Italie. Suppl. I. 822. a.
B a silée , ( Géogr. ) lieu de la Gaule Belgique. Recherches
fur fon emplacement. Suppl. I. 822. a.
BAS 151
Basilée , ( iGéogr.) lieu très-forrifié dans la Scythie d’Eu-
• rope. Suppl. I. 822. a. . f - y
) defeription d’un monument fingu-
her dont d eft parlé fous ce nom dans le recueil ¿’antiquités
de M. le comte de Caylus. Suppl. I. 822. b.
BASILIC, animal fabuleux. Différentes cfpcces de bafilics
qu'on a diftinguées. II. 116. ¿;
Bas ilic , {Botan. ) genre de plante. Ses carafteres. On en
diftingue quatre fortes, trois domeftiques 8c une fauvaee.
Culture des bafilics. II. 116. b.
Ba s il ic , ( Artill.)piece de canon, qui n’eft plus d’ufaee»
H. 116. b.
RASILICON, ( Pharm. ) onguent fuppuràrif, aüffi nommé
tetrapharmaçon. Comment- on le prépare. II. 1 ijt.'a.
BASILIDIENS , {Hijl eccl.) liéréti ques feélateurs de
BafiUde au commencement du deuxième fiecle. 11 étoit fûrti
de l’école des gnoftiques. Ses érreurs. Il avoit écrit vingt-»
quatre livres fur les évangiles, 8c avoit feint de nouveaux
livres de prophètes. En quoi il hnitoit Pythagore. II. 117. a.
Bafilidiens, évangile de Bafilide leur chef. VI. 117. 4.
Ufage qu’ils faifoient du mot Abraxas. I. 34, 4,
BASILIQUE, {Hijl.) maifon royale: bâtiment magnifique
à Rome où l’on rendoit la juftice à couvert. Sa defeription.
Principales bafiliques qu’il y avoit à Rome. Ce nom a paffé
aux édifices facrés. Bafiliques des faints apôtres à Conftanti-
nople. Pourquoi ce nom fut . donné, aux églifes. Ecrivains
eccléfiaftiques qui l’ont employé dans ce fens. M. Perrault
diftingue les temples des bafiliques. Leurs différences félon
Bellarmin. U. 117. b.
Bafiliques des anciens Romains. XVI. 85. A
-■ Ba s il iq u e s , {Jurifpr.) recueil des lôix romaines, traduites
en grec par ordre des empereurs. Bafile & Léon. Ce
qu’il comprend. Pourquoi il eft àppellé bafiliques. Livres de
ce recueil que nous avons perdus. II. 118. a: '
Bafiliques, articles à coiifulter fur cette compilation de.-»
loix. IV. 996. b. V» 140. 4-, ¿. . \
, B a s i l iq u e , {Hijl. anc.) mandataire de l’empereur de
Conftantinople, II. iï8. a.
Ba silique , {Anat. ) veine bafilique. il. 118. a» '
Ba s il iq u e , {Anat.) obfervations fur les troncs dès veines
des extrémités. Veines appellées médianes. Defeription de la
bafilique» Des cas -malheureux où. l’arterè placée derrière
cette veine a été percée. Suppl. I. 823-. b. Nerf 8c tendons
qui peuvent être bleffés dans la même opération, lbid*
824. 4.
B a s i l iq u e , {Ajlron.) étoile du lion , nommée aufij
régulas. IL 118. 4.
BASHJSSA, (lchthy.) defeription de ’ ce pôiffon. Scs.
moeurs. Maniéré de le claffer. Suppl. I. 824. d. '
BASIN, étoffe croifée, toute fil 8c çotdn , la chaîne eft
fil, la trame coton. Diverfes fortes de bafins» Principales
manufactures de bafins. Comment ils fe travaillent. Longueurs
6c largeurs des bafins félon leurs différentes èfjpeces, ordonnées
par les réglemens. H. 118. a. Bafins de Hollande ; de Bruges,
des Indes. De quoi font faites les barres 6c les raies dans ces
étoffes. lbid. ¿. ■
B A S K 1R S , n a tio n ta r ta re . X V . 920. 4»
BASKIRIE, ou Ba s k r o n , {Géogr.) obfervations for ces
articles de l’Encyclopédie, Suppl. I. 824. a.
BASLE, voyez.Bafilée , torrent qui traverfe cette ville.
Suppl. I. 903.4. Du concÜe de Bafte.HI. 811. b. XHI. 260.
4 , b. Décret de ce concile fur les annates. I. 478. b. Ce
concile continué à Laufanne. IX. 322. a. Defeription de la
bibliothèque de Bafle. XVII. 738. b. Faétions qui fe formèrent
en 1230 dans cette ville. XIII. 140. a.
BASOCHE , fignification de ce mot chez les clercs. III.
326» 4. Chancelier de la bafoche. 91. ¿.
BASNAGE, obfervations fur la vie' 6c les ouvrages de
trois favans de ce nom. XIV. 3.92. b. 393.4;
BASQUES , font les premiers qui* ont entrepris la pêche
de la baleine. Comment- ils la faifoient. II. 34.4, ¿. 3 3. a.
BASRA, {Géogr.) ville d’Afie près de l’embouchure du
Tigre. Digue qui etoit conduite à cette embouchure, Suppl. L.
824. b.
BASSAN, {Jacques du Pont, connu fous le nom de) peintre.
V . 332. b.
BASSANELLO , {Luth.) inftrument à vent 8c à anche.
Sa defeription. Suppl. I. 824. b.
BASSANO , ( Géogr. ) ville d’Italie. ■ Son imprimerie.
Hommes célébrés nés dahs ce lieu. Suppl.' f. 824. b.
BASSAREUS, {Myth.) furnom donné à Bacçhus. Raifon
de ce furnom. BaJJarides, prêtreffes. de ce dieu. Etymologie
de ce nom. H. 119. a.
• Bajfareus, furnom de Bacchus. Recherches fur fa fignification
8c fon origine. Suppl. I.' 824. b.
BASSE, (MufiqT) elle eft la plus importante des parties:
quand elle elt bonne, rarement l’harmonie eft mauvâife. Bajfc
continue. Son-principal ufage; -Son inventeur. Baffe figurée.
Baffe contrainte. Elle appartient originairement aux couplets