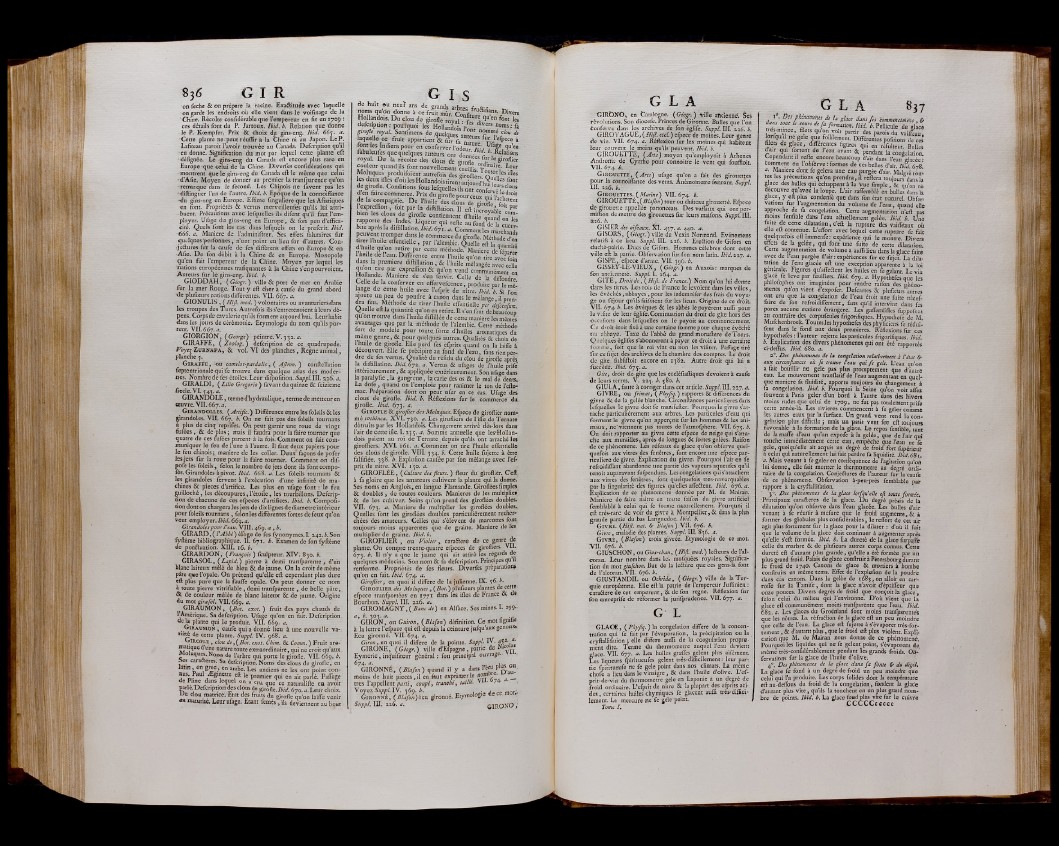
G IR
on feche & on prépare la racine. Exa&itudc avec laquelle
on garde les endroits où elle vient dans le voifinage de la
'Chine. Récolte confidérable que l’empereur en fit en 1709 :
ces détails font du P. Jartoux. Ibïd. b. Relation que donne
le P. Koempfer. Prix & choix djp gifts-eng. Ibid. 6 6 * . a.
Cette plante ne-peut réulfir à la Chine ni au Japon. Le P.
Lafiteau paroît l’avoir trouvée au Canada. Defcription qu’il
-en donne. Signification du mot par lequel cette plante eft
défignée. Le gins-eng du Canada eft encore plus rare en
Europe -que celui de la Chine. Diverfes confidérations qui
montrent que le gins-eng du Canada eft le même que celui
'd’Afie. Moyen de donner au premier la tranfoarence qu’on
• remai que dans le fécond. Les Chinois ne lavent pas les
•diftinguer l’un de l’autre. Ibid. b. Epoque de la connoiffance
•du gins-eng en Europe. Eftime finguliere que les Afiatiques
en font. Propriétés oc vertus merveilleufes qu’ils lui attribuent.
Précautions avec lefquelles ils difent qu’il faut l’employer.
Ufage du gins-eng en Europe, & fon peu d’efficacité.
Quels iorft les cas dans lefquels on le prefcrit. Ibid.
■666. a. Maniéré de l’adminiftrer. Ses effets lalutaircs fur
quelques pcrfonnes, n’ont point eu lieu for d’aütres. Con-
•jeâures ftfr la caufe de fes différens effets en Europe & en
•Afie. D e fon débit à la Chine & en Europe. Monopole
qu’en fait l’empereur de la Chine. Moyen par lequel, les
'nations européennes trafiquantes à la Chine s’en pourvoient.
Auteurs fur le gins-eng. Ibid. b.
G IO D D A H , ( Géogr. ) ville & port de mer en Arabie
fur la mer Rouge. Tout y eft cher à caufe du grand abord
■de plufieurs nations différentes. VII. 6 6 7 . a.
G IONULIS , (H ift . tnod. ) volontaires ou avanturiersdans
les troupes des Turcs. Autrefois ils s’entretenoient à leurs dépens.
Corps de cavalerie qu’ils forment aujourd’hui. Leur habit
dans les jo u r s de cérémonie. Etymologie du nom qu’ils portent.
VII. 667 . a.
G IO R G ÏO N , ( George) peintre. V . 332./*.
G IR A F FE , ( Zoolog. ) defcription de ce quadrupède.
V ?y«;ZuRNÀPA, 8c vol. V I des planches, Regneanimal,
planche &
GlRAFÏE, ou camelot-pardalis, ( Aftron. ) conftcllation
feptentrionale qui fe trouve dans quelque atlas des modernes.
Nombre de fes étoiles. Leur dilpofition. Suppl. III. 226. a.
G IR A LD I , ( Lilio Gregorio ) favant du quinze & feizieme
liecle.VI. <43.«.
GIR AND O LE , terme d’hydraulique, terme de metteur en
oeuvre. VII. 667. a.
G irandolles. ( Artific. ) Différence entre les foleils & les
girandoles. V II. 667. b. On ne fait pas des foleils tournans
à plus de cinq reprifes. On peut garnir une roue de vingt
-fùlées , & de plus y mais il faudra pour la faire tourner que
quatre de ces tufées partent à la fois. Comment on fait communiquer
le feu de l’une à l’autre. Il faut deux papiers pour
le feu chinois ; maniéré de les coller. Deux' façons de pofer
les iets fur la roue pour la faire tourner. Comment on dif-
pofe les foleils, félon le nombre de jets dont ils font compo-
lês. Girandoles à pivot. Ibid. 668. a. Les foleils tournans &
les girandoles fervent à l’exécution d’une infinité de machines
& pièces d’artifice. Les plus en ufage font : le feu
guilloché, les découpures, l’étoile, les tourbillons. Defcription
de chacune de ces efpeces d’artifices. Ibid. b. Composition
dont on chargera les jets de dix lignes de diametre intérieur
pour foleils tournans , félonies différentes fortes de feux qu’on
veut employer. Ibid. 669. a.
Girandoles pour l ’eau. V lI I . 469. a , b.
G IR A R D , ( l'Abbé') éloge de fes fynonymes.I. 242.¿.Son
fyftême bibliographique. II. 671. b. Examen de fon fyftême
de ponôuation. XIII. 16. b.
G IR A R D O N , ( François ) fculpteur. XIV'. 830. b.
G IR A SO L , ( Lapïd. ) pierre à demi tranfparente, d’un
blanc laiteux mêlé de bleu & de jaune. On la croit de même
pâte que l’opale. On prétend qu’elle eft cependant plus dure
eft plus pure que la fauffe opale. On peut donner ce nom
à toute pierre vitrifiable, demi tranfparente, de belle pâte,.
& de couleur mêlée de blanc laiteux 8c de jaune. Origine
du mot girafol. V I I .-669. a.
GIR AUM O N,. (B o t. exot. ) fruit des pays chauds de
1-Amérique. Sa defcription. Ufage qu’on en fait. Defcription.
J? P k °te i ui M produit. V II. 669. a.
• jS IRaum0n > caufe qui a donné lieu à une nouvelle variété
de cette plante. Suppl. IV . 968. a.
’ c^ou ^ ot‘ exot' Chim. 8c Comm. ) Fruit aromatique
d une nature toute extraordinaire, qui ne croît qu’aux
Moluques. Noms de l’arbre qui porte le girofle. V II. 669. b.
Ses caractères. Sa defcription. Noms des clous de girofle, en
latin, en grec, en arabe. Les anciens ne les ont point con-
-Ægmettc eft le premier qui en ait parlé. Paffage
dc J*"® « ^ .le q u e l on a cru que ce naturalifte en avdit
parle.Defcription des clous de girofle./¿M. 670. *. Leur choix.
Du clou matrice. Etat des fruits du girofle qu’on laiffe venir
maturitc- Leur ufage. Etant femés, m deviennent au bout
GIS
noms qu’on donne“ ’ j jÉ^ f e & y B Ë É l Dive™
Hollandois. Du clou dc girolle royal í qu en fom
dcfcrlpdon.: pourquoi les HollanL5V„„. „ rS § 1 1 $
girofle royal. Sentimens de .quelques an, clou de
laquelle ce fruit à
fontieslndienspour en conferver l'odeur lû d S i ' q“ “
fabuleufes que quelques auteurs ont données'1 i ■ !?ns
royal. D e la récolte des doits de eirofle ôr i S'foflter
couleur quand.ils font nouvellement cuefflis cur
Moluques produifoient autreîois des girofliers o í ' u é “
les deux tfles d’où les Hollandois tirent auiottrd’h d la i0n£
de girofle. Conditions fous lefquelles ils ont confetlé" u i
d en feire commerce. Prix du girofle pour ceux oun’. i f 0,t
de la compagnie. D e l’Huile des clous de girofle fd,e“ M
1 expreflion -, fott par la diftilladon. Il eft i,?cro„!î,ll p“
bien les clous de girofle contiennent d’huile quand on°fes
rapporte des Indes. Liqueur qui refte au fond de U /•
bue après la diftilladon. lu. g § | C o tnm em L m i r e S
peuvent iromper dans le commerce du girofle. Méthode d’en
tirer huile eflenttelle , par l’alembic. Quelle eft la quantité
d huile qu on rente par cette méthode. Maniere de fépa w
l bmle de l eau. Différence entre l’huile qu’on tire avec foin
dans la première difttllation , & l’huile mélangée avec-cellê
S o n " ú‘ r e i£í‘r •CXprCin0", & qu’on S Ü communément en
Hollande. Maniere de sen fervir. Celle de la difloudre.
Celle de la conferver en effervefccnce, produite par le mélange
de cette huile avec l’efprit de nitre. Ibid. é Si l’on
moute un peu de poudre à canon dans le mêlanire, il prendra
feu. Méthode de tirer l’huile eflemielle per dcfilnfum.
(¿uelle eft la quannté qu’on en retire. Il s’en faut de beaucoup
qu on trouve dans l’huile diftillée de cette maniere les mêmes
avantages que par la méthode de l’alembic. Cette méthode-
iert de modèle pour toute, forte d’huiles aromatiques du
meme genre, & pour quelques autres. Qualités & choix de
1 huile de girofle. Elle perd fes efprits quand on la laiffe à
découvert. Elle fe précipite au fond de l’eau, fans rien per-
dre de fes vertus. Qualité du réfidu du clou de girofle après
la diftillation. Ibid. 672. a. Vertus & nfages de l’huile prife
intérieurement, & appliquée extérieurement. Son ufage dans
la paralyfie, la gangrené, la carie des os & le mal de dents^
La do fe, quand on l’emploie pour ranimer le ton de l’cfto*
mac. Préparation dont on peut ufer en ce cas. Ufage des
clous de girofle. Ibid. b. Réflexions fur le commerce du,
girofle. Ibid. 673. a.
G iro f le 8c giroflier des Moluques. Eipece de giroflier nom*
mk tochinca. X V I . 730. a. Les girofliers de l'ifle de Ternate
détruits par les Hollandois. Changement arrivé dès-lors dan?
l’air de cette ille. 1. 235. a. Somme annuelle que lc^Hollan-.
dois paient au roi de Ternate depuis qu’ils ont arraché les
girofliers. X V I . 161. a. Comment on tire l’huile effentielle-
des clous de girofle. VIII. 334. b. Cette huile fujette à être
falfifiée. 338. b. Explofion cauféc par fon mélange avec l’cf-
prit de nitre. X V I . 150. a.
G IR OF LÉ E , ( Culture des fleurs. ) fleur du giroflièr. C ’eft
à fa gloire que les amateurs cultivent la plante qui la donne.
Ses noms en Anglois, en langue Flamande. Giroflées fimples
& doubles, de toutes couleurs. Manieres de les multiplies..
8ç de les cultiver. Soins qu’on prend des giroflées doubles.
V IL 673. a. Maniere de multiplier les giroflées doubles,.
Quelles, font les giroflées doubles particulièrement recherchées
des amateurs: Celles qui s’élèvent de marcottes font,
toujours moins apparentes que de graine. Maniere de les
multiplier de graine. Ibid. b.
GIROFLIER , ou V io lie r , caraétere de ce genre de
plante. On compte trente-quatre efpeces de girofliers. VU.
673. b. I l n’y a que le jaune qui ait attiré les regards de
quelques médecins. Son nom & fa defcription. Principes quu
renferme. Propriétés de fes fleurs. Diverfes préparation^
qu’on en fait. Ibid. 674. a.
Giroflier t en quoi il différé de la julienne. IX. ç6. b.
G iro f lier des Moluques, (B o t .) plufieurs plantes de cette
efpcce tranfportécs en 1771 dans les ifles de France & de
Bourbon. Suppl. III. 226. a.
G IR OM A G N Y , ( Banc d e) en Alface. Ses mines. I. 299-
G I^ O N , ou Guiron, (B la fo n ) définition. Ce mot fignifie
à la lettre l’efpace qui eft depuis la ceinture jufqu’aux genoux
Ecu gironné. VII. 674. a.
Giron, en quoi.il différé de la pointe. Suppl. IV. 4Ç2- •
G IR O N E , (G éo g r .) ville d’Efpagne, patrie de Nicolas
Eymcric , inquifitcur général : fon principal ouvrage.-
67GIRONNÉ,' (B la fo n ) quand il y a dant r* “ plSya° " '
moins de huit pièces, il en faut exprimer le ^ __
tres l’appellent partie coupé y tranohé, taillé. VI • 74* ,
V Z l o A t ) L gironné. M |
Suppl. III. 22v. a. Ç IR O N O ;
G L A
G IR O N O , èn Cataloone. (Géogr .) ville ahcîenïid. ^es
révolutions. Son diocefe. Princes de Gironné. Btilles que Ton
Conferve dans les archives de fon églife. Suppl. III. 226. b.
G 1R 0 V A G U E , ( Hifl. eccl. ) eipece de moines. Leur genre
de vie. VII. 674. a. Réflexion fur les moines qui habitent
leur couvent le moins qu’ils peuvent. Ibid. b.
G IR OU ET TE, (A r t s ) moyen qu’employoit à Athènes
Andrortic de Cyrrhe pour connoitre le vent qui fouffioit.
VII. 674. b. 4
G iroue tte, (A r t s ) ufage qu’on a fait des girouettes
pour la connoifiance des vents. Anémomètre fonnant. Suppl.
111. 226. b.
G irouettes. (M a r in e ) VII. 674. b.
GIR OU E T TÉ , ( Blafon ) tour ou château gi fouetté. Efpece
de girouette appellée panonceau. Des vaffaux qui ont per-
mifiion de mettre des girouettes fur leurs maifons. Suppl. III.
122 6. b.
G 1SIER des oiféaux. 3f l. 437. a. 440. a.
GISORS, (Géogr.) ville du Vexin Normand. Evénemens
relatifs à ce lieu. Suppl. III. 226. b. Ereftion de Gifors en
duché-çairie. Ducs de Gifors. Hommes célébrés dont cette
ville elt la patrie. Obfervation fur.-fon nom latin. Ibid. 227. a.
G 1SPE, efpece d’arme. VII. 396. b.
GISSEY-LE-VIEUX, (Géogr.) en Auxois: marques de
fon ancienneté. Suppl. I. 264. <1.
G IT E , Droit d e , (H ifl. de France.) Nom qu’on lui donne
dans les titres. Les roi» de France le levoient dans les villes,
les évôchés, abbayes, pour les indemnifer des frais du voyage
ou féjour qu’ils failoient fur les lieux. Origine de ce droit,
v i l . 674. b. Les évêques & les abbés le payèrent aulîi pour
la vifite de leur églife. Continuation du droit de gîte hors des
occafions dans lefquelles on le payoit au commencement.
C e droit étoit fixé à une certaine lomme pour chaque évêché
ou abbaye. Taxe de l'abbé du grand monaftere de Tours.
Quelques égliles s’abonnèrent à payer ce droit à une certaine
fomme, foit que le roi vînt ou non les vifiter. Paffage tiré
fur ce fujet des archives de la chambre des comptes. Le droit
de gite. fubfiftoit encore en 1382. Autre droit qui lui a
fuccédé. Ibid. 6 7 ç. a.
Gite y droit de-gîte que les eccléfiaftiques devoient à caufe
de leurs terres. Y . 225. b. 580. b.
G IU LA , faute à corriger dans cet article. Suppl. III. 227. a.
G IV R E , ou frimât^ (P à y flq .) rapports & différences du
givre & de la gelée blanche. Circonftances particulières dails
lefquelles le givre doit fe manifefter. Pourquoi le givre s’attache
particulièrement aux arbres. Les particules d’eau qui
forment le givre qu’on apperçoit fur le's hommes 8c les animaux,
ne'-viennent pas toutes de l’atmofphere. VII. 6 7 j . b.
On doit rapporter au givre cette efpece dc neige qui s’attache
aux murailles, après de longues 8c fortes gelées. Raifon
de ce phénomène. Les réfeaux de glace qu’on obferve quelquefois
aux vitres des fenêtres, font encore une efpece particulière
de givre. Explication du givre.- Pourquoi l’air en fe
refroidiffant abandonne une partie des vapeurs aqueufes qu’il
tenoit auparavant fufpendues. Les congélations qui s’attachent
aux vitres des fenêtres, font quelquefois très-remarquables
far la fingularité des figures qu’elles affeftent. Ibid. 676. a.
xplication de ce phénomene donnée par M. de Mairah.
Maniéré de faire naître en toute faifon du givre artificiel
femblable à celui qui fe forme naturellement. Pourquoi il
eft très-rare de voir du givre à Montpellier, & dans la plus
grande parue du bas Languedoc. Ibid. b.
GlVRE. (H ifl. nat. & B la fo n ) .V il. 676. b.
Givre t maladie des plantes. Suppl. III. 836. a.
G iv r é , (B la fo n ) croix givrée. Etymologie de ce mot.
V I I . 676. b.
G IUSCHON, ou Gius-chan, (H ifl. mod. ) le&eurs de Tal-
coran. Leur nombre dans les mofquées royales. Signification
du mot giufchon. But de la leélure que ces gens-là font
de l’alcoran. V I I . 676. b.
GIUSTANDIL ou Ochrida, (Gèogr .) ville de la Turquie
européenne. Elle eft la patrie de l’empereur Juflinien :
caraftere de cet empereur, 8c de fon regne. Réflexion fur
fon entreprife de réformer la jurifprudence. VII. 677. a.
G L
G LAO E , ( Phyflq. ) la congélation différé de la concentration
qui fe foit par l’évaporation, la précipitation ou la
cryftallifation ; elle différé aufli de la coagulation proprement
dite. Terme du thermomètre auquel l’eau devient
glace. VIL 677. a. Les huiles graffes gelent plus aiféraent.
Les liqueurs fpiritueufes gelent très-difficilement: leur partie
fpiritueufe ne fe gele point dans nos climats. La même
choie a lieu dans le vinaigre, & dans l’huile d’olive. L’ef-
prit-de-viif du thermomètre gele en Laponie à un degré de
froid ordinaire. L’efprit de nitre & la plupart des elprits acide
s, certaines huiles chymiqucs fe glacent aufli très-difficilement.
Le mercure ne fe gele point.
Tome I .
G L A 8 3 7
f â Ê Ë Ê Ë fi e,s -l“ ?". partir des parois du VaÙfeau,
lorfqu il ne ge.e que foiblemem. Différentes pofttions- ¡le ces
filets de glace, différentes figures qui e „ réfultenr. Bulles
i f S i S r x“Cependant il refte eneore be™auc'o &up pds'anird :dmatn s1 * l’ceoanug égllaatciéoen .t
Comment on 1 obferve î formes de ces bulles d’air. Ibid. 678.
a. Maniéré dont fe gelera une eau purgée d’air. Malgré tôm*
tes les précautions qu’on prendra, il reliera toujours dans la
S . , k.,11--- ,pent à la Vuefiniple, & qu’on né
e. L’air raffemblé en bulles dans là
- . . . - que dans ion état naturel. Obfer^
valions fur l’augmentation du volume de Teau, quand elle
approche de fa congélation. Cette augmentation 11’eft pas
moins fenfible dabs l’eau aftuellement gelée. Ibid. b. Une
fuite de cette dilatation, c’eft la rupture des Vaiffeaux où
elle eft contenue. L’effort avec lequel cette rupture fe fait
quelquefois eft immenfe: expérience qui le montre. Divers
effets de la gelée, qui font une fuite de cette dilatation.
Cette augmentation de volume a aufli lieu dans la glace foite
avec de l’eau purgée d’air : expériences fur ce fujet. La dilatation
de Teau glacée eft une exception apparente à la lot
générale. Figures qu’affeftent les huiles en le gelant. Le via
S. m V e. leVe P^ feuillets. Ibid. 679. â. Hypothefes que les
philofophes ont imaginées pour rendre raifon des phénomènes
qu’on vient d’expofer. Defcartes 8c plufieurs autres
ont cru que la congélation de Teau étoit une fuite nécef-
faire de fon refroidiffement, fans qu’il intervint dans fes
pores aucune matière étrangère. Les gaffendiftes fuppofent
au contraire des corpufcules frigorifiques. Hypothefe de M»
Mufchcnbroek. Toutes les hypothefes desphyficiens fe rédui-
fent dans le fond aux deux premières. Réflexions fur ces
hypothefes : fauteur rejette les particules frigorifiques. Ibid.
b. Explication des divers phénomènes qui ont été raDoortés
ci-deffus. Ibid. 680. a 1 ^
2°. Des phénomènes de la totigelâlion relallveMUt à l'état 6*
a u x ' circonftances où f e trouve Veau qui f e gele. L’eau qu’on
a fait bouillir ne gele pas plus promptement que d’autre
eau. Le mouvement tranflatif de Teau augmentant en quelque
maniéré fa fluidité, apporte toujours du changement à
fa congélation. Ibid. b. Pourquoi la Seine qu‘on voit allez
fouvent à Paris geler d’un bord à Tautte dans des hivers
moins rudes que celui de Ï7O9, ne fut pas totalement prife
cette année-là. Les rivieres commencent à fe gdler commfc
les autres eaux par la furfoce. Un grand vent rend la congélation
plus difficile ; mais un petit vent fec eft toujours
tavorable à la formation de la glace» Le repos fenfible, tant
de la maffe d’eau qu’on expofe à la gelée, que de l’air qui
touche immédiatement cette eau, empêche que Teau ne Ce
gele t quoiqu’elle ait acquis un degré de froid fort fiipérieufr
à celui qui naturellement lui fait perdre fa liquidité. Ibid. 6 8 1.
a. Mais venant à fe geler en conféquence de l’agitation qu’on*
lui donne, elle fait monter le thermomètre au degré ordinaire
de la congélation. Conjeétures de l’auteur fur la cauie
•de ce phénomene. Obfervation à-peu-près femblable pat-
rapport à la cryftallifation.
30. Des phénomènes de la glace lorfqu.'elle eft toiite formée*
•Principaux caractères de la glace. Du degré précis dc la
dilatation 'qu’on obferve darts Teau glacée. I^s bulles d’air
venant à fe réunir à mefure que le froid augmente, 8c à
former des globules plus confidérables, le reffort de cet air
agit plus fortement fur la glace pour la dilater : d’où il fuit
que le volume de la glace doit continuer à augmenter après
qu’elle s’eft formée. Ibid. b. La dureté de la glace furpaffe
celle du marbre 8c de plufieurs autres corps connus. Cette
dureté eft d’autant plus grande, qu’elle a été formée par un
plus grand froid. Palais déglacé conftruitàPétersbourgdurant
le froid de 1740. Canons de glace & mortiers à bombe
conftruits en même tems. Effet de Texplofion de la poudre
dans ces canons. Dans la gelée de 1083, on alloir en car-
roffe fur la Tamife, dont la glace n’avoit d’épaiffeur que
onze pouces. Divers degrés de froid que conçoit la glace,
félon celui du milieu qui l’environne. D ’où vient que la
glace eft communément moins tranfparente que Teau. Ibid.
682. a. Les glaces du Groenland font moins tranfparentes
que les nôtres. La réfraélion de la glace eft un peu moindre
que celle de Teau. La glace eft fujette à s’évaporer très-fortement
, & d’autant plus, que le froid eft plus violent. Expli-
cation que M. de Mairan nous donne de ce phénomené.
Pourquoi les liquides qui ne fe gelent point, s’évaporent de.
même três-confidérablement pendant les grands froids. 0&-
fervattons fur la glace de l’huile d’olive.
40. Des phénomènes de la glace dans fa fonte & du dégel.
La glace fe fond à un degré de froid un peu moindre que
celui qui Ta produite. Les corps folides dont la température
eft au-deffous du froid de la congélation.) fondent la glaCe
d’autant plus v ite , qu’ils la touchent en un plus grand nombre
de points. Ibid. b. La glace fond plus vite fur le cuivre
C C C C C c c c c c
t