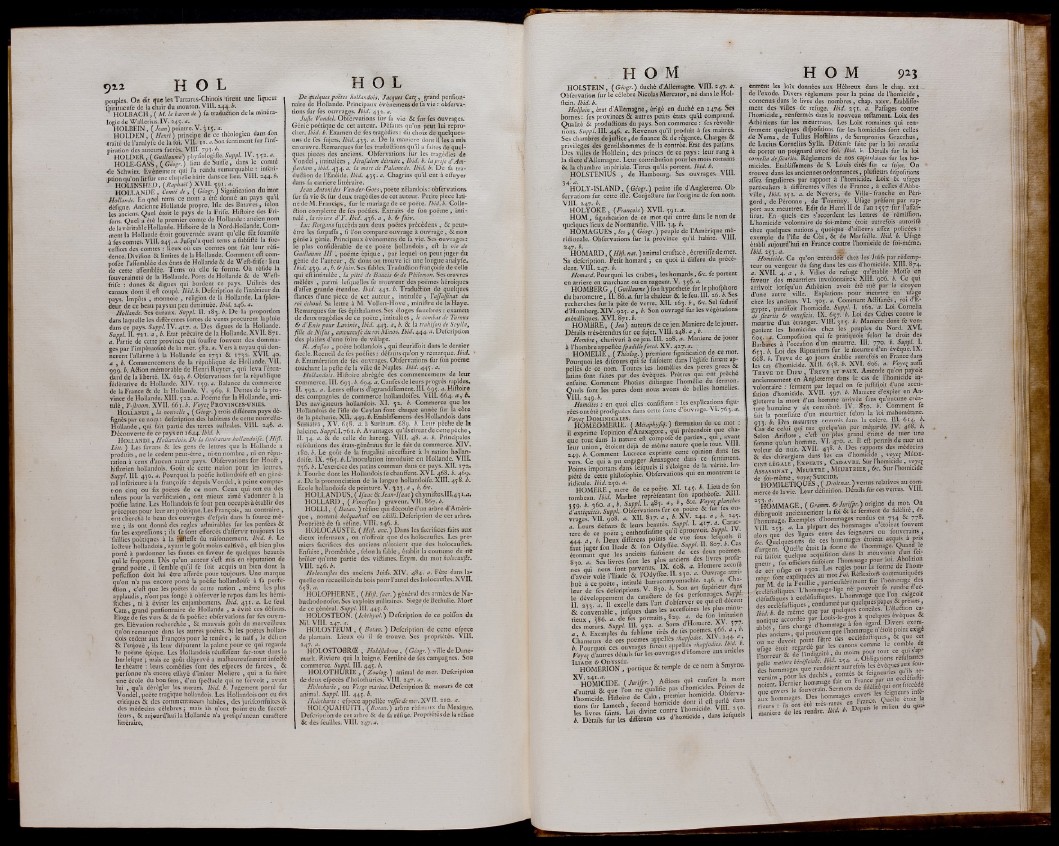
9 2 2 H O L
peuples. On eilt que les Tartarcs-Chinois 'tirent une liqueur
fpiritueufe de la chair du mouton. V I I I . 244. ¿.
H O L B A C H , ( M . le baron d e ) fa traduôion de la minéralogie
de Wallerius. IV . 245. a.
H O L B E IN , p e in t r e .V ^ i5.0.
H O L D E N , { H e n r i) principe de ce théologien dans ion
traité de l’analyie de la foi. V IL 1 1 . ¿.Son fentiment fur lin f -
piration des auteurs facrès. V I I I . 793 • % „ . Txr
H O L D E R , ( Guillaum e) pliyrtologiftc. %>/>/. IV . 352.0.
H O L E -G A S S , C Géogr. ) lieu d c S u iü e , dans le comte
4 e Schwitz. Evénement qui l’a rendu remarquable : inferi-
ption qu’on lirfur une chapelle bâtie dans ce heu. 1 1 . 2 4 4 - *
H O L 1N SH K D , ( Raphael ) X V I I . <91. a.
H O L L A N D E , Comté de , ( Geogr. ) Signification du mot
Hollande. En quel tems ce nom a été donné au pays qu’il
défigne. Ancienne Hollande propre. Ifle des Ba ta ve s, félon
les anciens. Q u e l étoit le pays de la Frifc. Hiftoire des Friions
Qu el a été le premier comm de Hollande : ancien nom
de la véritable Hollande. Hiftoire de la Nord-Hollande. Comment
la Hollande étoit gouvernée avant qu’elle fut foumife
à fes comtes. V I I I . 245. a. Jufqu’à quel tems afubfifté la fuc-
ceftion des comtes : lieux où ces comtes ont fait leur réfi-
dence. D ivifion & limites de la Hollande. Comment eft com-
pofée l’affemblée des états de Hollande & de Weft-frife: lieu
de cette affeniblée. Tems où elle fe forme. Où réfide la
fouveraineté de la Hollande. Ports de Hollande & de Weft-
frife ï dunes & digues qui bordent c e pays. Utilités des
canaux dont il eft coupé. Ibid. b. Defcription de l’intérieur du
pays. Impôts , mounoic , religion de la Hollande. La fplen-
deur de ce beau pays un peu diminuée. Ibid. 246. a.
Hollande. Scs canaux. Suppl. 11. 183. b. D e la proportion
dans laquelle les différentes lortes de vents procurent la pluie
dans ce pays. Suppl. IV< 417. a. Des digues de la Hollande.
Suppl. II. 72 1 . a , b. Etat précaire de la Hollande. X V I I . 871.
a . Partie de cette province qui fouffre fouvent des dommages
par l’impétuouté de la mer. 582. a. V e r s à tuyau qui donnèrent
l’allarme à la Hollande'en 1731 & 1732. X V I I . 40,
a , b. Commencemens de la république de Hollande. V I I .
999. b. A&ion mémorable de Henri R u y tc r , qui leva l’étendard
de la liberté. IX. 629. b. Obfervations fur la république
fédérative de Hollande. X IV . 150. a. Balance du commerce
de la France 8c de la Hollande. V . 969. b. Dettes de la province
de Hollande; XIII. 522. a. Poëme fur la H ollande, intitulé
, Y-ßroom. X V I I . 6 6 1 . b. Voye.£ P r o v in c e s -u n ie s .
H o l lan d e , la nouvelle , ( Géogr. ) trois différenspays dé-
fignés par ce nom : defcription des habitans de cette nouvelle-
Hollandc , qui fait partie des terres auftrales. V I I I . 246. a.
Découverte dé ce pays en 16 4 4 . Ibid. b.
H o l l a n d e , Hollandois. D e la littérature hollandoife. {H iß . ,
L itt . ) Les favans 8c les gens de lettres que la Hollande a
produits, ne le cèdent peut-être, ni en n ombre, ni en réputation
à ceux d’aucun autre pays. Obfervations fur H o o f t ,
hiftorien hollandois. Goût de cette nation pour les lettres. .
Suppl. III. 430. a. Pourquoi la poéfie hollandoife eft en général
inférieure à la françoife : depuis V o n d e l, à peine compte-
t-on cinq ou fix poètes de ce nom. C eu x qui ont eu des
talens pour la verfification , ont mieux aimé s’adonner h la
poéfie latine. Les Hollandois fe font peu occupés à établir des
préceptes pour leur art poétique. Les F rançois, au contraire ,
ont cherché le beau des ouvrages d’efprit dans la fource même
; ils ont donné des règles admirables fur les penfées 8c
fur les expreflions ; ils fe tont efforcés d’affervir toujours les
'faillies poétiques à la jSfteffe du raifonnement. Ibid. b. Le
Ic&eur nollandois, ayant le goût moins cu ltiv é , eft bien plus
porté à pardonner les fautes en favéur de quelques beautés
qui le frappent. D è s qu’un auteur s’eft mis en réputation de
grand poète , il fcmble qu’il fe foit acquis un bien dont la
poffemon doit lui être aflitrée pour toujours. Une marque
qu’on n’a pas encore porté la poéfie hollandoife à fa perfe-
ô io n , c ’eft que les poètes de cette nation , même les plus
applaudis, n’ont pas fongé h obferver le repos dans les hémi-
ftiches, ni à éviter les enjambemens. Ibid. 431. a. Le feul
C a t z , grand penftonnairc de Hollande , a évité ces défauts.
Eloge de fes vers 8c de fa poéfie : obfervations fur fes ouvrages.
Elévation recherchée , 8c mauvais goût du merveilleux
qu’on remarque dans les autres poètes. Si les poètes hollandois
cedent aux François pour le tendre , le n a ï f , le délicat
8c l’enjoué , ils leur difputent la palme pour ce qui regarde
le poëme épique. Les Hollandois réuflinent fur-tout dans lp
burlefque ; mais ce goût dépravé a malheureufement infeété
le théâtre : leurs comédies font des efpeces de fa r c e s , 8c
perfonne n’a encore effayè d’imiter Moliere , qui a fu faire
une école du bon fens, d’un fpeâacle qui ne f e r v o i t , avant
lui , qu’à dérégler les moeurs. Ibid. b. Jugement porté fur
V o n d e l, poète tragique hollandois. Les Hollandois ont eu des
critiques 8c des commentateurs habiles, des jurifconfultes 8c
des médecins célébrés ; mais ils n’ont point eu de fuccef-
feurs , 8c aujourd'hui la Hollande n’a prelqu’aucim caraétere
littéraire*
H O L
D e quelques poètes hollandois. Jacques Cat{ , grand penfioA*
nairc de Hollande. Principaux événemens de fa v ie : obfervations
fur fes ouvrages. Ibid. 43 2. a.
Julie Vondel. Obfervations fur fa v ie 8c fur fes ouvrages.
Génie poétique de cet auteur. Défauts qu’on peut lui reprocher.
Ibid. b. Examen de fes tragédies : du choix de quelques-
uns de fes fujets. Ibid. 433. a. D e la maniéré dont il les a mis
en oeuvre. Remarques fur les traduélions qu’il a faites de quelques
pièces des anciens. Obfervations fur les tragédies de
V o n d e l, intitulées , Jérufalem détruite , Ibid. b. la prife d ’A in -
jlcrc iam , ibid. 43 4. a. la mort de Palamede. Ibid. b. D e fa traduction
de l’Enéide. Ibid. 435. a. Chagrins qu’il eut à eflùyer
dans fa carrière littéraire.
Jean Antonides Van-der-Goes -, poète zélandois : obfervations
fur fa vie 8c fur deux tragédies de cet auteur. Petite piece latine
de M. Franchis, fur le mariage de ce poète. Ibid. b. C o lle ction
completre de fes poéfies. Extraits de fon p o ëm e , intitulé
, la rivière d 'Y . Ibid. 436. a , b. & fu iv .
L u c Rotgans fuccéda aux deux poètes précèdens , 6c peut-
être les furpaffa , fi l’on compare ouvrage à ouvrage , 8c non
génie à génie. Principaux événemens de fa vie. Ses ouvrages:
le plus confidérable de ce poète hollandois , eft la vie de
Guillaume I I I ', poëme épique , par lequel on peut juger du
génie de l’au teu r , 8c dont on trouve ici une longue analyfe.
Ibid. 439. a ,b .& J 'u iv . Ses fables.Traduction françoife de celle
qui eft intitulée , la piété de Bau cis 8* de Philcmon. Ses oe uvres
mêlées , parmi lefquelles fe trouvent des poèmes héroiquès
d’affez grande étendue. Ibid. 442. b. Traduction de quelqueis
fiances d’une piece de «et au teu r , intitulée , Yaffiijjinat d u
roi échoué. Sa lettre à M. V o llen -H o v e , miniftre de la Haye.
Remarques fur fes épithalames. Ses éloges funebres : examen
de deux tragédies de ce p o è te , intitulées, le combat de Turnus
6* d 'E n ce pour L a v in ie t Ibid. 443. a, b. 8c la trahifon de Scy lla y
f ille de N t fu s , amoureufe du roi Mino s. Ibid. 444. a. Defcription
des plaifirs d’une foire de village.
R . A nfloo , poète hollandois, qui fleuriffoit dans le dernier
fiecle. Recueil de fes poéfies : défauts qu’on y remarque. Ib id. •
b. Enumération de fes ouvrages. Obfervations fur fon poëme
touchant la pefte de la v ille de Naples. Ibid. 445. a.
Hollandois. Hiftoire abrégée des commencemens de leur
commerce. III. 693. b. 694. a. Caufes de leurs progrès rapides.
II. 592. a. Leurs efforts d’agrandiffement. III. 695. a. Hiftoire
des compagnies de commerce hollandoifcs. V I I I . 664. <*,' k .
D e s navigateurs hollandois. X I. 52. b. Commerce que les
Hollandois de l’ifle de Ce ylan font chaque année fur la côte
de la pêcherie. XII. 4 4 9 .0. Etabliffemens des Hollandois dans
Sumatra , X V . ¿58. a. à Surinam. 680. b. Leur pêche de la
baleine. S u p p l .I .y ô i .b . Avantages qu’ils tirent de cette pêche ,
II. 34. a. 8c de celle du hareng. V I I I . 48. a. b. Principales
réfolutions des états-généraux lur le fait du commerce. X IV .
180. b. L e goût de la frugalité néceffaire à la nation hollandoife.
IX . 765. ¿. L ’inoculation introduite en Hollande. V I IL
756. b. L ’exercice des patins commun dans ce pays. X II. 172 .
b. Tourbe dont les Hollandois iè chauffent. X V l. 468. b, 469.
a. D e la prononciation de la langue hollandoife. XIII. 458. b .
Ecole hollandoife de peinture. V . 3 23. a , b. & c .
H O L L A N D U S , ( Ifaac 8 cJ ea n - lfa a c ) chymiftes.III.431.a.
H O L L A R D , ( Fmcejlas ) graveur. V I I . 867. b.
H O L L I , I Botan. ) refine qui découle d’un arbre d’Améri-
ue , nommé holquahutl ou chilli. Defcription de cet arbre*
ropriété de fa rétine. V I I I . 246. b.
H O LO C A U S T E . ( H ift. a n c .) Dans les facrifices faits aux
dieux infernaux, on n’offroit que des holocauftes. Les premiers
facrifices des anciens n’étoient que des holocauftes.
Enfuite, Prométhée , félon la fable, établit la coutume de ne
brûler qu’une partie des viétimes. Etym. du mot holocaufie.
V I I I . 246. b.
Holocauftes des anciens Juifs. X IV . 484. a. Fête dans laquelle
on rccueilloit du bois pour l'autel des holocauftes. X V I I .
058. a.
H O LO PH E R N E , {H i f t . fa c r . ) général des armées de Na-
buchodonofor. Ses 'exploits militaires. Siege de Bethulie. Mort
de ce général. Suppl. III. 445. b.
H O LO S T E O N . { I c h th y o l.) Defcription de ce poiffon du
Nil. VIII. 247. <*.
H O LO S T EUM , | Botan. ) Defcription de çette efpece
de plantain. Lieux ou il fe trouve. Ses propriétés. V I I I .
247. a.
H O LO S T O B ROE , Holdftebrou , ( Géogr. ) v ille de Danemark.
Riviere qui la baigne. Fertilité de les campagnes. Son
commerce. Suppl. III. 445. b.
H O LO TH U R IE , ( Z oo log. ) animal de mer. Defcription
de deux efpecés d’holothuries. VIII. 247. a.
Holothurie , ou Verge marine. Defcription & moeurs de cet
animal. Suppl. III. 445. b.
Holothurie : efpece appcilèe vejfie de mer. X VII. 210. a.
H O L Q U A H U IT I , {B o ta n .) arbre réfinsux du Mexique.
Defcription de cet arbre 8c de fa réfiïjé.' Propriétés de la réfine
& des feuilles. V I t l . 247. a.
H O M
H O L S T E IN , ( Géogr. ) duché d’Allemagne. V lt t . ¿47- à-
Obfervation fur le célébré Nicolas M ercator, né dans le Hol-
ftein. Ibid. b.
H o lf te in , état d’Allemagne, érigé en duché en 1474« Ses
bornes : fes provinces & autres petits états qu’i l comprend.
Qualité 8c produftions du pays. Son commerce : fes révolutions.
Suppl. IIL 446. a. Revenus qu’il produit à fes maîtres.
Ses chambres de juftice, de finance & de régence. Charges 8c
privilèges des gentilshommes de la contrée. Etat des païfans.
D e s villes de Holftein j des princes de ce pays : leur rang à
la dicte d’A llemagne. Leur contribution pour les mois romains
& la chambre impériale. Titres qu’ils portent. Ibid. b.
H O L S T E N IU S , de Hambourg. Ses ouvrages. VIII.
34H Ô L Y - IS L A N D , ( Géogr.) petite ifle d’Angleterre. Ql>
fervations fur cette ifle. Conjeélure fur l’origine, de fon nom.
V I I I . 247. b.
H O L Y O K E , {F ra n ç o is ) X V I I . 5 9 1 .* .
H O M , fignifiçation de ce mot qui entre dans le nom de
quelques lieux de Normandie. V I I I . 34. b.
H OM A G U E S , les , ( Géogr.) peuple de l’Amérique méridionale.
Obfervations. fur la province qu’il habite; V I I I .
a 47' . ».
H O M A R D , {H ift . nat. ) animal cruftacé, écreviffe de mer.
Sa defcription. Petit homard ; en quoi il différé du précé- ^
dent. V I I I . 247. b.
Homard. Pourquoi les crabes, les homards, & c . fe portent
en arriéré en marchant ou en nageant. V . 3 56. a.
H OM B E R G , ( Guillaume ) fon hypothefe fur le phofphore
du baromètre , II. 86. a. fur la chaleur 8c le feu. III. 26. b. Ses
recherches fur la pâte de verre. XII. 163. b , 6*c. Sel fédatif
d ’Homberg. X IV . 925. a , b. Son ouvragé fur les végétations
métalliques. X V I . 871. b.
H O M B R E , ( J e u ) auteurs de c e jeu . Maniéré de le jouer.
Détails très-étendus fur ce fujet. V I I I . 248. a , b.
Hombre, charivari à c e jeu . III. 208. a . Maniéré de jouer
à l’hombre appellèe fpad ille forcé. X V . 427. a.
H O M E L IE , ( Théolog.) première fignifiçation de ce mot.
Pourquoi les difeours qui fe faifoient dans l’églife furent ap-
pellés de ce nom. Toutes les homélies des peres grecs &
latins font faites par des évêques. Prêtres qui ont prêché
enfuite. Comment Photius diftingue l’homélie du fermon.
Q u e ls font les peres dont nous avons de belles homelies.
V I I I . 249. b. ■ . V
Homélies : en quoi elles confiftent : les explications figurées
ont été prodiguées dans cette forte d ouvrage. V I . 763* a‘
Voy ez D o m in ic a l e s . .
HOM ÉOM ER IE . {M é ta p h y f iq .) formation de ce mot :
il exprime l’opinion d'Anaxagore, qui prétendoit que chaque
tout dans la nature eft compofé de parties , q u i, ayant
Leur u n ion , étoient déjà de même nature que le tout. VIII.
240. b. Comment Lucrèce exprime cette opinion dans les
vers. C e qui a pu engager Anaxagore dans ce fentiment.
Points importans dans lefquels il s’éloigne de la vérité. Inv
piété de cette philofophie. Obfervations qui en montrent le
ridicule. Ibid. 250. a . _ , f
H OM ER E , mere de ce poete. XI. M ï- ¡ ¡ ¡ g [ ° n
tombeau. Ibid. Marbre repréfentant fon apothéofe A l i i .
,5 9 . b. 360. i:'; b. Suppl. 1. 4 8 5 . / .
V L l q u L . Suppl. Obfervations fur ce W k & fnr k s ou-
vraees. V U . 908. XII. 817. « . »• X V -M 4- - . *4 5
u. le u r s défauts & leurs beautés. Suppl. I. 4t 7 - ‘>- Caractère
de ce poète ; enthoufiafme ¡ ¡ g ép rou v â t. Suppl. IV .
444- g é. b e u x différées points de vue fous k ^ e l s .
faut juger fon Iliade & fon Odyffée. Suppl. II. 807. b. Cas
étonnant que les anciens faifoient de ces deux poemes.
8 ,0 4 S « livres font les plus anciens des hv tes profanes
qui nous font parvenus. IX . 608. | Homere accufé
d’avoir v o lé l’Iliade & l’Odyffée. II. 230. a. Ouvrage attribué
à ce poete intitulé batracomyomachie. 146, o. »
leur de f e s deferiptions. V . 830. é. Son art.fupéneur * n s
le développement du caraffere de fes pcrfonnagcs. 5^
II. 233. i . Il excelle dans l’art d’obferver « q u .e ftd é ce t
& con v en ab le , jufques d an s les acceffo,tes les p l ~ -
tieux , 586. e. de Pes portraits, 829. 4. de fo n .m .talion
des moeurs. S u p p l III. 91 a. u Sorts dK omcre X V . ^ y y .
4 , 1 Exemples tlu fublime d ré sd e ie sp o em e s . , « é e i .
Chanteurs de ces poèmes appcllés 24+ ,
b. Pourquoi ces ouvrages furent appellés " • ■
i | f | d’autres détails fur les ouvrages d Homere aux articles
IUHOMERlDO N , portique 8c temple de ce nom à Smyrne.
^ H O M IC ID E . ( Jurifpr. ) Aélions qui caufent la mort
d’amn.1 & que l’on n f qualifie pas d’homicdes. Peine de
uautrui M , - premier homicide. Obfervaî
i t r ™ r ^ n d g g
les livres faints. L o i divine contr^ . . . , iefquels
b. Détails fur les différais cas d’honucide, dans lelqueis
H O M 923
entrent les loix données aux Hébreux dans le chap. x x t -
de l’exode. Divers réglemens pour la peine de l’homicide »
contenus dans le livre des nombres, chap. xxxv. Etabliffe-
ment des ville s de refuge. Ibid. 251. a . PalTages contre
l'homicide, renfermés dans le nouveau teftament. Loix des
Athéniens fur, les meurtriers. Les Loix romaines qui renferment
quelques diipofitions fur les homicides font celles
de N um a , de T ullus Hoftilius , de Sempronius Gracchus,
de Lucius Cornélius Sylla. Défenfe faite par la loi Cornelia
d e porter un poignard avec foi. Ibid. b. Détails fur la loi
comelia de ficarïis. Réglemens de nos capitulaires fur les homicides.
Etabliffemens de S. Louis cités fur ce fujet. O n *
trouve dans les anciennes ordonnances, ptufieurs diipofitions
affez fingulieres par rapport à l’homicide. L o ix 8ç ufages
particuliers à différentes villes de F ran ce, à celles d’Abbe-
v i l le , Ibid. 252. a. de N e v e r s j de V ille -fran ch e en Péri1
g o rd , de Péronne * de Tourn a y. Üfage préfent par rapport
aux meurtres. Edit de Henri II de l’an 1557 fur l’affaf-
iinat. En quels cas s’accordent les lettres de rémiflion*
L ’homicide volontaire de foi-même étoit autrefois autorifë
chez quelques nations, quoique d’ailleurs affez policées :
exemple de l’ifle de C é a , & de Marfeille. Ibid. b. Ufage
établi aujourd’hui en France contre l’homicide de foi-même*
Ibid. 253. a. :dBÎ .
Homicide. C e qu’on entendoit ch e z 'le s ’Juifs par rédempteur
ou vengeur du fang dans les cas d’homicide. XIII. 874*
a. X V I I . 4. a , b. Villes de refuge qu’établit Moïfe eh
faveur des meurtriers involontaires. XIII. 906. b. C e qui
arrivoit lorfqu’un Athénien aVoit été tué par le citoyen
d’une autre ville. Expiations pour hieurtre én ufage
chez les anciens. V I . 305. a. Comment Aétifanès , roi d’E*
g y p te , purtiffoit l’homicide. Suppl. I. 162. a. Loi Comelia
de ficariis 6» veneficie. IX . 657. ¿. Loi des Celtes contre le
meurtre d’un étranger. VIII. 315. b. Maniere dont fe v en -
geoient les homicides chez les peuples du Nord. X V I .
605.411. Compofition qui fe pratiquoit félon le droit des
Barbares à l’occafion d’un meurtre. III. 770. b. Suppl. I .
653. b. Loi des Ripuariens fur le meurtre d ’un évêque. IX .
668 b T r e v e de 40 jours établie autrefois en France dans
les cas d’homicide. M IL 658. b. X V I . 606. ¿t. Voye{ aufli
T r e v e d e D ie u , T r e v e e t p a ix . Amende qu on payoït
anciennement en Angleterre dans le cas^de l’homicide involontaire
: ferment par lequel on fe juftifioit d. une accu-
fanon d’homicide. X V I I . 397- *■ Maniere d’expier en Angleterre
la mort d’un homme arrivée fans quaucune crea-
ture humaine y ait contribué. IV . ? 5o. b. Comment fe
fait la pourfuite d’un meurtrier félon la loi mahométane*
933. b. D e s meurtres commis dans la colore. III. 614- »•
Cas de celui qui rue quelqu’un par mégarde, IV . 468. b.
Selon A r if to te ,' c ’eft un plus grand crime de tuer une
femme qu’un homme. V I . 47®'. "■ 11 permis de tuer un
voleur de nuit. X V II. 438. b. Des rapports des médecins
8c des chirurgiens dans les cas d’homicide , voyez Mede-
CINÍ LÍGALE, E x p e r t s , C a d a v r e . S u r i homicide, voytr
A s s a s s in a t , M e u r t r e , M e u r t r i e r , 6v. Sur 1 homicide
de loi-même, voyer S u ic id e . t
H OM IL E T IQ U E S , ( Droilnat. ) vertus relatives au commerce
de la vie. Leur définition. Détails fur ces vertus. VIII.
“ ’ h o m m a g e , ( Gramm. «■ Jurifpr.) origine du mon On
diftinguoit anciennement la foi 8c le ferment de fid d u é , de
l’hommage. Exemples d’hommages rendus en 734 8c 7 / ».
V I I I 2?2. a. La plupart des hommages netoient fouvent
alors que des ligues entre des feigneurs ou fouverains >
&c. Quelques-uns de ces hommages étoient acqins à prix
d’areent. Q u elle étoit la forme de 4 hommage. Quand le
roi faifoit quelque acquifirion dans la mouvancè d un fei-
gn eu r , fes officiers faifoient l’hommage pour lu,. Aboi[mon
l e cet ufage en 1302. Les regles pour la forme de lhom*
m , ‘ font expliquées au mot é d . Réflexions communiquées
nar°M de la Feu illie, particulièrement fur I hommage des
eedéfiaftiques. L ’hommage-lige né- pouvoit fe rendre d ec.
ciéfiaffiques à eedéfiaftiques. L’hommage que Ion exjgeoit
des ecclêfiaftiques, condamné par quelques papes 8cprélats ,
■ i l S 1 1 1 ^ à°queîque^ é v ^ u e s 8c
S Uefans°charge d’hommage à fou égard Divers' e x e »
ufage6 êioh regardé par les canons comme le comble de
noient. Dernier liommsgc a fidélité qui ont filccédé
que envers le fouverain. Sermens d e ¡nft.
aux hommages. Des hommages Quelle étoit la
rieurs.: ils ont miUc. du qua'
maniere de les rendre. Ibid. b. «SÇW