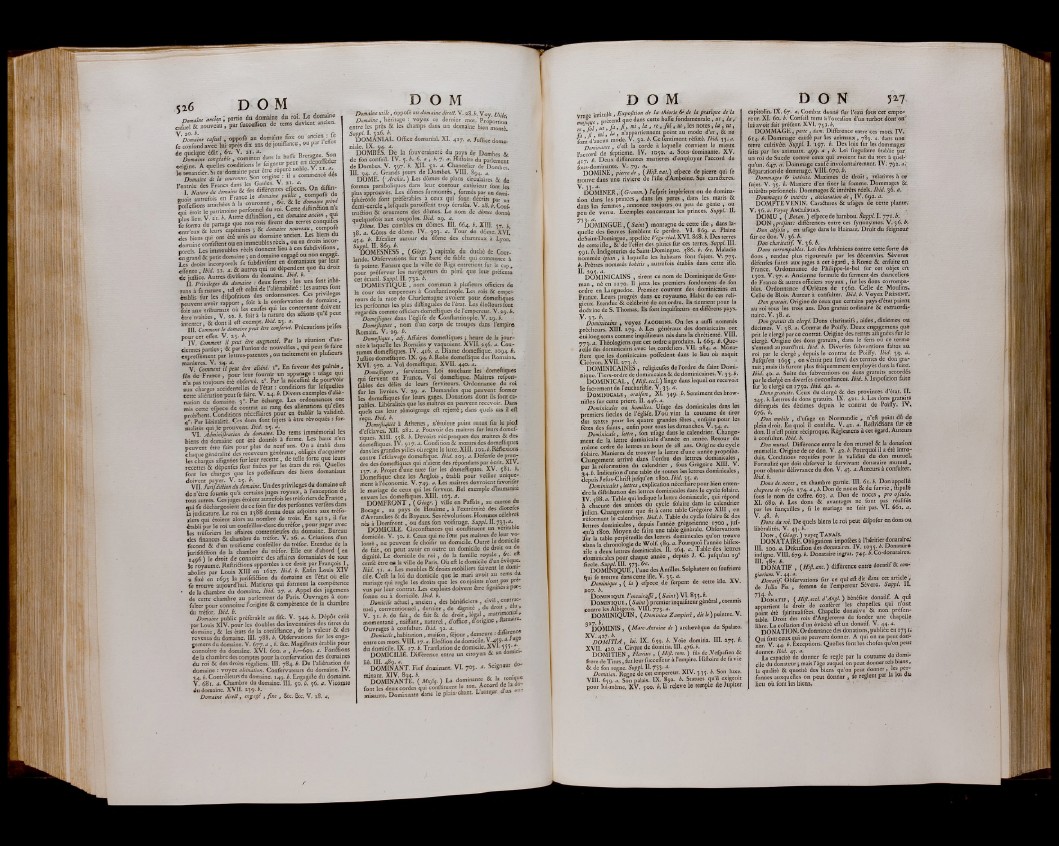
52.6 d o m
Domaine ancien \ partie du domaine du roi. Le domaine
cafuel & nouveau, par iiicccffion de tems devient ancien.
V 'Domaine cafuel, oppofé au domaine fixe
fc confond avec lui après dix ans de jouiffance, ou par
icz t z i ^*jsfâÈE origine. A quefle, conditions 1= 1ôrigneur pour on dipoffider
le tenancier? Si ce1 domaine peut toer fpnti noHe-V-ari a
Domain, de la couraane. Son origine . .1 a commence
r T Î t a 5 S d E r f S c Tes différentes cfpcce. O n j f c
qui étoit le patrimoine perfonnel du roi. Cette diflintomna
ntu. lieu V ai. é. Autre diftinâton, en domaine ancien , qui
?e forma du partage que nos rois firent des terres conquit«
entrieux & leurs capitaines ; & domaine nouveau, compofc
des biens qui ont été unis au domaine ancien. Les biens du
domaine ctUflent ou en immeubles réels ou en droits mcor-
norcls. Les immeubles réels donnent lieu à ces fubdnnfions
en grand 8c petit domaine ; en domaine engagé ou non engagé.
Les droits incorporels fc fubdivifent en domanuux parleur
effence, lbid. as; a. 8c autr« qm ne dépendent que du droit
de indice. Autre divifions du domaine, liai. |
II Privilèges du domaine : deux forte : les uns font inbé-
rens à fa nature, tel ell celui de l'aliénabibté t les autres font
établis fur 1« difpofitions d e ordonnances. Ces privilèges
peuvent avoir rapport, foit à la confervation du domaine,
L aux tribunaux où l e caufes qui les concernent tfoivent
être traitées, V. aa. b. foit 1 cire iraiicc», ». -■-*-------l-a- -n ,ature des aflions qutl peut
intenter, 8c dont il ell exempt. Ibtd. a t. a.
IIL Comment te domaine peut être confervé. Précauuons pnfes
pour cet effet. V. 23. é- , „ , „
IV. Comment il peut être augmenté. Par la réunion «anciennes
parti« ; 8c par l'union de nouvelle, qui peut fc faire
expreffément par lettres-patente, ou tacitement en pluficurs
^ C om m en t il peut être aliéné, 1°. En faveur d e puînés,
fils de France, pour leur fournir un appairage : uûge qui
n'a pas toujours été obfcrvé. a". Par la néceffité de pourvoir
aux charges accidentelle de l’état ; condmons fur lefquelles
cette aliéSation peut fc faite. V . 24- b. Divers exemple d aliénation
du domaine. 3”. Par échange. Les ordonnances ont
e 1 - - - - I1M *lllpf1gtlA11C f lll fiUCf nation au aomainc.j ------------------------------.------- , ,
mis cette cfoece de contrat au rang des ahénanons qu elles
prohibent. Conditions néceffaires pour en étabbr la validué.
40. Par libéralité. Ces dons font fujets a être révoqués : formalités
qui le prouvent. Ibid: 23. a. ,
VL Adminifiration du domaine. De tems immémorial les
biens du domaine ont été donnés à fe rm e . Les baux nen
peuvent être faits pour plus de neuf ans. On a établi dans
chaque généralité des receveurs généraux, obligés d acquitter
les charges affignées fur leur recette, de telle forte que leurs
recettes & dépenfes font fixées par les états du roi. Quelles
font les charges que les poffeffeurs des biens domaniaux
^°'Vu!jm/d1âion du Jômaine. Un des privilèges dii domaine eft
de notre fournis qu’à certains juges royaux, à 1 exception de
tous autres. Ces juges étoient autrefois les tréfoners de France,
qui fe déchargeoient de ce foin fur des perfonnes verfées dans
U judicature. Le roi en 1388 donna deux adjoints aux tréfo-
riers qui étoient alors au nombre de trois. En *412., il fut
¿tabli par le roi un confeiller-clerc du tréfor, pour juger avec
les tréforiers les affaires contentieufes du domaine. Bureau
des finances & chambre du tréfor. V. 26. a. Créations d’un
fécond & d’un troifieme confeiller du tréfor. Etendue de la
iurifdiftiôn de la chambre du tréfor. Elle eut d’abord (en
1496 ) le droit de connoître des affairés domaniales de tout
le royaume. Reftriâions apportées à ce droit par François I ,
abolies par Louis XIII en 1627. lbid. b. Enfin Louis XIV
a fixé en 1693 la jurifdiâion du domaine en léiat ou elle
fe trouve aujourd’hui. Matières qui forment la compétence
de la chambre du domaine, lbid. 17. a. Appel des jùgemens
de cette chambre au parlement de Paris. Ouvrages à con-
fulter pour connoître l'origine & compétence de la chambre
du tréfor. lbid. b. . , , L
Domaine public préférable au fifc. V. 344. b. Dépôt créé
par Louis XIV. pour les doubles des inventaires des titres du
domaine, & les états de la confiftance, de la valeur 8c des
revenus du domaine. III. 788. b. Obfervations fur les enga-
gemens du domaine. V. 677. a , b. Scc. Magiflrats établis pour
connoître du domaine. XVI. 600. a , b.—6ç>2. a. Fonoions
de la chambre des comptes pour la confervation des domaines
du roi & des droits régaliens. III. 784. b. De l’aliénation du
domaine : voyez aliénation. Confervateurs du domaine. IV.
34. b. Contrôleurs du domaine. 149. b. Engagifle du domaine.
V. 681. a. Chambre du domaine. HI. 50. b. 56. a. Vicomte
du domaine. XVII. *39-
Domaine direÛ, engagé | fixe, &c. &c. V . 28. -
D O M
Domaine utile, oppofé au domaine direff.V. 28. b. Voy. Utile'
Domaine, héritage : voyez ce dernier mot. Proportion
entre les prés & les champs dans un domaine bien monté.
Suppl. I. 326- b. .- .
DOMANIAL. Office domanial. XI. 417. a. Juftîce domaniale.
IX. 94. a.
DOMBES. De la fouveraineté du pays de Dombes &
de fonconfeil. IV. 5.b. 6. a , b.7. a. Hiftoire du parlement
de Dombes. V. 597. b. XIL fi7" a- Chancelier de Dombes.
III. 94. a. Grands jours de Dombes. VIII. 894. a.
DOME. ( Arch'u. ) Les dômes de plans circulaires 8c de
formes paraboliques dans leur contour extérieur font les
plus approuvés. Les dômes furmontés, formés par un demi-
fphéroide font préférables à ceux qui font décrits par un
demi-cercle , lelqucls paroifferit trop écrafé*. V . 28. b. Conf-
trudion & ornemens des dômes. Le nom de dômes donné
quelquefois aux coupoles, lbid. 29. a.
Dôme. Des combles en dômes. III. 664. b. XIII. 37. b.
38. a. Côtes de dôme. IV. 303. a. Tour de dôme. XVI.
454. b. Efcalier autour du dôme des chartreux à Lyon.
Suppl. II. 869. b.
DOMESNESS , ( Giop. ) capitale du duché de Cour-
lande. Obfervations fur un banc de fable qui commence à
fa pointe. Fanaux que la ville dé Riga entretient fur le cap,
pour préferver les navigateurs du péril que leur préfente
cet écueil. Suppl. II. 732. b.
DOMESTIQUE , nom commun à pluficurs officiers de
ht cour des empereurs à Conftantïnople. Les rois 8c empereurs
de la race de Charlcmagnc avoient pour domeffiques
les perfonnes les plus diftinguêes de l’état. Les éleâcurslont
regardés comme officiers domeftfoues de l’empereur. V. 29. b.
Domefliques dans l’églife de Conflandnoplc. V. 29. b.
Domefliques , nom d’un corps de troupes dans 1’empire
Romain. V . 29. b. ■
Domefiique, adj. Affaires domefliques ; heure de la journée
à laquelle les Romains y vaquoient. XVIL 256. a. Coutumes
domefliques. IV. 416. a. Dix me domefiique. 1094. b.
Juflice domefiique. IX. 94. b. Robe domefHque des Romains.
XVI. 370. a. vol domefiique. XVII. 440. a.
Domefliques , ferviteurs. Loi touchant les ” domefliques
qui fervent en France. Vol domefiique. Maîtres refpori-
lables des délits de leurs ferviteurs. Ordonnance du roi
fur les livrées. V. 29. a. Demandes que peuvent former
les domeffiques fur leurs gaçes. Donations dont ils font capables.
libéralités que les maîtres en peuvent recevoir. Dans
quels cas leur témoignage eft rejetté ; dans quels cas il eft
reçu. lbid. b. .
Domefiiques à Athènes, n étoient point tenus fur le pied
d’efclaves. XII. 282. a. Pouvoir des maîtres fur leurs domef-
tiques. XIII. 558. b. Devoirs réciproques des maîtres 8c des
domeffiques, IV. 917. a. Condition 8c moeurs des domeffiques
dans les grandes yilles où regne le luxe. XIII. 102. b. Réflexions
contre lefclavage domefiique. lbid. 103. a. Défenfe de prendre
des domefliques qui n’aient des répondans par écrit. XIV.
137. a. Projet aune taxe fur les domeffiques. XV. 581. b.
Domefiique chez les Anglois , établi pour veiller uniquement
à l’économie. V. 749. a. Les maîtres devraient favorifer
le mariage de ceux qui les fervent. Bel exemple d’humanité
envers les domefliques. XIII. 102. a.
DOMFRONT , ( Géoer. ) ville en PafTais, au canton du
Bocage , au pays de Houlme, à l’extrémité des diocefes
d’Avrancbes 8c de Bayeux. Ses révolutions. Hommes célébrés
né* à Domfront , ‘ou dans fon voifinage. Suppl. IL 733. a.
DOMICILE. Circonftances qui conftituent un véritable
domicile. V. 30. b. Ceux qui ne font pas maîtres de leur volonté
, ne peuvent fe choffir un domicile. Outre le domicile
ddee ftaaiitt,, oonn ppeeuutt aavvooiirr eenn oouuttrree uunn udoummiicuiliet ude* droit ou -dze
dignité. Le domicile du ro i, de la famille royale ,v c . en
cenfé être es la ville de Paris. Où eft le domicile d’un éveque.
lbid. x i. a. Les meubles 8c droits mobiliers fuivent le domicile.
Ceft la loi du domicile que le mari avoit^au tems du
mariage qui réglé les droits que les conjoints n’o n t pas pr -
vus par leur contrat. Les exploits doivent être figmfiés a pet-,
fonne ou à domicile, lbid. b. ,■
Domicile aâuel, ancien , des bénéficiers , civil » contractuel
, conventionnel, dernier, de dignité , de droit, êiu »
V. 31. b. de fait, de fait 8c de droit, légal , matrimoma ,
momentané, naifjant, naturel, d’office, aorigine, futuair .
Ouvrages à confultcr. lbid. 32. a.
Domicile, habitation, mai fon, féjour, demeure : T
entre ces mots. VIII. 17. a. Eleâion de domicile. V-459- a-} °
du domicile. IX- ty. b. Tranftation de domicile. XVI. Ç- f-
DOMICILIÉ. Différence entre un citoyen 8c un domtcir
DOMINANT. Fief dominant. VL 703. a. Seigneur do-
T S m Z n Î È \ Mujiq.) U dominamc Î I M *
font 1« deux corde qui conliiment fc wn A“ «rd de^
urinante. Dominante dans le plain-chant. L auteur a un
D O M D O N
vrase intitulé , Expojltion de la théorie ir de la pratique d e ls
mu/taue prétend que dans cette baffe fondamentale, u t, la ,
fol ’ ut y fa 1 fe » mlt ia » re » f° l » ut • ^es notes » la y tu y
Tf pi ’mi] la » n’appartiennent point au mode d’ut, 8c ne
font d’aucun mode. V . 32. b. Ce fentiment réfuté. Ibid, 33.*.
Dominante, c’cft la corde à laquelle convient le mieux
l’accord de feptieme. IV. 1050. a. Sous-dominante. XV.
4 i7. b. Deux différentes manières d’employer l’accord de
fous-dominante. V. 79. a. ;
DOMINE, pierre de y ( Dift.nat.) efpece de pierre qui fe
trouve dans une riviere de rifle d’Amboine. Ses caraéteres.
BBmINER, (G/wn/n.) l’efprit impérieux ou de domination
dans les princes, dans les peres , dans les maris 8c
dans les femmes, annonce toujours ou peu de génie , ou
peu de vertu. Exemples concernant les princes. Suppl. II,
73Î)OMINGUE, ( Saint) montagne de cette ifle , dans la-'
quelle des fleuves femblent fc perdre. VI. 869. a. Plaine
deSaint-Domingue, appellée Vcga-réal. XVI. 868. b. Des terres
de cette ifle, 8c de l’effet des pluies fur ces terres. Suppl. III.
591. b. Indigoteries de Saint-Domingue. ,586. b. &c. Maladie
nommée ¿pian , à laquelle les habitans font fujets. V*. 77S*
b. Prêtres nommés bohitis , autrefois établis dans cette ifle.
II. 295. a. • ■
DOMINICAINS , tirent ce nom de Dominique de Guz-
man , né en 1170. Il jetta .les premiers fondemens de fon
ordre en Languedoc. Premier couvent des dominicains en
France. Leurs progrès dans ce royaume. Habit de ces religieux.
Etendue 8c célébrité de cet ordre. Ils tiennent pour la
doélrine de S. Thomas. Ils font inquifiteùrs en différons pays.
ÏV* 33. b. . g
Dominicains , voyez Ja ç o b in s . On les a auffi nommés
prêcheurs. XIII. 279. b. Les généraux des dominicains ont
êtélong-tems comme inquifiteurs nés dans la chrétienté. VIII.
773! a. Théologiens que cet ordre a produits. L 663. b. Querelle
des dominicains avec les, cordeliers. VII; 284. a. Mona-
ftere que les dominicains poffedent dans le lieu où naquit
.Cicéron. XVII. 273. é. .
' DOMINICAINES , rellgieufes de l ordre de faint Dominique.
Tiers-ordre de dominicains 8c de dominicaines. V. 33. b.
DOMINICAL, (Hifi. ecçl. ) linge dans lequeLon recevoit
le facremcnt de l’euchanflie. V. 33. a.
D ominic ale, oraifon, XI. 349. b. Sentiment des brow-
niftes fur cette prière. II. 446. a.
Dominicales ou homélies. Ufage des dominicales dans les
premiers ficelés de l’églife. D ’ou.vint la coutume de tirer
des textes pour les quatre grandes fêtes, enfuite pour les
fêtes des faints, enfin pour tous les dimanches. V . 34. a.
Dominicale t lettre y fon ufage dans le calendrier. Changement
de la lettre dominicale d’année en année. Retour du
même ordre de lettres au bout de 28 ans. Origine du cycle
folaire. Maniérés de trouver la lettre d’une année propofée.
Changement arrivé dans, l’ordre des lettres dominicales,
par la réformation du calendrier , fous Grégoire XIII. V.
34. b. Indication d’une table de toutes les lettres dominicales,
depuisJefus-Chrift jufqu’en 1800.lbid.y,. a.
Dominicales, lettres, explication néceffairc pour bien entendre
la diftribution des lettres dominicales dans le cycle folaire.
IV 588 a. Table qui indique la lettre dominicale, qui répond
à chacune des années du cycle folaire dans le calendrier
julien. Changement que fit à cette table Gréeoire XIII, en
réformant le calendrier. Ibid. b. Table du cycle folaire 8c des
lettres dominicales, depuis l’année grégorienne 1700 , juf-
qu’à 1800. Moyen de faire une table générale. Obfervations
ïur la table perpétuelle des lettres dominicales qu on trouve
dans la chronologie de Wolf. 589. ¿. Pourquoi¿.année biffex-
tile a deux lettres dominicales. II. 264*. .Table des lettres
dominicales pour chaque année , depuis J. C. jufquau 19
1CDOMÎ&QUJiPrune des Antilles. Solphatere ou foufriere
bui fe trouve dans cette ifle. V. 35. a.
Dominique y { la ) efpeçe de ferpent de cette ifle. XV.
fc07. b.
DOMINIQUE l'encuirajfi, (Saint) VI. 833.®.
D o m in iq u e , ( Saint) premierinquifiteur général, commis
contre les Albigeois. VIII. 773. a. /
DOMINIQUIN, ( Dominico Zampieri, dit le) peintre. V.
ljOMINIS , ( Marc-Antoine de ) archevêque de Spalato.
DOMITIA y loi. IX. 659. b. Voie domitia. III. 273. b.
XVII. 420. a. Cirque de domitia. III. 476. b.
DOMITIEN , Flavius , (Hifl. rom. ) fils de .Vcfpafien 8c
frere de Titus, fut leur fucceffeur à l’empire. Hiftoire de fa vie
& de fon regne. Suppl. II. 733* , c ,
Domitien. Regne de cet empereur. XIV. 335. ¿. Son luxe.
VIII. 659. ¿. Son palais. IX. 89a. b. Statues quil exigeoit
pour lui-même, XV. 500* é, U rçlcYC le temple de Jupiter
capitolin. IX. 67. a. Combat donné fur l’eau fous cet empereur.
XI. 60. b. Confeil tenu à l’occafion d’un turbot dont on'
lui avoit fait préfent; XVI. 751 .b.
DOMMAGE i perte, dam. Différence entre ces mots. IV,
614. b. Dommage caufé par les animaux , 789. a. dans une
terre cultivée. Suppl. I. 197* f4 Des loix fur les dommages
faits par les animaux. 499. a , b. Loi finguliere établie par
un roi de Sucde contre ceux qui avoient fait du tort à quelqu’un.
647. a. Dommage caufe involontairement. IV. 792. a.
Réparation de dommage. VIII. 67Ö. b.
Dommages & intérêts. Maximes de droit, relatives à ci
fujet, V. 35. bi Maniéré d’en fixer la fomme. Dommages 8c
intérêts perfonnels. Dommages 8c intérêts réels, lbid. 36. a.
Dommages & intérêts , déclaration de , IV. 692. a.
DOMPTE-VENIN. Caraéteres 8c ufagés ue cette plante.
V. 36. a, Voyez AsCLÉPiAS.
DOMU , (Botan.) efpece de bambou, attppl. 1. 771. b.
DON y préfent: différences entre ces fyrionymes. V. 36. F.
Don abfolu , en ufage dans le Hainaut/ Droit du feigneuf
fur ce-don. V. 36. b.
Don charitatif. V. 3 6. t.
Dons corrompables. Loi des Athéniens contre cette forte d&
dons , rendue plus rigoureufo par les décemvirs. Sévères
défenfes faites aux juges à cet égard, à Rome 8c enfuite en
France. Ordonnance de Philippe-le-bel fur cet objet eft
1302. V. 37. a. Ancienne formule du ferment des chanceliers
de France 8c autres officiers royaux, fur les dons corrompa-
bles. Ordonnance d’Orléans de 1560. Celle de Moulins.
Celle de Blois. Auteur à confulter. lbid. b. Voyez P r é s e n t* ;
Don gratuit. Origine de ceux que certains pays d’état paient
au roi tous les trois ans. Don gratuit ordinaire 8c extraordinaire.
V. 38. a.
Don gratuit du clergé. Dons charitatifs, aides, dixièmes oïl
décimes. V. 38. a. Contrat de Poiffy. Deux engagemens què
prit le clergé parce contrat. Origine des rentes affignées fur le
clergé. Origine des dons gratuits, dans le fens ou ce terme
s’entend aujourd’hui, lbid. b. Diverfcs fubventions faites ait
roi par le clergé, depuis le contrat de Poiffy. Ibid: 39. à.
Jufqu’en 1695 , on s étoit peu forvi des termes de don gratuit
; mais* ils furent plus fréquemment employés dans la fuite.
lbid. 40. a. Suite des fubventions ou dons gratuits accordés
par le cleigé en diverfes circonftances. lbid. b. Impofition faite
furie clergé en 1750. Ibid. 42. a. ( '
Dons gratuits. Ceux du clergé 8c des provinces d état. II.
245. b. Lettres de dons gratuits. IX. 421. b. Les dons gratuits
diitingues des décimes depuis le contrat de Poifly. IV',
676. b. > ,
Don mobile , d’ufage en Normandie , n eft poirtt dü de
plein droit. En quoi il confifte. V. 42. a. ReftriélionS fur et
don. Il n’eft point réciproque, Réglemens à cet égard. Auteurs
à confulter. Ibid. b.
Don mutuel. Différence entre le don mutuel 8c la donation
mutuelle. Origine de ce don. V. 42. b. Pourquoi il a été introduit.
Conditions requifes pour la validité du don mutuel;
Formalité que doit obferver le furvivant donataire mutuel ,
pour obtenir délivrance du don. V. 43. a. Auteurs à confulter.
Ibid. b. _
Dons de. noces, ell chambre garnie. III. 61. b. Don appelle
chapeau de rofes. 174. a , b. Don de noces 8c de fur vie, ftijpulé
fous le nom de coffre. 603. a. Don de noces , pro ofeub.
XI. 680. b. Les dons 8c avantages ne font pas réalifés
les fiançailles , fi le mariage ne fuit pas. VI. 661. a.
. 48. b.
Dons du roi. De quels biens le roi peut difpofer en dons ou
libéralités. V . 43. b. ■
1
D o n , (Géogr.) voyrç T a n a ï s . . . . . ,
DONATAIRE. Obligations impôfées à l’héritier donataire.
III. 200. a. Difcuffion des donataires. IV. toU.b. Donataire
indigne. VUI. 679. b. Donataire ingrat. 743. b. Co-donataires.
DONATIF , (Hifl.anc.) différence entre donatif 8c con-
* Donatif. Obfervations fur ce qui eft dit dans cet article ,
de Julia Pia , femme de l’empereur Sévere. Suppl. 11.
73D o n a t i f , ( Hifl. ecel. d'Angl. ) bénéfice donatif. A qui
appartient le droit de conférer les chapelles qui nont
point été fpiritualifées. Chapelle donativc 8c non prèfen-
table. Droit des rois d’Angleterre de fonder une chapelle
libre. La collation d’un évêché eft un donatif. V. 44-*•
DONATION. Ordonnance des donations, publiée en 1731.
Oui font ceux qui ne peuvent donner. A qui on ne peut donner.
V. 44. b. Exceptions. Quelles font les chofes qu’on peut
donner, lbid. 4<. a. , .
La capacité de donner fe regle par la coutume dü tiomir
cile du donateur ; mais l’âge auquel on peut donner tels biens,
la qualité 8c quotité
des Viens qu’on donner, les per-
Tonnes auxquelles 01
lieu où font les biens.
qu on peut donne
Tonnes auxquelles on peut donner , fc règlent par la loi dtt