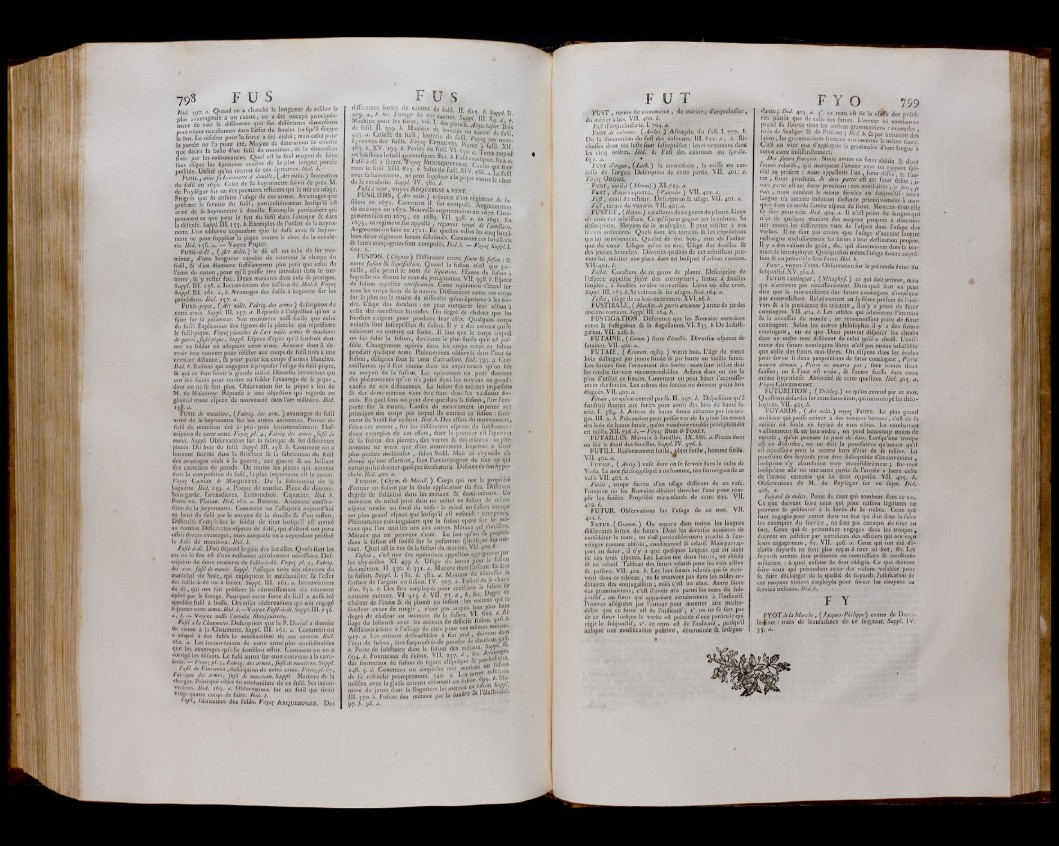
I l F U S
Ibid 197- * Quand on a cherché la longueur de calibre fa
»lus aVanogeüfc à un canon, on a été occupé principale-
intnt Je voir l’a différence que tes différentes dimeniton*
pourraient occafionner dans l’effet du boulet lorfqu’il frappe
le but. Le réfultat pour la force a été établi ; ruais celui pour
la portée ne l’a point été. Moyen de déterminer la courbe
que décrit la balle d’un fufil de munition, de la dimcnfion
fixée par les ordonnances. Quel eft le teul moyen de faire
fans rffque les épreuves cxaâes de la plus longue portée
poffible. Utilité qu’on tirerait de ces épreuves, /¿/Æ b.
Fusil , fit baïonnette à douillet (A r t miliu ) invention
du fufil en idiO. Celle de la bayonnette fuivit de près. M.
de Puyfégur fut un des premiers officiers qui la mit en ufage.
Progrès que fit enfuite l’ufage de ces armes. Avantages que
prétente l e fervice du fufil, particulièrement lorfqu’il eu
armé de fa bayonnette h douille. Exemples particuliers qui
prouvent ce que peut le feu du fufil dans l’attaque 6c dans
{a détente. Suppl. III. 1 55. b. Exemples de l’utilité de la bayon-
nette. V o n omerve cependant que le fufil avec fa bayonnette
tie peut fuppléer la pique contre le choc de la cavalerie.
ll>id. 15 6. a. — V o y e z Pique.
Fusil-à -d é , ( f i n mïlit.) le dé eft un tube de fer tres-
mince, d’une longueur capable de contenir la charge du
fufil, é c d'un diamètre fumfamment plus petit que celui do
l’ame du canon, pour qu’il puiffe être introduit dans le^ tonnerre
, 6c y refter fixe. Deux maniérés dont cela te pratique.
Suppl. III. i ç 6. a. Inconvénient des fufils-à-dé. Ibid.b. Foye[
Suppl. III. 16 t. a ,b . Avantages des fufils à baguette fur les
précédons. Ibid. 15% a. ,
F u s il’pique, ( Ar t mille. Fabria. des armes ) dcfcnption de
cette arme, Suppl. III, 137. a. Réponte à l’ob/eélion qu’on a
faite fur fa pefanteur. Son maniment aufli facile que celui
du fufil. Explication des figures de la planche qui repréfente
le fiifii-pique. Foyeçplanches de l'a n milit. armes b machines
de guerre JuCib-pique, Suppl. Efpece d'épée qu’il faudroit donner
au foldat en adoptant cette arme. Armure dont il de-
vroit être couvert pour réfifier aux coups de fufil tirés à une
certaine diftance, ec pour parer les. coups d'armes blanches.
Ibid, />. Jlaifons qui engagent à propoterj’ufage du fufil-pique,
6c qui en font fentir la grande utilité. Diverles inventions qui
ont été faites pour rendre au foldat l’avantage de la pique,
dont on ne te fert plus. Obtervation fur la pique à feu de
M, de Maizeroy. Réponte à une objeéUon qui regarde en
général toute efpece de nouveauté dans l'art militaire. Ibid.
t 58. a.
F usil de munition, ( Fabriq. des arm. ) avantages du fufil
armé de la bayonnette fur les armes anciennes. Portée du
fufil de munition tiré à -peu -prè s horizontalement, Defcription
de cette arme. Foye{ pl. 4 , Fabriq. des armes Au/il de
munit. Suppl. Obfervations fur la fabrique de tes différentes
pièces. D u bois du fufil. Suppl. III. 158, b. Comment on a
fouvent facrifié dans la ftruaurc 6c la fabrication du fufil
des avantages réels à la guerre, aux grâces 6c au brillant
des exercices de parade. D e toutes les pièces qui entrent
dans la compofition du fufil, la plus importante cil le canon,
Foye^ C anon b Maquette, D e la fabrication de la
baguette. Ibid. 159. a, Plaque de couclie. Pièce de détente.
Sous garde, Grenadieres. Embouchoir, Capucine, Ibid. b.
Porte-vis, Platine, Ibid. 160. a. Batterie. Ancienne confiru-
¿lion de la ^bayonnette. Comment on l’affujertit aujourd’hui
au bout du fufil par le moyen de la douille 6c d'un reffort.
Difficulté d'empêcher le foldat de tirer lorfqu’il eft arrivé
au combat. Différentes efpeces de fufil, qui d'abord ont paru
offrir divers avantages, mais auxquels on a cependant préféré
le fufil de munition. Ibid. b.
FufiUà’di. D ’où dépend le gain des batailles. Quels font les
cas ou le feu efl d’une reffource abfolument néeeflaire. Dcf-
cription de deux maniérés de fufils-à-dé. Foyer pl. / , Fabriq.
des arm. fu f il de munit. Suppl. Raffages tirés des rêveries du
maréchal de Saxe, qui expliquent le méchanifme 6c l’effet
des fufils-à-dé ou à fecrer. Suppl. III. 1 C i . a. Inconvénicns
du d é , qui ont fait préférer le rétrécifferaent du tonnerre
opéré par le forage. Pourquoi cette forte de fufil a suffi été
appellée fufil à boffe. Divertes observations qui ont engagé
à quitter cette arme. Ibid. ¿.— V oyez Fufil-à-dé. Suppl. 111. 1 3 6.
a , b. — V oyez auffi l’article Moufqueterie.
Fufil à la Chaumette. Defcription que le P. Daniel a donnée
du canon à la Chaumette. Suppl. III. 16 1 . a. C om m en t on
a adapté à des fufils le méchanifme de ces canons, Ibid.
a. Les inconvéniens de cette arme plus confidérablcs
quelles avantages qu’elle tembloit offrir. Comment on en a
corrigé les défauts. Le fufil auroit fur-tout convenu à la cavalerie.
— Fjyt^ pl. j , Fabriq. des armes, fu f il de munition. Suppl.
Fufil de Vïncenntt, defcription d e cette arme, Foyeçpl, 6 7 1
Fabrique des armes, fufil de munition. Suppl. Manier« de la
charger. Principal objet du méchanifme de c e fufil. Ses inconvénient
Ibid. 163. a. Obtervations fur un fufil qui tiroir
vingt-miatre coups de fuite. Ibid, b.
¿'“f i l , fabrication des fufils. Foyt i A rquebusier. Des
F U
différentes fortes de canons, de fufil rr r . . . , „
200. b. tyc. Forage de ces « „ „ l I WÊ «•
Machine pour les forer, vol, I. des n h u . l^ j , f 1
de fufil. il. ,09. Í , Maniere Jfe
4/13- «■ Culalfe du fu fil, baircrie de f.iiil r S ' - "
Epreuves des fufils. F e r a Epreuves p; nlm ‘
m \ X V . g P Í. Por tée du M X ï :
on fubftitua le fufil au tnoufquer, 8 ai, ¿ F u f .iL ' r auquel
F,ifd.à.dé à f e c r e r . ^
raier le fufil. XIII. 825. b, Salut du fufil. XI V ,88 , f r n
avec fa baïonnette, ne peut fupp éeràla niuue L.,'. \ ,
de la cavalerie. Suppl. IV. ,80! b 1 1 k cl,M
Fufil à v e n t, v o y e z A rquebuse a vent.
FUSILIERS, ( A n milit. ) création d'un régiment de f.,
fihers en 1671. Comment il fut compofé. Auemenra»il
de ce corps en 167a. Nouvelle augmentation en 1677 Chai*,
gemens faits en 1670, en 1689. VU. 398. CI1 ¡6 0 1 . t n
1693, ce régiment fut appellé, régiment royal de l'artillerie
Augmentation faire en « J § quelles villes les cinq bataib
Ions de ce régiment furent diftribués. Comment ces bataillons
& leurs compagnies font compofés. Ibid. b. — Foye^ Suppl. I.
FUSION. ( Chymie) Différence entre fonte 6c fufion • 8c
entre fufion 6c liquéfaflion. Quand la fufion n’eft que pa£
radie, clic prend le nom de liquation. Efpece de fufion .1
laquelle on donne le nom de précipitation. VU, 398. b. Efpece
de fufion appellée vitrification. C e tte opération s’étend fur
tous les corps fixes de la nature. Différences entre ces corps
fur le plus ou le moins de difficulté qu’on éprouve à les fondre.
Ufage des fondans : on peut comparer leur aélion à
celle des menrtrucs humides. Du degré <Je chaleur que les
fondans exigent pour produire leur effet. Quelques corps
volatils font fufccptibles de fufion. Il y a des métaux qui te
calcinent en entrant en fonte. Il faut que le corps auquel
on fait fubir la fu fio n , devienne le plus fluide qu il efl poffible.
Changemens opérés dans les corps tenus en fufion
pendant quelque tems. Phénomènes obtervés dans l’état de
fufion, defignés fous le nom d'attraflion. Ibid. 399. a. Con-
noiffances qu'il faut réunir dans les expériences qu’on fait
au m oy en de la fufion. Le;, opérations en petit donnent
des phénomènes qu'on n'a point dans les travaux en grand :
cautes de ces différences. La fufion des métaux imparfaits
6c des demi-métaux veut être faite dans les vaiffeaux fermés.
En quel tens 011 peut dire que dans la fufion , l’art l’emporte
fur la nature. Catites du mouvement imprimé aux
principes des corps par lequel ils entrent en fimon ; tenti-
ment de Stahi fur cefujct. ¡ lid . b. Des effets du mou v em en t,
te Ion cet auteur, fur les différentes efpeces de fubfiances ;
deux exemples de ces effets, dont le premier efl rignitioii
6c la fufion des pierres, des verres 6c des métaux : ce phénomène
ne vient que d'un mouvement imprimé à leurs
plus petites molécules , félon Stabl. Mais ce cbymilte n'a
donné qu’une aflertion, fans l’accompagner de tout c ç qui
auroit pu lui donner quelque fondement. Défaut« de fon bypo-
rhete. Ibid. 400, a.
F usion. (Chyrn. b Mita ll. ) Corps qui ont la propriété
d’entrer en riifion par la feule application du feu. Dinerens
degrés de fufibilité dans les métaux 6c demi-métaux. Un
morceau de métal jetré dans un métal en fufion de même
efpece tombe au fond du vafe : le métal en fufion occupe
un plus grand cfpace une lorfqn’il efl refroidi : exceptions.
Phénomènes très-fingubers que là fufion opere fur le*, métaux
que l’on unit les uns aux autres. Métaux qui s'uniiTcnt.
Métaux qui ne peuvent s’unir. Le but qu’on te propofe
dans la fufion eft fondé fur la pefanteur teécifique des métaux.
Qu e l eft le but de la fufion du minéral. VII. 40o. b.
Fufion , c’eft une des opérations appellées
les cbymifles, XI. 499. b. Ufage du borax pour la fufion
de# métaux. IL 330. b. 331. a. Matière dont 1 artenic facilite
la fufion. Suppl. I. 381. h. <82. a. M inière de décraflcr la
furface de l’a g en t en fufion, IV . 707, a. Fufion de la, cliaux
d’or. 83 2. b. Des flux employés pour accélérer la fiwpn < J
certains métaux. V I 913. b. V il. 7 1> a , b , 6cc> Degr *
chaleur de l’étain 6c du plomb en fufion : tes métaux qui <-
fondent avant de rougir , n’ont pas acquis leur plus ia
degré de chaleur au moment de la fufion, VI. 600. a.
liage du bifinutb avec les métaux de difficile fiiuon. 9|
Additions à faire à l'alliage du nitre pour c e s mêmes meta .
9 i 7 . ,/. Les métaux deflruaibles à feu nu d, doivent dan*
l’état de fu fio n , ê t r e fanpoudrés de poudre de charbon-9 *
b. Perte de fubftance dans la fufion des métaux, oupp • •
694. b. Fourneaux de fufion. V IL 417. d , M ^ M im a u e .
des fourneaux de fufion de figure elliptique 6c pu- fuj¡0IJ
448. 3. d. Comment on empêche une matière\ c^ ca-it.eH
de te refroidir promptement. 440. a. Les< ter ^
mêlées avec laglaite entrent aifément en «moi. ^ .
Diere de ¡Citer dans la língotiere ley n êum * p¿icaricíté,
HT, <30. b. Fufion des métaux par la foudre
97. b. 98. a.
F U T
FU ST , terme de commerce, de marine, d’arquebuficr,
du métier à bas. V\ \ . 400. h.
Fufl d’arquebuterie. L 704. a.
F u î t de colonne. ( Archi t. ) AAragalc du fufl. I. 777. b.
De la diminution du fufl des colonnes. III. 631. a , b. Ri-
ebeffes dont ces fu As font fufccptibles ; leurs ornemeus dans
les cinq ordres. Ibid. b. Fufl des colonnes en fpirale.
<>34. a. •
F u s t d'orgue, ( Luth. ) la meniiiterie , la caiffe ou car-
caffc de l'orgue. Defcription de cette partie. VIL 40t. a.
Voyei O r g u e .
F u s t , outil à ( Menuif ) XI, 719. a.
F w s t , d’une raquette « ( Faunuer ) VIL 401. a.
F u j i , outil de relieur, Defcription 6c ufage. V IL 401. a.
F u j i , terme de vcnerie.VII. 401 .a.
FU S T E T , (B ota n .) caraâcrc# de ce genre de plante. Lieux
où croit cet arbriffeau. Ce qu’il peut gagner par la culture. Sa
defcription, Moyens de le multiplier. Il peut réfifier à nos
hivers ordinaires. Quels font tes terreins 6c tes expofitions
qui lui conviennent. Qualité de fon bois, tant de l’aubier
que du coeur, Ufages qu’on en tire. Ufage des feuilles &
des jeunes branches. Diverfcs qualités de cet arbriffeau peuvent
lui mériter une place dans un bofquet d'arbres curieux.
V I I . 40t. b.
Fufiet. Cara ètere de ce genre de plante. Defcription de
l ’efpece appellée fufiet des corrqyeurs, fumac à feuilles
fimples, à feuilles ovales renvcrlees. Lieux où elle croît.
Suppl. 111,163. ¿.Sa culture & tes ufages.Ibid. 164. a.
Fufiet, ufage de ce bois eu teinture. AVI. 26. b.
FUSTI RALE, ( Machin, de guerre ancienne ) arme de jet des
anciens romains. Suppl. III. 164. b.
FUSTIGATION. Différence que Ics Romains mettoient
entre la fufligation 6c la flagellation. VI, 833.¿ .D e lafufti-
gation. VII. 2 16 . b.
FU TA IN E , ( Comm. ) forte d'étoffe. Diverte» efpeces de
futaincs. VII, 404. a.
FU TA IE , ( E canoni, rufliq. ) vieux bois. L’âge du vieux
bois diflingué par jeune furate 6c par liante ou vieille futaie.
Les futaies font l’ornement des forêts ; mais leur utilité doit
les rendre fur-tout recommandables. Arbres dont on' tire le
plus d'utilité en futaies. Comment on peut hâter l'accroiffe-
ment des futaies. Les arbres des futaies ne doivent point être
élagués. VU. 404. a.
Futaie, c e qu’on entend par-là. II. 497. b. Difpofition qu’il
faudroit donner aux forêts pour avoir des bois de haute futaie.
I. 584. b. Arbre# de haute futaie abbattus par les orages.
III. 4. b. Précaution pour préferver de la pluie tes troncs
des bois de haute futaie,qu’on voudrait rétablir promptement
en taillis. XII. 746. b. — Voyez B o is b F o r ê t .
FUTAILLES. Marrant à futailles. IX. 886. a. Piccesdont
on fait le fond des futailles, Suppl. IV. 1)7(1. b.
FUTILE, Rationnement futile »objet futile, homme futile.
VII. 404 .a .
F u t i le , ( Am iq .) vate dont on te fervoit dans 1e culte de
Verta. Le mot futile appliqué à un homme, tire fonoriginede ce
vate. VII. 404. a.
Futile , coupe facrée d’un ufage différent de ce vate.
Fontaine où tes Romains alloient chercher l’eau pour remplir
les futiles. Propriété miraculeufe de cette eau. VII.
404. b.
FUTUR. Obtervation# fur l’ufage de ce mot. VII.
404. b.
F u tu r . ( Gramm. ) On trouve dans toutes tes langues
différentes fortes de futurs. Dans tes diverfcs manières de
confidérer le tems, on s’eft particulièrement attaché à l’cn-
vifager comme abfolu, conditionnel 6c relatif. Mais par rapport
au futur, il n'y a que quelques langues qui en aient
de ces trois cteeces. Les Latins ont deux futurs, un abfolu
& un relatif. Tableau des futurs relatifs pour les voix aflivc
& paflive. VII. 404. b. Les huit futurs relatifs qui te trouvent
dans ce tableau , ne te trouvent pas dans tes tables ordinaires
des conjugaifons ; mais c’eft un abus. Autre faute
des grammairiens; c’eft d'avoir mis parmi tes tems du fub-
jonéuf, un futur qui appartient certainement à l’indicatif.
Preuves alléguées par I auteur pour montrer aux métho-
dirtes que ce futur eft de l'indicatif ; t°. 011 ne te fert pas
de ce futur Iorfane le verbe eft précédé d’une particule qui
régit le fubjonélif ; a“, ce tems eft de l’indicatif, puifqu’il
«juique une modification pofitive, déterminée 6c tndépcn-
F Y O 799
oante ; m a . 403. f . ce tems ef
rus plutôt que de celle des futurs.
prertd fa fotirce dans les anciens g
tiré# de Scaliger 6c de Prifcien ; Jù
latins, les grammairiens françois ou
C ’tfft un vice (pie d'appliquer la g
toute autre indiuinâement.
1 de la cllfle des prêtée
L’erreur ici combattue
rammairierts : e x em p le s ,
jd. b. 6cpar imitation des
t commis la même faute;
rairimaire d’une langue à
Des futurs françois. Nous avons un futur abfolu 8c deux
futurs relatifs, qui marquent l’avenir avec un tannàrt fpê~
cial au prêtent : nous appelions l'un, futur défini, & l’autre
, futur prochain. J e dois partir eft un futur défini • je
vais partir eft un futur prochain : ces auxiliaires, je dois* je
v a is , nous rendent le même fervice au fu b jo n ilii t no’tré
langue n’a aucune inflexion deftinée primitivement à mar*
uüer dans ce mode l’autre efpece de futur. Mo yens dont elle
te fert pour cela, Ibid. 494, a. Il n’eft point d e langue qui
n ait de quelque maniéré des moyens propres à déterminer
toute# tes différentes vues de l’eterit dans l’ufagc des
verbes. Il ne faut pas croire que l’uiage d’aucune lanpne
reftreigne cxclufivcmcnt les futurs à leur deftination propre.
Il y a des raifonsde goût, b c . qui déterminent dans Ja manière
de les employer. Quelquefois même l’ufage donne au prêtent
6c au prétérit 1e tens futur. Ibid. b.
Futur, v o y e z T ems. Obtervation fur le prétendu futur du
fubjonélif. X V . 36z.b.
F utur contingent, ( Mitaphyf ) ce qui doit arriver, mais
qui n’arrivera pas néceffaircmcnt. Dans quel fens on peut
dire que la non-cxiftcncc des futurs contingcns n’implique
pas contradiction. Relativement au fyftéme prêtent de l’univers
6c à la prefcience du créateur, il n 'y a point de futut*
contingent. V il, 404, b. Les athées qui admettent l’éternité
6c la néceifité du monde , ne reconnoiffent point de futur
contingent. Selon tes autres pbilofophes il y a des futurs
con tin r en t, en c e que Dieu pouvoir difpûfer les chofes
dans un ordre tout différent de celui qu’il a choifi. L’exif-
tence des futurs contingcns libres n’eft pas moins infaillible
que celle des futurs non-libres. On difpute dans les écoles
pour favoir fi deux propofitions de futur contingent, Pierre
mourra demain , Pierre ne mourra pa s , font toutes deux
fauffes ; ou fi l’une eft vraie, 6c l’autre fauffe dans cette
même hypothefe. Abfurdité de cette queftion. Ibid. 403. a»
Foyer CONTINGENT.
FU TU R IT ION , ( Théolog.) c e qu’on entend par ce mot;
Qucftions abfurdes fur cette futurition, qui ont occupé les théologiens.
VU. 403, b.
FU YA R D S , ( A n milit.) voye[ F uite. Le plus grand
malheur qui puiffe arriver à des troupes battues, c’eft de te
retirer en foute en fuyant de tous côtés. En combattant
vaillamment 6c en bon ordre , on perd beaucoup moins de
monde , qu'en prenant le parti de fuir. Lorfqu'une troupe
eft en d éto rd re, on ne doit la pourfuivre qu'autant qu’il
eft néceffaire pour la mettre hors d’état de fe rallier. La
tourfiiitc des fuyards peut être fufceptibte d’inconvénient,
orfqu’on s’y abandonne trop inconfidérément ; fur-tout
lorfqu'une aile ou une autre partie de l’armée a battu celle
de 1 armée ennemie qui lui était oppofée. VIL 403. b.
Obfervations de M, de Puyfégur fur ce fujet. Ibid.
406. a.
Fuyard de milice. Peine de ceux qui tombent dans ce cas.
Ce que doivent faire ceux qui pour raifons légitimes ne
peuvent te préfenter à la levée de la milice. Ceux qui
font engagés pour entrer dans un état qui doit dans la fuite
les exempter du fervice , ne font pas exempts de tirer au
fort. Ceux qui te prétendent engagés dans tes troupes,
doivent en juftifier par certificats des officiers qui ont reçu
leurs engagemens, b c . VIL 406. a. C eu x qui ont été déclarés
fuyards ne font plu» reçus à tirer au fo r t, b c . Les
fuyards arrêtés font préfentés au commiffaire 6c conftitués
miliciens : à quoi enfuite ils font obligés. Ce que doivent
faire ceux qui prétendent avoir des raifons valables pour
te faire décharger de la qualité de fuyards, /uftification de
ces moyens violens employés pour forcer les citoyens au
fervice militaire. Ibid. b.
F Y
F YO T delà Marche, (Jacques-Philippe) comte de Draci-
le-Fort : traits de bienraifonce de ce feigneur. Suppl. IV.
33.