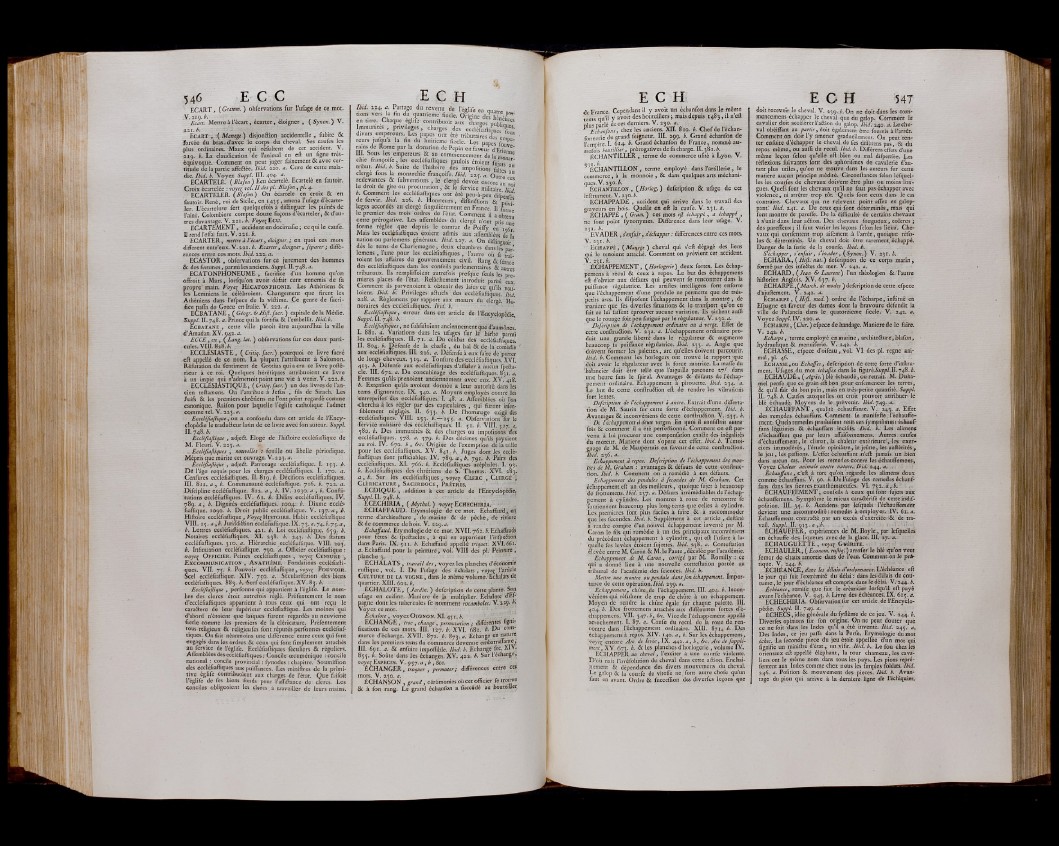
546 E C C
ECART, ( Gramm. ) obfcrvations fur l’ufage de ce mot.
.V. 2 lÇf. b. ■ ■ ..t i v ■ • £• ‘
Ecart. Mettreiil’écart, écarter, éloigner , ( Synon. ) V.
3.21. b. 3 ■' ' " ’
EcàU T Manege) disjonélion accidentelle, fubite &
forcée du bras.d’avec le corps du cheval. Ses caufes les
plus ordinaires. Maux qui refultcnt de cet accident. V.
219. b. La claudication de l’animal en cil un figne trés-
équivoque. Comment on peut juger fainement & avec certitude
ae la partie affeélée. Ibid. 210. a. Cure de cette maladie.
Ibid. b. Voyez Suppl. III. 4°4- a- _
ECARTELÉ. ( Blafon) Ecu écartelé. Ecartelé en fautoir.
Croix écartelée : voyez vol. I l des pl. Blafon, pl. 4.
ECARTELER. ( Blafon) On écartele en croix 8c en
fautoir. René, roi de Sicile, en 1435 »amena l’ufagc d’écarte*
ler. L’écartelure fert quelquefois à difiinguer les puînés de
l’aîné. Coiombierc compte douze façons d’écartelcr, 8c d’autres
davantage. V. 211. b. Voyc[ ECU.
ECARTEMENT , accident en docimafie ; ce qui le caufe.
Il rend l’effai faux. V. aai. b.
ECARTER, mettre à l’écart, éloigner ; en quoi ces mots
different entr’eux. V. 221. b. Ecarter, éloigner, féparer ; différences
entre ces mots. Ibid. 212. a.
ECASTOR , obfervations fur cé jurement des hommes
8c des femmes, parmi les anciens. Suppl. II. 748. a.
ECATONPHONEUME , facrince d’un homme qu’on
offroit à Mars, lorfqu’on avoit défait cent ennemis de fa
propre main. Voye{ H é c a t o n p h o n i e . Les Athéniens 8c
les Lemniens le célébroient. Changement que firent les
Athéniens dans l’efpece de la viélime. Ce genre de facri-
ficc pafia de Grece en Italie. V . 222. a.
ECBATANE, ( Géogr. b Hifl. facr. ) capitale de la Médie.
Suppl. II. 748. a. Prince qui la fortifia 8c l’embellit. Ibid. b.
E c b a t a n e , cette ville paroit être aujourd’hui la ville
d’Amadan. XV. 042. a.
ECCE y en , (Lang. lat. ) obfervations fur ces deux particules.
VIII. 828. ¿.
ECCLÉSIASTE, ( Critiq. facr.) pourquoi ce livre facré
eft appellé de ce nom. La plupart l’attribuent à Salomon.
Réfutation du fentiment de Grotius qui a cru ce livre pofté-
rieur à ce roi. Quelques hérétiques attribuoient ce livre
à un impie qui n^idmettoit point une vie à venir. V. 222. b.
ECCLÉSIASTIQUE, {Critiq. facr.) un des livres de l’ancien
teftament. On l’attribue à Jcfus , fils de Sirach. Les
Juifs 8c les premiers chrétiens ne l’ont point regardé comme
canonique. Raifon pour laquelle l’églile catholique l’admet
comme tel. V. 223. a.
Eçccléfiajiique, on a confondu dans cet article de l’Encyclopédie
le traduâeur latin de ce livre avec fon auteur. Suppl.
II.748 .b.
Eccléftaflique , adjeél. Eloge de l’hiftoire ecdéfiailiquc de
M. Fleuri. V. 223. a.
... Eccléfiaflïques , nouvelles : feuille ou libelle périodique.
Mépris que mérite cet ouvrage. V . 223. a.
Eccléftaflique , adjeéh Patronage eccléfiaflique. I. 153. b.
Dé l’âge requis pour les charges cccléfiaftiques. I. 170. a.
Ccnfurcs eccléfiafliques. II. 819. b. Dédiions eceléfiaftiqucs.
IO. 812. a , b. Communauté eccléfiaflique. 716. b. 722. a.
Difcipline eccléfiaflique. 812. <x, b. IV. 1030. a , b. Confti-
tutions eccléfiafliques. IV. 62. b. Délits eccléfiafliques. IV.
789. a t b. Dignités eccléfiafliques. 1004.'. b. Dixmc ecclé-
fiaftique. 1000. b. Droit public eccléfiaflique. V. 127. a y b.
Hifloire eccléfiaflique, Voye{ H i s t o i r e . Habit eccléfiaflique
VIII. 13. a, b. Jurifdiélion eccléfiaflique. IX.73.<x.74.^75.a,
b. Lettres eccléfiafliques. 421. b. Loi eccléfiaflique. 659. b.
Notaires eccléfiafliques. XI. 238. b. 243. b‘. Des flatuts
eccléfiafliques. 310. a. Hiérarchie cccléfiaftiquc. VIII. 203.
b. Infinuation eccléfiaflique. 790. a. Officier eccléfiaflique :
woye{ O f f i c i e r . Peines eccléfiafliques , voye^ C e n s u r e ,
E x c o m m u n i c a t io n , A n a th êm e . Fondations cccléfiaili-
ques. VII. 75. b. Pouvoir eccléfiaflique, voyeç P o u v o i r .
Scel cccléfiaftiquc. XIV. 730. a. Secularlfation des biens
eccléfiafliques. 083. b. Sert cccléfiaftiquc. XV. 83. b.
Eccléftaflique, perfonne qui appartient ä l’églile. Le nombre
des clercs étoit autrefois réglé. Préfentcment le nom
d’eccléfiaftiqucs appartient à tous ceux qui ont reçu le
cara&erc de leur fupéricur eccléfiaflique. Les moines qui
d’abord n’étoient que laïques furent regardés au neuvième
ficcle comme les premiers de la cléricature. Préfentement
tous religieux 8c rcligieufes font réputés perfonnes eccléfiaf-
tiques. On fait néanmoins une différence entre ceux qui font
engagés dans les ordres 8c ceux qui font fimplcmcnt attachés
au fcrvicc de l’églifc. Eccléfiafliques féeuhers 8c réguliers.
Affcmblée6 descccléfiafliqucs : Concile oecuménique .’ concile
national : concile provincial : fynodes : chapitre. Soumiflion
des eccléfiafliques aux puiflances. Les miniftres de la primitive
églife contribuoicnt aux charges de l’état. Que faifoit
l’églife de fes biens fonds pour l’affiftancc de clercs. Les
conciles obligeoient les clercs à travailler de leurs mains.
E C H
m v i n
en titre. Chaque églife eontrihuoi. aux X g «
Immunités , privilèges, charges des eccléfiidliL e T r
divers empereurs Les papes ont été tributaires l ' c m T
reurs iufqu a la fin du huitième ficcle. Les panes 0, P
rams de Rome par la donation de Pepln en faveur dît-
111. Sous les empereurs & au commencement de la in™ '
chie françoife,mm les eceléfiaftiques gaulois étoient f i î S
tribut, h. Suite de l’hiftoire des impofitions fiifS “
cierge fous la monarchie françoife. Ibid. zz<. a Ouïr. -■
redevances & fubvemions , le clergé devoit encore lu ***
1 é rlrAïf rit» o i tr» /mi nvA/n.o.ÎAM . 52. Ia /*. * _ _ . . . .
iC f c Î Î i î J “®-011 P™£u™tion>& , fcrvicc militaire.1/¿/V
b. Comment les cccléfiaftiques ont été peu-à-peu difoeie
defervir. Ibid. zz6. b. donneurs, diLftions & ^ penfts*
leges accordés au clergé finguliércment en France. Il (Ptivile'premier
o
des trois ordres'de l’état. Comment é a obtenu
cette prérogative. Les aflemblécs du clergé n’ont pris „né
forme réglée que depuis le contrat de Poifty en itCi
Mais les eccléfiafliques étoient admis aux aflemblécs de I
nation ou parlcmens généraux. Ibid. 227. a. On diflineuoiV
dés le tems de Charlemagne, deux chambres dans les parI
lemcns, l’une pour les eccléfiafliques , l’autre où fe trai-
toient les affaires du gouvernement civil. Rang & féancè
des eccléfiafliques dans les confeils parlementaires 8t autres
tribunaux. Ils rcmpliffoicnt -autrefois prefqUc feuls les premières
places de l’état. Relâchement introduit parmi eux"
Comment ils parvenoient à obtenir des laïcs ce qu’ils vou-
loicnt. Ibid. b: Privilèges aéluels des cccléfiaftiques. Ibid.
228. a., Réglcmcns par rapport aux moeurs' du clergé. Honoraires
des eccléfiafliques. Ibid. b.
Eccléfiaflique, erreur dans cet article de l’Encyclopédie,
Suppl. II. 748. b.
Eccléfiafliques, ne fubfiftoient anciennement que d’aumônes.
I. 881. a. Variations dans les ulbges fur lîr barbe parmi
les eccléfiafliques. II. 71. a. Du célibat des ecdéfiaftiques.
II. 804. b. Défenfe de la çhaffe, du bal 8c de la comédie ‘
aux eccléfiafliques. III. 226. a. Défenfe à eux faite de porter
de longs cheveux. 319. a. Tonfure des eccléfiafliques. XVL
413. b. Défenfe aux eccléfiafliques d’aflifter à aucun fpcûa-
cle. III. 672. a. Du concubinage des eccléfiafliques. 831. a.
Femmes qu’ils prenoient anciennement avec eux. XV. 418.
b. Extenfion qu’ils avoient donnée à leur autorité dans les
tems d’ignorance. IX. 340. a. Moyens employés contre les
entreprîtes des eccléfiafliques. I. 48. a. Aflemblécs où l’on
•chercha à les régler par des capitulaires , qui furent infenfiblement
négligés. II. 633. 0. De l’hommage exigé des
•eccléfiafliques. Vlll. 233. b. — 233. a. Obfervations fur le
•fervice 'militaire des eccléfiafliques. II. 31. b. VIII. 317, a,
380. b. Des immunités 8c des charges ou impofirioiis' des
eccléfiafliques. 378. a. 379. b. Des uécimes qu’ils payoient
au roi. IV. 670. b , b a Origine de l’exemption de la taille
pour les eccléfiafliques. XV. 841. b. Juges dont les ccçlé-
fiafliques font jufticiablcs. IV. 789. a , b. 791. b. Pairs des
eccléfiafliques. XI. 766; b. Eccléfiafliques acéphales. I. 93!
b. Eccléfiafliques des chrétiens de S. Thomas. XVI. 203.
a y b. Sur les . eccléfiafliques, voyez C l e r c , C l e r g é \
C l é r i c a t u r e , S a c e r d o c e , P r ê t r e s .
ECDIQUE , .addition à cet article de l’Encyclopédie/
Suppl. II. 748. b.
ECECHIRIA, ( Mythol. ) voye^ E c h e c h i r i a . •
ÉCHAFFAUD. Etymologie de ce mot. Echaffaud.',. cri
terme d!architeélure , de marine & de péché,- de rivière
8c de commerce de bois. V. 229. a.
Echajjfaud. Etymologie de ce mot. XVII. 762. b. Echaffauds
pour fêtes• 8c fpcélaclcs , à qui en appartient l’ihfpéftibri
dans Paris. IX. 311. b. Echaffaud appellé triquet. XVI. 66i.
a. Echaffaud pour la peinture, voh VIII des pi/ Peinture ,
planche j.
ECHALATS , travail des, voyez les planchcç d’économie
ruftique, vol. I. De l’ufage des échalats, voye^' l ’article
C u l t u r e d e l a v i g n e , dans le môme volume.’Echalâts de
quartier. XIII. 602. b. *t
ÉCHALOTE, {Jardin.) defeription de cette plante. Son
ufage en cuifins. - Manière de la multiplier. Echalote d’Er
pagne dont les tubercules fc nomment rocamboles. V. aap- bi
Voyez ce mot.
Échalote, voyez O i c n o n . XI. 431. b.
ECHANGE, troc y change , permutation } différentes figni"
fications de ces mots. III. 127. ¿. XVI. 681. b. Du commerce
d’échange. XVII. 872. b. 873. a. Echange en naturé
dans les premiers tems du commerce devenue embarraffamc,
III. 601. a. 8c enfuitc impoffiblc. Ibid. b. Echange fcc. XIV.
833. b. Soûte dans les échangés. XV. 422. b. Sur l’échange,
voyez E spè ce s . V. 937. a , b , 8cc.
ÉCHANGER, troquer , permuter; différences entre cet
mots. V. 230. a.
ÉCHANSON , grand, cérémonies où cet officier fe trouve
8c à fon rang. Le grand écjianfon a fuccédé au boutaller.
E C H E C H 54?
de France. Cependant il y avoit un cchanfondans le même
tems qu’il y »voit des bontcillers ; mais depuis 1483, il n’eft
plus parlé de ces derniers. V. 230. a.
Echanfons, chez les anciens. XII. 810. b. Chef de l’échan-
fonncric du grand feigneur. III. 299. b. Grand échanfon de
l’empire. I. 614. b. Grand échanfon de France, nommé autrefois
boutillier »prérogatives de fa charge. II. 381. b.
¿CHANTILLER, terme de commerce ufité à Lybn. V.
07 1. b.
ÉCHANTILLON, terme employé dans l’artillerie , le
commerce, à la monnoie, 8c dans quelques arts méchani-
ques. V.230.E ■ .
É c h a n t i l l o n , {Horlog. ) defeription 8c ufage de cet
infiniment. V. 230. b. .
ECHAPPADE , accident qui arrive dans le travail des
graveurs en bois. Quelle en eft la caufe. V. 231. a.
ÉCHAPPÉ , ( Gram. ) ces mots efl échappé , a échappé ,
ne font point fynonymes. Différence dans leur ufage. V.
231. b.
EVADER, s’enfuir, s'échapper : différences entre ces mots.
V. 231. b. ' ’ .•*' «
E c h a p p é , {Manège) cheval qui s’eft dégagé des liens
qui le tenoient attaché. Comment on prévient cet accident.
V. *31. b.
ÉCHAPPEMENT, {Horlogerie) deux fortes. Les échap-
pemens à récul 8c ceux à repos. Le but des échappemens
eft d’obvier aux défauts qui peuvent fe rencontrer dans la
puiffance régulatrice. Les artiftes intclligens font enforte
que l’échappement d’une pendule ne permette que de très-
petits arcs. Us difpofent l’échappement dans la montre , de
manière que fes diverfes fituations 8c le tranfport qu’on en ■
fait ne lui faffent éprouver aucune variation. Ils tâchent auflï
que le rouage foit peu fatigué par le régulateur. V. 232. a.
Defeription de l ’échappement ordinaire ou à verge. Effet de
cette conftfuélion. V. 232. a. L’échappement ordinaire produit
une grande liberté dans le régulateur 8c augmente
beaucoup fa puiffance régulatrice. Ibid. 233. a. Angle que
doivent former les palettes, arc qu’elles doivent parcourir.
Ibid. b. Comment les horlogers ont trouvé le rapport 'que ,
doit avoir le régulateur avec la force motrice. Lamaffedu
‘balancier doit être telle que l’aiguille parcoure 27/ dans
une heure fans le fipiral. Avantages 8c défauts de l’échap-
pement ordinaire. Echappement à pirouette. Ibid. 234. a.
Le but de. cette conftruâion efl de rendre les vibrations |
fort lentes.
Defeription de l’échappement à ancre. Extrait d’une differta- ’
tioii de M. Saurin fur cette forte d’échappement. Ibid. b- '■
Avantages 8c inconvénicns de cette confiruâion. V . 233. b. j
De l’échappement à deux verges. En quoi il confiftoit autre- |
fois 8c comment' il a été perieâionné. Comment on efl par- :
venu à lui procurer une conïpeniation exaéle des inégalités
du moteur. Maniéré dont s’opère cet effet. Ibid. b. Tcmoi-
enage de M. de Maupertuis en faveur de cette conftruélion.
Ibid. 236. a.
Echappement, à repos. Defeription de l’échappement des mon- ,
très de M. Graham : avantages 8c défauts de cette conftruç- ;
rion. Ibid. b. Comment on a remédié à ces défauts.
Echappement des pendules à fécondes de M. Graham. Cet !
échappement eft un des meilleur^, quoique fujet à beaucoup !
de frottemeos. Ibid'. 237. a. Défauts irrémédiables de l'échap- j
pcment à cylindre. Les montres à roue de rencontre fe j
fqutienncnt beaucoup plus long-tcms-que celles à cylindre. ’
Les premières font plus faciles à faire 8c a raccommpdcr :
que les fécondés. Ibid. b. Supplément à cet article , deftiné
a rendre compite d’un nôiivel échappement inventé par M. '
Caron le fils qui remédie à un des principaux inconvénicns ;
du précédent échappement à cylindre , qui eft l’ufure à la-
■quelle fes levées ctoicnt fujettes. Ibid. 238. a. Conteftation •
élevée entre M. Caron 8c M. le Paute, décidée par l’académie.
Echappement de M. Caron, corrigé par M. Romilly : ce ,
qui a donné lieu à une nouvelle conteftation portée an
tribunal de l’académie des fcicnccs. Ibid. b. v
Mettre une montre ou pendule dans fon échappement. Impor- ;
tance de cette opération. Ibid. 239. a.
Echappement, chûte,dc l’échappement. III. 404. -b. Incon- .
véniens qui réfultent de trop de chute à un échappeiRent. j
Moyen de rendre la chute égale fur chaque palette. II(.
404. b. Des frottemens attachés aux différentes fortes d!é-
chappemcns. VII. 347. b, &c. Vice de l’échappement appellé i
acrochement. I. 87. a. Caufe du recul de la roue de. ren- !
contre dans l’échappement ordinaire. XIII. 8714 b. Dps |
échappemens â repos. XIV. 140. a, b. Sur les échappemens,
voyeç encore Arc de levée, IX. 442. a , b y &c. Arc de fupplé- j
ment, XV. 673. b. 8c les planches d’horlogerie , volume IV.
ECHAPPEIl im cheval, l’exciter â une courfc violente.
D’où nait l’irréfolution du cheval dans cette aélion. Enchaînement
8c dépendance des divers mouvemens du cheval.
Le galop 8c la courfe de vîteffe ne font autre chofe qu’un
faut en avant. Ordre 8c fuccefïion dos diverfes leçons que j
doit recevoir le cheval. V. 239../'. On ne doit dâns les commence
mens échapper lç cheval -que du galop. Comment le
cavalier doit accélérer l’aétion du galop. Ibid. 240. a. Le cheval
obéiffant au partir, doit également être fournis à l'arrêt*
Commcnt.on doit l’y amener graduellement. On peut tenter
enfuitc d’échapper le chcval .de fes différons pas, 8c du
repos même, ou aufli du recul. Ibid. b. Dlfférens effets d’une
môme leçon félon qu’elle efl bien ou mal difpenféc. Les
réflexions fuivantes tont des aphorifmes de cavalerie doutant
plus utiles, qu’on ne trouve dans les auteurs fur cette
matière aucun principe médité«. Girconftances félon lcfquel-
les les courfes de chevaux doivent être plus ou moins longues.
Quels font les chcyaux qu’il ne faut pas échapper avec
violence, ni arrêter trop tôt. Quels font ceux dans lé cas
contraire. Chevaux qui ne relevent point affez en galop-
pant.’ Ibid. 241. a. De ceux qui font déterminés, mais qui
font montre de pareffe. De la difficulté de certains chevaux
à s’unir dans leur aélion. Des chevaux fougueux, colères j
des pareffeux ; il faut varier les leçons félon les lieux. Chevaux
qui consentent trop aifément à l’arrêt, quoique réfo-
lus 8c déterminés. Un cheval doit être rarement, échappé.
Danger de la furie de la courfe. Ibid. b.
S’échapper, s’enfuir, s’évader , {Synon.) V. 231. b.
ECHARA, ( Hifl: nat. ) defeription de ce corps marin,
formé, par des infeéles de mer. V. 242. a.
ECHARD, {Jean b Laurent) l’un théologien 8c'l’autre
hiftorien Anglois. XV. 637. b.
ÉCHARPÉ, (March. de modes ) defeription de cette efpecc
d’ajuftement. V. 242. a.
Echarpe , ( Hifl. mod. ) ordre de l’écharpe, inftitué en
Efpagne en faveur des dames dont la bravoure défendit la
ville de Pal?ncia dans le quatorzième fiecle. V. 242. a.
Voyez Suppl. LV. 220. a.
Echarpe, {Chir. ) cfpece de bandage. Maniéré de le faire.
V. 242. b.
Echarpeterme, employé en marine, architeélure , blafon,
hydraulique 8c menuiferie. V. 242. b.
ECHASSE,. cfpece d’oifeau, vol. VI des-pl. règne animal
, pl. 46.
Echasse,ou Echajfcs, defeription de cette forte d’inftru-
ment. .Ufages du, niot échajfes dans le figwréBuppl.II.748.0.
ÉCHAUDÉ-, ( Agric.) blé échaudé, ou retrait. M. Duhamel
penfe .que çe grain efl bpn pour enfemencer les terres,
8c qu’il fait du bon pain, mais en très-petite quantité. Suppl.
U. 7 4 8 . b. Caufes auxquelles ; on croit pouvoir attribuer le
blé échaudé/ Moyens de le, prévenir. Ibid. 749. a.
ÉCHAUïTANT , qualité échauffante. V., 243. a. Effet
des rem,edes échauffans. Cornaient fe inanifefte réchauffement.
Quels remèdes produifent toifsces fymptômes: échauf*
fans légitimes; & échauffans incififs. Ibid. b. Les. alimens
n’éçhauffent que par leurs affaifonnemens. Autres. caufes
d’échauffcment, le climat, la chaleur extérieure^-les exercices
immodérés, l’étude opiniâtre, l&jeûne, les aùfléritéis,
le jeu, les pallions. L’effet échauffant n’eft jamais, un bien
dans aucun cas. Pour les remedes-contrè les échauffemens,
Voyez Chaleur animale contre nature., Ibid,' 244. a. .
Échauffansc’eft .à tort qu’on regarde les alimens doux
comme échauffans, V . 90. b. De Tiilage des remedes éçhauf-
fans dans les fievres exanthémateufes. VI. 732..d, b. 1
ÉCHAUFfiÈMENT, confeils â ceux qui font- fujèts aux
échauffemens.,Symptôme le mieux càraélérifé de cetteindif-
pofition. III. 35. b. Accidcns par lefquels Réchauffement
devient une incommodité t-remedés à emplpyer.rlV. 61. a.
Échauffemcnt .cpntraélé, par un-excès d’cxcrcice-8c de travail.
Suppl., II. 943* & >.b. 1 .
ÉCHAUFFÈRj expériences, de M. Boy le, par lefquelles
on échauffe des-liqueurs avec-de la.glace.III. 27..a.
ÉCHAUGUÉTiE, voye{ G u é r i t e . - ,
ECHAULER, ( Économ. rufliq'.) arrofer le blé -qu’on veut
iemer de chaux amortie dans de l’eaU. Comment on le pratique.
V. '244. b'. . . -. - - *• ■ '
ÉCHÉANCE, dans les délais d’ordonnance. L’échéance eft
le jour qui fuît l’extrémité du délai': ddns les délais de coii-
tume, le jour d’échéance eft compris -dans le délai. V/244. b.
Échéance, remife que fait le créancier lorfqu’il eft payé
avant l’échéance. V. 943. b. Livre des échéances. IX. 613. a.
• ECHECHIRIA. Obiervation fur cet article.de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 749. a, ■ ^ •
ÉCHECS, idée générale du fyftême de ce jeu. V. 244. b.
Diverfes opinions fur fon origine. On ne peut douter que
ce ne foit dans les Indes qu’il a.été inventé. Ibid. 243. a.
Des Indes, ce jeu paffa dans la Perfe, Etymologie du mot
échec. La fécondé piece du jeu étoit appellée d’un mot qui
fignifle un miniftre d’état, un vifir. Ibid. b. Le fou chez les
orientaux efl appellé éléphant, la tour chameau, les cavaliers,
ont le même nom dans tous les pays. Les pions repré-
fentent aux Indes comme chez nous les fimples foldats. Ibid.
246. a. Pofition & mouvement des pièces. Ibid. b. Avantage
du pion qui arrive à la derniere ligne de l’échiquier.