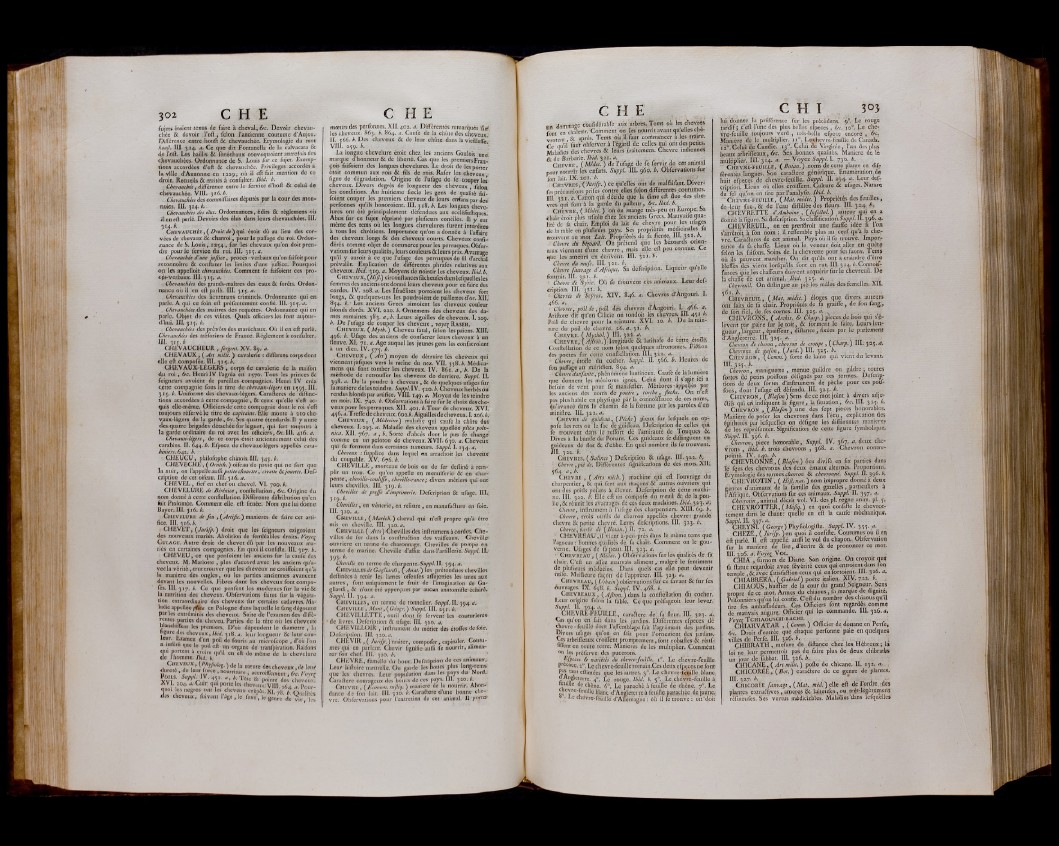
3 0 2 CHE CHE fujcts ¿toictit tenus de faire à cheval, Oc. Devoir chevauchée
8c devoir . Toft » félon l'ancienne coutume d’Anjou.
Différence entre houft & chevauchée. Etymologie du mot
houfl. 111 314. a. Ce que dit Fontanclla de la calvacata 8c
de l’oft. Les baillis fie fénéchaux convoquoicnr autrefois des
chevauchées. Ordonnance de S. Louis fur ce fujet. Exemptions
accordées d’oft & chevauchée. Privilèges accordés à
la ville d'Auxonne en 1229 j oü il cil fait mention de ce
droit. Recueils fie traités à confultcr. Ibid. b. • .
Chevauchée 4 différence entre Je fcrvicc d ho/1 & celui de
chevauchée. VI IL jtô.b.
- Chevauchées des commiffairc# députés par la cour des mon-
noies. LU. 314. é.
Chevauchées des ¿lus. Ordonnances, édits fie réglcmcns où
il en efl perlé. Devoirs des élus dans leurs chevauchées. III.
3ta.b. . v' . .
Chevauchée, ( Droit de) qui étoit dû au lieu des corvées
de chevaux fie charroi, pour le paffage du roi. Ordonnance
de S. Louis, 1234, fur les chevaux qu’on doitprendre
pour le fcrvicc du roi. III. 315. a.
Chevauchée d'une jujlice, procès-verb
reconnoitre fie conftater les limites d’une iuflicc. Pourquoi
0/1 les appclloit chevauchées. Comment fe faifoient ces procès
verbaux. XII: 315. a.
■: Chevauchées des grands-maîtres des eaux fie forêts. Ordonnance
où il en efl parlé. III. 315. a.
. Chevauchées des licurcnans criminels. Ordonnance qui en
parle. A qui ce foin efl préfentement confié. III. 315.
. Chevauchées des maîtres des requêtes. Ordonnance qui en
parle. Objet de ces vifites. Quels officiers les font aujourd’hui.
111.313. b.
. Chevauchées des prévôts des maréchaux. Oit il en cft na
Chevauchées des treforiers de France. Règlement à confuli
III. 313.
CHEVAUCHEUR, feront. XV. 8p. 0.
CHEVAUX, ( An mi lit.') cavalerie i différons corps dont
elle efl compoféc. 111.315.0.
CHEVAUX-LÉGEnS, corps de cavalerie de la maifon
du roi, Oc. Henri IV l’agréa en 1570. Tous les princes fie
feigneurs avoient de pareilles compagnies. Henri IV créa
cette compagnie fous le titre de chevaux-légers en 1591.111.
3,1:5. b. Uniforme des chcvaux-légcrs. Caracteres de diftinc-
tiens accordées à cette compagnie , fie ceux qu’elle s’cfl acquis
elle-même. Officiers de*cette compagnie dont le roi s’cfl
toujours réfervéle titre de capitaine. Elle monte & 210 chcvaux
légcrs de la garde, Oc. Ses quatre étendards. 11 y a une
des quatre brigades détachée fur léguer, qui fert toujours à
la garde ordinaire du roi avec les officiers, bc.lll. 416. a.
Chtvaux-légers, de ce corps étoit anciennement celui des
carabins. II. 044. b. Efpccc de chcvaux-légers appelles carabiniers.
642. b.
CHEUCU, obilofophc chinois. III. 343. b.
CHEVECHE, ( Ornith. ) oifeau do proie qui ne fort que
la nuit, on l’appelle uufftuctitc choueut, civette fie joue lie. Def-
cription de cet oifeau. lit. 3 / (. a.
CHEVEL, fief en chef ou chcvcl. VI. 700. b.
CHEVELURE de Bérénice, conflellation, bc. Origine du
nom donné à cette conflellation. Différente diflribution qu’en
Ait Ptoloméc. Comment elle efl fituée. Nom que lui donne
Rayer. 111. 316. b.
Chevelure de feu, (Artifie.) manieres de faire cet artifice.
111.31 (.b.
1 CHEVET, (Juàfp.) droit que l;c# feigneurs exigeoient
«les nouveaux mariés. Abolition de fcmblablcs droits. Voye{
C vlage. Autre droit de chevet dû par les nouveaux mariés
en certaines compagnies. En quoi il confiftc. 111.317, b.
CHEVEU, ce que penfoient les anciens fur la enufe des
cheveux. M. Mariette , plus d’accord avec les anciens qu’avec
la vérité-, crut trouver que les cheveux ne croiffoicnt qu’à
la manière des ongles, ou les parties anciennes avancent
devant les nouvelles. Fibres dont les ebeveux font compo-
fés. III. 317, b. Ce que penfent les modernes fur la vie fie
la nutrition des cheveux. Obfcrvations faites fur la végétation
extraordinaire des cheveux fur certains cadavres. Maladie
appclléc pitea en Pologne dans laquelle le fang dégoutte
par les extrémités des cheveux. Suite de l’examen des diflé-
ï®,,tc* parties du cheveu. Parties de la tête où les cheveux
blanchifTcnt les premiers, D’où dépendent le diamètre, la
ngure des cheveux, Ibid. 118. a. leur longueur fit leur coii-
•r'a a 1mc,î ^ ,ln P°Ilde fouris au microfcoj>c , d’où l’on
n m r que le poil cft un organe de tranfpiration. Rnifons
¡o l Z Z e .m d V ^ cn cft dc m6mc dc 1 chcvcll,rû
AurettiViÎë ibiir :I««!«. f '^ d* natMrc deschcvenx ,de leur
* PI XVI. 10/ i . Cuir 1 porlol« r t v t f v m S »
quoi es nègres ont les cheveux crèbéi.XL^fl
des chev eu x, fuivant 1’% , le foxe , le genre‘ d¿ vie , k *
moeurs des perfonnes. XII. 402. a. Différentes remarqués fuf
les cheveux. 863. b. 864. a. Caufe dc la chute des cheveux.
II. 566. b. Des cheveux fie dc leur chûtc dans la viciUcfTc*
VIII. 259. b.
La longue chevelure ctoit chez les anciens Gaulois une.
marque d’honneur fie dc liberté. Cas que les premiers François
faifoient des longues chevelures. Le droit dc les porter
ctoit commun aux rois fie fils dc rois. Rafer les cheveux -
de dégradation. Origine dc l’ufagc dc fe couper les
cheveux. Divers degrés dc longueur des cheveux , fdon
les conditions. Au huitième ficelé les gens dc qualité faifoient
couper les premiers cheveux dc leurs crrftns par des
perfonnes qu’ils honoraient. III. 3x8. A. Les longues chevelures
ont été principalement défendues aux ccdéfialliquc».
Abus fur ce iujct réprimé par pluficurs conciles. Il y eut
môme des tems où les longues chevelures furent interdite»
h tôt» les chrétiens. Importance qu’on a donnée à l’affaire
des cheveux longs fie des cheveux cour». Cheveux confia
dérés comme objet dc commerce pour les perruques. Obfcrvations
fur leurs qualités, leurs couleurs fie leurs prix. Avantage
qu’il y aurait à ce que l’ufagc des perruques dc fil d’archal
prévalût. Explication dc différentes phrafes relatives aux
cheveux. Ibia. 310. a. Moyens dc noircir les cheveux. Ibid. b.
C heveux, Qhjl.) circonflancesfâchcufcsdanslcfqucllcslcs
femmesdes anciens ont donné leurs cheveux pour en faire des
cordes. IV. 208.0. Les Ifraélites portoicntlcs cheveux fort
longs, 8c quelques-uns les poudroient dc paillettes d’or. XII.
854. b." Les anciens Grecs aimoient les cheveux couleur
blonds dorés. XVI. 220. b. Ornemens des cheveux des dames
romaines. 283. 0, b. Leurs aiguilles dc cheveux. 1. 209.
b. Dc l’ufagc de couper les cheveux, voyez Raser.
C heveux. (Myth.) Cheveu fatal, félon les païens. XIII.
496. b. Ufage des anciens dc confacrcr leurs cheveux à un
fleuve. XI. 71.0, Age auquel les jeunes gens los cou fac roi eut
à un dieu. IV. 575. b.
C heveux , ( Art) moyen dc détruire lés cheveux qui
viennent jufqucs vers la racine du nez. VII. 338. b. Médica-
mens qui font tomber les cheveux. IV. 861. a , b. Dc la
méthode dc retroufTer les cheveux do derrière. Suppl. II.
298.0. Dc la poudre à cheveux , 8c de quelques ufages fur
la manière dc les teindre. Suppl. IV. 520. b. Cheveux herbésou
rendus blonds par artifice. VIII. 149. 0. Moyen de les teindre
en noir. IX. 740. b. Obfcrvations à faire fur le choix des cheveux
pour les perruques. XII. 401. é.Tour dc cheveux. XVI.
456.0. TrciTc dc cheveux. 6oi.b. Aiguilles de cheveux, 1. 20 6.b.'
C h e v eu x , ( Médecine) maladie qui caufe la chûte dc#
cheveux. I.293. a‘ Maladie des cheveux appellée plita polo-
nica. XII. 767. a y b. Sorte d’abcès dont le pus fe change
comme cn un peloton dc cheveux. XVII. 620. 0. Cheveux
qui ■ fb forment dans certaines tumeurs. Suppl. 1. 134. 0.
Cheveux : fupplicc dans lequel en arrachoit les cheveux-
du coupable. XV. 6 0 . b.
CHEVILLE, morceau dc bois ou dc fer defliné à remplir
un trou. Ce qu’on appelle cn mcnuifcric fie cn charpente,
chtville-coultffe, chcville-rancc; divers métier# qui ont
leurs chevilles. III. 319. b.
• Chevilles de prejfe d’imprimerie. Deferiprion 8t ufage. III.
_ ^Chevilles, en vénerie, cn reliure, cn manufacture cn foie.
III. 320. 0.
C heville, (Maréch.) cheval qui n’eft propre qu’à être
mis cn cheville. III. 320.0.
C heville* ( Arts) Chevilles des inftrumcns à cordée. Chevilles
dc fer clans la conftruélion dos vniffeaux. Cheville1
ouvrière cn terme de charo»nage. Chevilles de pompe en
terme dc marine. Cheville d’aftut dans l’artillerie. Suppl. 11.
395,'/'
Cheville cn terme de chámente. Suppl. II. 394,0.
C hevilles de Gagliardi, ( Anat. ) les prétendues chevilles
doflinécs à tenir les lames offeufes affiijcttics les unes aux
autres, font uniquement le fruit de l’imagination de Gagliardi
, fie n’ont été apperçues par aucun anntomifte éclairé.
Suppl. II. 394. 0.
C hevilles, en terme dc tonnelier. Suppl. II. 394.0.
C heville , Mont, ( Géogr, ) Suppl. III, 231, b,
CHEVILLETTE,outil dont fe fervent les couturière»'
dc livres. Defeription 8c ufage. ïlf. 320. 0.
CHKVILLOIK , infiniment du métier dos étoffes do foie.
Defeription. III. 320.0.
CHEVIR , ( Jurifp.) traiter, compofer, capituler. Coutu-
mesqui cn parlent. Chevir fignific auffi fe nourrir, alimenter
fon chef III, 320. b.
CHEVRE, femelle du bouc. Defeription do ces animaux;
Leur bifloire naturelle. On garde los boucs plus long-roms
que les chèvres. Leur population dan» les pays du Nord.:
CJaraélcro courageux des boue» de ce# pays* III* 310,
Che VUE, ( Econom. rufliq. ) maniere dc la nourrir. Abondance
de fon laír. III. 320. b. Caraéloro d’une bonne chc-1
vrc. Obfcrvations pour l’entretien dc cet animal. Il porto»
CHE un dommage cónfiddrabíe aux arbres. Tems où les çbevres
font en chalctfr. 'Comment on les ndurnt avant qu elles chevrotent
8c après. Tems où (il.faut corfimenccr a les traire.
Ce qu’il fat/t ôbfcrvcr à l’égard de celles qui çnt des petits.
Maladies des chèvres 8c léurs traitcmens. Chèvre indiennes
6c de Barbarie. Ibid. 321.0. ^ .
CHEVRE, (Médec. ) de 1 ufage de fe fervir (Je cet animal
pour nourrir lés cnfatis. Suppl. III. 960. b. Obfcrvations fur
fon lait. IX. Ml. b. , v; ,y. te/.r tv '
C hevrest i'Jdrifp.) ce quelles ont de malfatfant. Divcr-
fes précautions prifes contre elles félon différentes cputuhjcs.
III. 321. e. Cahoïi qui décide que la tlime efl due des chèvres
qui font h la garde dù pailcur, &c. Ibid. b.
CHevre, (Médec.) on en mange très-peu cn Europe: ba
chair étoit plus ufitéfe chez les anciens Grecs. Mauvaife qualité
de fa chair. Erfiploi dit lait dc chcvrc pour les ufages
de la table cn plüAeür# pays. Scs propriétés médicinales le
trouvent au mot L'ait. Propriétés de fa fíente. III. 321. b.
Chèvre du bérpdril. On prétend que les bezoards orientaux
viennent d une chèvre, mais elle cil peu connue. Ce
que les arttehrí éh éfcriVént. lïl. 321./>.
Chevre du mufe. III. 321. b, . r, v, , - j
Chèvre fattvage d'Afrique. Sa dcfcripuon. Liqueur qu elle
fournit. III. 321.. b. ■ , , . ,..v t ... x i r
• Chevre de Syrie. Où fe tróúvcnt ces animaux. Leur dcl-
cription. III. 321. b. n... .. *,i . T
1 Chevres de Sefros. XIV. 846. 0. Chevres d Angouri. I.
- Chevres, pôil de,poil des chevres d'Àngouri. I. 466. 0.
Ariflotc (lit qu’en Cilicio on toridoit lés chèvres. III. 45 x b.
Poil dc chcvrc pour la teinture. XVI. 10. b. De la teinture
du poil dc chevrC. 26. 0. 31. b.
C hèvre. ( Mytltbl. ) III. 3%±i a. Jt
C hevre, (AflrJit.)ilontàtudic 8c latitude de cçjto ¿toué,
Conflellation de ce nom félon quelque s- aflronomcs. Fiélion
des poètes fur cette conucllajion. 111., 322. 0. (
• Chevre, étoile du cocher. Suppl. 11. 560. b. Heures dc
fon pafiage afi méridien. 894.0. ' , .
Clievre danfârtte, phéhôîhche lunïincux. Caufé de la lumière
que donnent les météores ignés. Celui dont il s agit ici a
hcfoin de vent pour fe manifefter. Météores - appelles par
les anciens des noms dé poutre , torche, feche. On n cil
pas plus habile cn pbyfiquc par la corinôîuaucc dc ces noms,
qu’avancé dans le clieihin de la fortune prfr les paroles d’urt
miniflrc. 111. 322^0.
C hevre de guûleait, (Pêche) pieux fur^ lcfquels on op-
pofe le# rc» où le fac de guideau. Defeription de celles qui
fe trouvent dans lé refTort de l’amirauté dc Ttniques 8c
Dives h la bande du- Ponant. Ces guideaux fe diilingucm en
Juidcaux dc flot 8c d’ebbe. En quel nombre ils fe trouvent.
II. 322. b. •
C he vu es. ( Salines ) Defeription 8c ufage. III. 322. b,
Chevre,pii de. Différente# fignifications de écs mots. XII:
364. a, b. , - A '
C h e v r e , ( Arts méc/t.) machine qtli cil l’ouvràgç du
charpentier, fie qui fert aux ihaconS 8¿ autres ouvriers qui
ont des poids péfans à. élever. Defeription dc cette machine.
III. 322. 0. Elle cil un cohippic du treuil fie de la.pou-
lio ,8c réunir les avantages de ces deux machines. //>/'</.,323. 0;
' Chevre, inflrument à l’ufaeé des charpentiers. XIII. <>9. b.
Ctuvre, rroiS olftilW de charron appelles chcvrc: grande
chcvrc 8ç petite chcvré. Leurs deferiptions. III. 323. b.
Chevre, barbe de (.Botan.) II. 72. 0.
■ CHEVREAU, il vient à-pcù-près dans lé même tems que
l'agneau : bohilcS qualités de. fa chair. Comment on le gouverne.
Ufages de fa peau. IJI. 323. 0.
• C hevreau , ( MéÛéc. ) Obfcrvations fur les qualités dc fir
chair. C’eA un afiez mauvais aliment,~ malgré le fentiment
de plufieurs médecins. Dans quels cas elle peut devenir
utile. Meilleure façô'n dé l’apprêter. III. 323. 0.
C hevreau, ( Urbain)obfcrvations fur' ce (avant 8c fur fes
¿uvragcs. IX. 698. b. Suppl. IV. 468. b. L
C hev r e au x , ( Aflron,) dans la conflellation du cocher.
Leur origine fcloii la fable. Ce que préfageoit leur lever.
Suppl. 11. 304. 0.
CHEVRE-FEUILLE, caraélcrç de, fa fleur. III. 323. a.
Cas qu’on cn fait dans les jardins. Différentes cfpcccs de
chcvrc - feuille dojjt.raiTcmblagc fait l'agrément des jardins.
Divers ufages qu’on en fait pour rornement des lardins.
Ces arbrifleaux croiflcnt promptement, font robuÂ’cs oc réuf-
“dent cn toute terre; Manieres dc les multiplier. Commènt
°n les préfervé’ des pucerons.
Efpeces 6* variétés du chèvre-feuille. i°. Le clicvrc-feuillc
précoce. 2°. Le chcvrc-fcuillc romain.Ccs dcilx cfpeccs ne font
I$v taJu eftimées que les autres. 30. Le chcvrc-leqiHe blanc,
u Angleterre. 40, Le rouge. Ibid. b. ç". Le chcvrc-fcuillc à
rcuille de chêne. 6°. Le panaché, à feuille de chêne. 70. Le
clicvrc-feuillc blanc d’Angleterre à fcuillc.panaçhéc de jaune.
* c c‘,'iVrc-féiîiltc d’Allcniagnc : ÔÛ’ il le trouve : on‘doit
C H I 303
lui/donner la préférence fur les précédens. 9°. Le rouge
tardif y c’cft l’une des plus belles cîpcces , ¿v. to°. Le che-
vre-fcuillc toujours yerd, très-belle cfpecç cncçre , S’c,
manjérc de le multiplier, n " . Ltaclievre-feuille de Canada.
120.Celui de Candie. 13". Celui de Virginie, l’un des plus
beaux ^rbrificaux, 6>c. Ses bonnes qualités. Manière de lé
milltîplier. XIT. ,314- al - Voyez Suppl.X. yjo. b.
CHEVRE-FEUILLE, (Botan.) .noms dc çcttc plante cn différentes,
langues. Son caraélcre générique. Enumération de
huit cfpeces dc chevre-feuilic. Suppl. II. 294* fr Leur defeription.
Lieux où elles craifTent. Culture fie ufages. Nature
du fel qu’on en tire par 1’analyfe. Ibid. b.
' C hèvre-feuille , ( Mât. médic. ) Propriétés des feuilles,
do leur fuc., & de l’eau diftilléc des fleurs. III. 324. b.,
CHEVRETTE d’Amboine , {Infc£lol.) t auteur qui çn a
donné là figure. Sa defeription. Sa ciamfication.5,tt/>p/. H. 396.0.
CHEVREUIL, on-en prerfdroit une faufile idée fi Ion
s’arrétÔit à fon nom ; il rcflcmble plus au cerf qu’à la chèvre.
Caraétcrcs dé cet animal. Pays où il fe trouve. Importance
de fa chaffe. Lieux oii le veneur doit ajjcr en quêto
félon les faifons. Soins de la chevrette pour fes faons. Tem»
où ils peuvent marcher. On dit qu’ils ont à craindre d’être
blelTés des vieux lorfqu’ils font cn rut. III. 314./>. Connoif-
fanccs ùücjes chafieurs doivent acquérir fur le chevreuil. De
la cliatïe (le cet animal. Ibid. 325. 0. .
Chevreuil. On diilinguc au pié les mâles des femelles. AIL
561, b. . u . ;
C he v r eu il , (Mat. médic.) éloges que divers auteurs
ont fait#, (le fa chair. Propriétés dc la graifTe, de fon fang,
de jfon fîèl, de fes cornes. III. 325. 0.
CHEVRONS, ( Àrchit. 6* Charp. ) pièces de bois qui s’élèvent
par paire fur le. toit, fie forment le faite. Leurs longueu
r , largeur, épaifïcur, diftance, fixées par le parlement
d’Angleterre. III. 325. 0.
Chevron de cheron , chevron de croupe, ( Charp.) III. 325.0.
Chevrons de gafon, (Jard.) 111. 325. b. . ■ .
CHÈviÎpN, ( Comm.) forte dc laine qui vient du levant.
Iïî. i 25, b.
Chevron, manigucttc , menue guildre ou gildrc ; toutes
fortes de petits poifïbns défignés par ces termes. Deferip-
tions dé deux fortes d’inftruinens de pêche pour ces potf-
fons, dont l’ufagc cft défendu. III. 325. b.
C he v r o n , (Blafon) Sens de ce mot joint à divers adje-
élifs qui cri indiquent la figure, lafituation , Oc. 111. 325. b.
C hevron , (Blafon) une des fept pièces honorables.
Manière de pofer les chevrons dans l’écu, explication des
épithetes par lcfquellcs on défigne les différentes manières
(le les repréfemer. Signification dc cette figure fymbolique.
i Suppl. II. 396. b. . . . > , • .
Chevron, piece honorable , Suppl. IV. 367. 0. deux chevrons
, ibia. b. trois chevrons , 368. 0. -Chevron contrepdihté.
IV. 140. b. ............
CHEVRONNÉ, (Blafoq) écu diyifé en fix parties dans
le feus des chevrons (les deux émaux alternés. Proportions.
Etymologie des termes tjhcvron 8c chevronné. Suppl. H. 396. b,
CHEV ROTIN , ( Hift. nat. ) nom impropre donné à deux
genres d’animaux de la famijlc des gazelles, particuliers à
fAfrique. Obfcrvations ftir ces animaux. Suppt II. 397. 0.
Çhevrotin, animal décrit Vol. VI. des pl. règne anim. pl. 5,
CriEVR.OTTER, (Mùfia. ) cn quoi confiftc le chcvrot-
tement dans le ¿liant: quelle cn cft la caufe méchanique.
Giorgc ) Pbyfiologiftc. Suppl. IV. 355. a. .
CHEZÊ., ( J'urifp. ) cn quoi il confiftc. Coutumes ou il eq
cft parlé. Il cft appcllé auffi le vol du cliapon., Obfcrvation
fur la manière de lire, d’écrire fie de prononcer ce mot.
III. 326. 0. (foyer V o l . . _
CHIA , fùrnom dc Diane. Son origine. On croyoït que
fa ftatuc regardoit avec févérité ceux qui envoient dans fon
temple, 8è avec (atisfaélion ceux qui enfortoient. III. 326. 0.
CHIABREKA, (Gabriel) poëtç italien. XIV, 722* b- *
CHIAOUS, huimer de la cour du graqd .Sçigneur. Sens
propre dc ce mot. Armes du chijious, Ta ritarque de dignit.e,
Prifôriniers qu’oii lui confie. C ’cft du nombre des cluaous qu il
tire fes ambaffadeurs. Ces Officiers font regardés comme
dc mauvais augure. Officier qui les commande. III. 326. a.
Voyez T c h ia o u s c h -b a c h 1. * ,
CHÎÂRVATAR , ( Comm. ) Officier de douane cn Perfc,
; Oc. Droit d’entrée que chaque perfonne paie cn quelques
; vilics dc Perfc. III. 320. E
CHIBRATH, mefurc de diftançc chez Jlc» Hébreux j la
loi ne leur permettoit pas de faire plus de deux chibratbs
un jour de fabbat. III. 326. b. ;
CÎHlCANE, ( Art milit. ) pofte de chicane. II. 132. 0.
CHICORÉE, (Bot.) caraélerc dc ce genre de plantes.
111.327.0. . . . . . . ..* ÿà-.i'' -'i
C h ic o r é e fauvage, (Mat^ méd.) elle eft de Iordre,*des
plantes extraélives, amenés & lauçujcs,ou trèS:légere.qipitt
; ré'fincufcs. Ses vertus médicinales. Mala'tÜcs dans rcfquclle»