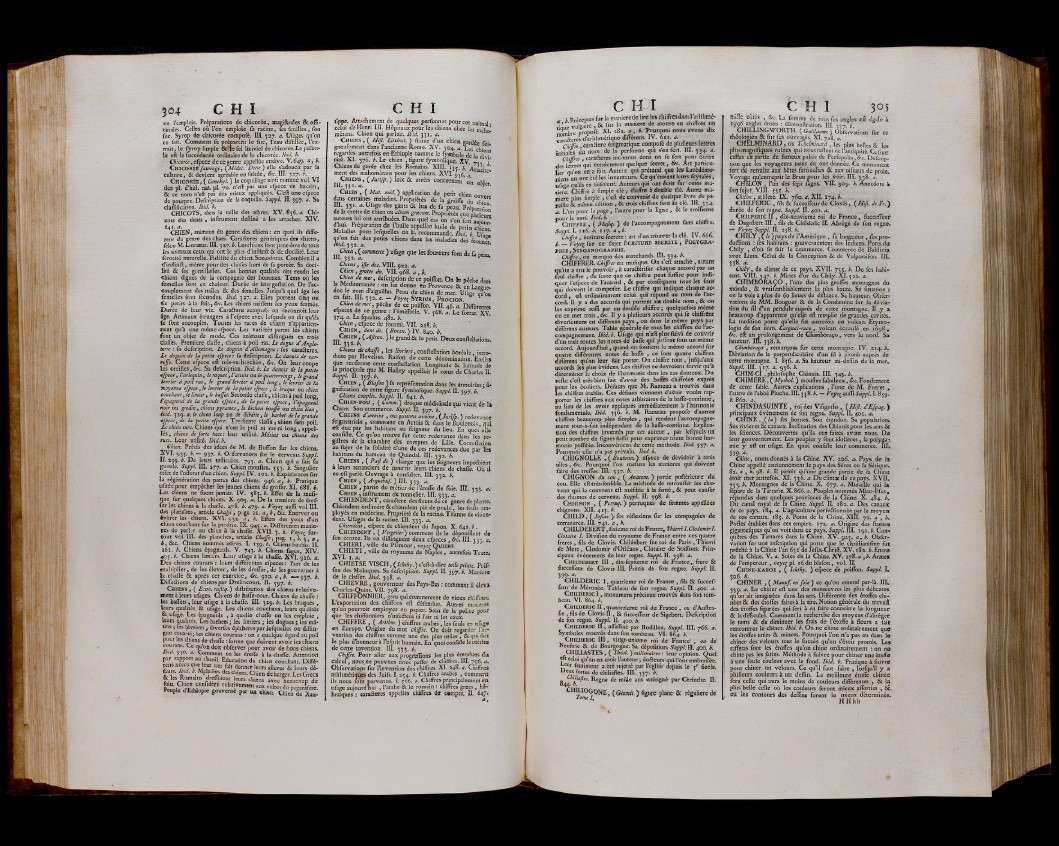
3 04 C H l
on l’emploie. Préparations de chicorée, magiftrales & offi-
tinales. Celles Où l’on emploie fa racine, les feuilles, fon
fue. Syrop de chicorée compofé. 111. 327. a. Ufages qu’on
en fait. Comment fe préparent le lue, l’eau diftilléc, l’extrait,
le fyrop (impie & 'ie fel lixiviel de chicorée. Le piflen-
lit eft le fuccédanéè ordinaire de la chicorée, Ibid. b.
Chicorée, efpece decègenre appellée endive. V.^49. à, b.
CHICORÉÉ fauvage, ( Mcdtc. Diète ) die s’adoucit par la
culture, & devient agréable en faladc, bc. III. 327. b.
C hicorée, ( Conchyl. ) le coquillage ainfi nommé vol. VI
des pl. d’hift. itat. pl. 70. n’eft pas une efpece de buccin,
6c ce nom n’eft pas des mieux appliqués. C’cft une efpece
de pourpre. Dcfcription de la coquille. Suppl. H. 397. a. Sa
«lanification. IbiJ. b. , •
CHICOTS, dans la taille des arbres. XV. 836. à. Chicots
des dents , infiniment deftiné à les arracher. XIV.
(41. a.
CHIEN, animaux du genre des fchiertS : eh quoi ils différent
du genre des chats. Caraéteres génériques des chiens,
félon M. Lin meus. III. 327. b. Les chiens font peut-être de tous
les animaux ceux qui ont le plus d’inftinô8c de docilité. Leur
férocité naturelle, fidélité du chiert. Son.odorat. Combien il a
d’inftintt, même pour des chofes hors dé fa portée. Sa docilité
& fes gcntillefles. Ces bonnes qualités ont rendu les
chiens dignes de la compagnie des hommes. Tems où les
femelles font en chaleur. Durée de leur geftation. De l’ac-
Couplement des mâles & des femelles. Jufqil’à quel âge les
femelles font fécondes. Ibid. 327. a. Elles portent cinq ou
fiK petits à la fois, bc. Les chiens naiflent les yeux fermés.
Durée de leur vie. Caraétere auxquels on reconnoît leur
âge. Animaux étrangers à l’eipece avec lefqucls on dit qu’ils
fe font accouplés. Toutes les races de chiens n’appartiennent
qu’à une même efpece. Les variétés parmi les chiens
font un objet de mode. Ces animaux diltingués en trois
claifes. Première claffe, chiens à poil ras. Le dogue d‘Angle-
terre : fa dcfcription. Le doguin'd Allemagne : fes caraéteres.
Le doguin de la petite efpece: fa defeription. Le danois de car-
rojfe. Cette efpece eft très-recherchée, bc. On leur coupe
les oreilles, &c. Sa defeription. Ibid. b. Le danois de la petite
efpece, l’arlequin, le roquet, l’artois ou le auatre*vingt, le grand
levrier à poil ras, Ce grand levrier à poil long, le levrier de la
moyenne efpece, fe levrier de la petite efbece , le braque ou chien
couchant, le limier -, le bajfet. Seconde claffe, chiens à poil long,
l ’épagneul de la grande efpece, de la petite efpece» Vépagneul
noir ou gredin-, chiens pyrames , le bichon bouffé ou chien lion »
ibid. 329. a. le chien loup pu de Sibérie, le barbet de la grande
efpece, de la petite efpece. Troifieme claffe, chien farts poil.
Le chien turc. Cliiens qui n’ont le poil ni ras ni long, appel-
lés, chiens de forte race: leur utilité. Mâtins ou chiens des
rues. Leur utilité. Ibid. b.
Chien. Précis des idées de M. de BufFon fur les chiens.
XVI. 933. b. — 937. b. Obfervatións fur le cerveau. Suppl.
H. 299. b. De leurs tefticules. 793. a. Chien qui a fait fa
gueule. Suppl. III. 277. a. Chien monftre. 353. b. Singulier
effet de l’oaorat d’un chien. Suppl. IV. 102. b. Expériences fur
la régénération des pattes des chiens. 946. a, b. Pratique
ufitécpour empêcher les jeunes chiens de eroflir. XI. 688. b.
Les chiens ne fuent jamais. IV. 383. b. Effet de la mufiÎ[
ue fur quelques chiens. X. 903. a. De la manière de dref-
er les chiens a la chaffe. 478. b. 479. a. Voye{ auffi vol III.
des planches, article Chaffe, p gc 21. a, b, &c. Énerver ou
évérer les chiens. XVI. 932. a , b. Effets des yeux d’un
chien couchant fur la perdrix. IX. 945* <*• Différentes manieres
de parler au chien à la chaffe. XVII. 3. b. Voyez fur-
tout vol.lIL des'planches, article Chaffe, pag. i , b . \ , a ,
h, &c. Chiens nommés adirés. I. 130. b. Chiens baubis. II!
161. b. Chiens épagneuls. V. 743. b. Chiens fages, XIV.
403. b. Chiens limiers. Leur ufage à la chaffe. X v l. 916. a.
Des chiens courans : leurs différentes efpeces : l’art de les
multiplier, de les élever, de les dreffer,dc les gouverner à
la chaffe & après cet exercice, bc. 920. a , b. — 937, b.
Différions de chiens par Drelincourt. IL 397. b.
C hiens , ( Econ. rujliq. ) diftributiou des chiens relativement
à leurs ufages. Chiens de baffe-cour. Chiens de chaffe ;
les baffets, leur ufage à la chaffe. III. 320. b. Les braques ,
leurs qualités & ufage. Les chiens coucha», leurs qualités
&. ufage. Les épagneuls , à quelle chaffe on les emploie ,
leurs qualités. Les barbets ; les limiers ; les dogues ; les mâtins
; les lévriers, diverfes épithetes par iefqucucs on diftin-
gue ceux-ci ; les chiens courans : on a quelque égard au poil
pour les chiens de chaffe : forme que doivent avoir les chiens
9“ on doit obferver pour avoir de bons chiens»
Co™mcnt °n les dreflè à la chaffe. Attention
par rapport au chcml. Education du chien couchant. Diffé-
F™ T / r J u " " / ” a«™* leurs allures & leurs débuts.
1M. Í. Malad.es des chiens. Chien dubcrgcr.Lcs Grecs
& les Romains drciro.cn. leurs chiens avec beaucoup de
£ ” • ,Ch!,'," “ nf,d¿ré 'Envernen, aux cul.es du paranlfme.
Peuple dEduop.e gouverné par un chien. Chieh de
C H î
t’ppe. Attachement de quelques perfonnes pour cet animal
celui de Henri III. Hôpitaux poûr les chiens chez les mah
métans. Chien qui parloir. Ibid. 331. a.
C hiens , ( Hift. Littéral. ) ftatue d’un chien gardée fo‘*
gneufement dans l’ancienne Rome. XV. 304. a. Les ch
regardés autrefois en Ethiopie comme le fymbole de la d1,6”*
nité. XI. 376. b. Le chien , figure fymboliqué, XV. 7, - lVî*
Chiensdè garde chez les Romains. XIII. 13* g Att h
ment des mahométans pour les chiens. XVI. çyi& a c*
C hiens, ( Junfp. ) loix & arrêts concernant cet ohi»,
III. 331. a. OX)Jet*
i C h “ " î (Mat. M d .) ippllcatíon du petit chien ouvert
ÿn s ccnancs maladies. Propnétés de la graifle du S
? I M * 'd !& & ieS & baî d= fa peau. Prépara,'™
de la crdtte de Chien on aibm gracum. Propriétés qüe u l u S
auteurs lu. ont attribuées. Dans quel cas on s'en Ven a t t S
dhm. Preparat.on de l’hude appeUéc huile de petits chienL
Maladies pour lefquelles on la recommande, llid. b Ufi™
qu on fat des pems chiens dans les maladi« des femmfs
ibtd. 33®* es»
Ch,en, ( comhtrct) ufage qüe 1« foureurs font de fa oeau.
111. 232. a. ^
Chiens , ijle des. VIII. 922. a.
Chien , grotte do. Vil. 968. a , b.
1 S í ? de defeription de ce poiffon. On 1e pêche dans
la Méditerranée : on lui donne en Provence & en Langue,
doc fe nom d aiguillât. Peau du chien de mer. Ufage qu’on
IU* 332*û- Voyet^ S y r iu s , Pro cioN .
Chun de mer, pêche de ce poiffon. VII. 46. a. Différentes
efpeces de ce genre : l’émiffolle. V. 368. a Le forrat. XV>
374. a. Le fqualus. 482. b.
Chien, efpece de fourmi. Vil. 118. b.
CHIEN , dent de. ( Botan. ) IV. 840. b.
C hien , ( AJlron. ) le grand & le petit. DeuxconftellationSh
u i. 332. b.
Chiau tochaJTç , les Ihritn, conftcllstlon boréale , intro*
mte par Hevehus. Raifon de cette dénomination. Etoiles
que renferme cette confieliafioti. Longitude Si latitude de
la prtnetpale que M. Hallcy appeüoit le coeur de Charl« II.
Sumí, II. jnÿ. b.
Chien , ( Blajbn 1 fa repEéfcntatibü dans 1« armoiries ; fi.
gniftcanon de cette figure fymholiquei Suppl. H. 307. b.
Chiens couplés. Suppl. II. 641. b.
C hîen-fou , ( Comm.) drogue médicinale qui vient de là
Chine. Son commerce. Suppl. II. $97. b.
C hiens d’avoine , ou quienne avoine t {Jurifp, ) redevance
feigneuriale , commune en Artois 8c dans le Boulenois, qui
due par les habitans au feigneiir du lieu. En quoi elle
confifte. Ce qu’on trouve fui Cette redevance dans les re-
giftres de la chambre dés comptes de Lille. Conteftation
au fujet de la folidité d’une de ces redevances due par les
habitans du hameau de Quindal. III. 332. b.
C hiens , ( Pajl de ) charge que les ieigneurs impofoient
à leurs tenanciers de nourrir leurs chiens de chafle. Où il
en eft parlé. Ouvrage à confulter. 111. 332. b.
C hien , ( Arqueluf ) III. 333. a.
C hien , partie du métier de l’étoffe de foie. ID. 333. a.
C hien , infiniment de tonnelier. III. 333. a.
CHIENDENT, caraétere des fleurs de ce genre de plante*
Chiendent ordinaire & chiendent pié de poule, les feuls employés
en médecine. Propriété de la racine. Tifannc de chiendent.
Ufages de la racine. III. 333. a.
Chiendent, efpece de chiendent dtl Japon. X. 64t.b.
C hiendent , ( Vergetier) comment ils le dépouillent de
fon écorce. Ils en diftinguent deux efpeces, be. III. 221. a.
CHIERI, ville du Piémont, voyeirQ uieks.
CHIETI, ville du royaume de Naples, autrefois Tcatej
XVI. x. a.
CHIETSE VISCH, (Ichthy.) c’eft-à-dife toilepeinte. Poif*
fon des Moluques. Sa defeription. Suppl. II. 397. b. Maniere
de le daffer. Ibid. 398. a.
CHIEVRE, gouverneur des Pays-Bas : cortiment il éleva
Charles-Quint. VII. 798. a.
CHIFFONNIER, gens qui Commercent dé vieux chiffons.
L’exportation des chiffons eft défendue. Autres matières
qu’on pourroit employer en papier. Soin de la police pouf
que les chiffonniers n’irlfeftent ni l’air ni les eaux.
CHIFFRE , ( Arithm. ) chiffres arabes, les feuls en ufage
en Europe. Origine du mot chiffre. On doit regarder l’in-
ventiôn des chiffres comme une des plus utiles, & qui fait
le plus d’honneur à l’eibrit humain. En quoi confifte le mérite
de cette invention. III. 333. b.
Chiffre. Pour aller aux progfcffíons fes plus étendues du
Calcul, nous rte pouvons nous paffer de chiffres. III. 796. a.
Obfervatións fur l'invention des chiffres. XI. 248. a. Chiffres
arithmétiques des Juifs. 1. 234. b. Chiffres árabes , Comment
ils nous-font parvenus. I. <¡66. a. Chiffres principalement en
ufage aujourdWi , l’arabe & fe romain : chiffres grecs, hébraïques
: caraâeres appcllés chiffres de compte, II. 647*
C H I
, prACeptes fur la fnanierede lire les chiffrtTSdârfsl’ariflifnê- 118 vulgaire , & fur la mànierede mettre en chiffres uh
E h r e propofé. XI. 28a t a , b. Pourquoi nous avons dix
«arafteresd’àrithmétiquo différais. IV. 6 lt. à.
Chiffre, Câràâere énigmatique compofé de plufiéurS letffes
initiales du nom de la perfonne qui s’en fert. III. 334L A.
Chiffrés, cnra&eres inconnus donx on fe fert pour écrire
des lettres qui Contiennent quelque fecret, bc. Art particulier
qu’on en a fait. Auteur qui prétend que les Lacédémo-
niens en ont été les inventeurs. Ce qu’étoiertt leurs feÿtafes*
ufage qu’ils en faifoient. Auteurs qui ont écrit fur cette ma*
tiere. Chiffré à fimple clé y chiffre à double clé. Autre maniéré
plus fimple y c’çft de convenir do quelque livre dé pareille
« même édition , & trois chiffres font la clé. 1H. 334.-
a. L’un pour la page, l’autre pour la ligne, & le troiftemé
pourlemot. Ibidïb. . ~ ^
C h i f f r e , ( Mufiq. ) de l’accompagnement fartS cluffre.
Suppl. I. 116. b. 117. a yé. xr'arV
Chiffre, écriture fecrete : art d’en trbuver la dé. IV. 666.
g. » Voyei fur ce fujet É c r i t u r e s e c r e te , P o ly gR A -
PHIE , StÉGANOGRAPHU. j
Chiffre, ou marque de9 marchands. III. 334. m
CHIFFRER. Chiffrer èn mufique. On s’eft attaché » autant
qu’on a Cru le pouvoir , à caraélerifcr chaque accord par un
feol chiffre , do forte que ce chiffre peut fuffire pour indiquer
l’efpece de l’accord , & par conféquent tous les fonS
qui doivent le compofer. Le chiffré qui indique chaque accord
, eft ordinairement celui qui répond au nom ae l’ac*
cord. Il y a des accords qui portent ua double nom, & on
les exprime aufli par un double chiffre ; quelquefois même
on en met trois, bc. Il y a plufieurs accords qui fe chiffrent
diverfement en différens pays , où dans le' même pays par
différons auteurs. Table générale de tous les chiffres de 1 accompagnement.
Ibid. b. Ufage qui n’eft plus fùivi de cortvrir
d’un trait toutes les notes de Baffe quï paffent fous un même'
accord. Aujourd’hui, quand on foutient le même accord fur
quatre différentes notes de baffe y cè font quatre chiffres
différens qu’on leur fait porter. On chiffre tout, jufqu’aux
accords les plus évidens. Le9 chiffres ne devraient fervir k
déterminer fe choix de Y harmonie dans les cas douteux. Du>
refte c’eft très-bien fait d’avoir des baffes chiffrées exprès
pour les écoliers. Défauts que M. Rameau a trouvés dan9
les chiffres établis. Ces défauts viennent d’avoir voulu rapporter
les chiffres aux notes arbitraires de la baffe-continue*
au lieu de les avoir appliqués' immédiatement à l’harmonie
fondamentale. Ibid. 336. b. M. Rameau propofe d’autres
chiffres- beaucoup plus fimpfes » qui rendent l’accompagnement
tout-à-fait indépendant de la baffe-continue. Explication
des chiffres inventéspar cet auteur , par lefqucls un
petit nombre de fignes fùfnt pour exprimer toute bonne harmonie
poftible. Inconvéniens de cette méthode. Ibid. 3137. a.
Pourquoi elle n’a pas prévalu. Ibid. b.
CHIGNOLLE T(.Boutonn.') efpece de dévidoir à trois
ailes, bc. Pourquoi l’on melùre les matières qui doivent
faire des treffes. TH. 337. b.
CHIGNON du cou ( Anatom. ) partie poftérieure du
cou. Elle efttrès*fenftblë. La méthode de retroufter les che-
' veux qui- la couvrent cil nuiftble à la fanté, & peut caufer
des rhumes de cerveau; Suppl. IL 398. b.
C hignon ( Pemup y perruques de femmes appeUéès
chignons. XII. 413. b.
CHILD, CJoJîas )* fes réflexions fur les compagnies de
commerce. in .74 1 . * , * . .......................
CHILDEBERT, fixicme roi de France, Thierri I. Clodomtrî.
Cio taire I. Divifion du royaume de France entre ces quatre
freres, fils de Clovis. Childebert fut roi* de Paris , Thierri
de Metz, Clodomir d’Orléans, Clotaire de Soiffons. Principaux
événemens de leur regne. Suppl. 11. 398'. a.
C hildebert III y dix-feptieme roi de France1, frere &
fucceffeur de Clovis III. Précis de fon regne. Suppl. H.
399. a.
CHILDERIC I , quatrième roi de France , fils & fucceffeur
de Méronée. Tableau de fon regne. Suppl. II. 400; a.
C hilderic I , monumens précieux trouvés dans fort tombeau.
VI. 864. b. /
C hilderic I I , quatorzième roi de France , ou d’Auftra-
fie, fils de Clovis I I , & fucceffeur de Sigebert. Dcfcription
de fon regne. Suppl. II. 400. b.
C hilderic I I , affaffmé par Bodillon. Suppl. III. 766. a.
Symboles trouvés dans fon tombeau. VI. 864. b.
C hilderic III,- vingt-unicme rai de France', ou de'
Neuftrie & de Bourgogne. Sa dépofttion, Suppl: II. 400. b.
CHILIASTES , ( Théol. y millénaires : leur opinion. Quel
w celui qu’ôn en croit Vauteut; dofteurs qui l’ont embraffêe.
~!Ur fentiment' a'été rejetté par l’églife depuis le ç* ftecle.
Ch’ ^0rtes chiliaftes, III; 337. b.
844. ^e6n® ans enfeigné par Cérinthe: II.
/ ^ E > { ) figure plane- 8c régulière dé
CHI 305 rtiifle côtes , bc. La fomnVe dé toiis fes angles cil égale à
î 996 angles droits : dêmohftfàtîoh. III «*t a
C Guilloumey ólferv'ations fur ce
théologien oc fur fes ouvrages. XI. 728. a.
CHELMINARD , ou fchclminard , les plus belles & les
plns magntóqués fuinés c[ui riôuis relient de Antiquité. Ce font
celles en partie du faifièùx palais de Perfcpolis, bc. Defeription
que les voyageurs nous en ont donnée. Ce monument
fert dé retraite aux bêtëà farouches & aux oifeaux de proie»
Voyage qu’entreprit le Brun pour lés ÿôir. HT. 338. a.
CHÎLON, l’Un des fépt fages. VIL 909. b. Anecdote à
fort fujet. VÏU. f3t. b. ,
"ûhilbn', atiiiêtê» ÎX. 760. d. XII. 174. b,
CHlLPERIC , fils & fucceffeur de Clovis, { tìijl. de Fr. y
düféè de fort régné. Suppl. II. 401. a.
C h ì l p e r i c I I , dix-neuvième roi de Francò* fucceffeur
dê Dagôbèft I II, fils de Childèric II» Abrégé de fon regne»
f r°ÿexJ^uPlp f IL 238. b.
CHILi , \ l c ) pays de l’Àmèrique , fa longueur, fes produirions
: fes habitans : gouvernement des Indiens. Ports, du
Chily., d’où fe fait lé commerce. Commérce d i Baldi via
avec Lima. Celili de là Conception & de' Vafparaifon. IIL
3Î8- ..
Chily, du climat de cè pays. XVII. 722. b. De fes habitans,
VIII..347. f Mines d’or du Ghily. XI. 320. a.
CHIMBORAÇO , l’une des plus groffes montagnes du
mónde, & vraisemblablement la plus haute, fituation :
on la voit àphis de 60 lieues de diltaiice. Sa hauteur» Obfcr*
varions de MM. Bouguer & de la Condaminc fur la déviation
du fil d’un pendine auprès dé cette montagne. Il y a
beaucoup d’apparence qu’eué eft remplie de grandes cavités.
Là tradition porté qu’ellé fut autrefois un volcan. Etymologie
de fori nom. Càrguai-raco , volcan écroulé en 1698 ,
bc. eft un prolongement dé Chiiiiboraço, vers le nord. Sa
hauteur. lu . 338. b.
Chimboraço , remarques fur cette montagne. IV. 214. b.
Déviation de la perpendiculaire d’un fil à plomb auprès de
cette montagne. I. 836. a. Sa hauteur aù-deffus de là mer»
Süppl. HI. 317. a. 936. b.
CHIM-CI, philofophe Chinois. IIL 343» b.
CHIMERE, ( MythoL ) monftre fabuleux, bc. Fondement
de cette fable. Autres explications , l’une de M» Freret ,
l’autre de l’abbé Plüche. IIL 338. b. — Voye^ aufli Suppl I» 839»
b. 860.1 a.
CHINDASUINTE , rot des Vifigoths, (Hiff d’Efpag. )
principaux événemens dé ion'regne. Suppl. II. 401. a.
CHINE , ( la ) fes bornes. Son étendue. Sa population»
Ses rivières & canaux. Inclination des Chinois pour fes arts &
fes feiences. Découvertes qu’ils ont- faites avant nous. De
leur gouvernement. Les peuples y font idolâtres, la polyga-i
mie y eft en ufàge. En quoi confifte leur commerce. III»
Chine, noms donnés à la Chiiie» XV. 206. a. Pays de la
Chine appellé anciennement lé pays dès Séres qu la Sèrique»
82. à , b. 98. b. Il paraît qu’iine grande partie de là Chine
¿tûit mer autrefois. XI. 326. a. Du climat de' ce paÿs. XVII»
73 3. b. Montagnes dè la Chine. X 677* u. Muraille qui la
fèpare de la Tartarie. X. 866. a. Peuples nommés Mrao*-Ffes ,
répandus dans quelques provinces' dé la Chine» X. 484. b.
Du canal royal de la Chiné. Suppl. II. 182. a. Dès canaux
de ce pays. 184. a. L’agricultureperfeâàonnée par le moyen
de ces canaux. 183. b. Ponts de la Chine. Xllf. 72» a , b»
Poftes établies dans cet empire. 172. a. Origine tics ftatue s
gigatirefques qu’on voit dans ce pays. Suppl. n f. 191. b. Conquêtes
des Tartares dans la Chine. XV. 923. a, b. Obfcr-
vation fur une infeription qui porte que le cnriftianifme fut
prêché à la Chine l’an 63 r de Jefùs-Clirift, XV. 182. b. Encre
de là Chine. V» a. Soies de la Chine. XV» 278. a ,b. Armes
dè lfenlpereur , voyez pl. 16 du blafon * vol. H.
C hine-kaboe , ( Ichthy. ) efpece de poiffon. Sappi. I»
306. b.
CHINER , ( Manuf en foie ) ce qu’on entend par-là. IIL'
330. a. Le chiner eft une des manoeuvres les plus délicates
qu’on ait imaginées dans les arts. Différence des étoffes chi-'
nées & des étoffes faites à la tire, Notion générale du travail
des-étoffes figurées qui fert à én faire connoîtrc la longueur
& la difficulté. Comment la recherche des moyens d’abréger
le tems & de diminuer fes frais de l’étoffe à fleurs a fait
rencontrer lé chiner. Ibid. b. On ne chipe ordinairement que
les étoffes unies & minces. Pourquoi l’on n'a pas eu dans le
chifiér des velours tout le fuccès qu’on s’étoit promis. Les
taffetas font fes étoffes qu’on chiné ordinairement : on ne
chiné pas les fatins. Méthode à fuivre pour chiner une étoffe
àruffe feulé couleur avec le fond. Ibid. b. Pratique à fuivre,
pour chiner, un velours. Ce qu’il faut faire , lorfqu’il y a
plufieurs couleurs à un deffin. La meilleure étoffe chinée
fera celle qui aura le moins de couleurs différentes , & la
plus belle celle où les couleurs feront mieux ^fforties , 8c
où les contours des deffins feront le mieux déterminés.
H Hhh