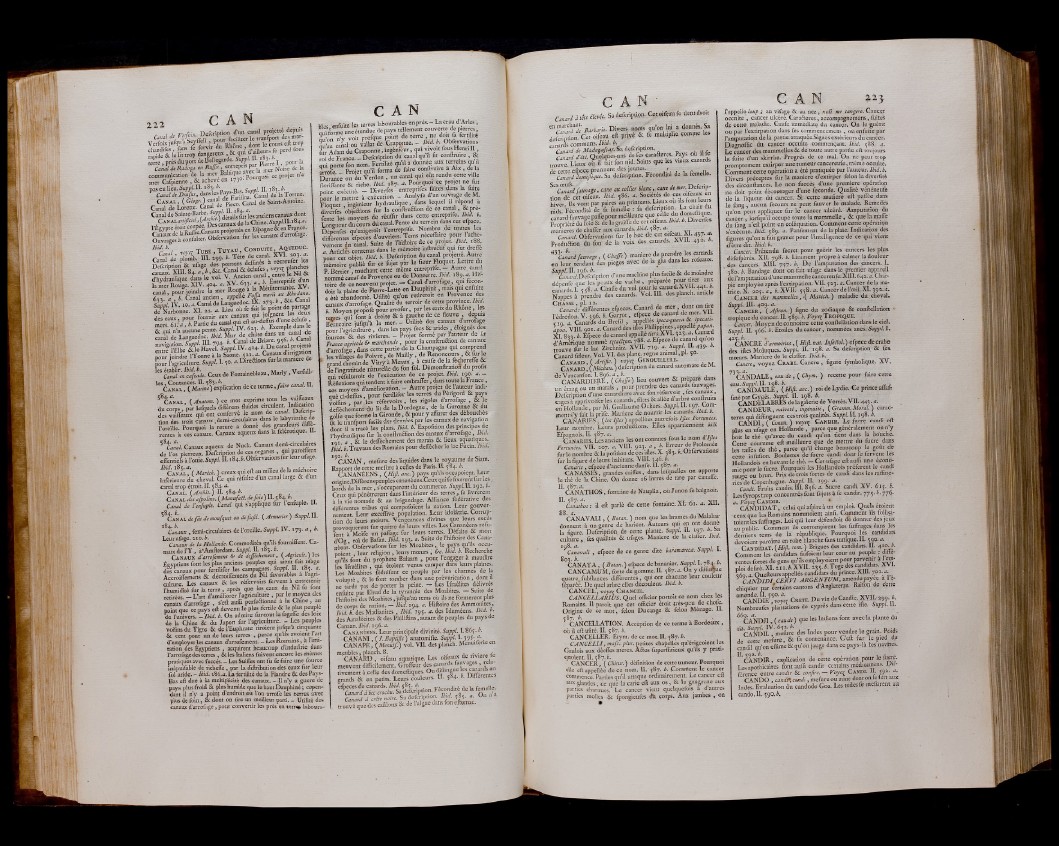
222 C A N
•Vertox Rhône , dont le cours eft trop
S & S S E dangereux fc oui H - fe PP«> fous
terre, près du port deBellegsrde. Suffig 183. • fa
1 3 1 1 1 % en im S R ^ Æ S ïk  & la
communication de la 'ne', 4 0 - pourqUoi ce projet n’a
mer Cafpienne, & achevé en 1730. TOurq.
p a s e u lie u .W .U .iS 3-i- s , n . ,8 , . i
Canal dcDrufus, dans les IW » / ¡Ç ^ j de ja Tortue.
C a n a l , ( d e Saint-Antoine.
Canal de Lorette. Canal de neco.
Canal de détails fut les anciens canaux dont
S l l l l Y n. f ‘ ‘ lïgypte éton ccMj^éÛg UD es ¿anaux gde lgaC hine. & ç „ France.
§ ^ i l l | | | | Obfervànon fur les canaux d arrofage.
'ÎÊm M . . 'T'iinv T u y a u , C o n d u i t e , A q u e d u c .
dïydrauUque d ^ i e v ol Ancutn g | | | | | | | tfun
navigation. ; IV. 414. 4. Du canal projetté
B f l lf iK t tM P | Ë | | É I Ceux de Fontainebleau, Mariy, Verfail-
■ P P O H M dece terme, faire eannl.U.
‘,8C a n a l, ( Anatom. ) ce mot exprime tous les vaiffeaux
du corps, pi- lefquels diiférens fluides circulent, dntonon
des vaiffeaux qui ont confervè le nom de canal. Pefcnjs
tion des trois canaux .demi-circulaires dans le labyrinthe de
l’oreille. Pourquoi la nature a donné: des g^deure différentes
à ces canaux. Canaux aqueux dans la fclèronque. II.
^Canal. Canaux aqueux de Nuck. Canaux dembeirculaires
de l’os pierreux. Defcription de ces organes , qui paro.ffent
effentiels à l’ouïe. Suppl. H. i 84. *• Obfervanons fur leur ufage.
U C a n a l? ( Marieb. ) creux qui eft au milieu de la «nphoire
inférieure du cheval Ce qui réfulte dun canal large & dun
canal trop étroit. II. 584. a.
C a n a l . ( Archit.) IL 584. Q ,
C a n a l des efpolins. ( Manufad. de Joie ) IL $ 04. b.
Canal de l'enfuple. Canal qui s'applique fur lenfuple. 11.
S ?C a n a l de fût de moufquet ou defitfd. ( Armurier ) Suppl. II.
Canaux, femi-circulaires de l’oreille. Suppl. IV. 179. a , b.
^Unaux de'laHollande. Commodités qu’ils fourniffent. Ca-
naux de l’Y , à-Amfterdam. iuppl.ll.183. b.
Canaux d’amfemem 6- de difficilement, (Agrmult.)1 les
Égyptiens font les plus anciens peuples qui aient fait ufage
dis canaux pour fertilifer les campagnes. SnppA U. ,185. a.
Accroiffemens & décroiffemens du Nd favorables a 1 agriculture.
Les canaux & les réfervoits ferveru à entretenir
l’humidité fur la terre , après que ks .caux du Nd fe font
retirées. - L’art d’améliorer l’agricnlmre , par le moyen des
canaux d'arrofage , s’eft auffi perfcffionne a a Chrne , au
point que ce pays eft devenu le plus femle & le plus peuple
de l’univers. - Ibid. b. On admire fur-tout la figeffe des Ion
de la Chine & du Japon fiir l’agriculture. - le s peuples
voifins du Tigre & de l’Euphrate tlroiem pifqn a cinquante
Sc cent pour un de leurs terres , parce qu’ils avoient 1 art
d'employer les canaux d’arrofement. — Les ¡Romains, a 1 imitation
des Égyptiens , acquirent beaucoup d’induftrie dans
l’arrofage des terres, & les Italiens fuiyent encore les mêmes
pratiques avec fuccès. - Les Suiffes ont fu fe faire une fource
inépuifable de richeffe, par la diftribution des eaux fur leur
fol aride. — Ibid. i86.<t. La ■fertilité de la Flandre & des Pays-
Bas eft due à la multiplicité des canaux. - Il n’y a guère de
pays plus-froid & plusbumide que lehautDauphiné ; cependant
il n’y a point d’endroit ou l’on arrofe les terres avec
plus de foin, & -dont on tire un meilleur parti. - Utilité des
canaux d'arrofage, pour convertir les prés en terres laboura-
C A N
qui forme un - de Krre > n0 floit fa fertilité
¡K ü "anal ou vallat de.Craponne. _ Ibid. b. Obferva.io.is
H Adam de.Craponne, ingénieur, qui vtvoit fousHennII,
roi de France. - Defcription dn canal qu il fit conftruire , &
Ü porte fon nom. Fertilité qu’ila donnée aux g h « |
wrofe. - Projet qu’il forma de faire conftruire à A ix , de la
Durance on du terd on, un cand qm eût tendu cette v.Ue
S a u t e & riche. Ibid. .87. | Pourquo. ee projet ne fut
point exécuté. - Diverfes entrepnfes feues dans la fuite
pour le mettre à exécution. - Analyfe d’un ouvrage de M.
Iloquet , ingénieur hydrauhque, dans lequel il répond a
diverfes objeftlons fur la conftru£hon de ce canal, &pre-
fente les moyens de réuflir dans cette entrepnfe. lbtd. b.
Longueur dn cours ducanaLPente du terremdaju cet efface.
Dèpenfes qu’exigeroit l’entfefrife. Nombre de toutes les
diifcrentes efpeces d’ouvriers, Tems nèceffaire pour 1 achèvement
du clnal. Suite de l’hiftoue de ce projet. ./Ad. 188.
a. Articles contenus dans le mémoire mftruaif qui fut dreffé
pour ce. objet. Ibid. b. Defcription du canal pro,ette. Autre
mémoire publié fur ce fujet par le fieur Floquet. Lettre du
P.Berner,touchant cette mêmelentreprife. Autre .canal
nommé eannl de Provence ou de Donrçrre./Ad. « ^ .H i f -
toire de ce nouveau projet.,— Canal darrofage , qui fécon-
doit la plaine de Pierre-Latte en Dauphulé , mms qm enfuue
a été abandonné. UriUté qu’on reureroit en Provence des
canaux d’arrofage. Qualité du terrotr de cette provmee lbtd.
b. Moyen propofé pour arrofer, par les eaffx du Rhône, les
umres qui font à iroite & à inuàtn de ce fleuve depna
Beaucaire jufqu’à la mer. - Üdlné des ç^aux d arrofage
pour l’agricailture , dans les pays fecs & andes, ébignés des
fources & des rivières. - Projet formé pat1 auteur de la
France agricole & marchande , pour la conftruftion de canaux
d’arrofage, dans cette partie de la Champagne ggj comprend
- les villages de Poivre, de Mailly, de &
* grandcHeminde Vitry à Meaux, à çaufe de la fédiereffe &
l e l’ingratitude natureUe de fon fol. Dèmonftrauoff du profit
qui réïulteroit de l’exécuùon de ce projet, lbtd. 190-. n. -
Réflexions qui tendentàfaire embraffer, dans toute la France,
ces moyens d’améUorarion. - Autre projet de 1 auteur indiqué
ci-ueffus, pour fertilifer les terres du Périgord & pays
voifins , par les rèfervoirs, les rigoles darrofage , & le
defféchement-du lit de laDordogne, de la Garonne & du
golfe que forme la Gironde, & pour y affûter des débouchés
& le tranfport facile des denrées par les canaux de navigattoii
dont il a tracé les plans. Ibid. b. Expofmon des principes de
l’hydraulique fur la confiruftion des canaux darrofage, Ibid.
101. a & le defféehement des marais & lieux aquatiques.
Ibid. b. Travaux des Romains pour deffécher le lac Fucin. Ibid.
I9CANAN, mefure des liquides dans le royaume de Siam.
Rapport de cette mefure à celles de Paris. IL 584. b.
CANANÉENS , {FTifl. anç.) pays qu’ils occupaient. Leur
orieine.Différenspeuples cinanééns.Ceux quife fixèrent fur les
bords de la mer, s’occupèrent du commerce. ¿uppl.U.. 192. b.
Ceux qui pénétrèrent dans l’intérieur des terres, fe livrèrent
à la vie nomade & au brigandage. Alliance fédérative des
différentes tribus qui compofoient la nation. Leur gouvernement.
Leur exceffive population. Leur idolâtrie. Corruption
de leurs moeurs. Vengeances divines que leurs exces
provoquèrent fur quitte de leurs villes. Les Cananéen rein-
fent à Moïfe un paffage fur leurs terres. Défaite & mon
d’Og roi de Bafan. Ibid. 193 .a. Smte de l’hiftoire des Cananéen.
Obfervarions fur les Moabites, le pays quils occu-
poient leur reügion , leur? moeurs, &c. Ibid. b. Recherche
qu’ils font du prophète Bdaam , pouç l’engager à maudire
les Ifraélites , qui étoient venus camper dans leurs plaines.
Les Moabites léduifent ce peuple par les charmes de la
volupté , & le font tomber dans une prévarication | dont il
ne tarde pas de porter la peine. — Les Ifraélites délivrés
enfuite par Ehud de la tyrannie des Moabites. — Suite de
l’hiftoire des Moabites, jufqu’aù tems où ils ne formèrent plus
de corps de nation. — Ibid. 194. a. Hiftoire des Ammonites ,
Ibid. b. des Madianites , Ibid. 195. a. des Iduméens. Ibid. b.
des Amalécites & des Philiftins, autant de peuples du pays de
Canaan. Ibid. 19.6. a. » T or 1
C ananéens. Leur principale divinité. Suppl. 1.005- f-
CANANI, ( J.BapùJle) anatomifte. Suppl. I. 39ï*.f’ .
CANAPÉ, (Menuif.) vol. VII. des plancb. Menuifene en
meubles, plan.cn. 8. , . . f
CANARD I oifeau aquatique. Les oifeaux de rivière le
meuvent difficilement. Groffeur des canards auvages, r
tivement à pelle des domeftiques. On diftingue k o M
grands & en petits. Leurs couleurs. IL 584- A Différentes
efpeces de ceni.rds. / i . F é c o n d i t é de la femelle.
Canard à bec crochu, ba cleicripuon. *
Canard A erlte noir,. Sa defcription. lbtd. 583. «. On lia
trouvé que des cailloux & de l’algue dans fon eftomgc.
C A N '
Canard i tlte iUvie. Sa defcription. C«oifçW fe tieotd.oit I
W B Ê É & S S ^ . donnés. S a
d e l S o n ; Cet oifça« eft privé & fe mulnplte compte les
cinaras communs. Ibid. . . . . !
Canard de Madagafçap. Sa defcription, . - I
Canard d'été. Quelques-uns de fes çaraéterçs. Pays ou il fe I
tr„uv“ Lieux oh i Ü fon nid. Soins que les vteux canards
dCS ^ Æ mn e t r i P . SPécondib de la femelle.
^ Ca n id Couvage, carte au collier blanc, cane de mer. Defcnp- I
tion d f cet oifeau. Ibid. 586. n. Sociétés de U B I “
hiver Ils vont par paires au prmtems. Lieux ou ils font leurs I
nids Fécondité de la femeUe : fa defcription La chair du
canard fauvage pnffe p.our meilleure que celle du domeftique. I IflftpfeH de la graiffe de cet oifeau. lbtd. b. Dtvetfes
manieres de chaffcr aux canards. Ibid. 507. a. 1
Canard. Obfervations fur le bec de cet oifem XL 437- ^
Produftion du fon de là voix des canards. XVII. 43*- »•
* % L r d f a u v a g e , (Cbaffc) maniere-de prendre
en leur rendan? des pieges avec de la glu dans les rofeaux.
Í Y ^ D “ d’une machine plus facile & de moindre
dépenfe que les peaux de vache, préparée Ponc mer aux
canards.lî t<8. a. Chaffe du vol pour le canard.XVIl. 441. b.
Nappes à prendre des canards. Vol. 111. des planch. aruçle
C CeW.-Pdiffé‘rentes efpeces. Canard de mer , dont on dre
l’édredon. V . 306. 4. Garrot, efpeec de canard * mer. VU.
ciq. a. Canards du Brefil , appdies tpecartaca &
avoa VIH. 901. a. Canard des i fle s Pbibppines, appeUéWen.
f l 8,3. A Ifpece decanardappellér,«« XVI-3Z3- ‘■• Canard
ff Amérique nommé !
trouve fur le lac Zirehmra. XVII. 719- Í H M | “ • 43»’ *’
Canard fifleur. Vol. VI. des plane, regne animal, pl. ;.?•
C a n a r d , ( Artific. ) voye[ G e n o u i l l è r e .
C a n a r d , ('Miel,an. ) defcription du canard automate de M.
^CANARDIERls Chaffe ) lieu couvert & préparé dans
un étang ou un biarais , pour prendre des canmds fauvagM.
Defcription d'une canardiere avec fon réfervoir , fes canaux,
c a g e s i apprivoifer les canards, filets & allée d arbre conftnuts
en Hollande, par M. Guillaume O-kers. Suppl. II. 197. Comment
s’y fait la prife. Maniere de nourrir les canards./4rA A
CANARIES, (les mis) appellées autrefois Ifes Fortunées.
Leur nombre. Leurs produirions. Elles appartiennent aux
C a n a r i e s . Les anciens les ont connues fous le nom i'JJlcs
Fortunies. Vn . ao7. n. VIII. 923. a , A Erreur de Ptoloniée
furie nombre & la pofition de ces ifles.X. 383.4. Obfervauons
fur la figure de leurs habiians. VIII. 346. A.
Cañarte, efpece d’ancienne danfe. II. 587. a.
CANASSES, grandes caiffes, dans lefquelles on apporte I
le tlié de la Chine. On donne 16 livres de tare par canalfe. I
11 CANATHOS, fonteine de Nauplia, où Junon fe baignoit. I
11 Canàthos: il eft parlé de cette fontaine. XI. rit. a. XII. I
88CANAVALI, ( Botan. ) nom que les brames du Malabar
donnent à un genre de haricot. Auteurs qui en ont donné
la figure. Defcription de cette plante. Suppl. ) H 4. Sa
culture fes qiiaUtés & ufages. Maniere de la claffer. lbtd,
1^Canavali , efpece de ce genre dite baramareca. Suppl. I.
8°LaNA YA , ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl. 1. 784. 4.
CANCAMUM, forte de gomme.II. 587. a. On y diftuSue
quatre^fubftances différentes, qui ont chacune leur couleur
léparée. De quel arbre elles découlent. Ibid. b.
CANCEL, voyez C h a n c e l .
CANCELLARIUS. Quel officier portoit ce nom chez les
Romains. Il paroît que cet officier étoit très-peu de chofe.
Origine de ce mot, félon Ducange & félon Ménage. II.
587. b. .
. CANCELLATION. Acception de ce terme a Bordeaux,
où il eftufité. II. 587. b.
CANCELLER. Ëtym. de ce mot. H. 587. b.
CANCELLI, mafe. plur. petites chapelles qu’érigeoient les
Gaulois aux dèeffes meres. Aâes fuperftitieux qu’ils y prati-
qooient.U. 587.^.
CANCER, ( Chirur.) définition de cotte tumeur. Pourquoi
elle eft appellée de.ee nom. II.' 587* Conutient le cancer
commence. Parties qu’il attaque ordinairement. Le cancer eft
aux -glandes, ce que la carie eft aux os, & la gangrene aux
parties charnues. Le cancer vient quelquefois à d autres
parties molles & fpongieufes dû corps. Aux jambes , on
•
C A N
l’appelle loup i au vifagç &. au nez, noli me tangere. Cancer
occulte ", cancer ulcéré. Carafteres, accompagnemens, fuites
.de cette maladie. Calife immédiate du can'cçrx On le guérit
ou par l’extirpation dans fes commenccmens , ou enfuite par
l’amputation de la partie attaquée.Signes extérieurs du cancer.
Djagnoftic du cancer occulte commençant. Ibid. 588. a.
Le cancer des mammelles 8c de toute autre partie eft toujours
la fuite d’un sjrirrhe. Progrès de ce mal. On ne peut trop
promptement extirper une tumeur cancereufe, môme occulte.
Comment cette opération a été pratiquée par l’auteur. Ibid. b.
Divers préceptes fur la maniéré d’extirper félon la diverfité
des circonftances. Le non fuccès d’une première opération
ne doit point décourager d’une fécondé. Qualité vénéneufe
de la liqueur du cancer. Si cette matière eft paliee dans
le fang, aucun fecours ne peut fauver le malade. Remedes
qu’on peut appliquer fur le cancer -ulcéré. Amputation du
cancer , lorfqu’il occupe toute la mammelle, & que la malle '
du fang n’eft point en colliquation. Comment cette opération
s’exécute. Ibid. 589. a. Panfement de la piaiè. Indication des
figures qu’on a fait graver pour l’intelligence de ce qui vient
d’être dit. ïbid. b. , ,
Cancer. Prétendu fecret pour guérir les cancers les plus
défefpérés. XII. 798. b. Liniment propre à calmer la douleur
des cancers. XIII. 757•• b. De l’amputation des cancers. I.
c 380. b. Bandage dont on fait ufage dans le Premier appareil
de l’amputation d’une mammelle Cancereufe. XIII. 642. a. Charpie
employée après l’extirpation. VIL 523. a. Cancer de la ma*
i trice. X. 205 .a , b. XVII. 558. a. Cancer de l’oeil. XL 392. à.
C ancer des mammelles, •( Maréch. ) maladie du cheval.
Suppl. III. 409*a' 0 n i, .
C a n c e r , ( Aftron. ) figne dp zodiaque & conftellation *
tropique du cancer. II. ç 89.4. Fw T r o p iq u e . '
Cancer. Moyen de connoirre cette çonftelhmon dans le ciei.
Suppl. H. 966. A Etoiles du cancer, 'nommées anes. Suppl. I.
^CANCRE d’armoiries, ( Hijt. nat. Infegol.) efpeCe de crabe
I des ifles Moluques. Suppl. IL 198. a. Sa defcription & fes I moeurs. Maniéré de le claffer. Ibid.t. I Cancre, voyez C rabe. Cancre , figure fymhohque. XV.
73CANDALE, eau de , ( Chym. ) recette pour faire cette
eau. Suppl. lï . 198.4. . c
CÀNDAULE, ( Hijl.anc.) roi de Lydie. Ce prince allai;
^ C A N D eS brÎÉ de la galerie de Verrès. VII. 443. u.
CANDEUR, naïveté i ingénuité, ( Gramm. Moral.) caractères
qui diftinguent ces trois qualités. Suppl. II. 198. b.
CANDI, ( Comm. ) voye^ C andir. Le fucre candi eft
plus en ufage en Hollande , parce que généralement on n y
boit le thé qu’avec du candi qu’on tient dans la bouche.
Cette coutume eft meilleure que de mettre du fucre dans
les taffes de thé | parce qu’il change beaucoup le gôut de
cette infufion. Boulettes ,de fucre candi dont fe fervent les
HoUandois en buvant le thé. - Cet ufage eft auffi une éconp:
mie pour le fucre. Pourquoi les Hollandois préfèrent le candi
rouge ou brun. Prix de trois fortes de candi dans les raffineries
de Copenhague. SudvI. II. 199.
Candi. Fruits candis. 111. 856. *. Sucre candi. XV. 6x5. b.
Les fyrops trop concentrés font fujets à fe candir. 775. b. 779.
a CANDIDAT, celui qui afpire a un emploi. Quels étoient
■ ceux que les Romains nommoient ainfi. Comxnent ils follici-
toient les fuffrages. Loi qtii leur défendoit dé donner des jeux
au public. Comment ils corrompirent les fuffrages dans les
derniers tems de la république. Pourquoi les candidats
devoient paroître en robe blanche fans tunique. 11. 590. a.
C a n d i d a t . (Hijl. rom. ) Brigues des candidats. 11. 4
Comment les candidats faifoient leur cour au peuple : difte-
rentes fortes de gens qu’ils employoient pour parvenir? lemploi
déliré. XI. ¿tt.i/XVH. 235. ATogedoscand.diit . XVI,
260.a. Ouefteursappellés candidats du pnnee. AI11.yQi.a.
CAND1D I CERVI ARGENTUM, amendepayée à lé-
chiquier par certains cantons d’Angleterre. Raifon de cette
amCANDIE5î9vôyiî C rete. Du vin de Candie. XYIU 299. I Nombreufes plantations de cyprès dans cette îfle. Suppl.W.
I C ANDJI, ( eau de ) que les Indiens font avec la plapte du
I TlZr A ^ ï l T mefore des Indes pour vendre le grain. Poids
I de cette mefure, & É contenance. C’eft fur le pied dp
candil qu’on eftime 8L qu’on jauge dan? ce pays-là les navires.
I c I nDIR , explication de cette opération pour le fuprp.
Les apothicaires font auffi candir certains médicamens. p r - I férence entre candir & confire. — Voye{ C andi. IL J0». a.
I CANDO candi* candi, mefure ou aune dont on le îert aux I Indes. Evaluation du candode Goa. Les toiles fe mefurent au
I cando.U. 590. b.