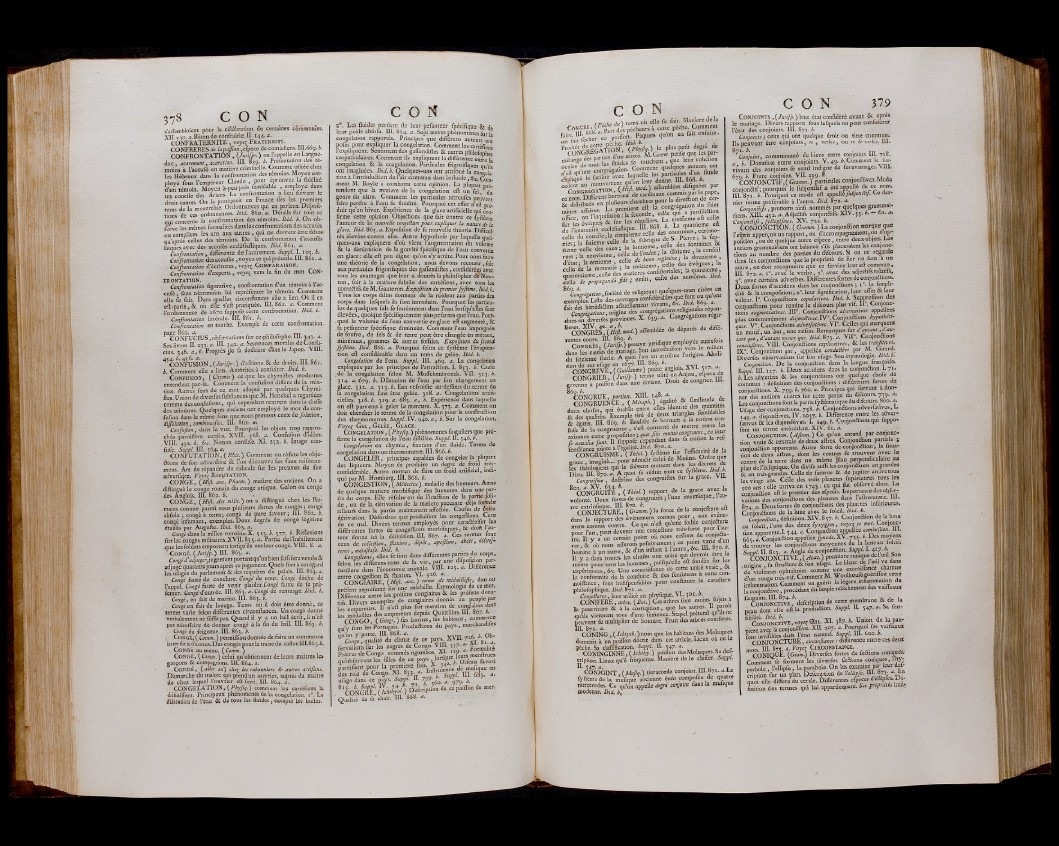
378 CON ,'aflèmbloient pour la célébration de certaines cérémonies.
XII 330. a. Bâton de confrairle. I l 144 u.
CONFRATERNITÉ, voyn F ra t irn ite .
CONFRERES de Uvagim ,efpece de comédiens. UI.669. i.
CONFRONTATION , (Jurifpr.) on l'appelle en Languedoc,
acarmml.acaraüon. III. 859. b. Préfentanon des témoins
à l’accu fè en matière criminelle. Coutume ufitée cher
les Hébreux dans la confrontation des témoins. Moyen employé
fous l’empereur Claude , pour éprouver la fidélité
5’un témoin. Moyen à-peu-près femblable . employé dans
un concile des Ariens. La confrontauon a heu fmvant le
droit canon. On la pratiquon en France des les premiers
tems de la monarchie. Ordonnances qui en parlent. Dépolirions
de ces ordonnances. lbti. 860. t. Détails fur tout ce
oui concerne la confrontauon des témoins. Ibid. b. Un ob-
ferve les mêmes formalités dans les confrontations des accufés
ou complices les uns aux autres, qui ne doivent être faites
qu’après celles des témoins. De la confrontation d’accufés
laïques avec des accufés eccléfiaftiques. Ibid. 86 x. a.
Confrontation, différente .de l’acarement. Suppl. L 103. b.
Confrontation desaccufés, voyez ce qui précédé. III. 861. a.
■Confrontation d’écritures, voye^ COM PA RAISO N .
Confrontation d’experts, voye^ vers la fin du mot Conf
r o n ta t io n . | •. .
Confrontation figurative, confrontauon d un témoin à lac-
cufé, fans néanmoins lui repréfenter le témoin. Comment
elle fe fait. Dans quelles circonftances elle a lieu. Où il en
eitiparlé, & où elle s’eft pratiquée. III. 861. a. Comment
l’ordonnance de. 1670 fuppofe cette .confrontation. Ibid. b.
Confrontation littérale*. III- 861. b..
Confrontation en tourbe. Exemple de cette confrontauon-
Pafx>NFUCIUS ,obfervations fur ce-philofophe. III. 343. a.
Ses livres II. 133. *. III. 34*- g Sentences morales de Confo-
. cius. 346. a,b. Progrès de fa doétrme dàns le Japon. Vlil.
45CONFUsÎÔN , ( Jurifpr.) d’aétions.& de droits. HL 861.
b Comment elle a lieu. Autorités à confulter. Ibid. b.
' C o n f u s i o n , ( Chymie) ce que les, chymiftes modernes
entendent par-là. Comment la confufion différé de la mixtion.
Autres fens de ce mot adopté par quelques Chymiftes.
Union de diverfes fubftances que M. Henckel a regardées
comme des confufions, qui cependant rentrent dans la claffe
des mixtions. Quelques anciens ont employé le mot de confufion
dans le même fens que nous prenons ceux de folution,
dilfolut'ton, combinaifon. III. 862. a.
Confufion, dans la vue. Pourquoi les objets trop rapprochés
paroiifent confus. XVII. 568. a. Confufion d’idées.
VIII. 492. b. &c. Notion confùfe. XI. 232. b. Image con-
fufe. Suppl. III. 564.«. . . _ , . .
CONFUTATION, ( Rhét. ) Comment on réfute les obje-
âsons de fou adverfaire & l’on découvre fes faux raifonne-
mens. Art de répandre du ridicule fur les preuves de fon
adverfaire. Voyez RÉFUTATION. _
CONGE, {Hiflanc. Phann. ) mefure des anqens. Un a
diftingué le congé romain du congé attique. Galpn ou congé
.des Anglois. IEL 862. b. .
CONGÉ, {Hifl. Art milit.) on a diihngue chez les Ko-
mains comme parmi nous pluneurs fortes de congés ; congé
abfolu congé à tems; congé de pure faveur; III. 862. b.
congé infamant , exemples. Deux degrés de congé légitimé
établis par Augufte. Ibid. 863. a.
Congé dans la milice romaine. X. 313. b. 377. b. Réflexions
furies congés militaires. XVII. 8| 3. a. Partie de l’habillement /
que les foldats emportent lorfqu’ils ont leur congé. VIII. 8. a.
C o n g é . {Jurijp.) HI. 863. <*. . . ' r .rr , *
Congé d’adjuger,fl^enfent portant qu un bien faili lera vendu oc
adjugé quarante jours après ce jugement. Quels font à cet égard
les ufages du parlement & des requêtes du palais. III. 863. a.
Congé faute de conclure. Congé de cour. Congé déchu de
l’appel. Congé faute de venir plaider .Congé faute, de fe pré-
fenter. Congé d’entrée. III. 863. a. Congé de remuage. Ibid. b.
Congé, en fait de marine. III. 863.
Congé en fait de louage. Tems. où il doit être donne, ce
terme varie félon différentes circonftances. Un congé donné
verbalement ne iuffit pas. Quand il y a un bail écrit, il n eft
pas nèceffaire de donner congé à la fin du bail. III. 863. b.
Congé du feigneur.III. 863. A. . . .
/ Congé, ( Comm. ) permiffipn donnée de faire un commerce
interdit à d’autres. Des congés pour la traite du caftor.IlI.863A
Congé au menu. {Comm.)
Congé, (Comm.) celui qu’obtiennent de leurs maîtres les
garçons & compagnons. III. .864. a.
. CO N G É , \ aller au) chc{ les rubanniers 6* autres artifans.
D ém a r ch e du maître qui prend un ouvrier, auprès du maître
de chez lequel l’ouvrier eftforti. III. 864. a.
CONGELATION, ( Phyfiq, ) comment les cartéfiens la
définiffent. Principaux phénomenesde la congélation. i°. La
dilatation de l’eau 8t de tous les fluides, excepté les huiles.
C O N
a°. Les fluides perdent de leur pefanteur fpècifiqùe & de
leur .poids abfolu. 111. 864. a. Sept autresjphénomencs fur la
congélation rapportés. Principes que différens auteurs ont
pofës pour expliquer la congélation. Comment les cartéfiens
l’expliquent. Sentiment des gaffendiftes & autres philofophes
corpulculaires. Comment ils expliquent la différence entre là
congélation & la coagulation. Particules frigorifiques qu’ifc
ont imaginées. Ibid. b. Quelques-uns ont attribué la congela-
tion à l’intrbuuétion de l’air commun dans le fluide, &c. Comment
M. Boyle a combattu cette opinion. La plupart prétendent
que la matière de la congélation eft un fel, dû
genre du nitre. Comment les particules nitreufes peùvent
faire perdre à l’eau fa fluidité. Pourquoi cet effet n’eft pr<>.
duit qu’en hiver. Expérience de la glace artificielle qui confirme
cette opinion. Objections que fait contre ce fyftèmé
l’auteur de la. nouvelle conjecture pour, expliquer la nature de la
glace. Ibid. 863.it. Expofition de fa nouvelle théorie. Difficul-
tés, élevées contre elle. Autre hypothefe par laquelle quel-
ques-uns expliquent d’où vient l’augmentation du volume
8c la diminution de la gravité fpécinque de l’eau convertie
en glace; elle eft peu digne qu’on s’y arrête. Pour nous faire
une théorie de la congélation, nous devons recourir ,lbit
aux particules frigorifiques des gaffendiftes, confidérées avec
tous les avantages que leur a donnés la phUofophie de Newton
, foit à la matière fubtile des cartéfiens, avec tous les
correctifs de M. GoMteton. Expofition du premier fyjlême. Ibid. b.
Tous les corps falins donnent de la roideur aux parties des
corps dans lefquels ils font, introduits. Pourquoi les particules
de quelques fels fe fouticnnent dans l’eau lorfqu’eues font
élevées, quoique fpécifiquement pluspefantes que l’eau. Pour-
. quoi le volume de l’eau convertie en glace eft augmenté, &
fa pefanteur fpécifique diminuée. Comment l’eau imprégnée
de foufre, dé fels 8c de terre peut être changée en métaux,
minéraux, gommes & autres foflties. Expofition du fécond
fyftéme. Ibid. 866. a. Pourquoi félon ce fyftême l’évaporation
eft confidérable dans, un tems de gelée. Ibid. b.
Congélation de .l’eau. Suppl. 111. 469. a. La congélation
expliquée par les principes de l’attraétion. I. 833. b. Caufe
de la congélation félon M. Muffchenbroeck. VIL 313. b.
314. a. 679. b. Dilatation de l’eau par fon changement en
glace. 312. a. 313. b. Eau refroidie au-deflous du.terme de
la congélation lans être gelée. 318. a. Congélations artificielles.
318. b. 319. a. 683. a , b. Expérience dans laquelle
on eft parvenu à geler le mercure. X. 373. a. Comment on
doit chercher le terme de la congélation pour la conftruétion
des thermomètres. Suppl. XV. 940. a, b. Sur la congélation.
Voyc[ G e l , G e l é e , G l a c e .
C o n g é l a t i o n , ( Phyfiq. ) phénomènes ftnguliers que préfente
la congélation de l’eau tuftillée. Suppl. II. 346. b.
Congélation en chymie, fixation d’un fluide. Terme de
congélation dans un thermomètre. III. 866. b.
CONGELER, principes capables de congeler 1? plupart
des liqueurs. Moyen de produire , un degré de froid très-
confiderable. Autre moyen de faire un froid artificiel, indiqué
par M. Homberg. III. 866. b.
CONGESTION, {Médecine), maladie des humeurs. Amas
de quelque matière morbifique des humeurs dans une partie
au corps. Elle réfulte 011 de l’inaétion de la partie Joli-
de , ou de la dérivation de la matière peccànte déjà formée
ailleuA dans la partie maintenant affettée. Çaufes de cette
dérivation. Défordres que produifent les congeftions. Cure
de ce mal. Divers termes employés. pour caracténier les
différentes fortes de congeftions morbifiques, & M y*"1"
teur donne ici la définition. III. 867. a. Ces termes font
ceux de collection, fluxion, dépôt, apofleme, abcès, deltiej-
cence, métaftafe. Ibid. b. , _
Congeftions, elles fe font dans différentes parties du corps,
félon les différens tems de la vie, par une difpofinon particulière
dans l’économie animale- VIII. 125- g Différence
“ cONGfAIM ¡ § ¡ 1 1 1 1 don on
préfc?nfe“ “ é V a r ie mini)«: Etymologie de ce mot.
Différence entre les préfens congiatres & les préfens dona
r i f Divers exemplesP de congiafres donnés au peuple par
les empereurs. Il n’eft plus foit mcnno" de congtaires dans
les médailles des empereurs depuis Quintillus. III. ¡ g l f e
rO N G O , (Géogr.) fes bornes, fes habitans, commerce
qu’y font les Portugais. Produéhons du pays, marchanthfes
de ce pays.IXVH.72|r é. Ob-
fervations fur les negres de Congo. VIII. 337- “■ Fo’rmal’ité’
Prêtres de Congo nommés ngombos. XL 12g menftrues
qu’obfervent les filles de ce pays ,lorfqu<■ i &yori
paroiifent pour la première fois. . ' 1 ¿c mufiquê en
Ses rois de Congo. III. | g |
ufage dans ce pays. Suppl. U- 799- , Æ y à , b.
mmmH t »‘k,ie*oa i I E°iiron dc ma' Qualité de fa chair. IH. 868. a.
C o N
1 Pidle du) tems où elle fe fait. Maniere delà
Part des pécheurs à cette pêche. Comment
Paq»e« quon “ “ fuite.
P rod u it de c m t e ^ l m - ^ plus petit degré de
CONGREGA IlL»n > penfe que lesparmê
lan ge des parti« d ^ & 'touchent, que leur cohéfion
& diftribués en Plufie“^. i j congrégation du faint
taines affaires. La pe qui | jurifdiétion
office, troifieme eft celle
fur les évêques & f e 868. b. La quatrième eft
de Pimmunite. ee|1-fiaftxq • • ^ coutumes , cérémocelle
du concilerà cinauiem des. Pierre; la fepnies
; la fixieme celle de q des fontaines &
tierne -celle des eaux; la i ». la dixième, le confeil
rues ; la neuvième, „¿mine; la douzième ,
d’état; la onzième , celle d S des évêques; la
celle de la monnoie ; ^ confiftoriales; la quinzième ,
«"fin. “ Ile des aumênes. g
s6?: n- , . . . d e reUdeuit: quelques-unes citées en
affembléc de députés de diffé
' T onS f / J I ) preuve ¡„ridique employée autrefois
~ à p SSb idan s mie riviere. Droit de congner. 1IL
C o n g r u e n c e ™ ('A'r'“ /’*. )4 ¿gnUtè & fimiUrade de llseSSSïSl I f e ^ e ì a congruence, s’eft contenté de mettre entre les g
Congruifme , doétrine des congruiftes fur la grâce. VII.
S°CO NG RU lìl , (Thiol.) rapport de la grâce avec Ta
volonté. Deux fortes de congruités ; l’une intrinfeque.lautreCONJEclriÌRE
j (jsramm.) la force u m m u i e i u . , V / dnenlnàr c. &anujex£ lèovrèe neef-t
C O N 379
C o n j o in t s , { Jurifp. ) leur état confidèrè avant '8c après
le mariage. Divers rapports fous lefquels on peut confidérei
l’état des conjoints. 111. 87t. b.
Conjoints; ceux qui ont quelque droit ou t'itue commun»
Ils peuvent être conjoints, re , verbis, ou re 6‘ verbis. III»
7Conjoint, communauté de biens entre conjoints. ÎIÏ. 718»
mur l’un, peut devenir une contefture
re II v a un certain point ou nous çeffons de conjectu
er',& oùnous affurons pofitivement ; ce P“ nt.1g n|
tomme à un autre, & d’un inftant | 1
il y a dans toutes les chofes une unité » 1 » être la
même pour tous les hommes ^puifqu elle
expériences, &c. Une connoiffance de cette
la conformité de la conduite & des t a M l l M R K
noiffance, font Indifpenfables pour conftnuer le caractère
philofophique. Ibid. 871. a.
. Conjectures, leur utilité en phyfique.Vl. 301. *. .
CONIFERE, arbre. (Sot.') Ces arbres font moins lu|etsa
la pourriture & à la corruption, que les autres. 11 paro*
qu’ils viennent tous d’une femence. Stapel prétend qu us ne
peuvent fe multiplier de bouture. Fruit des arbres , coniteres.
CONING , ( Ichtyth. ) nom que les habitans des Moluques
donnent à ;unj>,o.ifTon décrit dans cet article. Lieux ou on le
pêche. Sa clamfication. Suppl. 1I. 347- *• c
CONÏNGINNE, (Içhthy. ) poiffon des Moluques. Sa def-
cription. Lieux qu’il fréquente. Maniéré de le claffer.. Suppl.
CONJOINT, (Muftq.) tétracorde conjoint. III. 871. êi.Le
fyftême de la mufique ancienne étoit compofée de quatre
tétracordes. Ce qu’on appelle degré conjoint daHS la muüque
moderne. Ibid. bt
¿. Donation entre conjoints. V. 49. ¿.Comment le fur*
vivant des conjoints fe rend indigne de fes avantages. VIII»
679. b. Ffere conjoint» VII. 299. 9. ,m ,
CONJONCTIF,( Gramm.) particules conionftives.Mode
conjonétif ; pourquoi le fubjonftif a été appellé ^ ce nom.
III. 871. b. Pourquoi ce mode eft appellè fubjonCtif. Ce der
nier terme préférable à l’autre. Ibid. 872. <*»
Conjonltifs, pronoms ainfi nommés par quelques grammairiens.
XIII. 432. a. Adjeftifs conjonétifs.XIV. 33» b.-*- 61. <*»
ConjonClifs ,fyllogifmes. XV» 722. b.
CONJONCTION. ( Gramm.) La conjonéhort marque que
l’efprit apperçoitunrapport, ou d’accompagnement,ou dop*
polition , ou de quelque autre efpece, entre deux objets. Les
anciens grammairiens ont balancé s’ils placeraient les conjonctions
au nombre des parties du difeours. Si on ne regarde
dans les conjon&ions que la propriété de lier un fens à un
autre, on doit reconnoitre que ce fervice leur eft commun ,
ÜI. 872. a. i°. avec le verbe, 20. avec des adjectifs relatifs,
30. avec certains adverbes. D if fé r e n te s fortes de conjonctions*
Deux fortes d’accidens dans les conjonétions ; z°. la fimpu-
cité & la compofirion ; 20. leur ftgnification, leur effet 8c leut
valeur. 1°. Conjonétions copulatives. Ibid. b. Suppremon des
conjonctions pour rendre le difeours plus vif. 11°. Conjonctions
augmentatives. III“. Conjonétions alternatives appellées
plus communément disjonCtives. IV°. Conjonctions hypothett-
ques. V°. Conjonétions adverfatives. VI°. Celles qui marqueni
un motif, un but, une raifon. Remarques fur d’autant »dautant
que-d'autant mieux que. Ibid. 873. a. V il0. Conjonctions
concluftves. VIII. Conjonétions explicatives, & \estranfitives.
IX°; Conjonétion que, appellée conduClïve par M.
Diverfes obfervatious fur fon ufag e . Son étymologie. Ibtd.b.
Conjonction. De la conjonétion dans la langue françoite»
Suppl. IÜ. 127. b. Deux accidens dans la conjonétion. 1. 71»
b. Les adyerbes 8c les conjonétions ont quelque chofe de
commun ; définition dès conjonétions : différèntes fortes de
conjonétions. X. 739. b. 760. Principes qui fervent à donner
des notions claires fur cette parue du difeours. 730. **
Les conjonétions font la partie fyftémarique du difeours. 860. <x*
Ufage de? conjonétions. 738. ¿. Conjonétions adverfatives, L
140. a. disjonCtives. IV. 1037. b. Différence entre les adver-*
fatives 8c les disjonCtives. • 1. 149. b. Conjonétions qui fuppo*
fent un terme antécédent. XIV. 6i. à.
C o n j o n c t i o n . {Aflron. ) Ce qu’où entend | pat conjonction
vraie 8c centrale de deux aftres. Conjonâion partiale ;
conjonétion apparente. Autre forte de conjonction; la fitua-
tion de deux aftres, dont les centres fe trouvent avec le
centre de la terre dans un même f>lan perpendiculaire au
plan de l’écliptique. On divife auffi les conjonâions en grandes
8c en très-grandes. Celle de faturne 8c de jupiter arrivetous
les vingt ans. CeUe des trois planetes fupéneures tous les
300 ans : elle arriva en 1743 : ce qui fut obfervé alors. La
conjonétion eft le premier des afpeûs. Importance des n e r vations
des conjonétions des planetes dans laftronomie. 111»
874. a. Deux fortes de conjonétions des planetes inférieures»
Conjonétions de la lune avec le {o\e\l Ibid. b.
Conjonction, définition.XIV.837. b. Conjonétion de lalune
au foleil,ioleü, l’une l une des aes deux ucu». fyzygies,174.75»«, voye^ce mot. uonjonc--
I rAA i'.nninnclioil appelle1
tion apparente.1. î44- <»■ Conjpnaion appellso » mbufiou. 111.
66e. a. Conjonâion appellée fynode. XV. 735. i. Des moycas
de trouver les conjonaions moyennes de la1 lune au foleth
Suppl. II. 813. a. Angle de conjonâion. Suppl. I. 427.4.
CONJONCTIVE , (Anal.) première tunique de 1 oeiLSon
.origioe ft ftruaure&Vori n/age- LeM“ = * f ll v ^ ins
^ O ^ Î ' d e f c t l p f i o n d e cette membrane & de là i
peau dont elle eft la produâion. Suppl IL 347. a. Sa fen-
H - 3«7- é É | E de
piere avec la conjonfve. XII. 207. a. Pourquoi fes vatffeanx
font inviübles darfs l’état naturel. Suppl. IU. 600. ¿»
CONJONCTURE, circonflance ; différence entre ces deux
TTT 87«. a. Voyer Circonstance. ' . . WÊM
CCOONNIIQUU^EL-. V(<GLxéeoomm..)) D.iverfes f»o«r»t»ev»s de feétions comq^nës.
Comment fe forment les diverfes ieftions coniques, lhyr
perbole , l’ellipfe, la parabqle. On les examtnepsr 1^ur idef-
cription fur un plan.. Defcrtpuon de \Mrpfi. f f lB B g S i t y
quoi elle diffère du cercle. Différentes eipeces d e ^ . Dê
finition des termes qui lui appartiennent. Sa propmta tndt.