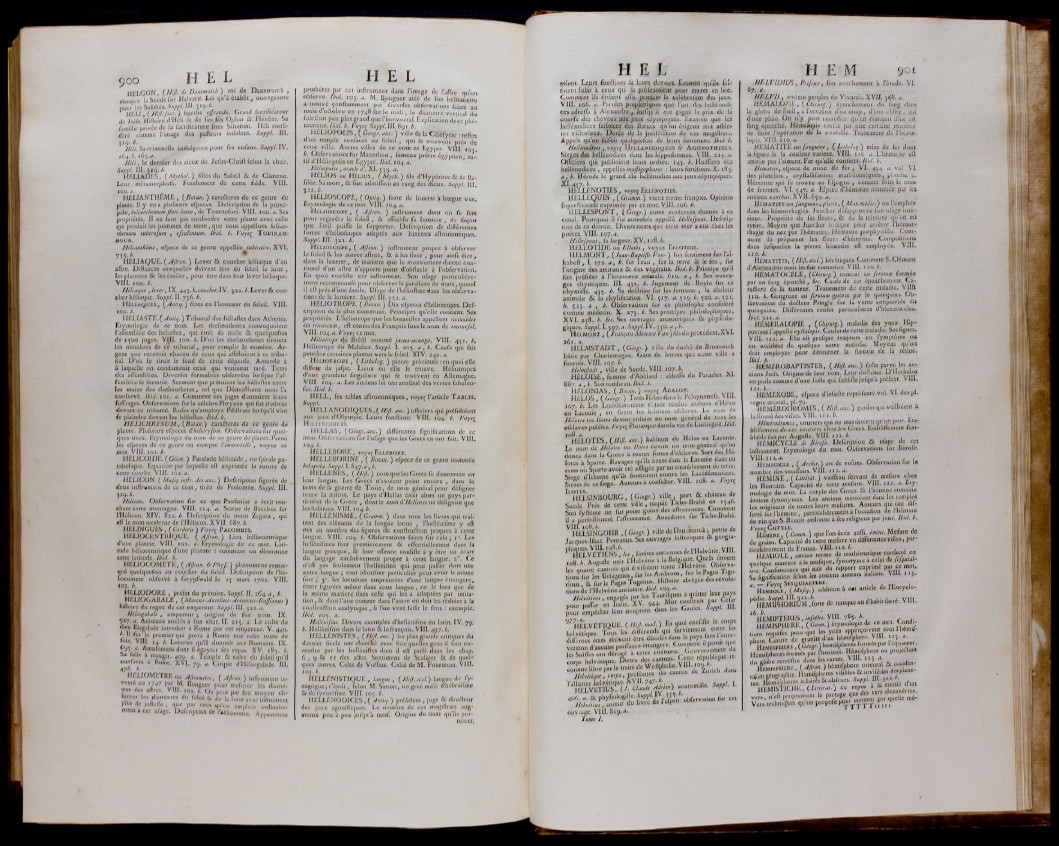
fjoo H E L
HELG O N , ( M ( k à * Danematck ) roi de Danemarck ,
conquit la Suède fur Halvard, l o i qu’il établit, outrageante
pour fes Suédois, S u p p l , l l f y 0 'b , , , c -,
Ü l iU ( Hïfffa cr , ) fm m § offrande. Grand facrificateur
de Juifs, H im r e d’H m % de fes ft)s O p lw i & Hunées, Sa
famille privée de la facrificature fous Salomon. Héli çonfi-
dêrê comme l’image des pafteurs indofens, Suppl. III.
Hili, Sa criminelle indulgence pour fes enfons, Suppl. IV ,
///A', le dernier des aïeux de /efus*Chrift félon la ehalr,
Suppl. 111, % 10 , b. v
HÉLIADES, ( Mythol, ) filles du Soleil 8c de Climene,
Leur m é tm o rp k o fe , F ond em ent d e cette fable, V III,
100,//,
HéLIANTHEMË, ( Botan, ) eara&eres de ce genre de
plante. Il y en a plufieurs efpeccs, Defeription de (a principale
, helianthemum jlore luteo, de T o u r n e fort, V III. io q , a. Ses
propriétés. Il ne faut pas confondre cette plante avec celle
qui produit les pommes de terre» que nons appelions helian*
themum tuberolum , efculcntum, Ibid, b. Voyez Topinambour,
Hé lianthém, efpece de ce genre appellée lubiraire. X V I,
7M>b,
HÉLIAQUE, ( A jlron ,) Lever 8c coucher liêliaq ue d'un
aftre, Diffences auxquelles doivent être du foleil la lune»
les planètes 8c les étoiles. pour être dans leur lever liéliaque,
V III, io q , b,
Héliuuue , lever ^ IX, b,coucher,\S, 322, b. Lever 8c coucher
hêbaque. Suppl, II, 736, b,
Hj-uaquj-.s , ( Anùq, ) fêtes en l'honneur du foleil, V III,
f©0, b,
HÉLIASTE.( A n tiq ,) Tribunal des héliaftes dans Athènes,
Etymologie de ce nom. Les thefmothetes conyoquoient
l’affemblèe des héliaftes, qui étoit de mille 8c quelquefois
de 1 <ço juges, VUI, 190, b. D ’où les thefmothetes tiroient
les membres de ce tribunal, pour remplir le nombre, A r gent
que receyoit chacun de ceux qui affiftoient à ce tribu*
nal. D ’où fe droit le fond de cette dépenfe. Amende k
k laquelle on condamnoit ceux qui ven o ien t tard, Tems
des affemblées, Diyerfes formalités obfervées lorfque J’af-
femblée fe ibrmoit, Serment que prêtoient les héliaftes entre
les mains des thefmothetes, tel que Démofthene nous l’a
conferyé, Ibid, t ô t , a, Comment ces juges donnoient leurs
feftrages, Obfervations fur la célébré Phrynée qui fut traduite
devant ce tribunal, Rufes qu’employa Pififtrate lorfqu’il viut
fe plaindre devant les héliaftes, Ibid, b,
H E L lC H l lP S U M , (B o ta n ,) caraéleres de ce genre de
plante. Plufieurs efpeces à'héhcryfnm, Obfervations fur quelque
«-unes, Etymologie du nom de ce g enre de plante. Parmi
les efpeces de ce genre on compte l'immortelle, voyez ce
mot, V il/, tôt, b,
HÉLICOIDE, ( Qlàm, ) Parabole héhcoïde, on fpirale parabolique,
Equation par laquelle eft exprimée la nature de
cette courbe, V U I, 10%, a,
HÉLICON. ( Mujùj.injlr, des anc, ) Defeription figurée de
deux inlïrumens d e ce nom » tirée de Ptolomée, Suppl, III,
W L £ 2 , ’ „ !
Helicon, Obfervarion fur ce que Paufanias a écrit roucitant
cette montagne, V III, 214, a, Statue de Baechus fur
l'Hél’icon, X IV , 02a, b, D e fe r ip t io n 'd u mont Z a ga ra , qui
eft le nom moderne de l’Hélieon, X V II, 687, b,
HÉLINGUE5 , ( Corderie ) Voyez P a lom b e s ,
HÉLlOCENTluQUE, ( A jlro n ,) Lieu héliocentrique
d’une planete, V III, 10%, a, Etymologie de ce mot, Latitude
béliocentrique d’une planete ; comment on détermine
cette latitude, Ibid, b,
HÉLIQCÔMETE, ( Ajlron, & Bhyf, ) phénomène remarqué
quelquefois au coucher du foleil, Uefcription de l’hé-
hocomete obferyé à Grypfwald le 13 mars 170%, V III,
102, b,
HÉLIODORE »préfet du prétoire, Suppl, II, 264, a » b,
HÉLIOGABALE, (Marçus-Aurelius-AntoniusBaffianus )
biftoire du regne de cet empereur, Suppl, III, 3%i,a ,
HiliostibaU, empereur 5 origine de fon nom, IX,
927, a. Animaux attelés à fo n char, II, 213, a, Le culte du
mew Elagabale introduit à Rome par cet empereur, V, 440,
b t\ l fut le premier qui porta à Rome une robe toute de
»oie, V III, 14. b, Loteries qu'il donnoh aux Romains, IX,
JVÎ- 0, Amufemens dont il kayoit fes repas, XV , 183, b,
sa latte a manger, 409, u, Temple 8t culte du foleil nu'il
e ° 6 t “ 79’ f , tirqu? d'Héliogabale, III,
HÉUOMETREou M im m r s , ( Â fm t , ) Infiniment in>
yenri: en (747 liouguer pour mefurer les diamer
«s des i f t p VH I, 0 « « par fon moy en obf
e es^ ?/'ietres dM
f f l > %“.e r P " e m y /o n smjilols ordinaire-
ment a cet nfage, Defonpiion de Vkélwmc,re, Apparences
HEL produites par cet inftrument dans l’image de l’aftre qu’on
ob le rv e , Ibid, iç ^ , a, M, Rpuguer aidé de fon héJlometre
a trouvé çonnamment par diverfes obfervations faites au
mois d’oélobre en 1748 fer Je midi, le diamètre vertical du
feJeil un peu plus grand que l’horizontal. Explication dece phénomène,
Ibid, b, Voyez Suppl, Wi, S o i .b ,
_ HÉLIÜPOLP), ( Glogr, anc, | ville de la Céléfyrie ; reftes
d’un temple confacré au foleil » qui fe trouvent prés de
cette ville. Autres villes de ce nom en Egypte, V III, 193,
b, Obferyations fur Manethon , fameux prêtre êavprien natif
d’Hélioj/olis en Egypte, Ibid, 104.//,
Hé liopolis, oracle a , XI, 330, a.
HÉLIOS ou HÉuys, (M y t h , ) fils d’Hypérion 8cdeBa-
filêe» Sa mort, 8c fon admiffiou au rang des dieux, Suppl, h l,
321, b,
HÉLIOSCOPE» ( Optiq, ) forte de lunette à longue vue.
Etymologie de ce mot. V lII, 104, a,
H é lio s c o p e , I Allron, ) inftrument dont on fe fert
pour regarder le foleil, 8c affbiblir fa lumtere, de façon
que l’feil puiffe la fepporter, Defeription de différentes
fortes d’héliofeopes adaptés aux lunettes aftronomiques.
Suppt. III. 321, b.
Helioscope , ( Ajlron, ) infïrument propre à obferver
le foiéil 8c les autres aftres» 8c à les fixer » pour ainft dire,
dans la lunette, de maniéré que le mou vem en t diurne continuel
d’un aftre n’apporte point d’ohftade à l’ohfervatiou.
En quoi confifte cet inftrument. Son ufage particulière-*
ment recomnrandé pour ob fe rve r la parallaxe de ma rs, quand
il eft près d'une étoile» Ufage de l’helioftate dans les ohfervarions
de la lumière, Suppl, fil, 321, a,
HÉLIOTROPE, ( Botan, ) Dix efeeces d’héliotropes, Def-
sription de la plus commune, Principes qu’elle confient. Ses
propriétés. L'héliotrope que les botaniftes appellent ricinoides
ou trïcoccum, eft connu des François fous le nom de tourne fo l,
V III, 194, m Voyez ce mot.
Héliotrope 4 u B ré fil nommé jacuo-acanga, V III, 431, b.
Héliotrope du Malabar, Suppl, 1, 203, a » b, Caufe qui fait
pencher certaines plantes vers le foleil, X IV , 242, //.
H é l i o t r o p e , ( Litbolog, ) pierre précieufe ten quoi elle
diflèse du jafpe. Lieux où elle fe trouve, Héltotropes
d’une grandeur finguliere qui fe trouvent en Allemagne.
V III, iQA, a. Les anciens lui ont attribué des vertus fabuïeu-
fe s, Ibid, i ,
HELL, fes tables aftronomiques, voyez l’arricle T a b l e s ,
Suppl,
HELLANODIQUES, ( H iß , anc, ) officiers qui préfidoienf
aux jeux d’OIympie, Leurs fondions. VHI. 104, b, Voyez
HfcU.ENOOJCES,
H E L L A S , ( Géogr, anc, ) différentes fignifications de ce
nom, ü b fe rva t ion s fur l’ufage que les Grecs en ont fait, V III.
104, b,
HELLEBORE, voyez E lle b o b e ,
HELLëRORINë , ( Botan, ) efpece de ce genre n ommé e
belapola, Suppt, 1, 84y ,a f b,
HëLLEwES, ( H iß , ) nom que lés Grecs fe donnèrent en
leur langue. Les Grecs n'ayotent point encore , dans le
terns de Ta guerre de Troie , de nom général pour défigner
toute la nation, Le pays d’Hellas étoit alors un pays particulier
de la Grece , dont le nom d'Hellenes ne déOgnoit que
lesbabitans, V III, 104, b,
HELLÉNISME, (Gramm, ) dans tous les livres qui traitent
des élémens de la langue latine , l’hellénifme y eft
mis au nombre des figures oe conftruéiion propres à cette
langue, V IIL 104, b, Obfervations faites fer cela; 1“ , Les
hellénifmes font premièrement 8t efTentiellement dans la
langue grecque, 8c leur effence confifte à y être un écart
du langage exclu fi yement propre à cette langue, 2”, Ce
n’eft pas feulement Phelléfltfme qui peut paffer dans une
autre, langue ; tout idlotlfme particulier peut avoir le même
fort ; y , les locutions empruntées d’une langue étrangère,
étant figurées même dans cette langue» ne le font que d e
la même maniéré dans celle qui les a adoptées par imitation
. & dans l’une comme dans l'autre on doit les réduire à la
çonftro&ion analytique, fi l’on veut faifir Je feus ; exemple.
Jbid, w d , a,
HAlinifme, Divers exemples d’hellénifme en latin. IV , 79.’
b, Hellénifme dans le latin le françois, V III, 497, b,
HELLENISTES, ( H iß , anc, ) les plus grands critiques du
dernier fie de ont cherché avec foin quelles gens il faut entendre
par les belléulftes dont il eft parlé nans les chap,
6 , 9 & 1 1 des aéfes, Sentimens de Scaliger 8c de quel*
ques autres, Celui de Voifius, Celui de M, Fourmont, V IIL
»03, b,
HELLÉNISTIQUE, langue» ( H i f l .m l . ) langue de fy *
nagogue’,c 'é to i t » félon M, Simon» un grec mêlé dbébraifmo
8tdefyrjaçifme. V lII, 103, b,
HELLENODICES, 1 Ântf/j, ) nrêfident, juge & direéleur
des jeux agoniftiques. Le nombre de ces magiftrats augmenté
peu-Vpeu jufqu’à neuf. Origine du nom qu’ils portoi
eut,
HEL foient. Leurs fondions 8c leurs devoirs. Examen qu’ils f d -
fuient fobir à ceux qui fe préfentoieut pour entrer eu lice.
C om m e n t ils étoieut afiis netjtdant la célébration des jeux,
VUL to 6, EaruJes prophétiques que l’uu des bellénodi'
ces adrefta à Alexa/idi;#,, lorfqu'il eut gagné le prix de la
ço u r fe des chev/iq# aux jeu x olympiques, Exatnen que les
jiellénodices faifbient des ftatucs qu ou érigeoit aux athlètes
vi&orieqx. D u r é e d e la jurifdicfiou de ces magiftrats.
Appels qq’o/i faifoit quelquefois de leurs fentences, Ibid, b,
tUllénodicrs, voyez UlLLANOPl^ULS AcOWOTHETES,
Siegesdes liellénodices daus les hipj/odromes, VUL 213,,/,
Officiers qui pubUoient leurs ordres, 143, b. Huiffiers dés
hellénodices, appel lés mpfligophorrs : leurs fonâions, X, 183,
u , b, Hé rod e le graud élu hellénodice aux jeux, olympiques,
XL 4 3 7 * h
HELLÉNOTIES. v o y e zEllénotîes,
HÉLLEQUIN , ( Gfiimm. ) vieux terme françois, Opinion
feperftirieufe exprimée par ce mot, VUL »06, b,
HELLESPONT, ( Géogr,) noms modernes donnés à ce
canal. Pourquoi il fut autrefois appellé HdUJ’pont, Defcrip*
tiou de c e détroit. Divers noms que cette mer a eus cirez lés
poètes, V IIL w y .a ,
l/dle fpon t » fa largeur, X V , »28, b,
HËLLOTIDE ou Kllo tè s, voyez Ello tipe,
H E LM O N T, ( Jean-BoptiJU Pan* ) fon fenfiment fur l’ai*
kaheft, l , 272, u » b, fer l'eau » fer la terre 8c le leu » fur
l'origine des animaux 8c des végétaux, Ibid, b, Principe qu’il
lait préfider à l’économie animale. C io . a » b. fies ouvrag
e s chymiques, HL 432, b, Jugement de Royle fur ce
chymifte, 433, b, Sa doftr'me fur les fermens » la chaleur
animale & la chylificarion. VI. 317, a, 3 u), b. 320, u, 32t.
b, 323. a f b, Obfervations fur ce philofoohe confidéré
comme médecin, X, 273, b, Ses principes pnilofophiques,
X V I. 238, b, b c . Ses ouvrages a/iatomiqnes 8c pliyfiolo*
d o u e s ,S u p p l ,L w y ,4'S u p p l , ÏV •w ® ,4% b,
Helmobt f (VrainjeU Mtrcurc Va tu) fils du précédent, XV L
HE LM STA DT, (G éo g r,) ville du duché de Brunswick
bâtie par Cltarlemagne» Gens de lettres que cette ville a
fournis, V IIL 107. b,
Helm/ladi, ville de b u e d e .V 1 1 1 . 1 0 7 ,b,
HÉLOISE» femme d’Abélard ; abbeffe du Paraclet, XL
887, a , b, Son tombeau, Ibid, b,
HÉLONIAS, ( B o tan.) voyez Abalon,
HÉLOS, ( Géogr, ) Trois Hélos dans 1s Péloponnefe, V III.
10 7 , b. L e s Lacétlémonieus sV tant rendus maîtres dlielos
en Laconie » en firent les habitat).« efelaves. Le nom de
M u t a ou Ilotes d e vin t enfuite un nom général de tousses
efclaves publics, VoyezPlutarque dansla vie de Lucurgue. Ibtd.
^HÉLOTES , ( Hijl, anc,) habitans de Hélos en Laconie,
t e nom de Hélotes ou Ilotes devint un nom général quon
donna dans la Grece à toutes fortes d’efc aves. Sort tfes H *
lotes à Sparte, Ravages qu’ils firent dans la Laeome dan» un
te,us où Sparte avoir été affligée par un tremblement de terie.
Siege d’Iiltome qu'iU fouiiurent coDire lee l i M i r n i m .
Suites de ce fiege. Auteurs a confitlter. V lII, 108, m l 'o y n
U HELSINBQURG, ( G i ïg r . ) ville, port ^
Suede Près de eette ville, naquit Titlio-Brahi en M4«'
Son (y(terne 11e lut point goûte des aftronome^
d 0 perieôiomiè l'aftronomie. Anecdotes lut TiclwBralte.
o HPI uw g o H R (G /o e r ,) ville de D1an%tmar«tit &i p atrie de ^
rinus. fit fur te Pagus Tugenus. Hiftoire abrégée des révolu
pour paffer en Itahe, XV» ^ ,iâS Suool III,
pour empêclter leur Irruption dans les Gaules. S u f f i .
m m m m i w . » '$ > ) sa ie e® K
belvétiuue Tons les dilférends qui iurvlemient entre les
difl’éreiis états doivent être décidés dans 1e pays fans |
'‘'“SwTïfëT/,oe») y»«»^Suppi '■
ouvrage, V lII, 8tÿ, a. .
Tome l ,
HEM | H f L Ÿ W l U S , Pr i j 'eu s , fon anachement à l'étude, VL
87, a.
H E L V J t f anciens peuples du Vivarai». X V II, 368, a,
HÉMALOPIE » ( Chirurg, ) épandiement du fung dans
fe globe de l’oeil » a l'occafion d'un coup t d’une ‘■hùte, ou
d'une plaie. On n’y peut remédier quen donnant iffec au
fang épanché. Hêmalopie caufee par une certaine maniéré
de foire l ’opération de la catataée. Traitement de l’héma-
lojrie, V III, 110,4>
H É M A T I T E ou fauguinef ( Litholog.) mine de fer dont
la figure 8f la couleur varient. V IIL h q , a, L’hématite eft
attirée par l’aimanr. F e r qu’elle contient, Jbid, b.
Hématite, efpece de mine de fer» VI, 494, m vol. V I
des planches » cryftalbfarions mathématiques f pLnch« 2,
Hématite qui fe trouve en Lfpagne » connue fou s le nom
de ferretes, VI, <47, m Efpece d’iiématite nommé e par les
anciens xnnthus, X V II. Cqo. a,
H é m a t it e ou fa n g um ^ pierre, | Mat, médie.') on l’emploie
dans les hémorrliagies, JuncLer dlfopprouve Ion ufage intérieur.
Propriété de fes fleurs, 8c de la teinture qu’on en
retire. M o y en que Juncker indique pour arrêter l’hémor-
rhagie du nez par l’hématite, Uémarite porphyrifée. C o m ment
fe préparent les fleur» d’Iiémaths. Compofuions
dans lefquelles la pierre hématite eft employée, VUL
il®» A- . _ (
Hématites» (H i f fe c c l .) hérétiques.Comment 9,Clément
d’Alexandrie nons les fort connaître. VUL 1 io . b,
HÉMATOCELE. (Chirurg.) tumeur au ferotum formée
par un fang épanché, Oc. Caufe de cet épanchemenr. Ca-
raâere de la tumeur, Traitement de cette maladie, V il»
uo, b, Gangrené au ferotum guérie par le quinquina, Qb-
fervations du do&eur Pringle fer la vertu antiputride du
quinquina. Différentes caufes particulières d'bematoceles»
i b i d . l i t . a, . , . . .
HÉMêRALOPIE , (Chirurg.) maladie des yeux, Ihp-
pocrate l’appelle nyflalopte, Caufes de cette ntaladie. Ses figues,
VUL m , a, Elle eft prefque toujours un fymptbme ou
un accident de quelque autre maladie» Moyens quon
doit employer pour détourner la fiuxmn de la rétine,
^h/mÉROBAPTISTES, (H i j l ,a n c . ) fefte parmi les an-,
i eiens Juifs, Origine de leur nom. Leur poélrme. D HerbejOfr
en parle comme d’une feélc qui fubfiftejufqu’à prefcot. V IIL
1 'h é MÉROBE, efpece d'infeRe repréfenté vol. V I des pl.
% girè« qui vdllolent i
la fureté des villes» VUL 111» é, , L
Hémérodromes, courier.» qui ne marchoientuu un jour, tta*
bliffement d e ces eouriers chez le s Grecs, Etablme/nent fern-
blaldefoltpar Augufte, VUL u i . b,
HÉMICVCLL de Bérofe. Defeription u ufage de cet
inftfument, Etymologie dit mot, Obfervutlon» for Bèrofe.
V I I I » u t ,a , < r . ,, .
HÉMteiCLB » ( Archit,) arc de voûtes. Ohferyation fur le
nombre des vouffoirs, V III. 112» a, '
HËM1N E . ¡ U n i r a i , ) vaiffeau fervent de meWre ebe*
le» Romains. Capacité de cette mefore. V f II, u t , a, fcty-
tnologle do mot, Xa cotyle des Grecs Sc l'bemme romaine
étoient fynonymes. Ces anciens mettoient dans les temples
tes original» de tontes leurs mefores. Auteurs qui om diG
ferré fur l'Iteinine, pariiciiliérement a I occafwn de I nçimne
de vin nueS.Benoit ordonne à fes religieux par |our. IM . b.
s , , , 1
Humwï. ( Cmm, ) que l'on écrit and»., émut. Mefore de
de grains, ¿apacité de cette mefure en différentes ville», psrrniden’
ierme de inailiémaiiqne eonfcré en
quelque maniéré a la mufique, fynonyme a celui de ft fy a u l -
L . Confonnencc qui iulr do rapport eeprimé pw.ce mot,
Sa (igoidcailou félon les ancien# auteur» italiens. V1U. 113.
a _ SasQUiAi/row. „ ,
’ Hainiow!, (M u f iq .) addition i cei article de lEncyclo-
HEMlT^HOluiM ,forte de tunique ou d’Iubii facré. VUI.
'^HEMIPTERES, inftilii. VUI. 7*5. *> I .,
HEMISPHERE, ( G im . ) éiymotoglede ce moi. Condi-
lions requifes pour que les yen* apperiolvem tout 1 liémiff
obéré Centre de gravite d’un liémifpliere. VIU, 115. a.
1 h Î mis p h îW Æ i r . ) bemifplieres formé» par I équamir,
Hémlfpliere» formés par fboriaon. proieflion
j f f «ioaniiliie Hémlfpberes vinbles 8cmviftb)esdesplane
HEMISTICHE, (M i t r a i . ) c e repos » 8|exBm|rine,
vers, n’eft proprement le partage qoe le» »1» mi.
Vers teebniçjlies qu on propofe P»pr nfoW«,' P S