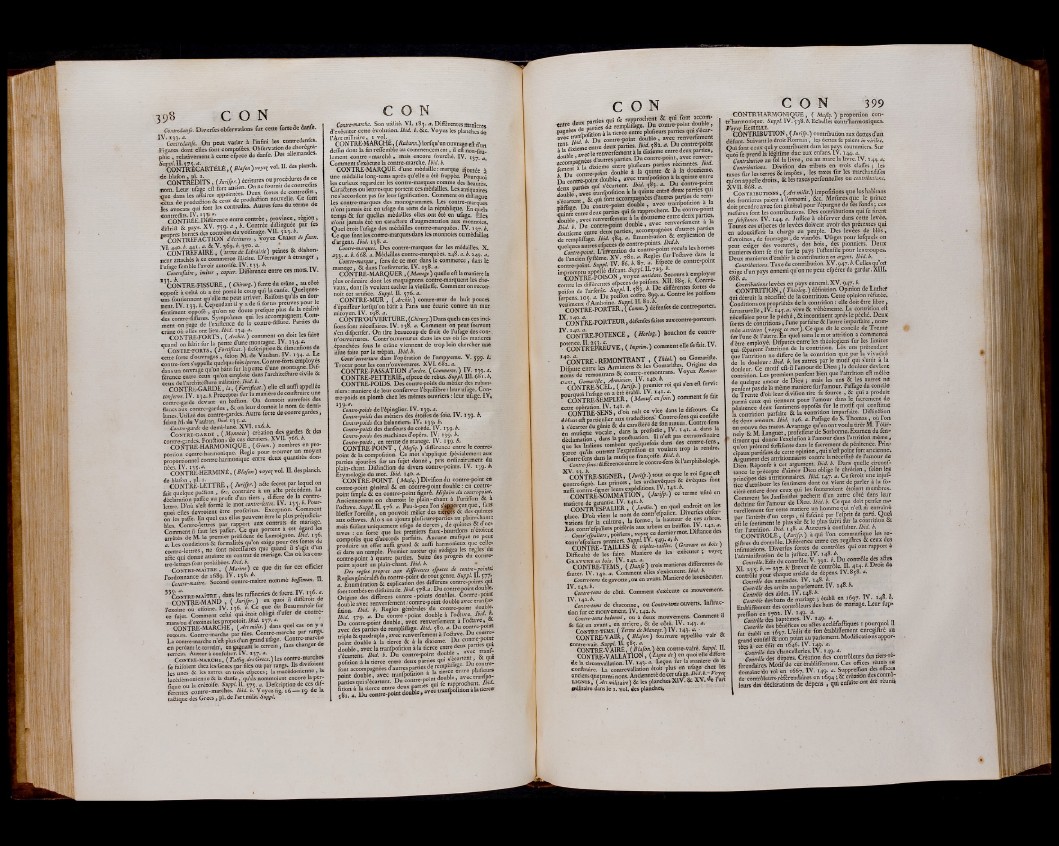
3 9 8 CON Contredatifa. Diverfes obfer va lions fur cette forte de danfe.
Contrtdanfe. On peut varier à l’infini les contredanfes.
Figures dont elles font compofées. Obfervanon dechorégr*-
pltie, relativement à cette efpece de danfe. Des allemandes.
^ T oN T R ’ÏcARTÉLÉ , ( Slafon ) voyti v d l . H . des planch.
CONTREDITS (furifpr.) tentâtes ou procédures de ce
« * *H? “ prodniUon nouvelle. Ce font
^ v t r Î u E m p o n t t e S i t s . Autres fens du terme de
C°r(MTRÉE. îl?ff£ence entre contrée, province, région,
aiftrla & pays. XV. 739- a , b. Contrée diftinguèe par fes
propres bornes des contrées du votfmage. VU. M* V t.
CONTREFACTION d'écritures , voyez Crime de faux.
VI 440. b. 441. a. & V. 369. b. 370. a.' S
' CONTREFAIRE , ( terme de Librairie) peines & déshonneur
attachés à ce commerce illicite. D’étranger à étranger ,
l’ufage femble l’avoir autorifé. IV. :13 3. b.
Contrefaire, imiter , copier. Différence entre ces mots. IV.
1 3èoNTRE-FISSURE, ( Chirurg. ) fente du crâne, au côté
©ppofé à celui où a été porté le coup qui la caufe. Quelques-
“r ■ . t .u . Î ______ a R n fnncnil e p p o l è à c e lu i o u a e t c p o r te vw«*» -------—lkv fin ( Olluns
fontiennent qu'elle ne peut arriver. Rations qu ils en donnent.
IV. 133. ¿.Cependant il y a de fi fortes preuves pour le
fentiment oppofé , qu’on ne doute prefque plus de la «alité
des contre-fiffures. Symptômes qui les accompagnent. Corn
ment on juge de l’exiftence de la contre-fiflùre. Parues du
crâne où elles ont lieu. Ibid. 134. a. .
CONTRE-FORTS, ( Archit.) comment on doit les taire
quand on bâtit fur la pente d’une montagne. IV 134. a.
ContR£-forts. (Fortificai.) defcnpnon& dtmenfions de
cette forte d'ouvrages , félon M. de Vauban. IV. 134. a. Le
contre-fort s’appelle quelquefoisqwron.Contre-forts employa
d a n su n ouvrage qu’on b â t i t fu r la pente dune montagne Différence
entre ceux qu’on emploie dans 1 ardutefture ctvde &
ceux del’architeâure militaire./¿¡d.é. _ .,
CONTRE-GARDE, la, ( Fortificai.) elle eft aufli appellée
conferve IV. 134.¿.Préceptes fur la manière de conftrùire une
contre^arde devant un baftion. On doratoti autrefois des
flancs aux contre-gardes, & on leur donnott le nom de demi-
lunes. Utilité des contre-gardes. Autre forte de contre gardes,
félon M. de V auban. Ibid. 13 frf* .
Contre.garda de demi-lune. XVI. ta6.b.
C o n t r e -g a r d e , (Monna,e) creanon des gardes & des
contre-gardes. FonSioni-Îe ces derniers. XVII. 766. i.
CONTRE-HARMONIQUE , ( Gtom. ) nombres en proportion
cintre-harmonique. Regie pour trouver un moyen
proportionnel contre-harmonique entre deux quanutés donn^
CONTREHERMINÉ, (Elafon) voyez vol. H. des planch.
deCONTR^-LETTRE , ( Jttrifipr.) a8e fecret par lequel on
fait quelque paéüon, Cet. contraire à un afte précédent. La
déclaration paffée au profit d’tm tiers , différé de la contre-
lettre D’où s’eft formé le mot contre-lettre. IV. 13 J. b. Pour
quoi elles devroient être proferites. Exception. Comment
¿n les paffe. En quel cas elfes peuvent etre le plus préjudiciables
Contre-lettres par rapport aux contrats de mariage.
Comment il faut les paffer. Ce que portent à cet égard les
arrêtés de M. le premier prèfident de Lamoignon. ibid. 136.
a Les conditions & formalités qu’on exige pour ces fortes de
contre-lettres, ne font néceflaires que quand il s agit dun
afte qui donne atteinte au contrat de nianage. Cas ou les con- * I mofEder l ° rCrnirMoaitn‘ Second contre-maître nommé bofieman. H.
C o n t r e -m a î t r e , dans les raffineries de fucre. IV. i a U
CONTRE-MAND , ( Jnrifpr.) en quoi il différott de
v ’mt eü ni ne IV f i 6. b. Ce que ait Beaumanoir fur
X “ — celili M C j f * * * co" 'T
CONtoÊ-mSrcGeP>° (^ « milit. f dans quel cas on y a
recours. Contre-marche par files. C o n t r e -m a r c h e par r a n ^
La contre-marche n’eft plus d’un grand ufage. Contre marche
en perdant le terrera', en gagnant le terrein, fans changer ue
terrein. Auteur à confulter. IV. 137. a.
C ontre-marche, ( Ta&iq. des Grecs.) les contre-marcnes
- fe faifoient chez les Grecs par files ou par rangs. Us diviioient
les unes & les autres en trois efpeces ; la macédonienne, la
lacédémonienne 8c la danfe, qu’ils nommoient encore la per-
fique ou la-crétoife. Suppl. II. 375. a. Description de ces différentes
contre-marches. Ibid. b. Voyez fig. 16— »9 de la
tadique des Grecs, pl. de l’art milit. Suppl.
C O N
Contre-marche. Son utilité. VI. 183. a. Différentes maniérés
d’exécuter cette évolution. Ibid. b. «c. Voyez les planches de
l’Art militaire, 1 vol.
CONTRE-MARCHE, (Rubann.) lorfqu’un ouvrage eft d’un
deffm dont la fin reflemble au commençjement, il eft non-feulement
contre-marché , mais encore fourché. IV. X37. a.
Comment s’exécute la contre-marche. Ibid. b.
CONTRE-MARQUE d’une médaille .-marque ajoutée à
une médaille long-tems après qu’elle a été frappée. Pourquoi
les curieux regardent les contre-marques comme des beautés.
Carafteres ou lettres que portent ces médailles. Les antiquaires
ne s’accordent pas fur leur fignificadon. Comment on diftingue
les contre-marques des monogrammes. Les contre-marques
n’ont jamais été en ufage du tems de la république. En quels
temps & fur quelles médailles elles xmt été en ufage. Elles
n’ont jamais été un caraftere d’augmentation aux monnoies.
Quel étoit l’ufage des médailles contre-marquées. IV. 137. b.
Ce que font les'eontre-marques dans les monnoies ou médailles
d’argent. Ibid. 138. a.
Contre-marques. Des contre-marques fur les médailles. X.
333. a. b. 668. a. Médailles contre-marquées. 248. a. b. 249. a.
Contre-marque , fens de ce mot dans le commerce, dans le
manege, 8c dans l’orfévrerie. IV. 138. a.
CONTRE-MARQUER, ( Manege ) quelle eft la maniéré la
plus ordinaire dont les maquignons contre-marquent les chevaux,
dont ils veulent cacher la vieilleffe. Comment on recon-
noît cet artifice. Suppl. II. 576. a.
CONTRE-MUR, (Archit.) contre-mur de huit pouces
d’épaiffeurlorfqu’on bâtit à Paris une écurie contre un mut
mitoyen. IV. 198. a.
CÔNTR’OUVERTURE, (Chirurg) Dans quels cas ces inci-
fions font néceflaires. IV. 138. a. Comment on peut fouvent
s’en difpenfer. On tire beaucoup de fruit de F ufage des con-,
» ’ouvertures. Contr’ouvertures dans les cas où les matières
épanchées fous le crâne viennent de trop loin chercher une
iflùe faite par le trépan. Ibid. b.
Contr ouverture dans l’opération de l’empyeme. V. 599. b:
Trocar pour les contr’ouvertures. XVI. 682. a.
CONTRE-PASSATION d'ordre. (Commerce.) IV. 139.4.
CONTRE-PETTERIE, efpece de rebus. Suppl. III. 681. b.
CONTRE-POIDS. Des contre-poids du métier des ruban-
niers : maniéré de leur conferver l’équilibre : leur ufage. Contre
poids en plomb chez les mêmes ouvriers : leur ulage. IV,
139.4. _ -
Contre-poids de l’épinglier. IV. iw.a.
Contre-poids des métiers des étoffes de foie. IV. 139. b.
Contre-poids des balanciers. IV. 139. b.
Contre-poids des danfeurs de corde. IV. 139. b.
Contre-poids des machines d’opéra. IV. 139. b.
Contre-poids, en terme de manege. IV. 139. b.
CONTRE-POINT, (Mufiq. ) différence entre le contrepoint
8c la compofition. Ce mot s’applique fpécialement aux
parties ajoutées fur un fujet donne , pris ordinairement du
plain-chant. Diftinfrion de divers contre-points. IV. 139. b.
Etymologie du mot. Ibid. 140. a.
CONTRE-POINT. ( Mufiq. ) Divifion du contre-point en
contre-point général 8c en contre-point double : en contrepoint
fimple & en contre-point figuré. Hiftoire du contre-pomt.
Anciennement on chantoit le plain-chant à luniflon 8c a
l’oâave. Suppl. II. 376. 4. Peu-à-peu l’on s’aggerçut que, lans
blefler l’oreille, on pouvoit mêler des tièfees'& des quintes
aux oftaves. Alo s on ajouta plufieursqparties au plain-chant:
mais faifant uniquement ufage de tierces, de quintes Ce d oc*
taves : en forte que les premiers faux-bourdons nétoient
compofés que d’accords parfaits. Aucune mufique ne peut
produire un effet aufli grand 8c aufli harmonieux que celle-
ci dans un temple. Premier auteur qui rédigea les réglés du
contre-point à quatre parties. Suite des progrès du contre*,
point ajouté au plain-chant. Ibid. b. * . 1
Des règles .propres aux différentes efpeces de contre-points.
Réglés général« du contre-point de tout genre. Suppl. 11. $77*
*. Énumération 8c explication des différens contre-points qui
font tombés en défuétude. Ibid. 578.4. Du contrepoint double.
Origine des différens contre - points doubles. Contre-point
double avec renverfement : contre-pomt double avec tranipo*
fition. Ibid. b. Réglés général« du contre-pomt double.
Ibid. 579. a. Du contre-point double à 1 °&™e. Ibid.
Du contre-point double, avec renverfement à loétave, oc
avec des parties de rempliflage.Ibid. 580. «. Du
triple 8c quadruple, avec renverfement à 1 oâave. Du coatr
point double i la tierce & à la dixième. Du comre-p
double, avec la tranfcofmon à la tierce entre deux p ^jmj
s’écartent. Ibid. b. Du contre-point double , &
CON
Pa8n „Lfitîoti i la tierce entre plufieum parues qms écar-
avee tranfpo „ „ „ .p o in t double, avec renverfement
entre deux pitiés. Ibid. 58a. «. Du contre-pomt
j ^hlc avec le renverfement àla dixième entre denxparnes,
«om¿Énées d’autres patries. Du contre-pomt avec renver-
aceompagne r plufteurs parnés récitantes. Aid.
f D nu con.rtpSnt do 'iblePà la qniitte. & à la donxieme.
ÏÏDÏu ScomSrv-pWv Ktranfpofttion à la qntnte entre !m m * “n,r^oin' £ h l e a v e c tranfpnfttion à la quinte entre deux pames qui
AéSncm & qui font accompagnées d’autres parties de rem-
r S Du contre-point double, avec tranfpofmon à la
P ? I deux parues qui fe rapprochent. Du contre-pomt
» M a l de lanaen fy^ênie- - 7 • Efpece de contre-point
contre-pomt. Suppl. l y . oo .o. 07 r
ta^‘^ W I o K O N ? v o y « Punri*K.'sêcot.ts à emjtloyer
ï e ^ o ^ D u p S o n e ^ e . 8u9.u. Contre les poiffons
VeCONTRtPORTER “fcomto. )défenfes de contre-porter.
^CONTRE-PORTEUR, défenfes faites auxeontre-porteurs.
^CONTRE-POTENCE, (Horlog.) bouchon de contre-
P0CONTR’e1>MuVE, C Imprim.) comment elle fe (kit. IV.
,4CONTRE-REMONTRANT , (TUol.) ou Gomarifle.
Difoute entre les Arminiens & les Gomartftes. Ongtne des
tmm^de txmontrans & contre-remontrans. Voyea Rcoton-
‘ '“cÔNTRE^icEL, ( Jurifp. ) premier roi qui s’en eft fervt t
CON 399
V.UN 1 KE.O'naE.l., V.■'“ " j r - / --------------
T7 ^ m m . & ^ ( M a n o f . InfoU.) comment fe (kit
CC ajSireÆ-SENS, tl'où naît ce vice dans le difeours. Ce
défemeft ^tieulier aux traduébons.’ Çontre-fens qm confifte
à s’écarter du génie & du caraftere de fon auteur. Contre-fens
en mufttiue vocale, dans la profodte, IV. 141- "• dans la
dèclTmarion, dans la ponanation. H n’eft pas extraordinaire
que les Italiens tombent quelquefois dans des contre-fens1,
Lee qu’ils outrent l’expreffton en voulant trop la rendre.
’ “coot^ omiS t^ nT cW èY “ '“ me uf,tê en
m CONTR^BpÀlIER , 4( Jardin. ) en quel endroit on les
nlace. D’où vient le nom de contr efpaber. Diverfes obfer-
viionsiùr la culture, la forme, la hauteur de ces arbres.
Les contr’efpaliers préftrés aux arbres en butîfon. IV. 14a. a.
ContFtfîtalicrs, poiriers, veyer ce dernier mot. Diftance des
contr’efpaliers pruniers. Suppl. IV. 349* / ... 1 :
CONTRE-TAILLES 8c triples-tadles. (Gravure en bots f
Difficulté de les faire. Maniéré de les exécuter ; voyez
G ravure en bois. IV. 142- u. ^ _ , r r j
CONTRE-TEMS, (Danfe) trois mameres différentes de
fauter.IV. 142.4. CommenteUess’exécutent./^.*•
Contre-tenu de gavoue, ou en avant. Mamere de les exécuter.
IV. 14a .b.
Çontre-tems de côté. Comment s’exécute ce mouvement.
Contre-tems de chaconne, .ou Contre-tems ouverts. Infirtio
tion fur ce mouvement. IV. 142. b.
CONTRUARMONIQUE, ( Mufiq. ) proportion con*
» ’harmonique. Suppl. IV. 538. b. Echelles contr’narmoniqucs.
Foyer E ch e lle .
Contre-tems balonné, ou à deux mouvemens. Comment u
fe fait en avant, en arriéré, 8c de côté. IV. 143. a.
CONTRIBUTION, ( Jurifp. ) contribution aux dettes d’un
défunt. Suivant le droit Romain, 1« dett« fe paient in viriles.
Qui font ceux qui y contribuent dans les pays coutumiers. Sur
quoi fe prend la légitime due aux enfons. IV. 144. a.
Contribution au loi la livre, ou au marc la livre. IV. Ï44. ai
Contributions. Divifion des tributs en trois dattes ; 1«
taxes fur les terres & impôts, les taxes fur les marchandif«
qu’on appelle droits, & les tax«perfonnelles ou contributions*
XVII. 868.4. Wm . . . . . .
C o n t r e - t e m s . ( Terme de Manege.) IV. 143- *•/ . „
CONTRE-VAIR, ( Blafon ) fourrure appellée vair ©c
tonCtrOe-NvaTiRr. ES-uvp AplÏ. RmÉ,m ( Bmlafo n.w) è cu contre-va.ir■é. W# . « II.
C o n t r i b u t i o n s , (Art milit.) împofïtions que 1« habit ans
des frontières paient à l’ennemi, 8cc. Mefùres qim le prince
doit prendre avec fon général pour l’épargne de Tes fonds j ces
mefures font les contributions. D « contributions qui fe tirent
en fubftance. IV. 144. a. Juftice à obferver dans cette levée.
Toutes ces efpeces de levées doivent avoir des prétextes qui
en adouciflent la charge au peuple. Des levées de blés ,
d’avoines, de fourrages, de viandes. Ufages pour lefquels on
peut exiger des voitur«, des bois, des pionniers. Deux
manier« dont fe tire furie pays l’uftenfile pour les troupes.
Deux maniérés d’établir la contribution en argent. Ibid. b. « .
CONTRE-VALLAT10N , ( Ligne de ) en quoi elle diftere
rie la circonvallation. IV. 143- W ™ furJ a ? an!crf K
conftrùire. La contrevaUation étoit plus en ufage chez 1«
anciens queparmi nous. Ancienneté d e Voye^
lig n e s , (Art militaire) 8c les planches XIV. & X V . ^ 1 art
Contributions. Taxe de contribution. XV. 947. b. CeU« qu oa
tige d’un pays ennemi qu’on ne peut efpérer de garder. XIII.
18.4.
Contributions levées en pays ennemi. XV.947. b.
CONTRITION, ( Thcolog.) définition. Opinion de Luther
lui détruit la néceflite de la contrition. Cette opinion réfutée.
Conditions ou propriétés de la contrition : elle doit être libre,
furnaturelle ,IV. 145.4. vive 8c véhémente. La contrition eft
néceflaire pour le péché, 8c incontinent après le péché. Deux
fortes de contritions, l’une parfaite 8c 1 autre imparfaite, nom*
mée attrition ( voynce mot). Ce que dit le concile de Trente
fur l’une 8c l’autre. En quel tems le mot attrition a commencé
d’être employé. Difputes entre 1« théologiens fur 1« limites
qui féparent l’attrition de la contrition. Lès uns prétendent
que l’attrition ne différé de la contrition que par la vivacité
de la douleur : Ibid. b. les autr« par le motif qui s unit a la
douleur. Ce motif eft-il l’amour de Dieu ; la douleur devient
contrition. Les premiers penfent bien que 1 attrition eft mêlée
de quelque amour de Dieu ; mais 1« uns 8c les autres ne
penfent pas de la même maniéré furl’amour. Paflage du concile
de Trente d’où leur divifion tire fa fource , & qui a produit
parmi ceux qui tiennent pour l’amour dans le facremcm de
pénitence deux fentimens oppofés fur le motif qui conftitue
la contrition parfaite 8c la contrition imparfaite. Diftinétion
de deux amours. Ibid. 146. 4. Paflage de S.Thomas, oulon
en trouve des traces. Avantage qu’en ont voulu tirer M. Tour-
nely 8c M. Languet, profeffeur de Sorbonne. Examen du len-
timent qui donne l’exclufion à l’amour <jans l’attrition même,
qu’on prétend fuffifante dans le facrement de pénitence. Principauxpartifans
de cette opinion, qui n’eft point fort ancienne.
Areument des attritionnaires contre lanéceflité de 1 amour de
Ditu. Réponfe à cet argument. Ibid. /. Dans quelle circqnf-
tance le précepte d>ùner Dieu oblige le chrétien , félon ies
princip« des attritionnaires. Ibid. 147. a. Ce feroit une mjuf-
tice d’attribuer les fentimens dont on Vient de parler à la fo*
ciété entier e dont ceux qui les foutenoient étoient membres.
Comment 1« Janfènift« pechent d’un autre côté dans leur
doarine fur l’amour de Dieu. Ibid. b. Ce que doit penfer naturellement
fur cette matière un homme qui n eft m entraîné
par l’intérêt d’un corps, ni fafemé par i eipnt de parti. Quel
?ft le fentiment le plus sûr 8c le plus fum fur la contrition 8c
fur l’àttrition. Ibid. 148. Auteurs à confulter. Ibid. b.
CONTROLE, (Jurifp.) à qui l’on communique les re-
eiftr« du contrôle. Différence entre ces regiftres & ceux des
infinuations. Diverfes fortes de contrôles qui ont rapport à
l’adminiflrarion de la juftice. IV. 148. b.
Contrôle. Edit du contrôle: V. 391. A Du contrôle det
v r - „ ÿ — 237. b. Brevet de contrôle. II. 4M-b- Droit de
« f lg S & g c la q u e article de dénem. IV.8,8.4.
Contrôle des amendes. IV. 148. b.
Contrôle des arrêts au parlement. IV. 148. o-
Contrôle de» rades. IV. 14“* é* -v „ ,
Contrôle des bans de mariage ; établi en 1697. IV. 148. t.
E tab liffem en t des contrôleurs des bans de mariage. Leur fup*
preffton en 170a. IV. *
Contrôle des baptêmes. IV. 149. a.
Contrôle dei bénéfices ou aftes ecdéfiafttques : pourquoi il
fut établi en 1637- W g de fo" au
rnnd confeil 8é bon point au parlement. Motbficauons appor.
tées k cet M en 1646. IV. 149. a.
■ Contrôla des chancelleries. IV. 149. a. .
Contrôle des dépéris. Création des contrôleurs des tiers-ri-
férendaires. Motif de cefétabliffement. Ces offices téunis au
domaine du roi en 1667. IV. 149. «• «“ PP^1?0"