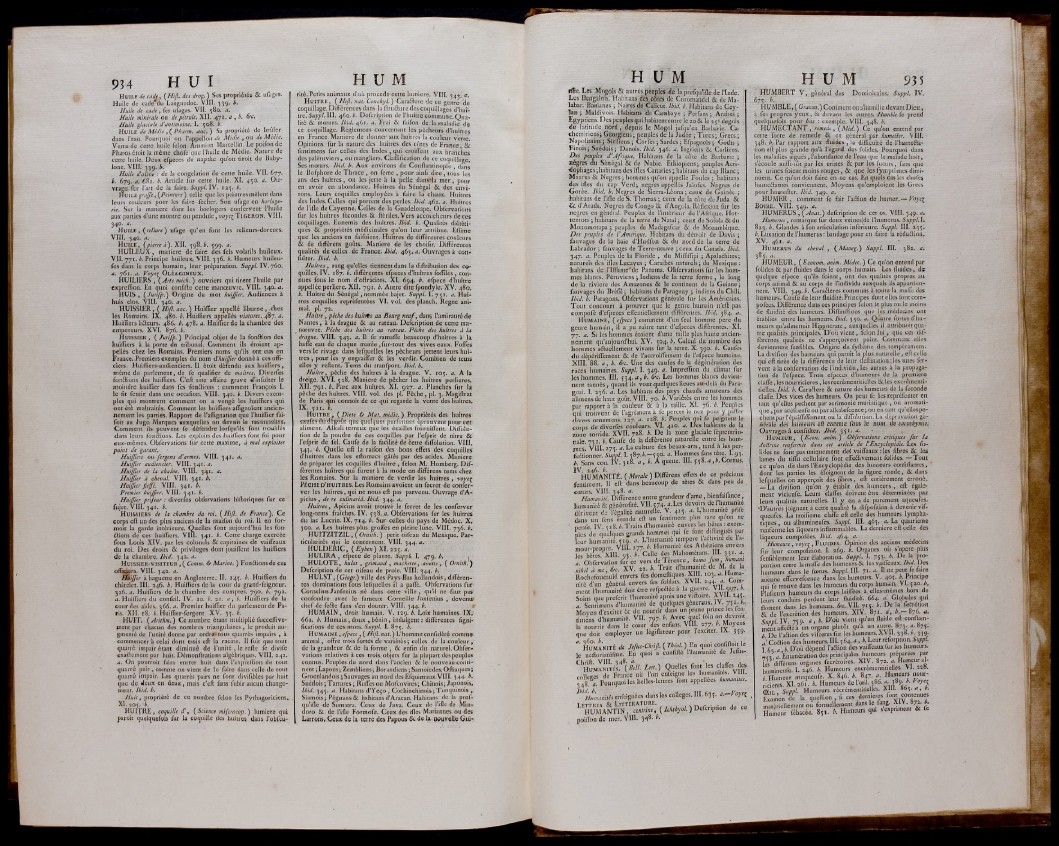
934 H U I
H uile de ende, {Hifi» des drog.) Ses propriétés 8c ufages.
Huile de cade du Languedoc. VIII. 339. b.
Hu ile de ca d e , fes uiages. VII. 580. a.
H u ile minérale ou de pétrole. XII. 47 1 . a , b. Oc.
H u ile glaciale d ’antimoine. I. 508. b.
H uile de M é d i t , ( Pharm. anc. ) Sa propriété de brûler
dans l’eau. Pourquoi on l’appelloit de Médie , ou de Médée.
Vertu de cette huile félon Ammien Marccllin. Le poifon de
Pharos étpit la même chofe que l ’huile de Médie. Nature de
cette huile. D eu x efpeces de napthe qu’on tiroit de Baby-
lone. VIII, 339. b.
H u ile d'olive : d e la congélation de cette huile. V I I . 677.
b. 679. a. 68*. b. Article fur cette huile. X I . 430. a. O u vrage
fur l’art de la faire. Suppl. IV . 113. b.
H v i lE gr.iffe, {P ein tu re ) celle que les peintres mêlent dans
leurs couleurs pour les faire féener. Son ufage en horlogerie.
Sur la maniéré dont les horlogers confervent l’huile
aux parties d’une montre ou pendule, voyrçTiGERON. V I I I .
340. a.
H u il e , { re liu re ) ufage qu’ en font les relieurs-doreurs.
V I I I . 340. *.
H u il e , {p ie r r e à ) . XII. 398. b. 399. a.
H U IL E U X , maniéré de faire des fels volatils huileux.
V I I . 7 7 1 . ¿.Principe huileux. VIII. 336. ¿.Humeurs huileu-
fes dans le corps humain, leur préparation. Suppl. IV . 760.
<*. 7 6 1, a. Voye3 OLÉAGINEUX.
HUILIERS , { A r t s méch. ) ouvriers qui tirent l'huile par
exprelfion. En quoi confifte cette manoeuvre. VIII. 340. a.
HUIS , (J u r ifp .) Origine du mot huiffier. Audiences à
huis clos. VIII. 340. a.
H UISSIER, ( H ifi. anc. ) Huiffier appellé liburn e, .chez
les Romains. I x . 480. b. Huiffiers appelles viatores. 487. a.
Huiffiers liâeurs. 486. b. 478. a. Huiffier de la chambre des
empereurs. X V I . 876. b.
H uissier , ( Jurifp. ) Principal objet de la fôriéïion des
huiffiers à la porte an tribunal. Comment ils étoient ap-
pelles chez les Romains. Premiers noms qu’ils ont eus en
France. Premiers exemples du nom A'huiffier donné à ces officiers.
Huiffiers-audienciers. Il étoit défendu aux huiffiers,
même du parlement, de fe qualifier de maîtres, Diverfes
fondions des huiffiers. C ’eft une affaire grave d’infulter le
moindre huiffier dans fes fondions : comment François I.
le fit fentir dans une occafion. V I I I . 340. b. Divers exemples
qui montrent comment on a vengé les huiffiers qui
ont été maltraités. Comment les huiffiers affignoient anciennement
les parties. Rapport de l’affignation que l’huiffier fai-
foit au Juge. Marques auxquelles on de voit le reconnoîtrc.
Comment ils peuvent fe défendre lorfqu’ils font troublés
dans leurs fondions. Les exploits des huiffiers font foi pour
eux-mêmes. Obfervations fur cette maxime, à mal exploiter
point de garant.-
Huiffiers ou fergens d ’armes. VIII. 341. a.
Huiffier audiencter. V I I I . 341. a.
Huiffier de la chaîne. VIII. 341* u.
Huiffier à cheval. VIII. 341. b.
Huiffier fieffé. V I I I . 341. b.
Premier huiffier. VIII. 341. b.
Huiffier prifeur : diverfes obfervations hiftoriques fur ce
fujet. VIII. 341. b.
H u issiers de la chambre du roi. {H i f i . de F ra n c e). C e
corps eft un des plus anciens de la maifon du roi. Il en for-
moit la garde intérieure. Qu elles font aujourd’hui les fonctions
de ces huiffiers. V I I Î . 341. b. Ce tte charge exercée
fous Louis X IV . par les colonels & capitaines de vaiffeaux
du roi. Des droits & privilèges dont jouiffent les huiffiers
de la chambre. Ibid. 342. a.
Huissier-v is it e u r , ( Comm. O Marine. ) Fondions de ces
offiôers. VIII. 342. a.
Hhiffer à baguette en Angleterre. II. 143. b. Huiffiers du
châtelet. III. 246. b. Huiffiers de la cour du grand-feigneur.
326. a. Huiffiers dé la chambre des comptes. 790. ¿. 792.
a. Huiffiers du confeil. IV . 10. b. 21. a , b. Huiffiers de la
cour des aides. 366. a. Premier huiffier du parlement de Paris.
XII. 18. b. Huiffier-fergent X V . 33. ^.
HU IT. {A r ithm .) C e nombre étant multiplié fucceffive-
ment par chacun des nombres triangulaires, le produit augmenté
de l’unité .donne par ordrditous quarrés impairs , à
commencer à celui dont trois eft la racine. Il fuit que tout
quarré impair étant diminué de l’un ité , le refte fe divife
exactement par huit. Démonftrationi algébriques. VIII. 242.
a . On pourrait faire entrer huit dans l’cxpreffion de tout
quarré p a ir , comme on vient de le faire dans celle de tout
quarré impair. Les quarrés pairs ne font divifibles par huit
que de «leux en d eu x, mais c’efl fans fubir aucun changement.
Ibid. b.
H u i t , propriété de ce nombre félon les Pythagoriciens*
XI. 203. b.
H U IT R E , coquille d f , ( Science mifcrocop. ) lumière qui
paraît quelquefois fur la coquille des huîtres dans l’obfcu-
HUM rité. Petits animaux d’où procédé cette lumière. VIII, 34^ a.
H u ître , ( H ifi. nat. Conchyl. ) Caraétere de ce genre* de
coquillage. Différences dans la ftruéture des coquillages d’huître.
Suppl. III. 460. b. Dcfcription de l’huître commune. Q u a lité
& moeurs. Ibid. 461. a. Frai & faifon de la maladie dé
ce coquillage. Réglemens concernant les pêcheurs d’huiircs
en France. Maniéré de donner aux huîtres la couleur verte.
Opinions fur la nature des huîtres des côtes de France 8c
fentimens fur celles des Indes , qui croiffent aux branches
des palétuviers, ou mangliers. Claffification de ce coquillage.
Ses moeurs. Ibid. b. A u x environs de Conftantinople , dans
le Bofphore de Thrace , on fem e , pour, ainfi d ire , tous les
ans des huîtres, on les jette à la pelle dansria m e r , pour
en avoir en abondance. Huîtres du Sénégal 8c des environs.
Leurs coquilles employées a faire la chaux. Huîtres
des Indes. C elles qui portent des perles. Ibid. 462. a. Huîtres
de rifle de Cayenne. Celles de la Guadeloupe. Obfervations
fur les huîtres fécondes 8c fiériles .Ve rs accoupheurs de ces
coquillages. Ennemis des huîtres. Ibid. b. Qualités diététiques
8c propriétés médicinales qu’on leur attribue. Eflime
que les anciens en faifoient. Huîtres de différentes couleurs
8c de différens goûts. Maniéré de les choiflr. Différentes
qualités de celles de France. Ibid. 463. a. Ouvrages à con-
lulter. Ibid. b.
H u îtr e s , rang qu’elles tiennent dans la difiribution des coquilles.
IV . 187. b. différentes efpeces d’huîtres foffiles, connues
fous le nom d’oflracites. XI. 694. b. efpece d’huître
appellée perliere. XII. 79 1 . b. Au tre dite fpondyle. X V . 480.
b. Huître du Sénégal, nommée bajet. Suppl. 1. 7 3 1 . a. Huîtres
coquilles repréfentées V I . v o l. des planch. Regne animal.
pl. 72.
H u îtr e, pêche des huit i f s au Bourg n e u f , dans l’amirauté de
Nantes, à la drague 8c au rateau. Dcfcription de cette ma-
t noeuvre. Pêche des huîtres au rateau. Pêche des huîtres à la
drague. V I I I . *43. a. Il fe ramaffe beaucoup d’huîtres à la
baffe eau de chaque maré e, fur-tout des v iv e s eaux. Foffes
v ers le rivage dans lefquelles les pêcheurs je t t e n t leurs huîtres
, pour les y engraiffer 8c les verdir. Combien de teins
elles y refient. T ems du tranfport. Ibid. b.
H u îtr e, pêche des huîtres à la drague. V . 103. a. A la
dreige. XVT. 328. Maniéré de pêcher les huîtres perlieres.
XII. 7 9 1 . b. Parc aux huîtres. X I. 927. a. Planches fur la
pêche des huîtres. V I I I . vol. des pl. P ê ch e , pl. 3. Magifirat
de Paris qui connoît de ce qui regarde la vente des huîtres.
IX . 3 1 1 . b.
H u ît r e , ( D ic te 6» M a t. médie. ) Propriétés des huîtres
caufes du dégoût q'ue quelques perfonnes éprouvent pour cet
aliment. AJkali terreux que les écailles fourniffent. Diffolu-
tion de la poudre de ces coquilles par l’efprit de nitre 6c
l’efprit de fel. Caufe de la facilité de cette diffolution. V I I I .
343 . b. Q u elle efi la raifon des bons effets des coquilles
d’huîtres dans les efiomacs gâtés par des acides. Maniéré
de préparer les coquilles d’huitre , félon M. Homberg. D if férentes
huîtres qui furent à la mode en différens tems chez
les Romains. Sur la maniéré de verdir les hu îtres , voyez
Pêche d ’h u îtr e s . Les Romains avoient un fecret de conserv
e r les huîtres, qui ne nous efi pas parvenu. Ouvrage d’A -
picius , de re culinariâ. Ibid. 344. a.
H u îtr es , Apicius avoit trouvé le fecret de les conferver
long-tems fraîches. IV . 338. a. Obfervations fur les huîtres
du Tac Lucrin. IX. 7 14 . b. Sur celles du pays de Médoc. X .
300. a. Les huîtres plus groffes en pleine lune. VIII. 736. b.
H U IT Z IT Z IL , ( Ornith, ) petit oifeau du Mexique. Particularités
qui le concernent. VIII. 344. a .
H U LD E R IC , ( Eyben ) XI. 223. a.
H U L IR A , efpece de plante. Suppl\ I. 479. b.
H U L O T E , hulot y grimaud , machette, -avette, ( Ornith. )
Dcfcription de cet oifeau de proie. VIII. 344. b.
H U L S T , {Géogr.) v ille des Pays-Bas hollandois, différentes
dominations lous lefquelles il a paffé. Obfervations fur
Cornélius Janfenius né dans cette v ille , qu’il ne faut pas
confondre avec le fameux Corneille Janfenius , devenu!
ch ef de fefte fans s’en douter. VIII. 344. b.
H U M A IN , droit humain. V . 129. b. Loix humaines. IX.'
662. b. Humain, doux , bénin, indulgent : différentes figni-
fications de ces mots. Suppl. I. 873. b.
H um a in e , efpe ce, ( H ifi. nat. ) L’homme confidéré comme
animal, offre trois fortes de variétés; celles de la couleur ,
de la grandeur & de la forme , & enfin du naturel. O bfervations
relatives à ces trois, objets fur la plupart des peuples
connus. Peuples du nord dans l’ancien & le nouveau continent
; Lapons ; Z embliens; Borandiens ; Samoïedes; O fiiaques;
Groenlandois ; Sauvages au nord desEfquimatix.VIII. 344* %
Suédois ; Tartares ; Rudes ou Mofcovites; Chinois; Japonois.
Ibid. 343. a. Habitans d’Y e ç o , Cochinchinois;Tunquinois ,
Siamois; Pégu ans& habitansd’Aracan. Habitans de la pref-
! qu’ifle de Sumatra. C eu x de Java. C eu x de l’ifle de Min-’
doro 8c de l’ifle Formofe. Ceux des ifles Mariannes ou des
Larrons. C eu x de la terre des Papous 8c de la. nouvelle G ui-
H U M
«tëe. L es Mogols & autres peuples de la prefqu’ ifle de l’Inde.
L e s Beugaloîs; Habitans'des, cotes dé Coromaridel 8c de Ma- ;
labar. Banianes ; Naires de Càlicut. Ibid. b. Habitans de C e y -
lan ; Maldivois. Habitans :de Cambaye ; Perfans; Arabes ;
Egyptiens. Des peuples qui habitententre le 20 8c le 23« degrés ,
d e latitude n o rd , depuis le Mogol jufqu’en Barbarie. Ca-
chemiriens»; Géorgiens; peuplés de la Judée ; T u rc s ; G re cs;
Napolitains ; Siciliens ; Corfes ; Sardes ; Efpagnols ; Goths ;
Finois¿Suédois ; Danois. Ibid. 346. a. Ingriens '8c Cariions.
D e s peuples d ’Afrique. Habitans de la côte de Barbarie ;
nègres au Sénégal 8c de Nubie. Ethiopiens; peuples Acri- .
'dophages;habitans des ifles Canaries ; habitans du cap B lanc;
Maures 8c Ncgres ; hommes qu’on appelle Foules ; habitans
des ifles du cap V e rd ; negres appelles Jalofes. Negres de
G oré e . Ibid. b. Negres de Sicrra-Léona ; ceux de Guinée ;
habitans de l’ifle de S. Thomas ; ceux de la côte de Juda 8c
8c d’Arada. Negres de Congo 8c d’Angola. Réflexion fur les
negres en général. Peuples de l’intérieur de l’A frique. Hot-
tentots ; habitans de la terre de Natal ; ceux de Sofola 8c du
Monomotapa ; peuples de Madagafcar 8c de Mozambique.
D e s peuples de l ’Amérique. Habitans du détroit de Davis ;
fauvages de la baie d’Hudfon 8c du nord de la terre de
Labrador ; fauvages de Terre-neuve ; ceux du Canada. Ibid.
347. a. Peuples de la Floride , du Miffiffipi ; Apalachites;
naturels des ifles Lucayes ; Caraïbes naturels ; du Mexique :
habitans de l’ IAhme*de Panama. Obfervations fur les hommes
blancs. Péruviens ; Indiens de la terre ferme , le long
de la riviere des Amazones 8c le continent de la Guiane ;
fauvages du Bréfil ; habitans du Paraguay ; indiens du Chili.
Ibid. b. Patagons. Obfervations générale fur les Américains.
T o u t concourt à prouver que le genre humain n’efi pas
compofé d’efpeces effemiellement différentes. Ibid. 384. a.
H u m a in e , ( efpece ) comment d’un feul homme pere du
genre humain, il a pu naître tant d’efpeces différentes. XI.
7 7 . a. Si les hommes étoient d’une taille plus haute anciennement
qu’aujourd’hui. X V . 304. b. Calcul du nombre des
hommes actuellement vivans fur la terre. X. 390. b. Caufes
du dépériffement 8c de l’accroiffemcnt de l’efpece humaine.
X III. 88. a , b. O c . Une des caufes de la dégénération des
races humaines. Suppl. I. 349* a- Impreffion du climat fur
les hommes. III. 334. a , b. Oc. Les hommes blancs deviennent
tannés, quand ils vont quelques lieues au-delà du Para-
guai. I. 236. a. Les habitans des pays chauds amateurs des
alimens de haut goût. V I I I . 70. b. Variétés entre les hommes
par rapport à la couleur 8c à la taille. X I. 76. b. Peuples
qui trouvent de l’agrément à fe percer le nez pour y paffer
divers ornemens. 127. a. 128. b. Peuples qui fe peignent le
corps de diverfes ’ couleurs. V I . 410. a. Des habitans de la
zone torride. X V I I . 728. b. D e la zone glaciale feutentrio-
nale. 73 1 . b. Caufe de la différence naturelle entre les hommes
V I I I 273. a . La culture des beaux-arts, tend a las per-
feftionner. Suppl. 1. 587 .4.-500. a. Hommes 6ns tête. 1. 95.
b. Sans cou. IV . 318. a , b. A. queue. UI. 358.a , b . Cornus.
I V 246. b.
H UM AN ITÉ . ( Morale ) Différens effets de ce précieux
fentiment. Il eft dans beaucoup de têtes 8c dans peu de .
coeurs. VIII. J 48. a.
Humanité. Différence entre grandeur d ¡une, bicnfaifance,
humanité 8c générofité. VII. 574. « Les devoirs de 1 humanité
dérivent de l’égalité naturelle. V . 4Ï5. a. Lhumamté prife
dans un Cens étendu eft un fentiment plus rare quon ne
1 o e n f e . IV . ? i8 . i . Traits d’humanité envers les bêtes : exemples
de quelques grands hommes qui fe font djftingués par
eur humanité. 519. a. L ’iuimanité tempere laftivitê de la-
mour-propre. V I I I . g § Humanité des Athéniens envers
les bêtes. XIII. 93. b. Celle des Maliométans. III. 3 31. a.
a. Obfervation fur ce vers d e T é r en c e , homo fum,.humant
nihil A me O c X V . 22. b. Trait d humanité de M. de la
Rochefoucauld envers fes domefliques. XIII. 103. u. Humanité
d’un général envers fes foWats. X V II. 244- g Comment
l’humanité doit être refpeftée à la guerre. V II 997. i.
Soins que preferit l’humanité après une vifto.re. X V II. 245.
a Sentimens d’humanité de quelques généraux. IV . 751 . b..
Moyen d’exciter 8c de nourrir dans un |eune prince les fen-
timens d’humanité. V I I . 707. b. Avec; quel foin on devroit
la nourrir dans le coeur des enfans. VIII. 277. *• Moyens
que doit employer un légiflateur pour 1 exciter. IX. 359.
*** îluMANITÉ 1 J 'fit t-C h n jl. ( En quoi confdloit le
le neftoriahifme. Ep quoi a confifté lhumamté de Jefus-
° 'h u m ANiTés.4*( B e ll. L e , , . ) Quelles fon t'le s c la ffe s.lc s
collèges de France où l’on enfeigne les humanités. VIII.
348 a. Pourquoi les belles-lettres font appellées bmnanuée.
'^HnmanUés enfeignées dans les collèges. III. | g a .-V o y e ^
L e t t r e s & L it t é r a t u r e . .
H UM AN T IN , ccntrinc, { Ichthyol. ) Defcription de ce
poiffon de mer. VIII. 348. b.
H U M 935
HUMBERT V , général des Dominicains. Suppl. IV .
'6 7 5- I l
H UM B L E , ( Grainm.) Comment on s’hiimÜic devant D ie u ,
à-fes propres y e u x , 8 c devant les autres. Humble ( g prend
quelquefois pour bas exemple. VIII. 348. b.
H U M E C T A N T , remede, {M é d .\ C e qu’on entend par
cette forte de remede 8ç en général par humefler. VIII.
348. b. Par rapport aux flu ide s, la difficulté de l’humeéla-
tion efi plus grande qu’à l’égard des folides. Pourquoi dans
les maladies aiguës, l’abondance de l’eau que le malade b o it,
s’écoule auffi-tôt par les urines 8c par les fueurs, fans que
les urines foient moins rouges, 8c que les fymptômes diminuent.
C e qu’on doit faire en ce cas. Ep quels cas les choies
humeélantes conviennent. Moyens qu’emploient les Grecs
pour hume&er. Ibid. 349. a.
H U M E R , comment fe fait l’a&ion de humer. —»Voye{
B o ire . VIII. 340. a.
HUMERUS , {A n a t . ) defcription de cet os. V I I I . 349.
Humérus, remarque fur deux veinesjde l’humerus. Suppl. I.
823. b. Glandes à ion articulation inférieure. Suppl. III. 233.
b. Luxation de l’humerus : bandage pour en faire la rédu&ion.
X V . 461. a.
Humérus du cheval , {M a n eg .) Suppl. III. 381. a.
Éf i d.
HUM EU R , ( Econom. anim. Médec. ) C e qu’on entend par
folides 8c par fluides dans le corps humain. Les fluides, de
quelque elpece qu'ils foient, ont des qualités propres au
corps animal & au corps de l’individu auxquels ils appartiennent.
VIII. 349. b. Caraéleres communs à toute la. mafle des
humeurs. Caufe de leur fluidité.Principes dont elles font com-
pofées. Différence dans ces principes lclon le plus ou le moins
de fluidité des humeurs. Difiinélions que les. médecins ont
établies entre les humeurs .Ib id . 330. a. Quatre fortes d’humeurs
qu’admettoit Hippocrate, auxquelles il attribuoit quatre
qualités principales. D ’où v ien t , félon lu i , que ces différentes
qualités ne s’apperçoivent point. Comment elles
deviennent fcnfibles. Origine du fyfteme des tempéramens.
La divifion des humeurs qui paraît la plus naturelle, efi celle
qui eft tirée de la différence de leur aeftination : les unes fervent
à la cohfervation de l’individu, les autres à la propagation
de l’efpece. Trois efpeces d’humeurs de la première
claffe, les nourricières, lesrecrémentitielles 8c les excréinenti-
tielles. Ibid. b. Caraftere 8c nature des humeurs de la fécondé
claffe. Des vices des humeurs. On peut fe les repréfenter en
tant qu’elles pechent par acrimonie muriatique , ou aromatique
, par aceicenfe ou par alkalefcence ; ou en tant qu’elles pechent
pari’épaiffiffement ou la diffolution.La dépravation générale
des humeurs efi connue fous le nom de cacochymieà
Ouvrages à confulter. Ibid. 331 . a .
H um eu r , {E co n . anim.) Obfervations critiques fu r la
doflrihe renfermée dans cet article de VEncyclopédie. Les fo lides
ne fontjïas uniquement deS vaiffeaux : les fibres & les
lames du tiflu cellulaire font effeélivement folides. — Tout
ce qu’on dit dans l’Encyclopédie des humeurs confifiantes, ‘
dont les parties les éloignent de la figure ronde, & dans
lefquelles on apperçoit des fibres, eft entièrement erroné.
— La divifion qu'on y établit des humeurs, eft également
vicieufe. Leurs claffes doivent être déterminées par
leurs qualités naturelles. Il y en a de purement aqueuieSè
‘D ’autres joignent à cette qualité la difpofuioji.à devenir vif-
queufes. La troificme claffe eft celle des humeurs lymphatiques
, ou albumineufes. Suppl. III. 463. a. La quatrième
renferme les liqueurs inflammables. La derniere eft celle des
liqueurs compofées. Ibid. 464. a. -
Humeurs, v o y e z , F luides. Opinion des anciens médecins
fur leur compoution. I. 269. b. Organes ou sopere plus
fenfiblement leur élaboration. Suppl. 1. 753*^* ,, ,
portion entre la maffe des humeurs 8c les vaiffeaux. Jbtd. IJes
humeurs dans le foetus. Suppl. III. 71. a. Il ne peurfe faire
aucune effervefcence dans les humeurs. V . 403. ¿. Principe
qui fe trouve dans les humeurs du corps humain, VI. 320.^.
Plufieurs humeurs du corps laiffées à ellesrinemes hors de
leurs conduits perdent leur fluidité'. 664. a. G lqM e s: qui
flottent dans les linmeurs. d-c. VII. 71 J. b. D e la feirénon
& de l’excrétion des humeurs. XIV . 871. a , b . r - i - j b . a.
Suppl IV 739. a , b. D ’où vient quun fluide ett conftam-
men taffe àé à un organe plutôt qu’a un autre. 873- ^ 87î-
b D e l’aftion des vifeeres fiir les humeurs. X VII. 338. b. 339.
Coêlion des humeurs. III. 564• “ . *• reforption. Suppl.
I*g_ a b D ’où dépend l’aftion des vaiffeaux fur les humeurs.
7 , , . 'e . ’Enumération des principales humeurs préparées par
[es différons organes fecrétoires. X IV . 872. u. Humeur al-
bumineufe. I. 246. b. Humeurs excrémentitieUes. V f. 228.
é Humeur muqueufe. X. 846. b. 8 4 7 "our'
ricieres. XI. 261. b. Humeuts de l’oe.!, l8d. ^ 9^ -
OE i l Suppl. Humeurs récrèmentiuelte. XIII. 865. a , b.
• Examen Se la queftion , fi ces dernieres foiitcomenucs
matériellement ou formellement dans le fang. X IV . 8 « . .
Humeur fèbacée. 8 5 .. b. Humeurs qui s’exprunent 8c fe