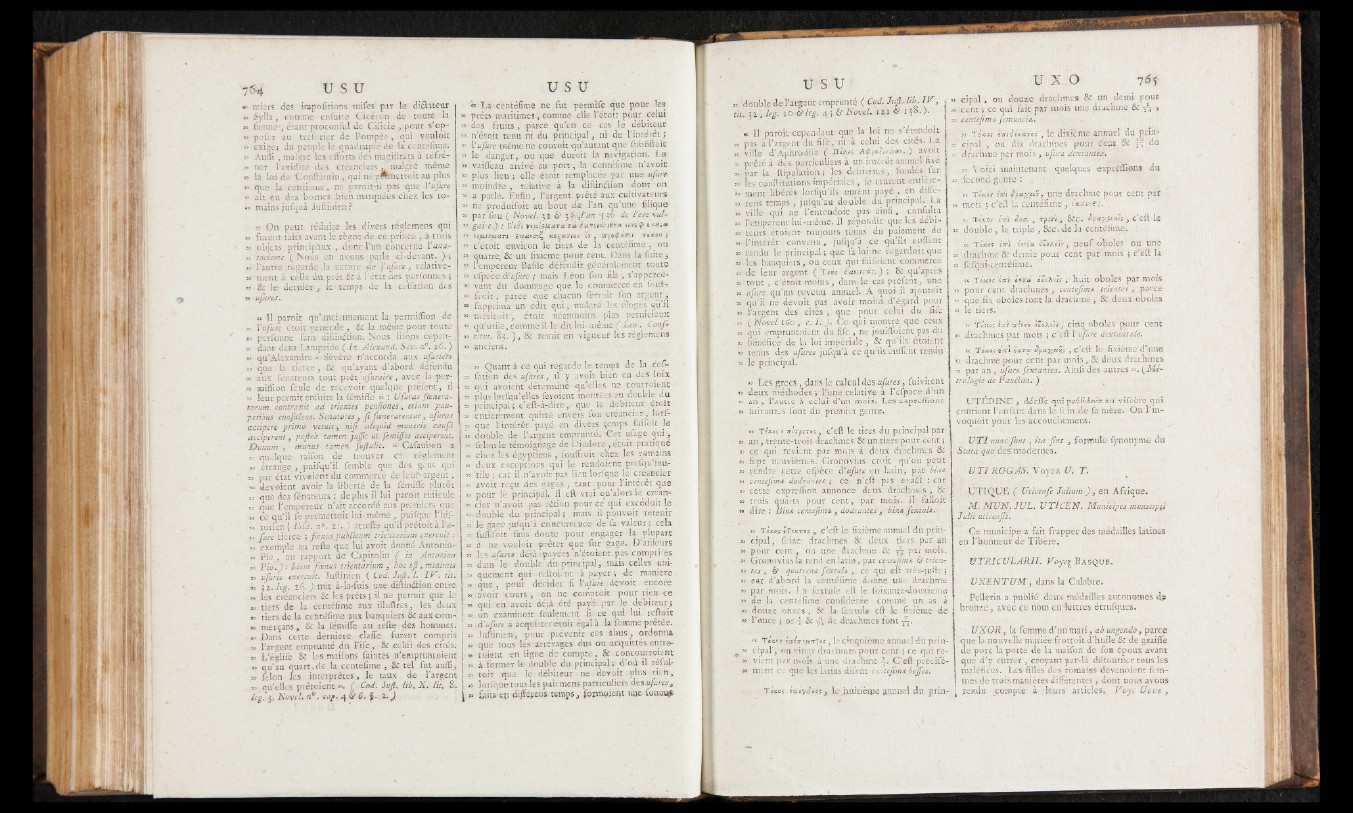
O
7tS4 U S U
« rr.iers des inapofitions raifes' par le di&ateur |
» Sylla j comme enfui te Cicéron de toute la ;
» fienne*, étant proconful de Cilicie , pour s’ op-
» pofer au tr.éfcrier de Pompée , qui vouloit
» exiger du peuple le -quadruple de la centéfime;
» Aufli , malgré les efforts des magiftrats à réfré-
s» ner P avidité-des créanciers , malgré même
a? la loi de Conftantin, qui ne pWmettoit au plus
» que la centième, ne paroitril pas que Yufure
r » ait eu des bornes .bien marquées chez les ro-
»» mains jufquà Juftinien?
os On peut réduire les divers réglemens qui
33 furent faits avant le règne de ce prince/, à trois
33 objets principaux , dont l’un concerne Y ana-
33 to'cisme ( Nous en avons parlé ci-devant. • )»>
33 P autre, regarde la nature de Yufure 3 relative^
»"ment à. celle du prêt 8e à l'état des personnes ;
a* 8c le dernierV, le'temps de la çeiïation des
» ufures.
« Il paroît qu anciennement la permiffion de
33 Yufure étoit générale, & la même pour toute
/ 03 perfonne fans diftinétian. Nous liions cepen- _
33 dant dans Lampvide ( In Alexand. Sev. n°. z 6 .)
»3 qu’Alexandre - Sévère n accorda, aux ufuriéfs.
si que là tierce 3 & qu ayant d’abord défendu
33 aux fénateurs tout prêt ufuraire, avec la per-
-, as miflion feule de recevoir quelque préfent, il
33 leur permit enfui te la fémiffe Ufuras ficenera-
torum contray.it ad. trientes pcnfon.es 1 etiam pau-
pefihus confulens. Sénat ores 3 fi foenerarentur 3 ufuras
accipcre primo vêtait 3. nifi aliquid muneris caufâ
acciperent 3 pcfiea tamen jutftt ut femijfes acciperent.
Uonum , rriunus . tamen. fuftulit. « Cafauben a
33 quelque raifon de trouver ce' réglement'
3» étrange , puifqu’il femble que des gens qui-
' sa par état viveient du commerce de leuN argent,
» dévoient avoir la liberté de la fémiffe plutôt
33 que des fénateurs : déplus il lui paroît ridicule
m que P empere ur n’ait accordé aux premiers que
» cé qu’ il fe permettoit lui-même ,_ puifque l’ hif-
» torien ( Ibid. n°. i t . ) âttéfte qu’il prêtoità l’à-;
»3 fure tierce; ftenus.publieum trientarium cxercuit :
» exemple au refte que lui avoit donné Àntonin-
33 Pie 3 au rapport de Capitolin J in Arüonino
si Vio:) :Tdem fænus trientarium 3 hoc'eft, minimis
33 ufuris exercuii. Juftinien ( Cod. Juft. I . I V . tit.
3» 3 z. leg. %6. ) mit à-la-fois ! une; diftin&ion entre
39 les créanciers 8c les prêts ; il ne permit que le
33 tiers de la centéfime aux illuftres , les deux
•3 tiers de la centéfime aux banquiers 8c aux com-
3* merçans 3 8c la fémiffe au refte dés hommes.
33 Dans cette dèrniere ciaffe furent compris
» l’argent emprunté du, Fifc., 8c celui des cités;
33 L’églife 8ç les maifons faintes n’empruntoient
33 qu’ au quart.de la centéfime , & tel fut auflî,
33 félon les. interprètes, lé -taux de l’argent
33 quelles prêtoient >=, f Cod: Juft. lib, X . lit, 8.
leg. 3. Novd. n°. cap. 4 & 6 .$. .1 . )
U S U
« La-centéfime ne fut permife que pour les
» prêts maritimes, comme elle l’étoit pour celui
33 des fruits, parce qu’en ce cas le débiteur
33 n’étqit tenu ni du principal 3 ni de l’ intérêt ;
»3 Yufure même ne couroit qu’autant que fubfiftoit
« le danger, ou que duroit là navigation. Le
3» vaiffeau arrivé au port, la centéfime n’avoit
33 plus lieu; elle étoit remplacée par une ufure
33 moindre, relative à la diftinéiion dont on
33 a parlé. Enfin, l’argent prêté aux cultivateurs
33 ne produifoit au bout de l’an qu’une filique
33 par fou ( Novel. 32 6? 3 f J ‘an «y36 de V'ereyul- ,
33 g a v e ) : E’ tJ i yoplspLotrot roi J'avîiKnÏTco ey/Â
33 vopio-fictrt iyieiviri^ xiça r to v ïv , irpo(pourn rexou }
33 c’ étoit environ le tiers de la centéfime, ou
quatre, 8c un fixieme pour cent. Dans la fuite, ?3 l’empereur Bafile défendit généralement toute
3-3 efpèce d’ ufure ,* mais Léon fon fils , s’apperce-
30 vant du dommage que le commerce en fouf?
=3 fr c it , parce que chacun ferroit fon argent,
*> fupprima un édit qui,.malgré les éloges qu’il
33 me ri to it, étoit néanmoins plus pernicièux
33, qu’utile, comme il le dit lni-même (;heo ... Coup
33 titut. 83'. ) , &' remit en Vigueur les.réglemens
»ÿ anciens.
33 Quant à cê qui regarde, le temps de la cef-
33 fation des u fu r e s il y avoit bien eù- deà loix
33 qui avoient déterminé qu’ elles ne cputroient
33 plus lorfqu’elles- feroient montées au double du
33 principal; c’eft-à-dire, que le débiteur etoit
33 entièrement quitte envers fon créancier, lorfi-
i3 que l’intérêt payé en divers çemps failoit le
» double de l’argent emprunté. Cet ufage qui,
33 félon le témoignage de Diodore, étoit pratiqué
33 chez les égyptiens , fouflfroit chez les romains
33 deux exceptions qui le readoient prefqu’iKU-
33 "tile ; car il n’àvoit pas lieu lorfque le créancier
33 avoir reçu des gage-s , tant pour l’intérêt que
33 pour le principal. Il eft vrai qu’alors le eréan-
33 cier n’avoit pas aétion pour ce qui excédoit le
33vAouble du principal; mais il pouvoir retenir
» Le gage jufqu’ à concurreuce de fa valeur; cela
33 fuffifoit fans doute pour engager la plupart
'33 à ne vouloir prêter que fur gage. D’aillelirs
33 les ufures déjà'payées n’étoient pas comp.rifes
33 dans le double; du principal, mais celles uni-
.33 quement qui reftoient à payer ; de maniéré
>» q ue, pour décider fi l’ ufure de^voit encore
33 avoir cours, on ne compto-it pour rien ce
3d qui en avoit déjà été payé par le débiteur;
33 on examinoit feulement fi: ce qui lui reftpit
33. d ufure à acquitter étoit égal à la fomme prêtée.
33 Juftinien, pour prévenir ces abus, ordonna
33 que tous les- arrérages dus ou acquittés-entre-
3* roient en ligne de compte, & concourroient
33 à "former le double du principal p d’où il réful-
33 toit que lé : débiteur ne : dey oit plus rien,
»3 lorfque tous les paiemens.particuliers des ufuresa
r» j$its en dijféjrens temps 3 fprnWiéOt uoe fomna^
U S U
33 double de l’argent emprunté ( Cod. Juft. Lib. I V 3
' tit. 32 , leg. 10 b leg. 4 ; & Novel. i l ! & 1'30.
«c IL paroît ^cependant que la loi ne s etendoit
33 pas à l’argent'du fifc, ni a celui des cites. La ^
. 33 ville d’Aphfodîfe ( nôxis Atyÿoho-Uuv. ) avoit
33 prêté à de,s particuliers a un intérêt annuel fixe
3D par -la ftipulation ; Jes debiteurs., fondés ^ fur
33 les conftitutions impériales, fe;crurent entière-
>3 ment libérés lorfqu’jls eurent payé , en diffé-
33 rens temps , jufquam double dû principal. La
33 ville qui ne l’ entendoit pas- ainfi, confulta
33 l’empereur lui-même. Il répondit que les debi-
33 teurs étoient toujours tenus du paiement de
33 l’ intérêt convenu, Jufqu’ à ce qu’ils euffent
» rendu le principal; que fa loi ne regardoitque
» les banquiers, ou ceux qui faifoient commerce
33 de leur argent ( 'T^'î Jantrà;. ) ; 8c .qu après
» - tout j c’étoit moins , dans le cas préfent, une
>3 ufure qu’un reveuu annuel. A quoi il ajoutoit
» qu’il ne devoit pas avoir moins d’égard pour
33 d’argent des cités , que, pour celui du fifc
33 ( Novel 160 3 c. I. ) . Ge qui montre que cèux
33 qui empruntoient du fifc , ne jouiffoient pas du
» bénéfice dé la loi impériale, 8c qu’ ils étoient ;
33 tenus des ufures jufqu’à ce qmils euffent rendu
' »3 le principal. -,
33 Les grecs, dans le calcul des ufures, fuivirent
33 deux méthodes ; l’une relative à l’efpace d’un
. 33 an , l’autre à celui d’un mois. Les expreffions
. » fui van tes font du premier genre.
ce Tf»052 mrùiroç 3: c’ eft le tiers du principal par
as an, trente-trois drachmes 8c un tiers pour cent ;
»3 cq qui revient par mois à deux drachmes 8c
33 fept neuvièmes. Gronovius croit.' qu’on peut
33 rendre cette efpèce à3ufure en latin, par- bine
>3 c e n te f im e dodrantes ; ce, n’ eft pas èxaét : car
' 33 cette expreffion annonce deux drachmes , 8c.
33 trois quarts polir cent, par mois, il failoit
»9 dire : Bine centefime , dodrantes 3 bine fextule. -
33 Tôxoç ItptKTos, .c’eft le fixième annuel du prin-
33 cipal, feize drachmes 8c deux tiers par an
39 pour cent, ou une drachme 8c par mois.
33 Gronovius la rend en latin, par centeftme & trient
33 tes 3 & quuterne fextule , ce qui ©ft très-jufte ;
»3 car d’abord la centéfime donne une drachme
>3 par mois. La fextule eft le foixante-dôuzieme .33 de k centéfime’ confidérée comme un as à
33 douze onzes, 8c ,1a fextule eft le fixième de
30 l’once ; or f & —,.de drachmes font fice
Toko? È7rUtce.7r'\os, le.cûiquième annuel du prin-
3ï cipal’, ou vingt drachmes pour cent ; ce qui re-
- 33 vient par mois à une drachme C ’eft précifé-
3» ment ce que les latins difent centeftme beftes.
Ti%os iirôySods, le’ huitième annuel du prinu
x o 7^5
3» cipal, ou douze drachmes 8c un demi pour
>3 cent ; ce qui fait par mois une drachme & 3
33 centeftme femuncie. -
.33 Tôxos i.TnJ'tx.u.Teç 3 le dixième annuel du prin-
|§f cipàl , ou dix draçhmes pour c’eut & f f de
33 drachme par mois , ufure dcxtantesK,
3? Voici maintenant quelques expreffions du
33 fécond genre ; ,
cc Tôkos eV< JpdxpA, une drachme pour cent par
; » mois ;'c’ eft la centéfime ,- ixtirc^. '
cc TÔxos irri-Jycv 3 rpilri. 3 Bec. Jpoi:%p.eiîs , c’eft Le
» double , le triple , 8cc. de la centéfime. \
cc Tôxoç èir) ivvtct ôÇoAoTf, neuf oboles ou une
33 drachme & demie pour cent par mois ; c’ eft la
33 fefqui-centéfime.
. cc To’xo? tWi Urù oSoXoIs , -huit oboles par mois
, » pour cent drachmes , centeftme trientes. , parce
33 que fix oboles font la drachme, 8c deux oboles
39 le tiers.
cc t Ikos irivrt 'oZoxoïs, cinq oboles pour cent
.drachmes pat mois ; c’ eft Yufure dextantale.
cc t ôxos ix\ ticra) Jpet%uîjs, c’ eft: le fixième d’une
»3 drachme pour cent par mois, Se .deux drachmes
33 par an, üfur,e fextantes. Ainfi des autres »?* (Métrologie
de Pducton. ) _
UTÉRINE , déeffe qui préfidoit au vifeère qui
contient l’enfànt dans le fein ffe fa mère. On l’ in-
voquoit pour les accouchemens.
U T I nunc funt, ita fint , formule fynoriyme du
1 Statu quo des_modernes.
U T I ROGAS. Voyez U. T.
UTIQUE ( Uticenfe Julium-) , en Afrique.
M. MUN. JUL. UTICEN. Municipes mumcipft
Julii uiicenfts.
Ce municipe a fait frapper des médailles latines
en l’honneur de Tibère.
U TRIC ULARII. Voyei BASQUE.
U X EN TUM , dans la Calabre.
Pellerin a publié deux médailles autonomes
bronze, avec ce nom en lettres étrufques.
UXO R, la femme d’un mari 3 ab ungendo, parce
que la nouvelle mariée frottoit d’huile 8c de graiffe
de porc la porte ffe la maifon de foa époux avant
i que d’y entrer, croyant par-là détourner tous les
maléfices. Les filles des romaiiss devenoient femmes
de trois manières différentes, dont nous avons
| rendu ^compte à leurs articles,. Voy. U su s ,