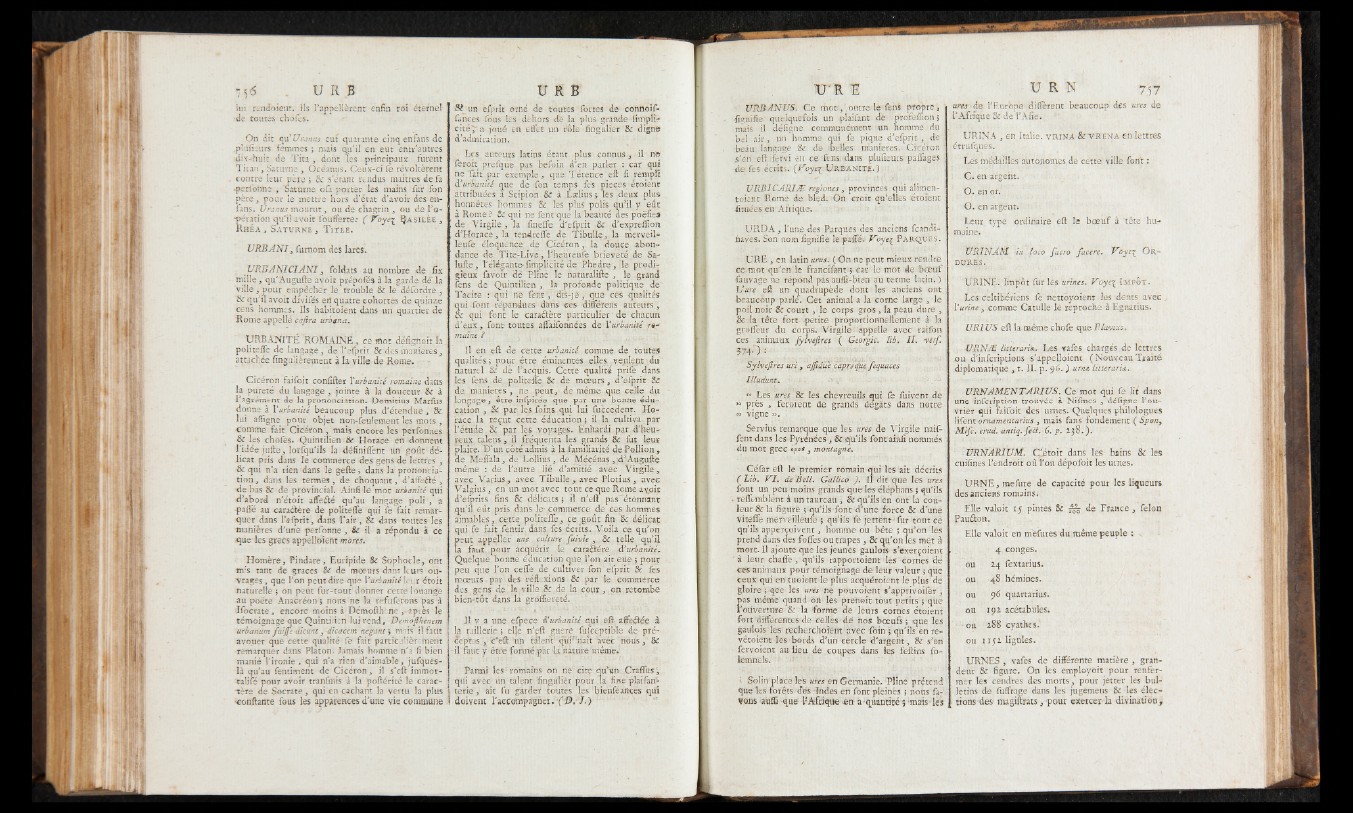
7 5 <5 U R B
lui rendaient. Ils l'appellèrent enfin roi éternel
•de toutes choies.
On dit qa'Uranus eut quarante cinq enfaris de
plufieurs femmes ; mais qu'il en eut entr'autres
dix-huit de Tita , dont les principaux furent
Titan, Saturne , Océanus. Ceux-ci fe révoltèrent
contre leur père ; 8c s'étant rendus maitres de fa
.perfonne , Saturne ofa porter les mains fur Ton
père, pour le mettre hors d'état d'avoir des en-
fans. Uranus mourut, ou de chagrin , ou de I'o-
•pération qu'il avoit loufrerte: ( T'oyez Qa s ilÉE ,
R héa , Saturne , T it ê e .
U RB AN1 , furnom des lares.
URBANICIANI3 foldats au nombre de fix
mille, qu'Augufte avoit pvépofes à la garde dé" la
ville ^ pour empêcher le trouble & le défordre 3
& qu'il avoit divifés erî quatre eohortès de quinze
cens hommes. Us habitoient dans un quartier de
Rome appellé cafira urbs.no..
URBANITÉ ROMAINE j ce mot dëfîgnoit la
politeffe de langage, de I'efprit & des maniérés,
attachée fingulièrement à la ville de Rome.
Cicéron faifoit confifter Yurbanité romaine dans
la pureté du langage , jointe à la douceur 8c à .
l'agrément de la prononciation. Domitius Marfus
donne à Yurbanité beaucoup plus d'étendue , &
lui affigne pour objet non-feulement les mots ,
comme fait Cicéron, mais encore les per fondes
& les chofes. Quintilien & Horace en donnent
l'idée jufte, lorfqu'ils la définiffent un goût délicat
pris dans le commerce des gens de lettres ,
& qui n'a rien dans le gefte, dans la prononciation
, dans les termes, de choquant, d'affedé , .
de bas & de provincial. Ainfi le mot urbanité qui
d'abord n'étoir affedé qu'au langage poli , a
-paffé au caradère de politeffe qui fe fait remarquer
dans l'efprit, dans l'a ir , & dans toutes les >
•manières d'une perfonne, & il a répondu à ce !
que les grecs appelloient mbrès.
Homère, Pindare, Euripide 8c Sophocle, ont
m:s tant de grâces & de moeurs dans kurs ou*-
orages, que l'on peutdire que Yurbanité leur étoit
naturelle ; on peut fur-tout'donner cette louange
au poète Anacréon 5 nous ne la rëfuferdtîs pas à
Ifocrate, encore moins à Démofthene ,• après le
témoignage que Quintilien lui rend, Demoftkenem
urbanum fuijje dicunt, dicacem negant 5 mais il faut j
avouer que cette qualité fe fait particulièrement
remarquer dans Platon. Jamais homme n'a fi bien
manié l'ironie, qui n’a rien d'aimable, jufquès-
là qu'au fentiment de Cicéron, il s’ eft immor-
-talifé pour avoir tranfmis à la poftérité le caractère
de Socrate, qui en cachant la vertu la plus
■ confiante fous les apparences d'une vie commune
U R B
Sè un efprit orné de toutes fortes de connoif-
fances fous les dehors de la plus grande fimpli—
crté-^ a joué en effet un Rôle fingulier & digne
d'admiration.
■ Les auteurs latins étant plus connus , il ne
feroit prefque pas béfoin d'en parler : car qui
ne Tait par exemple, que. Térence eft fi rempli
àYurbanité que de Ton temps fes pièces étoient
attribuées a Scipion & à Lælius ; les deux plus-
honnêtes hommes &_ les plus polis qu'il y eût
à Rome ? & qui ne fent que la beauté des poëfîes
de Virgile , la fineffe d'.efprit & d’expreffion
d'Horace, la tendreffe de Tibulle, la merveil-
leufe éloquence de Cicéron, la douce abondance
de Tite-Live, l'heureufe brièveté de Sa-
lufte , l'élégante- fimplicité de Phedre, le prodigieux
favoir de Plinè le naturalifte , le grand
fens de Quintilien ,. la profonde politique de'
Tacite : qui né fént , dis^je’ ,- que ces qualités
qui font répandues dans ces dittérens auteurs ,
& qui font le caradère particulier1 de chacun
; d'eux , font toutes affaxfonnées de Yurbanité romaine
? ; r
Il en eft de cette urbanité comme de toutes
qualités ; pour, être éminentes elles vejalept; du ‘
naturel 8c de l'acquis. Cette qualité prifè dans
les fens de politeffe & de moeurs, d'efprit &
de maniérés , ne peut, de même que celle du
langage, être infpirée que par une bonne éducation
, & par les foins qui lui fuccedent. Horace
la rjsçut cette éducation 5 il la cultiva par
l'étude. & par les voyages. Enhardi par d'heureux
talens, il fréquenta les grands & fut leur
plaire. D'un côté admis, à la familiarité de Pollion,
de Meffala, de Lollius, de Mécénas, ;d'Augufte
même : de l'autre lié d'amitié avec Virgile ,
avec Va ri us., avec Tibulle,. avec Plotius , avec
Valgius, en'un mot avec tout ce que Rome aypit
d'efprits fins & délicats ; il n'eft pas'étônnTtnt
qu'il eût pris dans le- commerce de ces hommes
aimables, cette politeffe., ce goût fin & délicat
qui fe fait fentir dans, fes écrits. Voila,.ce qu'on
peut' appeller une culture fuivie , , & . telle qu'il
ta faut pour acquérir le caradère & urbanité.
Quelque bonne éducation que l'on ait eue j pour
peu que l’on ceffe de cultiver fon efprit & fes
moeurs. par des réflexions 8c par le commerce
des gens de la ville.&.de la cour, on:retombe
bîen-tôt dans la groffiereté.
11 y a une efpece & urbanité qui eft- affectée à
la raillerie ; elle n'eft guère TuÇceptible de préceptes
V ë'èft un talent qtiif!tlaît avéc nous , &
il faut y être formé par 4a niture même.
Parmi les: romains on ne cité qu’un Craffus^
qui avec un talent ftngiiliêr pour .îa fine plaifan*
terie, ait fti garder foutes les fyienféances qui
doivent l'accompagner* (kEV J. )
V R E
URB ANUS. Ce mot , ’.outre le fens propre, i
•fianifie quelquefois un .plaifant de pïofeflion ;
mais il défigne communément un homme du ,
bel air, un homme qui fe pique d'efprit, de.
•beau langage .& de .'belles manières. Cieéton j
s'én eft.Tervi en-ce Te ns. dans plufieuis paffages
de; Tes écrits a (Roye% Ur banité.) , •
URBICARIÆ regioncs, provinces qui alimen- j
toient Rome de bled; On croit qu'elles étoient !
ütuées en Afrique. ' :
UR.DA, l'une des Parques des anciens feandi-
haves. Son nom fignifiè le paffé. Voye| Parqu e s .
URE , en latin urus. ( On,ne peut mieux rendre
ce. mot -qu'enTe francifant-; car le mot de boeuf
•fauvage ne répond pas auffi-bien au terme latin. ) i
JJure eft un quadrupède dont les anciens ont
beaucoup parle. Cet animal a la corne large , le
poil noir & cou rt, le corps gros, la peau dure ,
& la tête fort -petite proportionnellement à la
groifeur du corps; Virgile appelle avec raifon
ces animaux fylvefires ( Géorgie, lib. II. verf.
? 74- > ;
Sylvefirès uri 3 ajjidüe caprj que fequaces
Illudunt.
« Les tires & les chevreuils qui fe fuivent de
>» près , ’ fer oient de grands dégâts dans notre
» vigne ».
Servîus remarque que les ures de Virgile naif-
fent dans les-Pyrénées, &. qu'ils font ainfi'nommés
du mot grec opot, montagne.
Céfar eft le premier romain qui lés ait décrits
( Lib. VI. de Bell. Gallico Il dit que les ures
fent un peu moins grands que! les éléphans j qu'ils
reffemblent à un taureau, & qu'ils !én ont' la couleur
& la figuré 5 qu'ils font d'une force 8c d’une
viteffe merveilleufe j qu’ils1 Te jettent- fur tout ce
qu'ils apperçoivent, homme ou bête ; qu'on lés
prend dans des foffes ou trapes , & qu'on les met à
mort. Il ajoute que lés jeunes gaulois s'exerçoient
à leur enaffe, qu'ils rapportoient ‘lès cornés 'dé
ces animaux pour témoignage de leur Valeur j que
ceux qui en tueient le plus acquéroient le plus de
gloire j-qëe les ures ne pouvoient s'apprivoifer,
f-as même quand Ôrt les prenoit tout petits }‘que
ouverture & la forme de leurs cornes étoient
for t‘différentes'de celles-dé nos boeufs; que les
gaülqis les recherchoî‘ent; avec foin ; qu'ils en re-
vêtoient les bords d'un eërcle d'argent , & s'ën
fervoient au lieu de coupes dans les feftins fo-
îemnels. ■
« Solin place les ures en Germanie. ‘Pline prétend'
que les forêts dés Indes eri font plèinès ; nous fa-1
vons aûflî -que i3Afrique à-quantité 3 ‘mais-lès
U R N 757
ures dre l'Eurôpè diffèrent, beaucoup des ures de
l'Afrique & de l’Afie. .
URINA , en.Italie. vrina & vrena enlettres
étrufques.
Les médailles autonomes.de cette ville font :
C . en argent.
O. en or.
O. en argent;
Leur typé ordinaire eft le boeuf à tête humaine.
URINAM in ,loco facro facere. Voye£ ORDURES.
URINE. Impôt fur les urines. Voye£ Impôt.
Les celtibériens fe nettôyoient les dents avec ^
Y urine , .comme Catulle le reproche à Egnatius.
UR1US eft ta même chofe que Rlmius.
U-RNÆ litterarii. Les vafes chargés, de lettres
ou d'inferiptions s'appelloient ( Nouveau Tarait©
diplomatique , t. IL p. 96. ) urn& Huer aria.
URNAMENTARIUS. Ce mot qui fe lit dans
une infeription trouvée à Nifmes , défigne l'ouvrier
qui faifoit des urnes. Quelques philologues
lifent ornamentarius , mais fans fondement ( Spon3
Mifc. erud. antiq. fe f t . 6. p. 238. ).
URNÂRIUM. C^étoit dans les bains & les
cuifines l'endroit où Ton dépofoit les urnes.
• U RN E , mefure de capacité pour les liqueurs
des anciens romains.
Elle valoit 15 pintes & ^ de France, félon
Paudon.
Elle valoit en mèfures du même peuple ; .
4 conges,
ou 24 fextarius.
ou 48 hémines.
ou 5)6 quartarius.
ou 192. acétabules.
ou 288 cyathes.
ou i i j 2 ligules.
URNES, vafes de différente matière, gran-
! deùr & figure. On les employoit pour renfer-
1 mer les cendres des morts, pour jetter les bulletins
de luffrage dans les jugemens & les élec-
tions des magiftrats, pour exercer la divination,