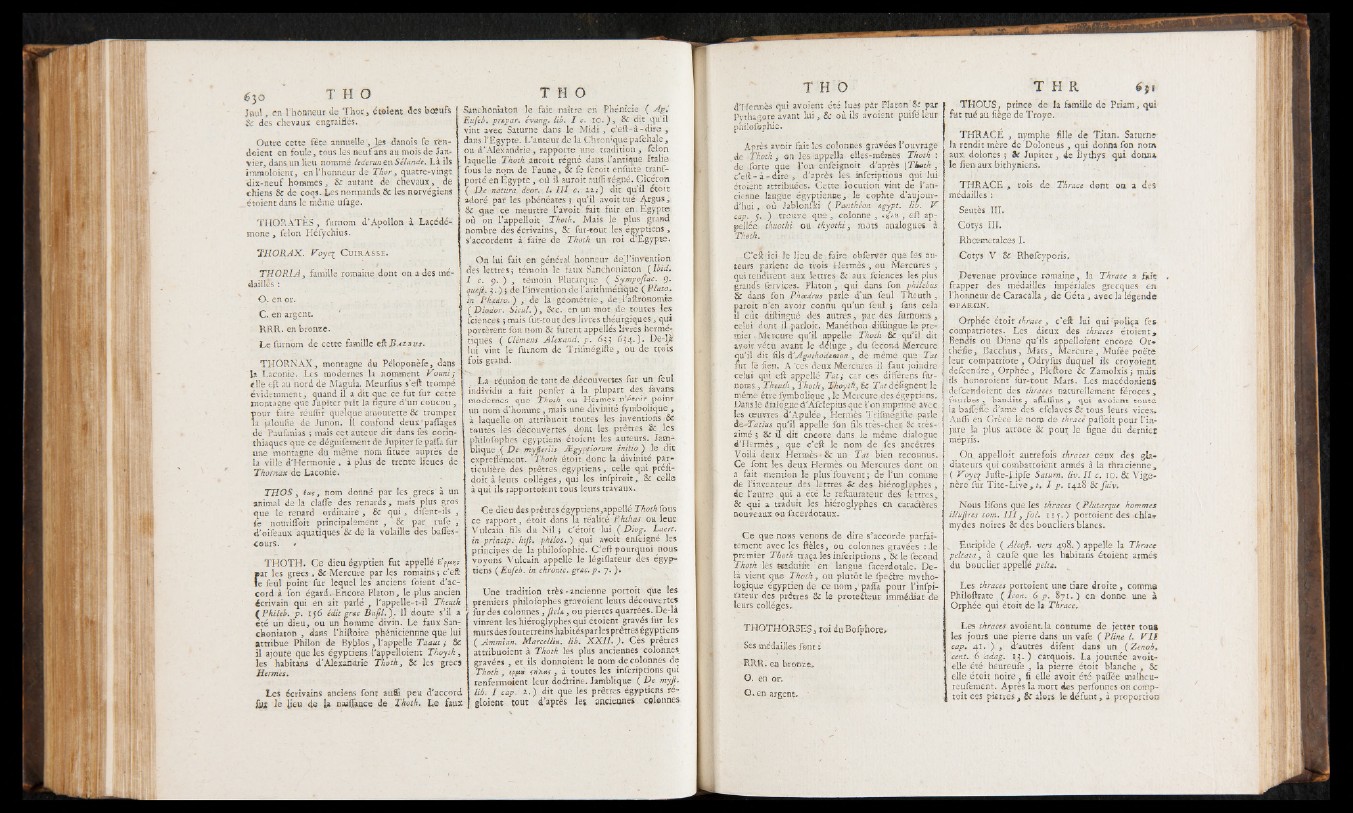
é 3o T H O
jau l, en l’honneur de Thor, étaient des boeufs
3c des chevaux engraiâès. - '
Outre celte fête annuelle , Je? danois fe rfen-
doient en foule , tous les neuf ans au mois de Janvier,
dans, un lieii nommé lederun en Sélande. La ils
immoloiènt, en l’honneur de Thor,3 quatre-vingt,
dix-neuf hommes, 8c autant de chevaux, de
chiens 8c de coqs. Les normands. 8c les norvégiens
„.étaient dans le même ufage.
THOR.ATÈS, furnom d’Apollon à Lacédémone
, félon Héfychius.
THORAX. Voyez Cuirasse.
TH O R I A 3 famille romaine dont on a des médailles
:
O. en or.
C. en argent. '
RRR. en bronze.
Le furnom de cette famille eftBalbvs.
THORNAX, montagne du Péloponèfe, dans
la Laconie. Les modernes la nomment Vouai;
elle ejl au nord de Magula. Meurlius s’eft trompé
évidemment , quand il a dit que ce fut. fut cette
montagne que Jupiter prit la figure d’un coucou,
pour faire réuflir quelque amourette 8c tromper
la jaloufie de Junon. 11 confond deux’paffages
de Paufanias ; mais cet auteur dit dans fes eorin-
thiaques que ce déguifement de Jupiter fe palïa fur
une montagne du même nom fituée auprès de
la ville d’Hermonie, à plus de trente lieues de
Thomax de Laconie.
THOS 3 èas, nom donné par les grecs à un
animal delà claffe des renards, mais plus gros
que le renard ordinaire , 8c qui, difent-ils ,
fe nouriffoit principalement , 8c par. rufe ,
d’oifeaux aquatiques-8c de la volaille des baffes-
cours. *
THOTH. Ce dieu égyptien fut appelle Ép/ws
par les grecs, 8c Mercure par les romains ; c’eft
le feul point fur lequel les anciens foient d’accord
à fon égard. Encore Platon, le plus ancien
écrivain qui en ait parlé , l’appelle-t-il Theuth
/ Phileb. p. I j 6 édit grAC B a f l .). Il doute s’il a
été un dieu, ou un nomme divin. Le faux San-
choniaton , dans l’hiftoire phénieiennne que lui
attribue Philon de Byblos , L’appelle Taaut ; 8c
il ajoute que les égyptiens /l’âppelloient Thoyth,
les habitans d’Alexandrie Thoth, 8c les grecs
Hernies.
Les écrivains anciens font auf£ peu d’accord
le heu de la naiflauce de Thoth. Le faux
T H O
SanchOniatoft le fait naître en Phénicie ( Apf
Eufeb. prApar. évang. lié. I c. 10. ) , 8c dit qu’il
vint avec Saturne dans le Midi, c-’eft-à-dire,
dans l’Egypte. L’auteur de la Chronique pafchale ,
ou d’Alexandrie, rapporte une. tradition , félon
laquelle .Thoth .aaroit régné dans l’antique Italie
fous le nom de Faune, 8c le feroit enfiute trànf-
porté en Égypte, où il auroit auflî régné. Cicéron
( De natura, de or. I. I I I c. 2 i . ) dit qu’il étoit
adoré par les phénéates ; qu’il avoittué Argus;
8c que ce meurtre l’avait fait fuir en. Égypt-e
où on l’appelloit Thoth. Mais le plus grand
nombre des écrivains, 8c fur-tout les égyptiens ,
s’accordent à faire de Thoth un roi d’Egypte.
On lui fait en général honneur de'l’invèntion
! des lettres; témoin le faux Sançhoniaton {Ibid.
1 c. 9 . ) , témoin Plutarque ( Sympofiac. 9.
' quefi. 3. ) ; de l’invention de l’arithmétique ( Flato.
in Ph&dro. ) , de la géométrie, de l’aftrônomie
( Di&dor. Sicul. ) , &c. en un mot- de toutes les
fcienc.es ; mais fur-tout de» livres théurgiques , qui
portèrent fon nom 8c furent appelles livres. hermétiques
{ Çlémens Alexand. p. 6 33 634. ). De-ljc
LLiu vint le furnom de Trifmégiifte, ou de trois
fois gFand,.
La réunion de tant.de découvertes fur un feul
individu a fait penfer à la plupart, des favans
modernes que Thoth ou Hermes n’etoit point
un nom d’homme, mais une divinité fymbolique ,
à laquelle on attribuoit toutes les inventions 8c
toutes des découvertes dont les prêtres 8c, les
philofophes égyptiens étoient les auteurs. Jam-
blique ( De myfieriis Ægyptiorum inilio ) le dit
expreffément. Thoth était donc la divinité particulière
des prêtres égyptiens', celle qui préfî-
doit à leurs collèges, qui les infpiroit, & celle
à qui ils rapportoient tous leurs travaux.
Ce dieu des prêtres égyptiens,appellé TAoM fous
ce rapport, étoit dans la réalité. P.hthas ou leur
Vulcain fils du Nil ; c’étoit lui {-Diog. Laert.
in princip. hfl. philos.) qui avoit enfeigné les
principes de la philofophie. C’eft pourquoi nous
voyons Vulcain appellé le légiflateur aes égÿp^
tiens {Eufeb. in chronic. grAC, p. 7. ).
Une tradition très * ancienne portait que les
premiers philofophes gravoient leurs découvertes
fur des colonnes , fleU, ou pierres quarrées. De-là
vinrent les hiéroglyphes qui étoient gravés fur les
murs des fouterreins habités par les prêtres égyptiens
(_ Ammia'n. Marcellin, lib. XXII. ) . Cés pretres
attribuoient à Thoth lés plus anciennes colonnes,
gravées , et ils donnoient le nom de colonnes de
Thoth y tppté çtixtts 3 g toutes les infcriptions qui
renfermaient leur do&rine. Jamblique ( De myjl.
lib. I cap; 2 .) dit que les prêtres égyptiens ré-
gloient tout d’apres le* anciennes colonnes
T H O
d’I-îermès qui avoient été lues pâr Platon & par
Pythagore avant lu i, 8c où ils avoient puifé leur
philofophie.
Après avoir fait les colonnes gravées l’ouvrage
de Thoth $ on les iappeUa elles-mêmes Thoth :
de >forte que l’on enfeignoit d’après \Tlmth ,
c’eft - à - dire , d’après les infcriptions qui lui
étoient attribuées. Cette locution vint de l’ancienne
langue égyptienne, le cophte .d’aujourd’hui
, où Jablonfki ( Panthéon Agypt. lib. V
cap. ÿ.. ) trouve que, colonne , « f/n , eft ap-
pellée thuothi ou tkyothi 3 mots analogues à
Thoth.
. C’eft [ici le lieu de , faire obferver que les auteurs
parlent de trois Hermès, ou Mercures ,
qui rendirent aux lettres 8c aux fciencès les plus
grands ferviçes. Platon , qui dans fon pki le b us
& dans fon Phoedrus parle d’ un feul Theuth,.
paroît n’en avoir connu qu’un feul ; fans cela
il eut diftingùé des autres, par des furnoms.,
celui dont il parloir. Manéthon diftingue le premier
. Me retire qu’il appelle Thoth & - qu’il dit
avoir vécu avant le déluge , du fécond Mercure
?u’ii dit fils daAgathod&man , de même que Tat
ut lé lien. A 'ces deux Mercures i l faut joindre
celui qui eft appellé Tat; car cés différens für-
noras, Theuth > Thoth, Thoyth, ëc Tat désignent le
même être fymbolique , le Mercure des égyptiens.
Dans le dialogue d’Afciepius que l’on imprime avec
les oeuvres 4’Apulée, Hermès Trifmegifte parle
Âe^Tatius qu’il appelle fon fils très-cher 8c très-1
aimé ; & il dit encore dans le même dialogue
d’Hermès, que c’eft le nom de fes ancêtres
Voilà deux Hermès - & un Tat bien reconnus.
Ce font les deux Hermès, ou Mercures dont on
a fait mention le plus fou vent; de l’un comme
de l’inventeur des lettres Sc des hiéroglyphes ,
de l’antre qui a été le réftauratetir des lettres>
8c qui a traduit les hiéroglyphes en caractères
nouveaux ou facerdotaux.
Ce que nous venons de dire s’accorde parfaitement
avec les ftèles, ou colonnes gravées : .le
premier Thoth traça les infcriptions , 8c le fécond
Thoth les etaduifk en langue facerdotale. Delà
vient que Thoth y ou plutôt le fpeétre mythologique
égyptien de ce nom Û paffa pour l’infpi-
tateur des prêtres 8c le protecteur immédiat de
leurs collèges► .
THOTHORSES, roi du Bofphorç^
Ses médailles font i
RRR: en bronze.
O. en or.
O.en argent, \
T H R
THOUS, prince de la fi»mille de Priant, qui
fut tué au fiege de Troye.
THRACÉ , nymphe fille de Titan. Saturne
la rendit mère de Doloneus , qui donna fon nom
aux dolones ; & Jupiter, de Bythys qui donna
le fien aux bithyniens.
THR ACE., rois de Thrace dont on a des
médailles :
Seutès III.
Cotys III.
Rhoemetalees I.
Cotys V 8c Rhefcyporis, •
Devenue province romaine, la Thrace a fi.it ,
frapper des médailles impériales grecques en
l’honneur de Caracalla > de Géta, avec la légende
©PAKC2N.
Orphée étoi t thrace 3 c’efi: lui qui -poliça fes
compatriotes. Les dieux des thraces étoient,
Bendis ou Diane qu’ils appelaient encore Or*
théfie, Bacchus, Mars, Mercure, Mufée poète
leur compatriote , Odryfus duquel ils croyoient
defeendre, Orphée, Pleiüore 8c Zamolxis ; mais
ils honoroient fur-tout Mars. Les macédoniens
defcéndoient des thraees naturellement féroces,
fourbes, bandits, affiiflîns , qui avoient toute
ia baffèfie d’ame des efclaves: 8c tous leurs vices»
Àuffi en Grèce le nom de thrace pafîoit pour l’injure
la. plus atroce 8c pour le figne du dernier
mépris.
On. appelloit autrefois thraces ceux des gladiateurs
qui combattoierit armés à la thracienne,
( Voyez Jufte-Lipfe Satum. Liv. I I c. 10. 8c Vige-
nère fur Tite-Live, r, I p. 1428 8c fuiv.
Nous liions que les thraces ( Plutarque hommes
ïllufires tom. I I I , fol,, i iy .) portaient des chia*
mydes noires 8c des boucliers blancs.
K Euripide ( Alceji. vers 498. ) appelle la Thrace
peltata, à caufè que les habitans étoient armés
du bouclier appellé pelts.
Les thraces portaient une tiare droite , comma
Philoftrate ( Icon. 6 p. 8 7 1 .) en donne une à
Orphée qui étoit de la Thrace.
Les thraces avoient. la coutume de jetter tout
les jours une pierre dans un vafe ( Pline l. V i l
cap. 41. y 3 d’autres difent dans un ( Zenob,
cent. 6 adag. 13. ) carquois. La journée avoit-
elle été heureuie , la pierre étoit blanche , 8c
elle étoit noire, fi elle avoit été paiTée mâlheu-
reufement. Après la mort des perfonnes on comptait
ces pierres, 8c alors le défunt, à proportion