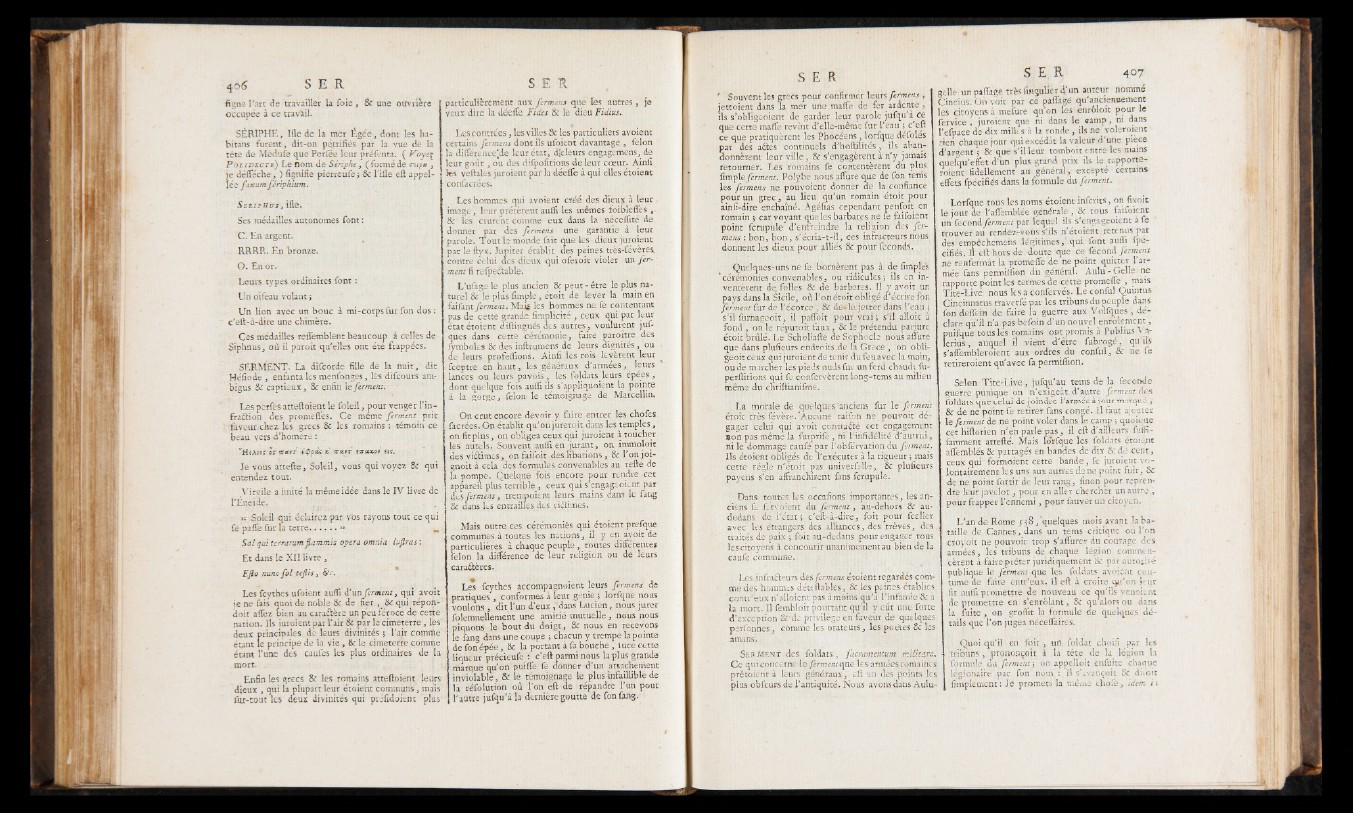
40(S S E R
figue l'art de travailler la fo ie , & une ouvrière
occupée à ce travail.
SÉRIPHE, Ifle de la mer Égée, dont les ha-
bitans furent, dit-on pétrifiés par la vue de la
tète de Médufe que Perfée leur préfenta. ( Voye^
P o l id s c t s ) Le nom de Séripke, (forméde ntp» ,
je défleche, ) fignifie pierreufe 5 & Tille eft appel-
lé e faxum fériphium.
S eriphus, ifle.
Ses médailles autonomes font :
C. En argent.
RRRR. En bronze.
O. En or.
Leurs types ordinaires font :
Un oifeau volant>
Un lion avec un bouc à mi-corps fur fon dos :
c'eft-à-dire une chimère.
Ces médailles reiTemblent beaucoup à cellès de
Siphnus, où il paroît qu'elles ont été frappées.
SERMENT. La difcorde fille de la nuit, dit
Héfiode , enfanta les menfonges, lës difcours ambigus
8c captieux, & enfin le ferment. -
Les perfes atteftoient le foleil, pour venger Tin-
fraélion des promelfes. Ce même ferment prit
faveur,chez les grecs & les romains : témoin ce
beau vers d’homere : _ -
wHtA«o? os 'Jtu.tr tÇpas k •jtot.tr vjrctKOt us.
Je vous attefte, Soleil, vous qui voyez & qui
entendez tout.
Virgile a imité la même idée dans le IV livre de
l'Enéide. ;; - ,
« Soleil qui éclairez par vos rayons tout ce qui
fé paffe fur la terre., . . . . »
Sol qui terrarum flammis opéra omnia, lufiras ï
Et dans le XII livre,
Efio nunc fo l te f i s , &c.
Les feythes ufoient aufli d’un ferment, qui avoit
je ne fais quoi de noble & de .fier , & qui répon-
doit affez bien au caractère un peu féroce de cette
nation. Ils juroientpar l’ air & par le cimeterre, lés"
deux principales de leurs divinités 5 l'air comme
étant le principe de la v ie , & le cimeterre comme
étant Tune des caufes les plus ordinaires de la
mort.
Enfin les grecs 8c les romains atteftoient leurs
dieux , qui la plupart leur étoient communs, mais
fur-tout les deux divinités qui prifid oient plus
S E R
particulièrement aux fermens que les autres, je
veux dire la déelfe Fides 8c le dieu Fidius.
Les contrées, les villes & les particuliers avoient
certains fermens dont ils ufoient davantage , félon
la différence'de leur état, dfeleurs engagemens, de
leur g o û t, ou des difpofitions de leur coeur. Ainfi
les veftales juroient par la déeife à qui elles étoient
confacrées.
Les hommes qui avoient créé des dieux à leur .
image, leur prêtèrent aufli les mêmes foibleffes ,
8c les crurent comme eux dans la néceflité de
donner par des fermens une garantie à leur
parole. Tout le monde fait que les dieux juroient
! par le ftyx. Jupiter établit des peines très-févères.
i contre celui des dieux qui oferoit violer un ferment
fi refpeétable.
L’ufage le plus ancien & peut - être le plus naturel
8c le plus fimple, étoit de lever la main en
fàifant ferment. Mais les hommes ne fe contentant
pas de cette grande fimplicité , ceux qui par leur
état étoient diftingués des autres, voulurent juf-
ques dans cette cérémonie, faire paroître des
fymboles 8c des inftrumens de leurs dignités, ou
de leurs profeflions. Ainfi les rois levèrent leur
feeptre en haut, les généraux d’armées, leurs
lances ou leurs pavois, les foldats-leurs épées,
dont quelque fois aufli ils s’appliquoient la pointe
à la gorge, félon- le témoignage de Marcellin.
On crut encore devoir y faire entrer les chofes
facrées.On établit qu’ on jureroit dans les temples ,
on fit plus, on obligea ceux qui juroient à toucher
les autels. Souvent aufli en jurant, on immoloit
des victimes, on faifoit des libations, & l’onjoi-
gnoit à cela des formules convenables au refte de
la pompe. Quelque fois encore pour rendre cet
appareil plus terrible , ceux qui s’engageaient par
des fermens, trempoie nt leurs mains dans le fang
& dans les entrailles, des victimes.
Mais outre ces cérémoniès qui étoient prefque
communes à toutes les nations, il y en avoit de
particulières à chaque peuple, toutes différentes
félon la différence de leur religion ou dé leurs
caractères.
Les feythes accompagnoient leurs fermens de
pratiques , conformes à leur génie > lorfqüe nous
voulons , dit l’un d’eux, dans Lucien, nous jurer
folemnellement une amitié mutuelle, nous nous
piquons le bout du doigt, 8c nous en recevons
le fang dans une coupe } chacun y trempe la pointe
de fon épée, Ôc la portant à fa bouche, luce cette
liqueur précieufe : c’eft parmi nous la plus grande
marque qu’on puifle fe donner d’un attachement
inviolable, 8c le témoignage le plus infaillible de
la réfolution où fon eft de répandre l'un pour
l’autre jufqu’ à la dernière goutte de fon fang.
r Souvent les grecs pour confirmer leurs fermens,
jettoient dans la mer une malle de fer ardente,
ils s’obligeoient de garder leur parole jufqu’à ce
que cette maffe revînt d’ elle-même fur l’eau ; c’ eft
ce que pratiquèrent les Phocéens, lorfque defoles
par des aétes continuels d’ hoftilités, ils abandonnèrent
leur ville, & s’engagèrent.à n’y jamais
retourner. Les romains fe contentèrent du plus
fimple ferment. Poly be nous affure que de fon térns
les fermens ne pouvoient donner de la confiance
pour un grec, au lieu qu’ un romain étoit pour
ainfi-dire enchaîné. Agéuas cependant penfoit en
romain >■ car voyant que les barbares ne le faifoient
point fcrupule d’enfreindre la religion des fermens
: bon, bon, s’ëcria-t-il, ces infracteurs nous
donnent les dieux pour alliés 8c pour féconds.
Quelques-uns ne fe bornèrent pas à de fimple's
'cérémonies convenables, ou ridicules} ils en inventèrent
de, folles & de barbares. Il y avoit un
pays dans la Sicile, où Ton étoit obligé d’ écrire fon
ferment fur de Tecor.ce . 8c de* le. jetter dans T eau ;
s’ il furnageoit, il pafloit pour vrai ; s’il allojt à
fond , on le réputoit faux, & le prétendu parjure
étoit brûlé. Le Scholiafte de Sophocle nous aflure
que dans plufieurs endroits.de la Grecé , on obli-
geoit ceux qui juroient de tenir du feu avec la main,
ou de marcher les pieds nuds fur un fefd chaud} fu-
perftitions qui fe confervèrent long-tems au milieu
même du cnriftianifme.
La morale de quelques'anciens fur le ferment
étoit très févère. Aucune raifon ne pouvoit dégager
celui qui avoit contracté cet engagement
Bon pas même la furprife, ni l’ infidélité d’ autrui,
ni le dommage caufé par l’obfèrvation du ferment.
Ils étoient obligés de l’exécuter à la rigueur ; mais
cette régie n’ étoit pas univerfelle, 8c plufieurs
payens s’en affranchirent fans fcrupule.
Dans toutes les occafions importantes, les anciens
fe fervoient du ferment, au-dehors 8c au- j
dedans de. l’état} c’eft-à-dire, foit pour fceîier
avec les étrangers des alliances, des trêves, des.
traités de paix 5 foit au-dedans pour engager tous
les citoyens à concourir unanimement au bien de la
caufe commune.
Les infraéteurs des fermens étoient regardés comme
des hommes déteftables, 8c les peines établies
contr’èux n’alloient pas à moins qu’ à l ’infamie & à
la mort. Il fembloit pourtant qu’ il y eût une forte
d’exception & ’de .privilège en faveur de quelques
perfonnes, comme les orateurs, les poètes 8c les
amans.
S e r m e n t des foldats, facramentum ndlitare.
Ce qui concerne le ferment que les armées romaines
prêtoient à leurs généraux, eft un des points les
plus obfcurs de l’antiquité. Nous avons dans Aulugelle
un paflage très fingulier d un auteur nommé
Cincius. On voit par ce paffagé qu’anciennement
les citoyens à mefure qu’on les enroloit pour le
fervice ,■ juroient que ni dans le «amp, ni dans
Tefpace de dix milles à la ronde, ils ne voleroient •
rien chaque jour qui excédât la valeur d’une pièce
d’argent} 8c que s’ il leur tomboit entre les mains
quelqu’effet d’un plus grand prix ils le rapporte-
roient fidellement au général-, excepte certains
effets fpécifiés dans la formule du ferment.
Lorfque tous les noms étoient inferits, on fixoit
le jour de Taffemblée générale , 8c tous faifoient
un fécond ferment par lequel ils s’engageoient à fe '
trouver au rendez--voUs s’ ils n etoient retenus par
des empêchemehs .légitimes,'qui font aufli fpe-
cifiés, li eft hors de doute que ce fécond ferment
ne renfermât la promeffe de ne point quitter 1 armée
fans permiflion du général. Aulu-Celle ne
rapporte point les termes de cette promeffe , mais
Tite-Live nous les a confervés. Le conful Quintus
Gincinnatus traverfépar les tribuns du peuple dans
fon deffem de faire la guerre aux Volf^ues, déclare
qu’ il n’a pas bèfoin d’un nouvel enrôlement,
puifque tous les romains ont promis à Publius Va-
lerius, auquel il vient d’être fubrogé, qu’ ils
s’affembleroient aux ordres du conful, & ne fe
retireroient qu’avec fa permiflion.
Selon Tite-Live , jufqu’ au tems de la fécondé
guerre punique on n’exigeât d'autre ferment des
foldats que celui de joindre l’armée à jour marqué,
8c de ne point fe retirer fans congé. Il faut ajouter
le ferment de ne point voler dans le camp } quoique
cet hiftorien n’ en parle pas, il eft d’ailleurs fuifi-
famment attefté. Mais lorfque les foldats étoient
affemblés & partagés en bandes de dix & d e cent,
ceux qui formaient cette bande, fe juroient volontairement
les uns aux autres de ne point fuir, 8c
de ne point fortir de leur rang, linon pour reprendre
leur javelot , pour en aller .chercher un autre ,
pour frapper l ’ennemi, pour fauver un citoyen.
L’ an de Rome '538 /quelques mois avant la bataille
de Cannes, dans un tems critique où Ton
croyoit ne pouvoir trop s’affurer du courage des
armées, les tribuns de chaque légion commencèrent
à faire prêter juridiquement & par autorisé
publique le ferment que les foldats avoient coutume
de faire entr’eux. Il eft à croire qu’ on kur
fit aufli promettre de nouveau ce qu’ ils venoient
de promettre en s’enrôlant, & qu’alorsou dans
la fuite, on groffit la formule -de quelques détails
que Ton jugea néceffaires.
Quoi qu’il en foit , ml foldat choifi par les
tribuns , prononçoit à la tête de la légion la
formule du ferment • ,on appelloit enfuite chaque
légionaire par fon nom : Il s’avançoit & difoit
Amplement : Je promets la même chofe, idem i 1