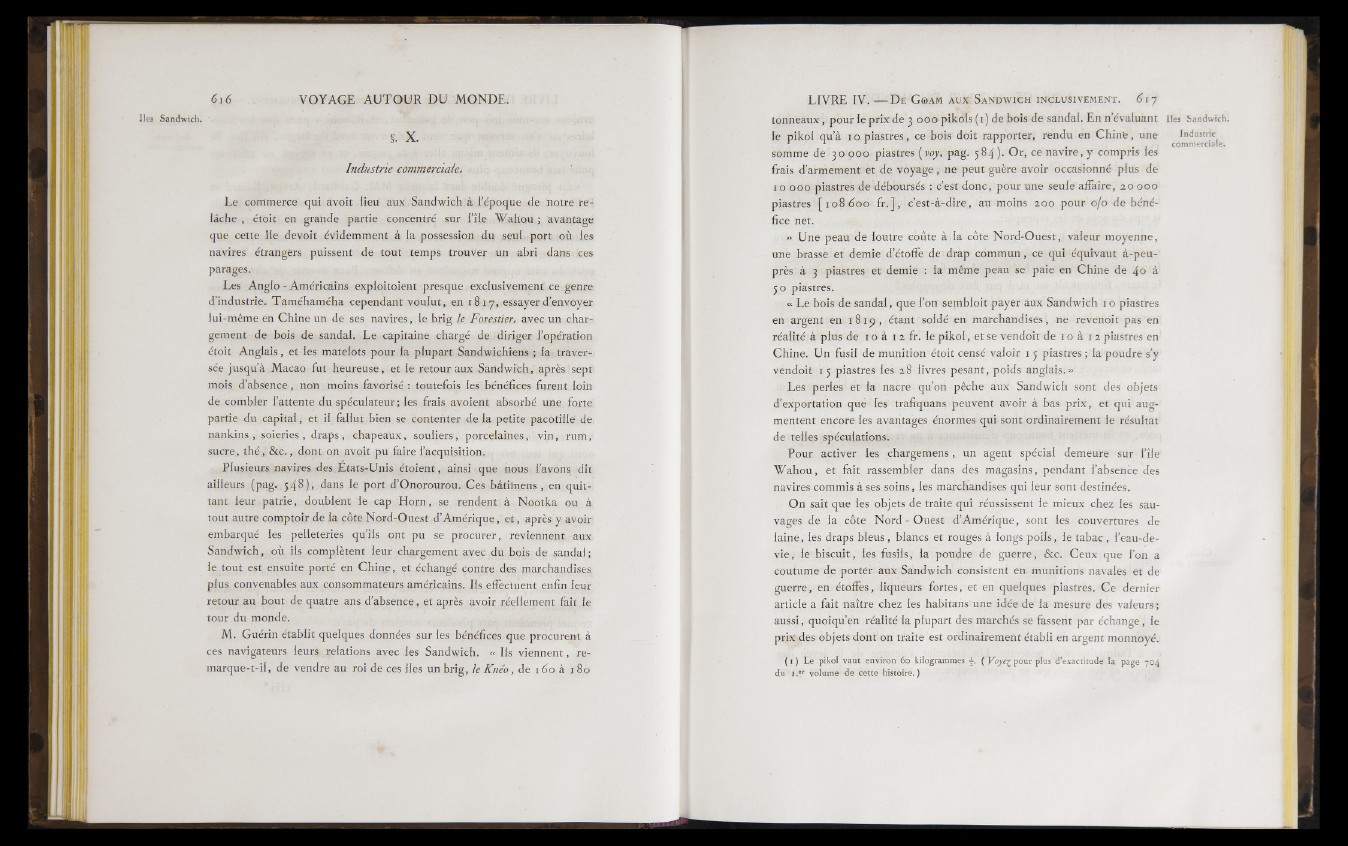
iii'
i 'liî
I '14 ■ ■
::i j.
HI
lies S andw ich.
>'!S
Ii
:ii
’ ! î
ili
j
’4
ill
§. X.
Industrie commerciale.
Le commerce qui avoit lieu aux Sandwich à l’époque de notre relâche
, étoit en grande partie concentré sur l’île Wahou ; avantage
que cette île devoit évidemment à la possession du seul port où les
navires étrangers puissent de tout temps trouver un abri dans ces
parages.
Les Anglo - Américains exploitoient presque exclusivement ce genre
d’industrie. Taméhaméha cependant voulut, en 1817, essayer d’envoyer
lui-même en Chine un de ses navires, le brig le Forestier, avec un chargement
de bois de sandal. Le capitaine chargé de diriger l’opération
étoit Anglais, et les matelots pour la plupart Sandwichiens ; la traversée
jusqu’à Macao fut heureuse, et le retour aux Sandwich, après sept
mois d’absence , non moins favorisé : toutefois ies bénéfices furent loin
de combler l’attente du spéculateur; les frais avoient absorbé une forte
partie du capital, et il fallut bien se contenter de la petite pacotille de
nankins, soieries, draps, chapeaux, souliers, porcelaines, vin, rum,
sucre, thé, & c., dont on avoit pu faire l’acquisition.
Plusiem-s navires des Etats-Unis étoient, ainsi que nous l’avons dit
ailleurs (pag. 548). dans le port d’Onorourou. Ces bâtimens, en quittant
leur patrie, doublent le cap Horn, se rendent à Nootka ou à
tout autre comptoir de la côte Nord-Ouest d’Amérique, et, après y avoir
embarqué les peileteries qu’ils ont pu se procurer, reviennent aux
Sandwich, où iis complètent leur chargement avec du bois de sandal;
le tout est ensuite porté en Chine, et échangé contre des marchandises
plus convenables aux consommateurs américains. Iis effectuent enfin ieur
retour au bout de quatre ans d’absence, et après avoir réellement fait le
tour du monde.
M. Guérin établit quelques données sur les bénéfices que procurent à
ces navigateurs leurs relations avec les Sandwich. « Ils viennent, re-
marque-t-il, de vendre au roi de ces îles un brig, le Kne'o, de i ¿0 à i 80
LIVRE IV. — D e G o a m a u x S a n d a v i c h i n c l u s i v e m e n t . ¿ 1 7
tonneaux, pour le prix de 3 000 pikols (1) de bois de sandal. En n’évaluant île s San dw ich,
le pikol qu’à 10 piastres, ce bois doit rapporter, rendu en Chine, une Industrie
A \ y'-v • • I commerciale. somme de 30000 piastres (voy. pag. 584 )■ Or, ce navire, y compris ies
frais d’armement et de voyage, ne peut guère avoir occasionné plus de
1 o 000 piastres de déboursés : c’est donc, pour une seule affaire, 20 000
piastres [ 108 ¿00 fr .] , c’est-à-dire, au moins 200 pour 0/0 de bénéfice
net.
'> Une peau de loutre coûte à ia côte Nord-Ouest, valeur moyenne,
une brasse et demie d’étoffe de drap commun, ce qui équivaut à-peu-
près à 3 piastres et demie ; la même peau se paie en Chine de 4 ° à
50 piastres.
« Le bois de sandal, que l’on sembloit payer aux Sandwich i o piastres
en argent en 1 8 1 9 , étant soldé en marchandises, ne revenoit pas en
réalité à plus de i o à i 2 fr. le pikol, et se vendoit de i o à 12 piastres en
Chine. Un fusil de munition étoit censé valoir i 5 piastres ; la poudre s’y
vendoit 15 piastres les 28 livres pesant, poids anglais.»
Les perles et la nacre qu’on pêche aux Sandwich sont des objets
d’exportation que les trafiquans peuvent avoir à bas prix, et qui augmentent
encore ies avantages énormes qui sont ordinairement le résultat
de telles spéculations.
Pour activer les chargemens, un agent spécial demeure sur l’île
Wahou, et fait rassembler dans des magasins, pendant l’absence des
navires commis à ses soins, les marchandises qui leur sont destinées.
On sait que les objets de traite qui réussissent ie mieux chez les sauvages
de la côte Nord - Ouest d’Amérique, sont les couvertures de
laine, les draps bleus, blancs et rouges à longs poils, le tabac , l’eau-de-
vie, ie biscuit, les fusils, la poudre de guerre, &c. Ceux que l’on a
coutume de porter aux SandAvich consistent en munitions naAniIes et de
guerre, en étoffes, liqueurs fortes, et en quelques piastres. Ce dernier
article a fait naître chez ies habitans une idée de la mesure des valeurs ;
aussi, quoiqu’en réalité ia plupart des marchés se fassent par échange, le
prix des objets dont on traite est ordinairement établi en argent monnoyé.
{ I ) L e pikol vaut environ 60 kilogrammes 2. ( V o ye i pour plus d’exactitude la page 704
du I . " volume de cette histoire.)
r
V
1 1 .